|
| |
|
|
 |
|
MÉMOIRE |
|
|
| |
|
| |
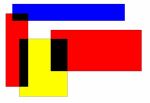
mémoire
Du latin memoria ; du grec mnémè. En allemand : Erinnerung, Gedächtnis, Eingedenken ; Errinerungsspur, « trace mnésique ».
La mémoire est la fonction par laquelle l'homme entretient son rapport au temps. Fonction psychologique, elle retient les impressions sensibles ou les jugements, sans pour autant que ceux-ci soient aisément accessibles. Cette difficulté fait le « mystère » de la mémoire, tout à la fois finie et infinie. Comme fonction de rétention mais aussi de sélection du passé, elle est aussi ouverte sur l'avenir et intervient dans notre action présente. Fonction collective, la mémoire est à la fois une histoire de la communauté des hommes, et l'intégration de celle-ci au sein de l'individu : c'est en absorbant la mémoire de la collectivité dans sa mémoire individuelle que l'homme peut véritablement s'intégrer au groupe dans lequel il vit.
Philosophie Générale
Désignant le rapport au passé, elle peut signifier la fonction psychologique individuelle ou une attitude collective des hommes face à leur histoire. Les traces des choses qu'elle conserve étant affectées par le temps, elle n'est pas opposée à l'oubli, qui est une instance de sélection interne de la mémoire.
Faculté capable de conserver les formes reçues de la sensation, la mémoire est envisagée par Platon à partir de la métaphore du sceau et de la cire(1) : passivité réceptrice, elle est malléable et peut conserver les déterminations issues de la sensation. Elle peut alors s'extraire du flux discontinu des impressions sensibles, et la rétention des différentes traces permet de les comparer et d'en extraire une opinion, bien qu'elle ne puisse pas pour autant assurer la mise en place de la science. La mémoire (mnémè) ne pouvant suffire à fonder cette dernière, Platon ouvre le champ d'une autre théorie, celle de la réminiscence, qui ne concerne plus la faculté sensible en tant que telle.
En reprenant l'étude de cette faculté, Aristote la saisit d'une part dans un sens proche de la mnémè platonicienne, puisqu'elle permet de saisir les formes des choses, abstraites de leur matière, et ainsi de rendre possible une induction source de l'expérience : « c'est de la mémoire que provient l'expérience pour les hommes : en effet, une multiplicité de souvenirs de la même chose en arrive à constituer finalement une seule expérience »(2). En ordonnant le flux multiple des sensations, la mémoire assure la constitution d'une unité, et s'affirme ainsi comme un moyen terme entre la sensibilité et l'intellect, car elle est une première abstraction de la matière. Aristote conserve la distinction entre mémoire et réminiscence, qui sont deux facettes de l'activité mnésique, mais les inscrit au sein de la sensibilité(3) : la mnémè conserve des traces qui ne sont pas de simple images, mais renvoient à des affections de l'âme, et la réminiscence (anamnésis) désigne l'activité de réappropriation de ces traces. La mémoire est donc envisagée en tant qu'elle restitue un lien causal entre l'image et l'affection qui en est la source, et comme lien consécutif faisant se succéder les affections dans le temps. Si les animaux possèdent le souvenir, ils n'ont pas la capacité de réminiscence, qui est une fonction abstractrice et ordonnatrice, manifestation de la raison dans la sensibilité elle-même.
L'héritage aristotélicien reste cependant problématique, car il risque d'assigner à la mémoire une fonction strictement sensitive, qui ne permettrait pas la conservation des notions universelles. Si en effet la trace mnésique naît des impressions sensibles, elle conserve la particularité de celles-ci parce qu'elle est une faculté sensitive, et ne peut donc saisir l'universel. Ainsi, Avicenne considère que l'homme conserve dans sa mémoire des représentations abstraites du sensible, mais que l'universel lui est donné de l'extérieur par un Intellect agent séparé, ce qui suppose qu'une partie de la mémoire se trouve en dehors de l'homme. Thomas d'Aquin refuse une telle conclusion, et distingue la mémoire en tant qu'elle est rétention d'événements passés, particuliers, qui se situe dans la partie sensitive, de l'intellect possible. Celui-ci, dégagé du sensible et donc du changement, est mémoire des formes intelligibles universelles, sans référence à la dimension du passé, tout en faisant partie de l'homme(4). La mémoire n'est donc pas une fonction universalisante ; en tant que fonction psychologique, elle ne peut pas dégager par elle-même une certitude, mais elle permet néanmoins de tracer un lien ordonné entre les différents moments de la déduction rationnelle. Elle doit donc être contrôlée par la pensée, qui seule peut l'assurer en l'insérant dans un processus cognitif(5).
Cependant, le contenu de la mémoire ne se laisse pas appréhender comme de simples représentations évidentes, et se donne le plus souvent à l'homme dans la confusion. S'interrogeant sur ce point, saint Augustin considère la mémoire comme un mystère obscur ouvert dans son esprit(6) ne pouvant être saisi que par un mouvement semblable à la réminiscence platonicienne. Confronté à l'étrangeté de la mémoire, à la fois totale et sélective, Bergson(7) distingue deux niveaux de cette faculté, l'un contenant la totalité des événements passés dans un état de fusion, l'autre capable de mobiliser ce passé en le rendant présent en vue d'une action.
À côté de sa signification individuelle, la mémoire peut aussi être celle d'une conscience collective, sous forme d'un ensemble de pratiques sociales que l'individu doit s'approprier en fonction de sa situation dans la communauté(8). L'histoire elle-même pourrait alors être envisagée à partir de cette notion. Cependant, si la mémoire est « matrice de l'histoire, dans la mesure où elle reste la gardienne de la problématique du rapport représentatif du présent au passé »(9), elle s'en distingue, car la trace historique représentative n'est pas de même nature que l'appropriation de cette trace dans le vécu de la conscience.
Didier Ottaviani
Notes bibliographiques
* Platon, Thééthète, 193b-b, trad. M. Narcy, Flammarion, Paris, 1995, p. 255.
* Aristote, Métaphysique, A, 1, 980b-981a, trad. J. Tricot, Vrin, Paris, 1986, pp. 3-4.
* Aristote, De la mémoire et de la réminiscence, in Petits traités d'histoire naturelle, trad. R. Mugnier, Les Belles Lettres, Paris, 1965, pp. 53-63.
* D'Aquin, Th., Somme théologique, I, qu. 79, art. 6, trad. A.-M. Roguet, Cerf, Paris, 1984, t. 1, pp. 700-701.
* Descartes, R., Règles pour la direction de l'esprit, VII, in Œuvres philosophiques, Garnier, Paris, 1988, t. 1, p. 109. Voir aussi la règle XII, ibid., pp. 139 sq.
* Saint Augustin, Les Confessions, X, in Œuvres, I, trad. P. Cambronne, Gallimard, La Pléiade, Paris, 1998, pp. 996 sqq.
* Bergson, H., Matière et mémoire, PUF, Quadrige, Paris, 1997.
* Halbwachs, M., La mémoire collective, PUF, Paris, 1968.
* Ricœur, P., La Mémoire, l'Histoire et l'Oubli, Seuil, Paris, 2000, p. 106.
→ connaissance, habitude, imagination, inconscient, oubli, réminiscence, temps, trace
Philosophie Générale, Philosophie Contemporaine
W. Benjamin distingue trois dimensions de la mémoire : « souvenir », « mémoire » et « remémoration » (Erinnerung, Gedächtnis, Eingedenken). Le « souvenir » (Erinnerung), qui relève de la tradition et de l'« expérience » (Erfahrung), est détruit par l'Erlebnis moderne, l'expérience vécue dans l'instant, conscience ponctuelle, succession de chocs. En tant que tradition il possédait une dimension collective. Si cette dernière existe encore, elle est enfouie dans l'inconscient de la « mémoire » (Gedächtnis)(1). La madeleine de Proust est selon Benjamin une forme de mémoire involontaire qui restitue cette expérience authentique. Chez Baudelaire celle-ci s'exprime parles correspondances dont la synesthésie offre le modèle d'une expérience à nouveau pleine et riche, à l'opposé de la dispersion, de la dissociation des sens qu'on observe dans les techniques modernes. Or, le propre de la remémoration est d'être instantanée ; elle relève donc de l'à-présent mais aussi du choc ; elle est, au sein de l'expérience moderne, le mode messianique moderne d'un sauvetage (salut) de l'expérience : « Chaque seconde est la porte étroite par laquelle peut entrer le Messie. Les gonds sur lesquels tourne cette porte sont la remémoration »(2). La remémoration qui arrête le temps tout en renouant avec le sens passé d'un événement « tient en mains les fragments disjoints d'une véritable expérience historique »(3).
Gérard Raulet
Notes bibliographiques
* Benjamin, W., « Sur quelques thèmes baudelairiens », in Gesammelte Schriften, t. I-2, Suhrkamp, Francfort, 1972.
* Benjamin, W., Thèses sur la philosophie de l'histoire, notes et fragments in Gesammelte Schriften, Ibid., t. I-3, p. 1352.
* Benjamin, W., « Sur quelques thèmes baudelairiens », op. cit., p. 643.
→ expérience, habitude, inconscient, oubli, temps, trace
Philosophie de l'Esprit, Psychologie
Capacité à conserver la trace d'expériences passées et à utiliser les informations ainsi retenues pour interpréter nos expériences présentes et guider nos comportements.
Les débats portent sur la manière dont ces deux formes de mémoire doivent être caractérisées, tant sur le plan logique qu'épistémique et phénoménologique. Ainsi, selon Bergson(1), la mémoire générique est fondée sur l'habitude et la répétition, elle dépend d'un mécanisme corporel et s'apparente à une forme d'action, tandis que la mémoire épisodique suppose une opération de l'esprit, une représentation du passé comme tel, et implique des images-souvenirs. L'idée du caractère corporel de la mémoire factuelle et son lien à la répétition ont été critiqués, certains auteurs(2) voulant distinguer la mémoire procédurale (la rétention d'un savoir-faire), qui implique le corps, de la mémoire proprement factuelle, qui met en jeu une croyance portant sur un fait. N. Malcolm(3) a également critiqué la thèse selon laquelle la mémoire personnelle implique nécessairement des images-souvenirs. Plusieurs philosophes, dont J. Campbell(4), se sont intéressés aux modes de représentation du temps et de représentation de soi qu'implique la mémoire épisodique, suggérant, à la suite de Bergson, que peut-être seuls les êtres humains disposent des capacités représentationnelles et réflexives nécessaires à la mémoire épisodique. Enfin, le débat philosophique porte également sur le statut épistémique de la mémoire, sur le type de justification que peuvent apporter le souvenir factuel et le souvenir épisodique et sur le fait de savoir si la mémoire est purement rétentive ou si elle peut constituer une source de connaissance(5).
Élisabeth Pacherie
Notes bibliographiques
* Bergson, H., Matière et mémoire, PUF, Paris, 1939.
* Martin, C.B., et Deutscher, M., « Remembering », Philosophical Studies, 75, 1966, pp. 161-196.
* Malcolm, N., « Three Lectures on Memory », in Knowledge and Certainty, Prentice-Hall, Englewood Cliffs (NJ), 1963.
* Campbell, J., Past, Space and Self, MIT Press, Cambridge (MA), 1995.
* Dummett, M., « Testimony and Memory », in The Seas of Language, Clarendon Press, Oxford, 1993.
→ conditionnement, connaissance, habitude, inconscient, justification, temps, trace
Philosophie Cognitive, Psychologie
Capacité complexe de fixation, de rétention, d'extraction (ou de rappel) et de restitution des informations.
C'est à H. Ebbinghaus qu'on doit les premiers travaux expérimentaux sur la mémoire (1885). Sa mesure, aboutissant à des formules mathématiques inspirées de T. Fechner, revient à établir des rapports entre la taille du matériel à retenir et le temps nécessaire à le fixer. Or l'oubli est moindre si le matériel à retenir est structuré, s'il a du sens, notamment. Un point de vue fonctionnel sur le mental a conduit ensuite à distinguer des mémoires implicite (jouer du piano) et explicite (ce que j'ai fait hier). Mais c'est l'essor de la neuropsychologie et de la neurobiologie qui a conduit à la description précise de divers mécanismes élémentaires de la mémoire, notamment par ses troubles. Le système limbique est impliqué dans le passage de la mémoire à court terme à celle à long terme. On connaît aussi des neurohormones modulant l'apprentissage et des « cartes » neuronales l'archivant. Les bases neurobiochimiques de la mémoire à très long terme restent cependant obscures.
L'aspect qualitatif de la structuration du matériel à retenir rend difficile l'extension de méthodes par conditionnement et l'apprentissage à l'explication des conduites complexes de remémoration. Ebbinghaus avait tenté ainsi de réduire son objet à une « pure mémoire » (par des tests sur des syllabes asémantiques). Reste qu'une pure mémoire, sans métamémoire (sans la capacité à en auto-évaluer les performances) laisse plus ou moins indistincts, surtout en situation de test, apprentissage, mémoire proprement dite, et capacité à réeffectuer. Quant à la métaphore de l'ordinateur, en vogue, elle est trompeuse : la mémoire des organismes n'est pas un stockage passif, et ils interagissent avec le milieu. On risque de confondre les propriétés de l'objet et celles du modèle ; la psychologie de la mémoire, entre paradigme informatique et paradigme biologique, est un cas exemplaire, historiquement déterminé (F. Yates). Enfin, il n'est pas sûr que l'explication de la façon dont on peut faire revivre une inscription morte ne reconduise pas les paradoxes déjà pointés par Platon : confondre l'aide-mémoire (inerte) et la mémoire vraie, qui est présence (vivante) du passé à l'esprit. Même neuronale, une carte est-elle plus qu'un aide-mémoire ?
Pierre-Henri Castel
Notes bibliographiques
* Chapouthier, G., La biologie de la mémoire, PUF, Paris, 1994.
* Ebbinghaus, H., Über Gedächtnis, 1885.
* Howe, M., Introduction to the Psychology of Memory, University Press of America, 1987.
* Parkin, A., Case Studies in the Neuropsychology of Memory, Lawrence Erlbaum, 1999.
* Yates, F. A., The Art of Memory, Chicago, 1974, trad. L'art de la mémoire, D. Arasse, Gallimard, Paris, 1975.
→ conditionnement, habitude, neuropsychologie
Psychanalyse
La conception psychanalytique de la mémoire interroge la constitution de la trace mnésique et ses modalités d'inscription. L'inconscient est le lieu d'une mémoire paradoxale : la mémoire de ce qui est oublié.
Pour Freud, la mémoire comprend plusieurs systèmes et plusieurs lieux d'archivage. Tous les systèmes de mémoires n'ont pas le même rapport à l'inconscient. Les traces des souvenirs inconscients ne peuvent parvenir telles quelles à la mémoire et doivent être véhiculées et camouflées par des traces préconscientes.
La théorie du souvenir, pour laquelle la fonction de la mémoire est donnée dans sa trame subjective, suppose une mémoire organisée en un système de traces. La précocité, l'intensité des liaisons et leurs constants déplacements dressent un obstacle de nature quantitative au travail de la pensée. La possibilité d'inhibition du processus primaire est effectivement proportionnelle à l'intensité de ce dernier, c'est-à-dire à son quantum d'affect. Le régime de la pensée joue sur la zone des incertitudes de la mémoire. Les indices des processus de pensée constituent donc une mémoire de la pensée elle-même.
La théorie de la mémoire repose alors sur la notion de refoulement, elle-même éclairée par la conception de l'amnésie infantile. Ultérieurement, les métamorphoses engendrées par la période pubertaire ne serviront pas aux conditions d'un souvenir, mais ils constitueront un faisceau d'induction rétroactives, réorientées vers une forme d'oubli. Les théories de la mémoire impliquent aussi que la vérité du sujet est faite d'un mixte entre retrouvailles (levées d'amnésie) et construction dans l'analyse.
La « mémoire » fait objet de débat avec les sciences cognitives, qui définissent deux systèmes différents d'analyse de la mémoire : d'un côté, mémoires procédurielle et relationnelle, de l'autre, mémoires à court terme et à long terme. La mémoire qui intéresse les psychanalystes aurait des caractères davantage relationnels et « à long terme ».
Olivier Douville
Notes bibliographiques
* Freud, S., Contribution à l'étude des aphasies (1891), trad. C. Van Reeth, PUF, Paris, 1983.
* Freud, S., L'esquisse d'une psychologie scientifique (1895), in la Naissance de la psychanalyse, trad. A. Berman, PUF, Paris, 1956, pp. 307-396.
* Freud, S., Lettres à Fliess (1887-1902), in la Naissance de la psychanalyse, op. cit., pp. 48-306.
* Freud, S., Formulations sur les deux principes du cours du fonctionnement psychique (1911), in Résultats, idées, problèmes 1, PUF, Paris, 1983, pp. 135-145.
* Freud, S., « Extrait de l'histoire d'une névrose infantile : l'homme aux loups » (1918), in Cinq Psychanalyses, trad. J. Altounian et S. Cottet, PUF, Paris, 1990.
* Freud, S., Constructions dans l'analyse (1937), in Résultats, idées, problèmes 2, PUF, Paris, 1985, pp. 269-281.
→ après-coup, inconscient, oubli, refoulement, topique, trace
Le désir de mémoire est la condition d'une pratique de l'histoire soucieuse de comprendre le passé. Mais il ne se suffit pas à lui-même. Il doit constamment être éduqué. Comment ne pas sombrer dans l'auto-contemplation commémorative ? Comment conjurer la tentation de la vengeance dans le cas des procès de la mémoire ? Plus largement, comment nouer les liens entre le passé et l'avenir dans une expérience consciente de l'histoire ?
L'élan commémoratif
La problématique des « lieux de mémoire » appartient au temps présent. Elle est issue du constat selon lequel la mémoire traditionnelle et ancestrale a laissé la place à une mémoire exténuée en mal d'incarnation symbolique. La mémoire « vécue » est devenue une mémoire « perdue » qu'il faut raviver(1). Le lieu de mémoire n'est cependant pas un simple lieu d'histoire. Une « intention de mémoire » et la décision d'un rituel sont requises pour transformer un élément de la vie publique (monument, dépôt d'archives ou compétition sportive) en objet de souvenir collectif. Le sentiment d'une rupture entre les époques joue aussi un rôle important. Si le calendrier révolutionnaire rythmait encore les journées de l'individu moderne, celui-ci ne penserait même pas à le commémorer. Dans cette dynamique générale, la mémoire s'extériorise de plus en plus. Elle se concentre sur ses traces.
Mais, durant les deux dernières décennies, le désir de mémoire semble avoir été dépassé par l'élan commémoratif. Une « tyrannie de la mémoire » a littéralement inversé l'ordre du temps. Le passé ne s'impose plus au présent par sa force propre, ce sont les exigences de l'actualité qui gouvernent le choix de ce qu'il convient de célébrer. Lorsqu'elle est excessive et arbitraire, la patrimonialisation de la mémoire française multiplie les manifestations, souvent au préjudice de l'analyse. Le comble de la commémoration est atteint au moment où la commémoration elle-même se représente comme l'événement principal. En l'absence de tout « surmoi commémoratif », est-il encore possible de penser et d'« agir sans commémorer »(2) ? La survalorisation de la mémoire ne vise-t-elle pas finalement à compenser la crise de l'expérience contemporaine : d'une part, la fin de toute croyance en l'histoire comme processus et instance de légitimation du rapport à l'avenir et, d'autre part, un certain désarroi devant le caractère énigmatique du présent(3) ?
L'effet en soi
Ainsi décrite, l'inflation du désir de mémoire évoque l'analyse nietzschéenne des formes d'histoire. La commémoration illimitée relève autant de l'histoire « traditionnaliste » que de l'histoire « monumentale ». Elle emprunte à la première son instinct de conservation tandis qu'elle partage avec la seconde son obsession de l'identique. Dans un cas, le désir de mémoire collectionne. Il « ne dispose alors, pour juger le passé, d'aucune échelle de valeurs et de proportions qui tienne réellement compte des rapports des choses entre elles »(4). L'essentiel n'est pas de se réapproprier le passé avec discernement mais de le stocker en veillant bien à n'en perdre aucun vestige. Dans l'autre cas, le désir de mémoire arase les différences et subsume la diversité historique des causes sous le genre commun des « effets en soi » : « Ce que l'on célèbre lors des fêtes populaires, des commémorations religieuses ou militaires, c'est au fond un tel effet en soi [...] non pas le véritable nœud historique de causes et d'effets qui, correctement apprécié, prouverait seulement que jamais la même combinaison ne pourra à nouveau sortir de la loterie du futur et du hasard »(5). L'élan commémoratif apparaît donc infondé et en menace d'excès lorsqu'il manque de critères ou n'hésite pas à faire abstraction du caractère unique des circonstances. À chaque fois, c'est le voile de l'uniformité qui recouvre l'esprit critique. Ici, rien n'interdit de maquiller le passé, voire de se fabriquer des origines. Comme l'a encore prouvé le récent conflit au Kosovo, le fantasme de la fondation rétrospective utilise abondamment ces « effets sans cause suffisante » pour mieux commettre et même justifier les crimes ethniques.
L'identification du passé
Identifier le passé, c'est vouloir le représenter tel qu'il a été : afin de le comprendre et de fuir les célébrations vides ou, pis, la mythification des origines, mais aussi pour s'émanciper le cas échéant de son poids trop lourd. En remontant du commémoratif à l'historique, la troisième forme d'histoire chez Nietzsche est celle qui « juge et condamne ». L'histoire « critique » est le fait de « celui que le présent oppresse »(6). C'est elle qui inspire le désir de mémoire lorsqu'il revendique, notamment dans les contextes post-dictatoriaux, la transparence des événements. Cette nouvelle définition du désir de mémoire exprime la nécessité d'un rapport démocratique au temps pluridimensionnel des sociétés. Le passé ne peut être conservé éternellement dans des archives secrètes, visible pour les uns, caché pour les autres. Tous doivent connaître ce qui a eu lieu. Le procès judiciaire est l'occasion par excellence d'une publicité du passé.
En raison de la lenteur des procédures, la convocation de la mémoire s'apparente la plupart du temps à une catharsis. Elle présente subitement des personnes physiques et morales (dans la France de Vichy, Papon incarne l'administration préfectorale) que la conscience collective désespérait de voir juger. Or l'on sait combien une grande souffrance crée le sentiment d'une dette qui attend son recouvrement. Comment ne pas tomber dans le cycle de la vengeance compensatrice ? Comment éviter le « paiement en retour », sur le schéma des dommages et intérêts, ainsi que la surenchère dans la « comptabilité des maux »(7) ? Une victime est-elle en mesure d'admettre que des « tables de dialogue » soient organisées, par exemple au Chili, dans lesquelles les militaires délivrent des informations sur les « disparus » en échange de l'anonymat ?
La fonction du procès est de substituer un jugement au désir de mémoire qui se métamorphose progressivement en désir de vengeance. Si la mémoire devient naturellement comptable dans ce type de circonstances, c'est néanmoins à l'institution de régler le compte grâce au tiers de la justice. Le procès est censé désamorcer le « mauvais infini » de la dette punitive. Il doit détourner l'envie de rétribution directe et dépasser la fausse égalité du talion en rappelant que la société dans son ensemble est également offensée par le crime(8). Au « temps clos du ressentiment » succède la dialectique de l'institution juridique. Le procès est une mise en scène du passé qui arrête et réouvre à la fois le cours du temps. Le rappel des faits met un terme à la « nuisance morale » de l'impunité prolongée. Il inscrit dans un système de valeurs communes une série d'actes auxquels le temps donnait un semblant d'immunité. Ce faisant, il les juge en privilégiant l'axe de la mémoire pour tenter d'instaurer ou de restaurer une concorde sociale(9).
Vertu de l'oubli ou besoin d'avenir ?
Par son activité de triage des souvenirs, l'histoire « critique » prête à l'oubli une indéniable vertu « cicatrisante » (Nietzsche). L'oubli panse les blessures et apaise les douleurs. L'amnistie, qui est une forme d'oubli politique, ne liquide pourtant pas toutes les ambiguïtés de la mémoire. En 403 avant notre ère à Athènes, le peuple chasse les oligarques du pouvoir. Un devoir de clémence est voté qui a pour conséquence d'effacer le tort précédemment subi par les nouveaux vainqueurs. On promet de ne pas mentionner les malheurs d'hier. Avec ce cas d'école, le désir de mémoire se mesure à l'obligation de s'adapter à la conjoncture. Le « double oubli », celui de la souffrance passée comme de la victoire présente, neutralise la rancune et invalide d'emblée le recours en justice, mais il paraît maintenir l'équilibre social durant la transition vers la démocratie. Dans un tel contexte d'orchestration de la réconciliation, le peuple conserve-t-il le bénéfice du pouvoir ? Quelle valeur possède une amnistie qui est une amnésie(10) ?
Avec le travail du deuil, la mémoire est déchirée entre le souhait de ressusciter l'être disparu et la conviction qu'il est préférable de sortir du piège de la commémoration plaintive. Quelles que soient les échelles, l'arbitrage entre le désir de mémoire et l'impératif de l'oubli est souvent ressenti comme impossible, mais il s'avère toujours indispensable. Ne serait-ce que parce que l'oubli qui permet la transfiguration du deuil ne détruit rien à proprement parler. Il relance au contraire l'action, libère éventuellement la décision du pardon (comme le voulait la « Commission vérité et réconciliation » en Afrique du Sud) et amorce l'effort spécifique du travail de mémoire(11). Il redonne également un axe à l'expérience de l'histoire en arrachant le désir de mémoire au seul passé pour le diriger vers l'avenir. Tout « champ d'expérience » est en effet indissociable d'un « horizon d'attente ». Tandis que l'expérience, « c'est le passé actuel, dont les événements ont été intégrés et peuvent être remémorés », l'attente, elle, « s'accomplit dans le présent et est un futur actualisé »(12). En d'autres termes, le souvenir, la perception et l'attente se modifient ensemble. La revitalisation du passé entraîne une repolarisation du sujet vers le « ne-pas-encore »(13). S'il est véritablement désir, c'est-à-dire tension vers un but, le désir de mémoire abrite certainement un sens du possible. Il désigne alors une capacité à agir non seulement à partir du passé mais aussi à partir du futur, le profond besoin d'une histoire orientée qui mise sur une confiance retrouvée de l'homme en l'avenir.
La mémoire se divise de plus en plus entre une exigence de clarté à l'égard du passé et l'extrême difficulté à juger des événements en situation. Des cours de justice internationales ont été créées, en ex-Yougoslavie et au Rwanda, dans le but d'inculper les responsables de crimes contre l'humanité. Malgré de nombreux dysfonctionnements, ces institutions ont contribué à forger une conscience d'époque qui ne supporte plus l'impunité. Mais le droit ne refonde pas à lui seul une communauté politique. Par quelles autres voies les sociétés meurtries par la guerre et le génocide garantiront-elles leur avenir ?
Olivier Remaud
Notes bibliographiques
* Nora, P. (dir.), « Entre mémoire et histoire » et « L'ère de la commémoration », in les Lieux de mémoire, Gallimard, Quarto, Paris, 1997, p. 32.
* Ibid., p. 4692 et p. 4688.
* Binoche, B., « Histoire, croyance, légitimation », in Études théologiques et religieuses, t. 75, 2000 / 4, pp. 517-529.
* Nietzsche, F., Considérations inactuelles. De l'utilité et des inconvénients de l'histoire pour la vie [II, 1874], in Œuvres philosophiques complètes, trad. P. Rusch, Gallimard, Paris, t. ii (1), 1990, p. 111.
* Ibid., p. 107.
* Ibid., p. 109.
* Tricaud, F., l'Accusation. Recherche sur les figures de l'agression éthique, Dalloz, Paris, 1977, p. 76 sq.
* Ost, F., le Temps du droit, Odile Jacob, Paris, 1999, pp. 101-107.
* Garapon, A., « La justice et l'inversion morale du temps », in Pourquoi se souvenir ?, F. Barret-Ducros (dir.), Grasset, Paris, 1999, pp. 113-124.
* Loraux, N., la Cité divisée. L'oubli dans la mémoire d'Athènes, Payot, Paris, 1997, pp. 255-277.
* Ricœur, P., la Mémoire, l'histoire, l'oubli, Seuil, Paris, 2000, pp. 642-656.
* Koselleck, R., le Futur passé. Contribution à la sémantique des temps historiques, trad. J. et M.-C. Hoock, Éditions de l'EHESS, Paris, 1990, p. 311.
* Bodei, R., Libro della memoria e della speranza, Il Mulino, Bologna, 1995.
* Voir aussi : Hazan, P., la Justice face à la guerre, de Nuremberg à La Haye, Stock, Paris, 2000.
* Kritz, N.-J., Transitional Justice : how Emerging Democraties Reckon with Former Regimes, United States Institute of Peace Press, 1995 (3 vol.).
DOCUMENT larousse.fr LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
négation |
|
|
| |
|
| |

négation
Du latin negare, « nier ». En allemand : Verneinung, de verneinen, « nier », composé de nein, « non », et de ver-, qui indique que l'action est menée jusqu'à son terme. Verneinung désigne à la fois la négation logique ou grammaticale, « nier », et la dénégation, au sens psychologique, « désavouer », « dé-mentir ».
La négation insiste sur l'idée de séparation entre deux choses, et se pense dans son opposition à l'affirmation. Dans les propositions, les deux sont en rapport étroit selon Aristote, car « à toute affirmation répond une négation opposée, et à toute négation une affirmation »(1). Parce que Dieu ne peut être atteint par notre raison, rien ne peut être signifié sur lui ; aussi la théologie a tenté de le cerner, non par ce qu'il est, mais par ce qu'il n'est pas, comme « théologie négative ».
Philosophie Générale
S'oppose à l'affirmation, moment intermédiaire du processus dialectique.
La négation n'est pas pensable en soi, se constituant vis-à-vis d'autre chose ; elle est une opposition réelle à la position de quelque chose, c'est pourquoi Kant la distingue, en tant qu'elle est « privation », du simple « manque »(2). La négation est quelque chose de constitutif, ainsi que l'affirme Hegel en identifiant déjà le travail du négatif dans la pensée de Spinoza : omnis determinatio est negatio (« toute détermination est négation ») signifie que la position de la détermination, par laquelle l'essence exprime son en-soi dans le pour-soi, est une négation(3). La négation étant de ce fait position, elle est donc constitutive d'un mouvement qui la conduit, une fois déterminée en position, à se nier elle-même, ouvrant sur la négation de la négation en tant que processus de positivation.
Didier Ottaviani
Notes bibliographiques
* Aristote, De l'interprétation, 6, 17a25-36, trad. Tricot, J., Vrin, Paris, 1994, pp. 86-87.
* Kant, E., Essai pour introduire en philosophie le concept de grandeur négative, I, trad. Kempf, R., Vrin, Paris, 1980, p. 28.
* Hegel, G. W. F., Science de la logique, I, 2, « La doctrine de l'essence », trad. Labarrière, P.-J. et Jarczyk, G., Aubier, Paris, 1976, t. 2, pp. 1-6. Cf. Macherey, P., Hegel ou Spinoza, IV, La Découverte, Paris, 1990.
→ affirmation, Aufhebung, dialectique, logique, tiers-exclu
Logique
Opérateur qui, appliqué à un énoncé donné, permet de former un nouvel énoncé dont la valeur de vérité est inverse de celle de l'énoncé d'origine. Asserter la négation d'un énoncé revient donc à le nier. En français, la négation est généralement rendue par la locution « ne ... pas » ; le symbole logique pour la négation est ¬, préfixé à l'énoncé nié.
La logique traditionnelle distingue les jugements affirmatifs, qui disent que quelque chose est le cas, et les jugements négatifs, qui disent que quelque chose n'est pas le cas. On admet aujourd'hui, à la suite de Frege(1), qu'une telle distinction ne peut être rigoureusement tracée, sauf à mettre dans deux classes différentes des énoncés qui ne sont visiblement que des variantes l'un de l'autre, comme Le Christ n'est pas mortel et Le Christ vit éternellement. Cependant, certaines distinctions traditionnelles restent intactes, comme celle qui sépare les paires d'énoncés contraires (dont les deux éléments ne peuvent être simultanément vrais, comme α est rouge et α est bleu) et les paires d'énoncés contradictoires (dont les éléments ne peuvent, en outre, être simultanément faux, comme α est rouge et α n'est pas rouge) : un énoncé forme, avec sa négation, une paire contradictoire.
Jacques Dubucs
Notes bibliographiques
* Frege, G., « La négation » (1919), trad. française Imbert, dans Écrits logiques et philosophiques, Seuil, Paris, 1971, p. 204.
→ contradiction
Psychanalyse
Capacité du psychisme à contourner le refoulement grâce au mécanisme logique de la négation, la dénégation permet de prendre connaissance, tout en s'en défendant, de contenus de pensée ou de représentation inconscients, sans que les affects correspondants soient pour autant accessibles.
Dans La Négation(1), Freud fait dériver les fonctions intellectuelles – jugement d'existence et de condamnation, négation – de motions pulsionnelles orales : avaler et cracher. Soumis au principe de plaisir, le moi-plaisir du début veut « s'introjecter tout le bon et jeter hors de lui tout le mauvais »(2) – le refoulement est, dans cette optique, un « cracher » interne. Les mécanismes logiques de l'affirmation et de la négation sont les héritiers, par affranchissement progressif du principe de plaisir, de ces motions pulsionnelles.
Restaurant une filiation entre la pensée rationnelle la plus évoluée et les processus psychiques les plus élémentaires, la dénégation éclaire la puissance et la fragilité de la première, et permet de comprendre le rôle essentiel que la négation y joue.
Christian Michel
Notes bibliographiques
* Freud, S., Die Verneinung (1925), G.W. XIV, la Négation, in Résultats, idées, problèmes II, PUF, Paris, 2002, pp. 135-139.
* Ibid., p. 137.
→ affirmation, esprit, pulsion, refoulement
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
VOLTAIRE |
|
|
| |
|
| |

François Marie Arouet, dit Voltaire
Cet article fait partie du dossier consacré à la Révolution française.
Écrivain français (Paris 1694-Paris 1778).
Voltaire, l’un des philosophes des Lumières les plus importants, a connu une vie mouvementée marquée par l’engagement au service de la liberté. Travailleur infatigable et prolixe, il laisse une œuvre considérable et très variée qui touche à tous les domaines, renouvèle le genre historique et donne au conte ses lettres de noblesse.
Famille
Il est né le 21 novembre 1694 ; son père est notaire et conseiller du roi ; sa mère meurt alors qu’il est âgé de sept ans.
Formation
Il est placé chez les jésuites du collège Louis-le-Grand (ancien collège de Clermont), puis fait des études à la faculté de droit de Paris.
Début de sa carrière
À partir de 1715, il fréquente les milieux libertins et les salons littéraires, compose des écrits satiriques qui le conduisent à la Bastille. En prison, il rédige Œdipe (1717). Il fait des voyages en Europe et connaît des intrigues de cour. Il continue à écrire pour le théâtre et commence une épopée, la Ligue (1723), première version de la Henriade (1728). Une altercation avec le chevalier de Rohan-Chabot lui vaut douze jours à la Bastille, puis l’exil en Angleterre (1726).
Premiers succès
Rentré en France en 1728, il fait jouer son théâtre ; il triomphe avec sa pièce Zaïre (1732). Il se retire à Cirey, chez Mme du Châtelet. Les Lettres philosophiques connaissent un succès de scandale (1734), de même que le poème provocateur le Mondain (1736).
Tournant de sa carrière
Il est rappelé à Paris où il est nommé historiographe du roi (1745). Parallèlement à son travail d’historien (le Siècle de Louis XIV, 1752 ; Essai sur les mœurs et l'esprit des nations, 1756), il commence à rédiger des contes satiriques (Zadig, 1748 ; Micromégas, 1752). Il accepte l’invitation de Frédéric II de Prusse et part pour Potsdam (1750). En 1755, il s’installe en Suisse, où sera publié Candide (janvier 1759) et, enfin, dans un village français près de la frontière suisse, Ferney (décembre 1758-février 1759).
Dernière partie de sa carrière
Devenu l’« hôte de l’Europe », il intervient dans des « affaires » (Calas, Sirven, La Barre). Il poursuit son combat en faveur de la tolérance (Traité sur la tolérance, 1763 ; Dictionnaire philosophique portatif, 1764) sans toutefois abandonner le conte (l’Ingénu, 1767). Il meurt le 30 mai 1778. Treize ans plus tard, en 1791, ses restes sont transférés solennellement au Panthéon.
1. LA VIE DE VOLTAIRE
1.1. LA FORMATION INITIALE (1694-1713)
François Marie Arouet est le cinquième enfant de François Arouet (1649-1722) et de Marguerite Daumart (vers 1661-1701) [sur les six enfants de la famille, trois meurent en bas âge]. Son père, notaire royal, puis payeur des épices à la Chambre des comptes, est en relations professionnelles et personnelles avec l'aristocratie. Il fait donner à ses fils la meilleure éducation possible. Pour l'aîné Armand, vers 1695, c'est celle des Oratoriens. Pour François Marie, en 1704, c'est celle des jésuites du collège Louis-le-Grand. La mésentente entre les deux frères vient sans doute en partie de là. Elle sera doublée de difficultés entre le père et le fils, lorsque le libertinage et la vocation littéraire apparaîtront simultanément. Voltaire affecte parfois de ne pas être le fils de son père, mais du chansonnier Rochebrune : affirmation agressive d'indépendance – la plaisanterie sur sa bâtardise est considérée de nos jours comme le signe d'une phobie et d'une hantise qui se retrouvent dans l'attitude de Voltaire devant Dieu, père au terrible pouvoir.
Son adolescence subit l'influence de l'humanisme jésuite et celle du libertinage mondain. Aux Jésuites, Voltaire doit sa culture classique, son goût assez puriste, le souci de l'élégance et de la précision dans l'écriture, son amour du théâtre et même, en dépit d'eux, les bases de son déisme. Aux libertins du Temple, son épicurisme, son esprit plaisant et irrévérencieux, son talent dans la poésie légère.
→ Compagnie de Jésus, → libertinage.
1.2. PREMIÈRE EXPÉRIENCE DE L’ÉCRITURE POLÉMIQUE (1713-1726)
Mais Voltaire ne se contente pas d'être un homme de plaisir : il y a dans son art de jouir une insolence qui lui vaut d'être envoyé par son père à Caen, puis à La Haye en 1713, d'être confiné à Sully-sur-Loire en 1716 sur ordre du Régent (sur lequel on dit qu’il a écrit quelques vers assassins) et embastillé en 1717. Dès ce moment, il prépare deux grandes œuvres, d'une tout autre portée que ses vers épicuriens : la tragédie Œdipe, triomphalement représentée en novembre 1718, et le poème de la Ligue, paru en 1723, qui deviendra en 1728 la Henriade. Il veut maintenant imiter Sophocle et Virgile. Le libertin commence à se faire philosophe en lisant Malebranche, Bayle, Locke et Newton.
C'est en 1718 qu'il prend le pseudonyme de Voltaire (d'abord Arouet et Voltaire), peut-être formé à partir d'Airvault, nom d'un bourg poitevin où ses ancêtres ont résidé. Le chevalier de Rohan (1683-1760), qui le fait bâtonner et, humiliation pire, de nouveau embastiller en 1726, semble avoir interrompu une carrière admirablement commencée d'écrivain déjà illustre et de courtisan. En fait, il rend Voltaire à sa vraie vocation, qui aurait certainement éclaté d'une façon ou d'une autre, car on ne peut guère imaginer qu'il se soit contenté d'être poète-lauréat.
1.3. SÉJOUR EN ANGLETERRE (1726-1728)
C'est Voltaire lui-même qui demande la permission de passer en Angleterre. Y a-t-il découvert ce dont il n'avait aucune idée et subi une profonde métamorphose ? Y a-t-il, au contraire, trouvé ce qu'il était venu y chercher, appris ce qu'il savait déjà ? Les deux thèses ont été soutenues. On admet maintenant que s'il a, avant son voyage, lu des ouvrages traduits, s'il a aussi adopté par ses propres cheminements des vues déjà « philosophiques » sur Dieu, sur la Providence, sur la société, sur la tolérance, sur la liberté, il n'est pourtant pas en état, dans les années 1726-1728, d'assimiler complètement la science et la philosophie anglaises.
Mais Voltaire fait l'expérience d'une civilisation, dont il sent et veut définir ce qu'il appelle l'esprit ou le génie. Il comprend l'importance pour la pensée et la littérature françaises de connaître ces Anglais, avec qui le Régent a noué alliance, et il réunit une masse de notations, d'idées, de questions, de problèmes, d'anecdotes, de modèles formels dont il ne cessera de tirer parti pendant tout le reste de son existence.
Les Lettres philosophiques, ou Lettres anglaises, conçues bien avant la fin de son séjour en Angleterre, paraissent en anglais dès 1733, en français en 1734. Elles sont, malgré leurs erreurs et leurs lacunes, l'un des essais les plus réussis pour ce qui est de comprendre et donner à comprendre le fonctionnement d'une société étrangère et le lien entre des institutions, des mœurs et une culture sous le signe de la liberté.
1.4. RETOUR EN FRANCE : SPÉCULATION FINANCIÈRE ET CLANDESTINITÉ (1728-1734)
De son retour en France (1728) à son installation en Lorraine, à Cirey (1734), Voltaire vit quelques années tiraillé : entre le monde et la retraite, le succès et les persécutions, la publication des œuvres achevées et la mise en chantier d'œuvres nouvelles.
Il fait applaudir Brutus (décembre 1730) et Zaïre (août 1732), mais son Histoire de Charles XII est saisie (janvier 1731). Son Temple du goût soulève des protestations violentes (janvier 1733), ses Lettres philosophiques (avril 1734), longuement revues et auxquelles il a ajouté les remarques « Sur les Pensées de M. Pascal », sont brûlées, et l'auteur doit se réfugier en Lorraine (mai 1734) pour échapper à une lettre de cachet (écrit formel du roi ordonnant l'incarcération ou l'exil). En mai 1732, il avait pour la première fois fait mention de son projet d'écrire l'histoire de Louis XIV.
C'est pendant cette période qu'il met au point deux moyens d'assurer sa liberté d'écrire, et dont il ne cessera désormais d'user : la spéculation, qui lui procurera l'aisance matérielle puis la richesse, et la clandestinité, dans laquelle il prépare l'impression et la diffusion de ses œuvres.
1.5. LA RETRAITE À CIREY (1734-1750)
1.5.1. PÉRIODE STUDIEUSE (1734-1740)
Voltaire s'est installé à Cirey, en Haute-Marne, chez Mme du Châtelet (Émilie Le Tonnelier de Breteuil, marquise du Châtelet, 1706-1749). C'est le lieu de sa retraite et le centre de ses activités jusqu'à la mort de sa maîtresse. Plusieurs raisons lui ont fait souhaiter de se retirer pendant quelques années : les poursuites entamées contre lui, le besoin de se recueillir pour l'œuvre de longue haleine que va être le Siècle de Louis XIV, le sentiment qu'il doit acquérir en science et en philosophie les connaissances qui lui manquent, et au seuil desquelles l'achèvement des Lettres philosophiques l'a conduit.
De 1734 à 1738 s'accomplit ce que l'on a appelé la rééducation de Voltaire. Il était déjà philosophe par son esprit critique, par ses idées sur la religion, sur la société, sur le bonheur. Il le devient au sens encyclopédique où son siècle doit entendre le mot : en se faisant métaphysicien, physicien, chimiste, mathématicien, économiste, historien, sans jamais cesser d'être poète et d'écrire des comédies, des tragédies, des épîtres ou des vers galants.
Avec Mme du Châtelet, il commente Newton, Leibniz, Christian von Wolff, Samuel Clarke, Bernard de Mandeville et fait des expériences de laboratoire. Sa correspondance avec Frédéric II de Prusse et le rôle qu'il espère jouer auprès du prince l'amènent à s'instruire sur la diplomatie et sur les problèmes économiques.
Toutes ces activités et ces recherches, qui explorent le concept de civilisation, aboutissent au Traité de métaphysique (Voltaire y travaille du début de 1734 à la fin de 1736, l'ouvrage ne sera pas publié de son vivant), aux Éléments de la philosophie de Newton (publiés en 1738), au Siècle de Louis XIV (une première version est prête en 1738, le début est publié en 1739 et aussitôt saisi), aux sept Discours sur l'homme (composés et diffusés plus ou moins clandestinement en 1738) et au projet de l'Essai sur les mœurs et l'esprit des nations.
1.5.2. PÉRIODE D'INSTABILITÉ (1740-1750)
Mais la retraite à Cirey n'est ni constante, ni solitaire, ni même toujours tranquille. Les visiteurs se succèdent. On fait du théâtre. On lit les œuvres toutes fraîches. On veille sur les manuscrits, qui sont comme des explosifs prêts à éclater : Voltaire entre en fureur quand des pages de la Pucelle disparaissent de leur tiroir. Il doit fuir en Hollande quand le texte du Mondain circule (novembre 1736).
La seconde partie de la période de Cirey est encore plus agitée : voyages à Lille auprès de sa nièce Mme Denis (qui devient sa maîtresse à partir de 1744), voyages à Paris pour la représentation, vite interdite, de Mahomet (août 1741) et pour celle de Mérope, triomphale (février 1743). Il rencontre Frédéric II à Wesel, près de Clèves (septembre 1740), part en mission diplomatique à Berlin et en Hollande (1743-1744), séjourne à Versailles pour la représentation de la Princesse de Navarre et celle du Temple de la gloire (1745).
Voltaire cherche, en effet, à obtenir la faveur de Louis XV. Son Poème de Fontenoy est imprimé par l'imprimerie royale (1745). Il est finalement nommé historiographe de France (avril 1745), élu à l'Académie française (avril 1746), avant de recevoir le brevet de gentilhomme ordinaire de la chambre du roi (décembre 1746). Les académies de province et de l'étranger rivalisent pour le compter parmi leurs membres. Il est reçu à Sceaux chez la duchesse du Maine, pour laquelle il écrit ses premiers Contes.
Mais, comme en 1726, l'édifice de son succès s'effondre quand il peut se croire au sommet. L'épisode du jeu de la reine (où Voltaire dit à Mme du Châtelet, qui perdait tout ce qu'elle misait, qu'elle jouait avec des coquins) est moins autant une des causes de sa disgrâce que la conséquence et le symbole de la conduite qu'il a adoptée. Il n'aurait en effet jamais sacrifié son œuvre et sa pensée à la quête des faveurs royales, dont il voulait se faire un bouclier, et le roi savait fort bien qu'il n'était pas un courtisan sincère. La mort de Mme du Châtelet prive Voltaire de son refuge, mais le délie de la promesse qu'il a faite de ne pas répondre à l'invitation de Frédéric.
1.6. AUPRÈS DE FRÉDÉRIC II DE PRUSSE (1750-1754)
1.6.1. ENTRE ADMIRATION ET DÉFIANCE RÉCIPROQUES
À son arrivée à Potsdam, en juillet 1750, Voltaire n'a plus d'illusions sur le roi-philosophe. Il comprend bien que la guerre et l'intrigue passeront toujours avant la philosophie aux yeux de celui qui lui a soumis, en 1740, une réfutation de Machiavel, mais a envahi la Silésie dès 1741. Le souverain et l'écrivain éprouvent l'un pour l'autre un sentiment étrange et violent, mélange d'admiration, d'attachement, de défiance et de mépris. Ce qu'ils se sont écrit l'un à l'autre, et ce qu'ils ont écrit l'un de l'autre, est à interpréter en fonction de toutes leurs arrière-pensées. Voltaire doit se justifier devant l'opinion française, et peut-être à ses propres yeux, d'être allé servir le roi de Prusse : celui-ci accable Voltaire de flatteries tout en le calomniant auprès du gouvernement français, pour lui interdire le retour en France. Le 15 mars 1753, Voltaire reçoit néanmoins le droit de quitter la Prusse.
1.6.2. UNE PÉRIODE FÉCONDE MALGRÉ TOUT
En peu de temps, Voltaire apprend beaucoup sur le pouvoir politique, sur la parole des rois, sur le rôle des intellectuels, et son expérience humaine, déjà variée, renforce encore davantage son caractère cosmopolite. Il travaille aussi beaucoup, malgré les divertissements, les corvées et les polémiques. En vérité, il songe d'abord à son travail en acceptant l'invitation de Frédéric II. Le Siècle de Louis XIV paraît (1752). Voltaire rédige de grands morceaux de l'Histoire universelle (le futur Essai sur les mœurs et l'esprit des nations), que déjà les éditeurs pirates s'apprêtent à publier d'après des manuscrits volés. Il pense à écrire son Dictionnaire philosophique portatif. Il donne, sous le titre de Micromégas (1752), sa forme définitive à un conte dont le premier état datait peut-être de 1739, et compose le Poème sur la loi naturelle, qui paraît en 1755.
1.6.3. DE NOUVEAU EN QUÊTE D'UN ABRI
Pendant un an et demi, de mars 1753 à novembre 1754, Voltaire cherche un abri. Malgré le bon accueil qu'il reçoit de plusieurs princes d'Allemagne, à Kassel, à Gotha, à Strasbourg, à Schwetzingen, les motifs de tristesse s'accumulent : deux représentants de Frédéric l'ont cruellement humilié et retenu illégalement prisonnier à Francfort (29 mai-7 juillet 1753). Les éditions pirates de ses œuvres historiques et les manuscrits de la Pucelle se multiplient. Mme Denis semble disposée à l'abandonner. Sa santé chancelle. À Colmar, pendant l'hiver de 1753, il songe au suicide. Mais il ne cesse de travailler : cela le sauve.
1.7. LE PATRIARCHE (1754-1778)
1.7.1. LA RETRAITE À FERNEY : UNE ACTIVITÉ INTENSE
En novembre 1754, Voltaire s'installe à Prangins (commune suisse du canton de Vaud), puis en mars 1755 près de Genève dans le domaine de Saint-Jean qu'il rebaptise « les Délices ». S'ensuivent des querelles et même des menaces d'expulsion, à cause des représentations théâtrales auxquelles il doit renoncer, à cause aussi du scandale de l'article « Genève », écrit par d'Alembert dans l’Encyclopédie, où l'on reconnaît son influence.
En décembre 1758, Voltaire achète le château de Ferney (dans l'Ain, près de la frontière suisse), où il ne s'installe qu'en 1759. Il y restera jusqu'à l'année de sa mort et y devient le « grand Voltaire », le « patriarche » qui reçoit des visiteurs de tous pays et correspond avec le monde entier – il dicte ou écrit parfois jusqu'à quinze ou vingt lettres à la suite. Il travaille de dix à quinze heures par jour, fait des plantations, construit des maisons, fonde des manufactures de montres, de bas de soie, donne des représentations théâtrales, des repas, des bals. Ainsi, en une vingtaine d'années, il lance dans le public plus de quatre cents écrits, depuis la facétie en deux pages jusqu'à l'encyclopédie philosophique en plusieurs volumes.
Candide, qui paraît en 1759, marque la fin d'une période d'inquiétude, au cours de laquelle il publie pourtant les Annales de l'Empire (1753) et l'Essai sur les mœurs et l'esprit des nations (1756). Il écrit, à la suite du tremblement de terre ayant détruit la ville, le Poème sur le désastre de Lisbonne (1756) et la première partie de l'Histoire de la Russie sous Pierre le Grand (1759). Il achève et fait paraître l'Orphelin de la Chine (1755), travaille à l'édition générale de ses œuvres entreprise par les frères Cramer. Il tente aussi, sans succès, d'arrêter la guerre en servant d'intermédiaire entre le duc de Choiseul et Frédéric II.
Dans l'immense production de Ferney figurent des tragédies comme Tancrède (1759), Olympie (1764), les Scythes (1768), les Guèbres (1769), les Lois de Minos (1772), Irène (1778), quelques comédies, le commentaire du théâtre de Corneille, des études historiques (Histoire du parlement de Paris, le Pyrrhonisme de l'Histoire, Fragment sur l'histoire générale), des études juridiques (Commentaire du livre des délits et des peines [de Beccaria], Commentaire sur l'Esprit des lois, le Prix de la justice et de l'humanité), des épîtres au roi de Chine, au roi du Danemark, à l'impératrice de Russie, à Boileau, à Horace, etc. Mais même les œuvres de pure littérature ou d'érudition sont liées aux polémiques dans lesquelles Voltaire est engagé, et chacune ne trouve son sens que replacée dans les circonstances qui l'ont fait naître. Il arrive à l'auteur d'expédier en quelques jours une tragédie, à la fois pour attirer l'attention du roi et obtenir la permission de revenir à Paris, qui lui est refusée aussi obstinément par Louis XVI qu'elle l'a été par Louis XV.
1.7.2. DÉFENSE DE LA LIBERTÉ DE PENSÉE
Dispute de Voltaire et de Jean-Jacques Rousseau
Tout sert le combat philosophique. « Écr. l'inf. », c'est-à-dire « Écrasons l'infâme », répète-t-il à ses correspondants – l'« infâme » étant la superstition, la religion en général et la religion catholique en particulier. Le combat vise aussi l'injustice, l'arbitraire, l'obscurantisme, la sottise, tout ce que Voltaire juge contraire à l'humanité et à la raison. Sa première arme étant le ridicule, satires, épigrammes et facéties bafouent les croyances et les usages qu'il condamne. Elles pleuvent sur Fréron, Omer de Fleury, les frères Le Franc de Pompignan, Jean-Jacques Rousseau, Chaumeix, Needham, Nonnotte, Patouillet, et bien d'autres ennemis récents ou de vieille date. Plusieurs de ces railleries mordantes sont restées célèbres : la Relation de la maladie, de la confession, de la mort et de l'apparition du jésuite Berthier, le Pot-Pourri, les Anecdotes sur Bélisaires ou la Canonisation de saint Cucufin.
Selon un dessein conçu depuis longtemps, Voltaire réunit des articles d'un ton plus sérieux, souvent tout aussi satirique, sur des sujets théologiques ou religieux (le Dictionnaire philosophique portatif, 1764, plusieurs fois réédité, augmenté à chaque réédition, devenu en 1769 la Raison par alphabet, puis simplement le Dictionnaire philosophique) ou sur tous les sujets de philosophie, législation, politique, histoire, littérature, où le philosophe a son mot à dire (Questions sur l'Encyclopédie, à partir de 1770). Il met en forme les recherches de critique religieuse et de critique biblique qu'il a commencées à Cirey avec Mme du Châtelet, et une vingtaine d'essais ou de traités sortent de Ferney de 1760 à 1778 : Sermon des Cinquante (1762), Traité sur la tolérance (1763), Questions sur les miracles (1765), Examen important de Milord Bolingbroke (1766), le Dîner du comte de Boulainvilliers (1768), Collection d'anciens évangiles (1769), Dieu et les hommes (1769), la Bible enfin expliquée (1776), Histoire de l'établissement du christianisme (1777).
Voltaire a des alliés dans ce combat, les encyclopédistes d'Alembert et Marmontel, et il prend leur défense quand ils sont persécutés. Mais, à mesure que se développe en France une philosophie athée, dont les porte-parole sont, entre autres, Diderot et d'Holbach, il ressent le besoin de raffermir les bases de sa propre philosophie, qui est loin d'être toute négative. Il le fait dans des dialogues comme le Douteur et l'Adorateur (1766 ?), l'A.B.C. (1768), les Adorateurs (1769), Sophronime et Adelos (1776), Dialogues d'Evhémère (1777) et dans des opuscules comme le Philosophe ignorant (1766), Tout en Dieu (1769), Lettres de Memmius à Cicéron (1771), Il faut prendre un parti ou le principe d'action (1772).
1.7.3. LE POLÉMISTE ENGAGÉ
Voltaire promettant son appui à la famille Calas
Enfin, la satire et la discussion ne suffisent pas à Voltaire. Il fait appel à l'opinion publique et intervient dans des affaires judiciaires qui l'occupent et l'angoissent pendant plusieurs années : affaires Calas, Sirven, Montbailli, La Barre, Lally-Tollendal. Les Contes (l'Ingénu, la Princesse de Babylone, l'Histoire de Jenni, le Taureau blanc) sont la synthèse fantaisiste de toutes ces polémiques et de toutes ces réflexions, pour la joie de l'imagination et de l'intelligence…
Le 5 février 1778, après avoir envoyé devant lui en reconnaissance Mme Denis, Voltaire part sans autorisation pour Paris et y arrive le 19. Sa présence soulève la foule, les visiteurs se pressent à son domicile, la loge des Neuf-Sœurs lui donne l'initiation. L'Académie française lui fait présider une de ses séances, la Comédie-Française – où l'on joue sa pièce Irène – fait couronner son buste sur la scène en sa présence.
Voltaire meurt le 30 mai, en pleine gloire. Son cadavre, auquel le curé de Saint-Sulpice et l'archevêque de Paris refusent la sépulture, est transporté clandestinement et inhumé dans l'abbaye de Seillières par son neveu, l'abbé Vincent Mignot.
Après la Révolution, le 11 juillet 1791, son corps entre en grande pompe au Panthéon, accompagné par l'immense cortège des citoyens reconnaissants, lors de la première cérémonie révolutionnaire qui se déroule sans la participation du clergé. Son épitaphe porte ces mots : « Il combattit les athées et les fanatiques. Il inspira la tolérance, il réclama les droits de l'homme contre la servitude de la féodalité. Poète, historien, philosophe, il agrandit l'esprit humain, et lui apprit à être libre. »
2. L'ŒUVRE DE VOLTAIRE
2.1. LE VOLTAIRE HISTORIEN
2.1.1. UNE NOUVELLE MÉTHODE HISTORIQUE
Voltaire a voulu que l'histoire soit philosophique et n'a cessé de faire avancer parallèlement ses travaux historiques et ses réflexions sur les méthodes et les objectifs de l'historien. Parti d'une conception épique et dramatique, qui a pu faire dire que la Henriade était une histoire en vers et l'Histoire de Charles XII une tragédie en prose, il a voulu ensuite faire le tableau d'un moment de haute civilisation dans un pays (le Siècle de Louis XIV), puis retracer l'histoire de la civilisation dans l'univers entier, en commençant au point où Bossuet avait arrêté son Discours sur l'histoire universelle (Essai sur les mœurs et l'esprit des nations et sur les principaux faits de l'histoire depuis Charlemagne jusqu'à Louis XIII, qui devait d'abord être une Histoire générale ou une Histoire de l'esprit humain).
Voltaire entend respecter plusieurs principes, qu'il a de mieux en mieux précisés avec le temps : les faits doivent être exactement établis, contrôlés par la consultation des témoins oculaires et des documents écrits ; tout ce qui est contraire à la raison, à la vraisemblance et à la nature doit être écarté ; les récits légendaires et les miracles n'ont pas leur place dans une œuvre historique, sauf comme exemples de la crédulité et de l'ignorance des siècles passés. Voltaire reproche à ses prédécesseurs et à ses contradicteurs moins leur manque de connaissances que leur manque de jugement. Il s'acharne à dénoncer leurs « bévues » et leurs « sottises ».
Tous les faits, même avérés, ne sont pas à retenir : l'érudition historique a réuni depuis le début du xviie s. une immense documentation, et le critère du tri à faire dans cette documentation est la signification humaine des faits. De sorte que Voltaire s'intéresse moins aux événements, batailles, mariages, naissances de princes, qu'à la vie des hommes « dans l'intérieur des familles » et « aux grandes actions des souverains qui ont rendu leurs peuples meilleurs et plus heureux ». Il ne renonce pas à raconter : l'Histoire de Charles XII est une narration. Les chapitres narratifs dans le Siècle de Louis XIV sont les plus nombreux, mais le récit est rapide et clair. Il vaut une explication et il comporte une signification critique, parfois soulignée d'un trait d'ironie.
Les idées, la religion, les arts, les lettres, les sciences, la technique, le commerce, et ce que Voltaire appelle les « mœurs » et les « usages », occupent une place croissante : ils constituent la civilisation, dont Voltaire écrit l'histoire, sans la nommer, puisque le mot n'existait pas encore.
2.1.2. TROIS CAUSES À L'ŒUVRE DANS L'HISTOIRE
Voltaire voit agir dans l'histoire trois sortes de causes : les grands hommes, le hasard et un déterminisme assez complexe, où se combinent des facteurs matériels – comme le climat et le tempérament naturel des hommes – et des facteurs institutionnels, comme le gouvernement et la religion. De ces dernières causes, il ne cherche pas à démêler le « mystère » : il lui suffit d'affirmer que tout s'enchaîne. Le hasard est ce qui vient dérouter les calculs humains, les petites causes produisant les grands effets. Ici encore, Voltaire est en garde contre une explication trop ambitieuse de l'histoire. Quant aux grands hommes, ils peuvent le mal comme le bien, selon leur caractère et selon le moment où ils apparaissent. Ceux qui comptent aux yeux de l'historien sont ceux qui ont conduit leur pays à un sommet de civilisation : Périclès, Philippe de Macédoine et Alexandre le Grand dans la Grèce antique ; César et Auguste à Rome ; les Médicis au temps de la Renaissance italienne ; Louis XIV dans la France du xviie s.
Voltaire n'ignore pas que ces grands hommes ont rencontré des circonstances favorables et ont été puissamment secondés, qu'ils n'ont pas tout fait par eux-mêmes, que, dans l'intervalle des siècles de « génie », l'humanité a continué à progresser. Mais son scepticisme et son pessimisme sont plus satisfaits de reporter sur quelques individus exceptionnels l'initiative et la responsabilité de ce qui fait le prix de la vie humaine.
2.1.3. UNE HISTOIRE POLÉMIQUE
Voltaire écrit l'histoire également en polémiste et, malgré son désir de tout comprendre, en civilisé de l'Europe occidentale. Ses jugements sont orientés par les combats philosophiques, par les problèmes propres à son époque et par les intérêts d'un homme de sa culture et de son milieu. Il est assez mal informé des mécanismes économiques. Il considère comme plus agissantes les volontés humaines. Il a délibérément renoncé à rendre compte du mouvement de l'histoire par un principe philosophique, métaphysique, sociologique ou physique : il pense que l'histoire, à son époque, doit devenir une science, non pas parce qu'elle formulera des lois générales, mais parce qu'elle établira exactement les faits et déterminera leurs causes et leurs conséquences.
Plusieurs de ces défauts qu'on reproche à Voltaire sont sans doute des qualités. En tout cas, les discussions actuelles sur l'ethnocentrisme ou sur la possibilité d'une histoire scientifique prouvent qu'on ne peut opposer à la conception voltairienne de l'histoire que des conceptions aussi arbitraires. Il reste que Voltaire a débarrassé l'histoire de la théologie et de toute explication par la transcendance, et qu'il l'a, en sens inverse, arrachée à l'événementiel, à la collection minutieuse de faits particuliers.
Historien humaniste, Voltaire a établi un ordre de valeurs dans les objets dont s'occupe l'histoire, mettant au premier rang le bonheur sous ses formes les plus évoluées. Il a ainsi fait apparaître un progrès que l'historien ne doit pas seulement constater, mais auquel il doit contribuer en inspirant l'horreur pour les crimes contre l'homme. Au récit des actions commises par les « saccageurs de province [qui] ne sont que des héros » (Lettre à A.M. Thiriot, 15 juillet 1735), il a tenté de substituer le récit d'une action unique : la marche de l'esprit humain.
LES PRINCIPAUX ESSAIS HISTORIQUES DE VOLTAIRE
2.2. LE VOLTAIRE DRAMATURGE
Au théâtre, l'échec est presque complet, si l'on met à part l'utilisation de la scène comme d'une tribune. Voltaire aimait trop le théâtre : l'histrion en lui a tué le dramaturge, qui, pourtant, avait des idées nouvelles et n'avait pas en vain essayé de comprendre Shakespeare – dont il reste le principal introducteur en France. Son plus grand succès théâtral fut Zaïre (1732) : la pièce a été traduite dans toutes les langues européennes et jouées par les comédiens-français 488 fois jusqu'en 1936.
Il y a certes de beaux passages, du pathétique, du chant dans les tragédies d'avant 1750 (Zaïre, 1732 ; Mérope, 1743). Mais peut-être faudrait-il mettre toutes les autres en prose pour faire apparaître leurs qualités dramatiques. On peut trouver un réel intérêt à quelques pièces en prose, étrangères à toute norme, comme Socrate (1759) ou l'Écossaise (1760) : pour Voltaire, c'était d'abord des satires, elles ont pourtant un accent moderne qui manque trop souvent aux drames de Diderot, Sedaine et Mercier.
LES PRINCIPALES PIÈCES DE VOLTAIRE
2.3. LE VOLTAIRE PHILOSOPHE
2.3.1. LE REFUS DE LA MÉTAPHYSIQUE
Si le philosophe est celui dont toutes les pensées, logiquement liées, prétendent élucider les premiers principes de toutes choses, Voltaire n'est pas un philosophe. Ce qu'il appelle philosophie est précisément le refus de la philosophie entendue comme métaphysique. Qu'est-ce que Dieu, pourquoi et quand le monde a-t-il été créé, qu'est-ce que l'infini du temps et de l'espace, qu'est-ce que la matière et qu'est-ce que l'esprit, l'homme a-t-il une âme et est-elle immortelle, qu'est-ce que l'homme lui-même ? Toutes ces questions posées par la métaphysique, l'homme ne peut ni les résoudre ni les concevoir clairement. Dès qu'il raisonne sur autre chose que sur des faits, il déraisonne. La science physique, fondée sur l'observation et l'expérience, est le modèle de toutes les connaissances qu'il peut atteindre. Encore n'est-il pas sûr qu'elle soit utile à son bonheur.
L'utilité est en effet le critère de ce qu'il faut connaître, et le scepticisme, pour Voltaire comme pour la plupart des penseurs rationalistes de son temps, le commencement et la condition de la philosophie. Mais le doute n'est pas total. Il épargne quelques fortes certitudes :
– que l'existence du monde implique celle d'un créateur, car il n'y a pas d'effet sans cause, et que ce créateur d'un monde en ordre est souverainement intelligent ;
– que la nature a ses lois, dont l'homme participe par sa constitution physique, et que des lois morales de justice et de solidarité, dépendant de cette constitution, sont universellement reconnues, même quand elles imposent des comportements contradictoires selon les pays ;
– que la vie sur cette terre, malgré d'épouvantables malheurs, mérite d'être vécue ;
– qu'il faut mettre l'homme en état de la vivre de mieux en mieux et détruire les erreurs et les préjugés qui l'en séparent.
2.3.2. LE REFUS DE L'ESPRIT DE SYSTÈME
Parce que son argumentation devait changer selon ses adversaires, Voltaire n'hésita pas à se contredire en apparence, unissant en réalité dans des associations toujours plus riches les arguments qu'il employait successivement. Ainsi, le tremblement de terre de Lisbonne lui sert, en 1759, à réfuter Leibniz et Alexander Pope, mais la sécurité des voyages « sur la terre affermie » lui sert, en 1768, dans l'A.B.C., à rassurer ceux qui ne voient dans la création que le mal. La métaphysique de Malebranche est sacrifiée vers 1730 à la saine philosophie de Locke et de Newton, mais l'idée malebranchiste du « Tout en Dieu » est développée dans un opuscule de 1769 et mise au service d'un déterminisme universel déiste, opposé et parallèle au déterminisme athée.
Voltaire ignore la pensée dialectique. Il ne sait pas faire sortir la synthèse du heurt entre la thèse et l'antithèse. Il ne peut qu'appuyer, selon le cas, sur le pour ou sur le contre, non pour s'installer dans un juste milieu, mais pour les affirmer comme solidaires, chacun étant la condition et le garant de l'autre. Ce faisant, il ne se livre pas à un vain jeu de l'esprit. Il est persuadé qu'une vue unilatérale mutile le réel et que, dans l'ignorance où est l'homme des premiers principes et des fins dernières, le sentiment des contradictions assure sa liberté.
2.3.3. LA PHILOSOPHIE COMME MORALE
Toute la philosophie se ramène ainsi à la morale, non pas à la morale spéculative, mais à la morale engagée, qui peut se faire entendre sous n'importe quelle forme : tragédie, satire, conte, poème, dialogue, article de circonstance, aussi bien que sous l'aspect consacré du traité. Voltaire a pourtant été obsédé par les questions qu'il déclare inutiles et insolubles : elles sont au cœur de ses polémiques.
Son esprit critique se dresse contre un optimisme aveugle fondé sur un acte de foi ou sur des raisonnements à la Pangloss, ce personnage de Candide (1759). Dès le début, il n'est optimiste que par un acte de volonté. Son poème le Mondain, si on le lit bien, fait la satire d'un jouisseur que n'effleure aucune inquiétude. Ses malheurs personnels ont confirmé à Voltaire l'existence du mal. Dire qu'il a été bouleversé et désemparé par le tremblement de terre de Lisbonne, c'est gravement exagérer. Mais il s'en prend aux avocats de la Providence avec irritation et tristesse, parce qu'il refuse de crier « tout est bien » et de justifier le malheur.
Voltaire condamne tout aussi énergiquement ceux qui calomnient l'homme, les misanthropes comme Pascal, et, croyant en un Dieu de bonté, il déteste l'ascétisme et la mortification. Il lui faut se battre sur deux fronts, puis sur trois quand entre en lice l'athéisme matérialiste.
Une aptitude sans égale, au moment où il affirme une idée, à saisir et à préserver l'idée contraire, une adresse géniale à l'ironie, qui est le moyen d'expression de cette aptitude, telles sont les qualités de Voltaire philosophe. Sa pensée est inscrite dans l'histoire de l'humanité. Il a passionné plusieurs générations pour la justice, la liberté, la raison, l'esprit critique, la tolérance. On peut redemander encore à son œuvre toute la saveur de ces idéaux, si l'on a peur qu'ils ne s'affadissent.
LES PRINCIPAUX OUVRAGES PHILOSOPHIQUES DE VOLTAIRE
2.4. LE VOLTAIRE CONTEUR
L'ironie voltairienne est intacte dans les romans et les contes « philosophiques », parce qu'ils n'ont pas été écrits pour le progrès de la réflexion ou de la discussion, mais pour le plaisir, en marge des autres œuvres. Voltaire y a mis sa pensée telle qu'il la vivait au plus intime de son être. Elle s'y exprime dans le jaillissement, apparemment libre, de la fantaisie. Ce qui est ailleurs argument polémique est ici humeur et bouffonne invention.
La technique du récit, le sujet des Contes, leur intention ont changé selon les circonstances de la rédaction : Micromégas est plus optimiste, Candide plus grinçant, l'Ingénu plus dramatique, l'Histoire de Jenni plus émue. Ils sont l'écho des préoccupations intellectuelles de Voltaire et de sa vie à divers moments (Zadig [1748] écrit en référence au « roi-philosophe » Frédéric II).
Mais dans tous, Voltaire s'est mis lui-même, totalement, assumant ses contradictions (car il est à la fois Candide et Pangloss) et les dépassant (car il n'est ni Pangloss ni Candide), répondant aux questions du monde qui l'écrase par une interrogation socratique sur ses expériences les plus profondes. Car l'ironie y est elle-même objet d'ironie. Elle enveloppe le naïf, dont les étonnements font ressortir l'absurdité des hommes et la ridiculisent. Elle vise non plus seulement les préjugés et la sottise, mais l'homme en général, être misérable et fragile, borné dans ses connaissances et dans son existence, sujet aux passions et à l'erreur, qui ne peut pas considérer sa condition sans éclater de rire. Ce rire n'anéantit pas ses espérances ni la grandeur de ses réussites, mais signale leur relativité (voyez Micromégas). La finitude et la mort frappent d'ironie toute existence humaine : en épousant l'ironie du destin, en ironisant avec les dieux, l'homme échappe au ridicule, s'accorde à lui-même et à sa condition, et se donne le droit d'être grand selon sa propre norme.
L'ironie de Voltaire est libération de l'esprit et du cœur. Ce que sa pensée peut avoir de rhétorique, de tendancieux, de court quand elle s'exprime dans des tragédies, des discours en vers ou même dans des dialogues, est brûlé au feu de l'ironie. Voltaire n'est dupe d'aucune imposture, d'aucune gravité. Il s'évade par le rire et rétablit le sérieux et le sentimental sans s'y engluer. Il ne court pas le risque de tourner à vide, de tomber dans le nihilisme intellectuel et moral du « hideux sourire » (selon les vers d'Alfred de Musset : « Dors-tu content, Voltaire, et ton hideux sourire/Voltige-t-il encor sur tes os décharnés ? », Rolla, 1833). Nullement dérobade d'un esprit égoïste qui ricanerait de tout et ne voudrait jamais s'engager, l'ironie voltairienne est appel au courage et à la liberté. Elle est généreuse.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
KANT |
|
|
| |
|
| |

KANT
PLAN
* EMMANUEL KANT
* 1. Une existence tranquille
* 1.1. Pétri de morale religieuse
* 1.2. Professeur éclectique
* 1.3. Penseur sédentaire
* Kant et les Lumières
* L'érudit de Königsberg
* 2. Kant ou le projet critique
* 2.1. La raison dogmatique
* 2.2. Le scepticisme de Hume
* 2.3. La critique selon Kant
* 2.4. La théorie des facultés, une théorie de la connaissance
* 2.5. La philosophie transcendantale
* La sensibilité
* L'entendement
* 2.6. Une révolution « copernicienne » en philosophie
* 2.7. La critique de la métaphysique
* 2.8. Renoncer à la métaphysique ?
* 3. La raison pratique : Kant et la réflexion morale
* 3.1. L'action par devoir et l'action conforme au devoir
* 3.2. L’impératif catégorique
* L’impératif hypothétique est conditionnel.
* L’impératif catégorique est un impératif moral.
* 3.3. L’autonomie et l’hétéronomie de la volonté
* 3.4. Un cas pratique : le droit de mentir
* 4. Kant et l’histoire
* 4.1. Le dessein de la nature
* 4.2. Le cosmopolitisme
* 5. L’œuvre d’art et le beau, l'esthétique kantienne
* 5.1. Le génie
* 5.2. Le sentiment esthétique
* L’antinomie du jugement de goût
* Jugement déterminant et jugement réfléchissant
* La solution de l’antinomie
* 5.3. Une définition du beau
* 5.4. Autres définitions du beau
* 6. L'apport de Kant
* 6.1. L'influence de Kant
* 6.2. Petit glossaire kantien
* Antinomie
* Catégories
* Connaissance a posteriori
* Connaissance a priori
* Criticisme
* Critique de la faculté de juger
* Critique de la raison pratique
* Critique de la raison pure
* Entendement
* Expérience
* Formes a priori de la sensibilité
* Idée
* Impératif catégorique
* Impératif hypothétique
* Intuition
* Jugement analytique
* Jugement synthétique
* Loi morale
* Maxime
* Noumène
* Phénomène
* Principes pratiques
* Pur
* Schème
* Subsumer
* Sensibilité
* Transcendantal
* Volonté
* Volonté pathologique
Emmanuel Kant
« Que puis-je connaître ? », « que dois-je faire ? », « que suis-je en droit d'espérer ? », trois questions au centre du projet kantien.
Prenant acte de la révolution intellectuelle accomplie dans les sciences par Copernic puis par Newton, Emmanuel Kant met en place une nouvelle philosophie, à laquelle il donne le nom de « criticisme ». Penseur d'un rationalisme renouvelé, grâce à Hume, qui le réveilla, dit-il, de son sommeil dogmatique, il formule les conditions a priori de toute connaissance (→ idéalisme transcendantal) et établit la valeur absolue de la loi morale : elle constitue pour lui un impératif catégorique qui fonde la liberté de l'homme.
Le vocabulaire kantien (cf. notre glossaire en fin d'article) a aujourd'hui intégré le langage courant de la philosophie : les concepts forgés par Kant ont été non seulement réinvestis, mais aussi modifiés et adaptés par la grande majorité des penseurs des xixe et xxe siècles.
La vie de Kant est peu fertile en événements remarquables : c'est celle d'un professeur qui ne quitta jamais sa province natale et, quelques années seulement, sa ville, Königsberg.
LES PRINCIPAUX ÉCRITS DE KANT
– Critique de la raison pure (1781)
– Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique (1784)
– Fondements de la métaphysique des mœurs (1785)
– Critique de la raison pratique (1788)
– Critique du jugement ou Critique de la faculté de juger (1790)
– La religion dans les limites de la simple raison (1793)
– Projet de paix perpétuelle (1795).
L’ESSENTIEL DU PROJET CRITIQUE
Kant désigne lui même l’essentiel de son projet critique par trois grandes questions, qui, posées à la première personne, articulent toute sa pensée.
Que puis-je connaître ?
Cette première question s’attache aux capacités de notre faculté de connaissance. Elle part d’une inquiétude première : notre raison est-elle capable de saisir tous les objets auxquels elle prétend accéder ? Prétendant au statut de science, la métaphysique nous présente en effet des réalités conceptuelles qui dépassent de loin l’expérience (l’Univers, Dieu, l’âme, l’un, etc.). Il s’agit donc de déterminer si la raison n'outrepasse pas ses propres limites lorsqu’elle s’aventure sur ce terrain.
Que dois-je faire ?
Cette deuxième question porte sur la morale et le devoir. Il s’agit ici de déterminer comment une action peut être évaluée comme bonne absolument. En effet, bon nombre de nos actions sont bonnes pour autre chose et ne relèvent en cela que du talent ou de la prudence. Mais certaines actions, bonnes pour autre chose, ne sont pas morales, c’est à dire absolument bonnes.
Considérons la proposition suivante : « pour me rendre chez mon voisin et lui dérober son argent, je dois emprunter tel trajet. » Ici, le moyen (le trajet emprunté) est bon pour la fin (la destination) ; mais la fin ne saurait être considérée comme bonne en soi. Il s’agit donc de déterminer si et à quelles conditions une action peut être déclarée bonne en soi.
Que suis-je en droit d’espérer ?
Même si le traitement de cette question n’est pas chez Kant aussi linéaire et clair que celui des deux précédentes, il s’agit de savoir s’il est permis d’espérer un bonheur futur, comme l’accession au paradis. Il sera donc avant tout question ici de théologie.
1. Une existence tranquille
1.1. Pétri de morale religieuse
Immanuel, en français Emmanuel, Kant est né en Prusse-Orientale, à Königsberg (aujourd'hui Kaliningrad), le quatrième d'une famille de onze enfants. Son père est un ouvrier sellier. Sa mère, luthérienne piétiste, lui donne une éducation morale très rigoureuse.
Ses maîtres, au collège puis à l'université de Königsberg, sont adeptes du piétisme ou s'efforcent de concilier le piétisme et le rationnalisme de Leibniz. Ce sont surtout les sciences qui attirent le jeune Kant.
1.2. Professeur éclectique
En 1746, Kant publie son premier ouvrage, Pensées sur la véritable évaluation des forces vives, dans lequel il s'efforce d'accorder la philosophie de Descartes (→ cartésianisme) avec la pensée de Leibniz. La même année, il perd son père et doit quitter Königsberg pour remplir les fonctions de précepteur dans plusieurs familles nobles de la Prusse-Orientale.
Revenu dans sa ville natale en 1755, il publie un deuxième ouvrage, Histoire universelle de la nature et théorie du ciel, dans lequel il propose une explication mécaniste, inspirée de Newton, de l'origine du monde, très proche de celle que Laplace proposera quarante ans plus tard.
La même année, Kant obtient à l'université de Königsberg la « promotion », puis l'« habilitation », qui lui confère le droit d'ouvrir un cours libre. Pendant quatorze ans, il est ainsi « privatdozent », c'est-à-dire professeur directement rétribué par les étudiants. Très apprécié, il peut vivre tout à fait à son aise. En 1770, il obtient l'« ordinariat » en présentant un essai en latin, De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principis (Dissertation sur la forme et les principes du monde sensible et du monde intelligible), devenu depuis la célèbre Dissertation de 1770.
Professeur scrupuleux, Kant est très aimé de ses élèves, parmi lesquels Herder, qui le décrit ainsi : « Son front découvert, taillé par la pensée, était le siège d'une gaîté et d'une joie inaltérables ; débordante d'idées, la pensée coulait de ses lèvres ; plaisanteries, esprit, humour ne lui faisaient jamais défaut, et son enseignement était un commerce des plus intéressants. »
Les matières qu'il domine sont très diverses : il donne des leçons de logique, de mathématiques, de physique, de métaphysique, d'anthropologie, de pédagogie et même de géographie physique. Cet aspect de son enseignement, souvent méconnu, est important, puisque, durant les quatre-vingt-deux semestres de son activité universitaire, la géographie physique figure quarante-sept fois au programme de ses cours.
1.3. Penseur sédentaire
Kant ne quittera jamais l'université de Königsberg : il est membre du sénat de l'université en 1780, recteur de 1786 à 1788, doyen de la faculté de philosophie et de toute l'Académie en 1792. L'Académie de Berlin l'élit en 1786, celle de Saint-Pétersbourg en 1794 et celle de Vienne en 1798.
Parallèlement, Kant se livre intensément à l'étude, en menant une existence de célibataire réglée avec minutie. On raconte que tous les jours, à la même heure, il fait la même longue promenade, si bien que chacun, en le croisant, peut connaître l'heure exacte… Il n'en suit pas moins avec passion les événements de la Révolution française. Lecteur assidu de Rousseau, il s'intéresse aussi à tout ce qui est publié d'important en Europe et partage ses idées avec les gens qu'il aime recevoir.
Kant et les Lumières
Dans un célèbre article de 1784 où Kant répondait à la question : « Qu'est-ce que “les Lumières” ? », il se pencha sur ce que fut en Allemagne le Zeitalter der Aufklärung, le « siècle des Lumières ». Ce mouvement manifestait, selon lui, la volonté de l'homme de quitter son « enfance intellectuelle » pour conquérir la liberté dans l'usage de la raison – ce qu'il résuma par cette formule : sapere aude, « ose faire usage de ton jugement ».
Cette aspiration était dans le droit fil des préoccupations des Lumières françaises, dont Kant était un fervent admirateur. Mais le philosophe prussien ne fut jamais partisan d'aucune révolution, même si une telle conception de la liberté de penser ne fut pas sans légitimer la contestation des monarchies autoritaires.
L'érudit de Königsberg
En 1796, conscient de son affaiblissement intellectuel, Kant abandonne son enseignement. Toutes ses grandes œuvres sont parues. Kant n'en continue pas moins de travailler ; il meurt le 12 février 1804 en disant « Es ist gut » (c'est bien).
Proche de Frédéric II le Grand, mais tenu à l'écart par ses successeurs, Kant reste l'érudit de Königsberg, qui lui fera des obsèques solennelles. Sur son tombeau, on lit ces mots : « Le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. »
2. Kant ou le projet critique
Jusqu'en 1760, Kant suit les traces du rationalisme dogmatique et subit l'influence de la physique newtonienne et de la métaphysique de Leibniz et de Wolff ; de 1760 à 1769, il découvre l'empirisme à travers Locke et Hume, et les droits du sentiment à la lecture de Shaftesbury et de Rousseau.
La Dissertation de 1770 clôt la période que l'on appelle précritique et ouvre véritablement aux yeux de Kant lui-même la période critique. Tous les doutes qui ont assiégé le Kant encore leibnizien s'y trouvent systématisés et préparés ainsi pour leur dépassement. Son apport essentiel est d'établir l'idéalité du temps et de l'espace (l'espace et le temps sont des formes a priori de la sensibilité, cf. paragraphe 2.5.). Cependant, sur de nombreux points, les thèses de la Dissertation de 1770 contredisent celles de la Critique de la raison pure qu' il publiera en 1781.
La philosophie critique de Kant commence par un constat : l’histoire des sciences physiques et des mathématiques est ponctuée de succès divers : par exemple, les découvertes de Thalès et de Galilée ont donné lieu aux plus grandes conquêtes de l’esprit.
Au contraire, l’histoire de la métaphysique reste un terrain de bataille sans cesse dévasté. Celle-ci n’a jamais su emprunter la voie sûre d’une science : les savoirs métaphysiques ne progressent pas, mais sont perpétuellement remis en cause. Pourtant, malgré ces échecs, la métaphysique continue de s’imposer comme une nécessité de la raison.
Kant va tenter de donner à ce problème une solution théorique.
2.1. La raison dogmatique
Le point de départ de Kant est le suivant : la raison est naturellement dogmatique. Elle use de son pouvoir de connaître sans s’interroger sur les conditions qui rendent légitimes les connaissances qu’elle prétend acquérir. Faute d’une telle interrogation, la métaphysique traditionnelle s’est perdue dans des contradictions interminables.
2.2. Le scepticisme de Hume
Devant ces échecs dogmatiques de la raison, David Hume, illustre prédécesseur de Kant, a opté pour une solution sceptique, en proclamant l’impuissance de la raison à acquérir une quelconque connaissance nécessaire et universelle. D’après Kant, ce scepticisme a le mérite de réveiller la raison de son sommeil dogmatique ; mais il a le défaut de la condamner plutôt que de lui prescrire des limites à l’intérieur desquelles son pouvoir de connaître serait garanti.
Ainsi, le criticisme (le système philosophique de Kant) a pour vocation de mettre en place un tribunal de la raison qui distingue son usage légitime de son usage illégitime.
2.3. La critique selon Kant
Dans le vocabulaire kantien, ce terme ne désigne pas une dénonciation vigoureuse, une remise en question, ni un compte rendu appréciatif d’une œuvre ou d’un spectacle.
Pour Kant, la critique est une activité de la raison consistant à opérer des partages, des discernements et porter des jugements. Plus précisément, Kant cherche à tracer les limites au delà desquelles la raison ne peut s’aventurer sans affirmer une chose et son contraire et tomber dans une chaine infinie de contradictions. La critique a donc pour vocation de définir le domaine à l’intérieur duquel les pouvoirs de la raison peuvent légitimement s’exercer.
2.4. La théorie des facultés, une théorie de la connaissance
Les philosophes distinguent traditionnellement deux grands genres d’accession au savoir : la méthode empirique, qui consiste, à partir de l’expérience (physique) à dégager les lois d'apparition des phénomènes ; et la méthode déductive, qui vise à déduire, à l’aide de la raison, des vérités à partir de concepts ou de nombres (mathématiques).
Kant récuse cette distinction : pour ce qui est des sciences physiques, elles fournissent bien des informations sur le réel ; elles sont alors dites « synthétiques ». Cependant, ces connaissances ne dépendent pas seulement de l’expérience : les lois formulées dans le cadre des sciences de la nature sont universelles et nécessaires. Or l’expérience n’est aucunement en mesure d’enseigner ni la nécessité, ni l’universalité. Ainsi, les principes de la physique sont non seulement synthétiques, mais aussi a priori, car ils précèdent l’expérience.
Mais quelles sont ces connaissances a priori ? Kant répond à cette question en distinguant deux grandes facultés de l’esprit humain :
– la sensibilité : les objets nous sont donnés par le moyen d’intuitions sensibles – c’est là l’objet de l’ « esthétique transcendantale » de la Critique de la raison pure ;
– l’entendement, au moyen duquel les objets sont pensés et mis en relation les uns par rapport aux autres.
2.5. La philosophie transcendantale
Il s’agit pour Kant de s’interroger sur les conditions de possibilité de la connaissance. C’est en ce sens qu’il qualifie sa philosophie de transcendantale. Sa question principale est la suivante : comment la connaissance est-elle possible ? Dans sa formulation, cette question suppose que quelque chose rend possible la connaissance. Cette condition de possibilité, c’est la structure même de l’esprit.
La sensibilité
Dans la Critique de la raison pure, l’« esthétique transcendantale » étudie l’espace et le temps comme formes a priori de la sensibilité, à travers lesquels tous les phénomènes de l’expérience nous sont donnés. Autrement dit, l’espace et le temps sont ce sans quoi la sensibilité ne saurait avoir lieu. Ils sont dits a priori, parce qu’ils précèdent l’expérience tout en la conditionnant.
L'entendement
Toujours dans la Critique de la raison pure, la « logique transcendantale » étudie les concepts purs de l’entendement (les « catégories ») à travers lesquels tous les phénomènes sont nécessairement pensés. Ils sont ce sans quoi la pensée ne pourrait s’exercer. Ils sont dits « purs » au sens où ils ne relèvent eux-mêmes d’aucune expérience particulière.
Parce qu’ils sont source de toute connaissances, l’espace, le temps et les catégories sont indépendants de l’expérience. Cependant, leur champ d’application et de validité se limite à l’expérience : les formes de la sensibilité et les concepts purs de l’entendement n’ont pas de sens en dehors de l’expérience. Autrement dit, considérer que ces formes et ces concepts ont un sens par eux-mêmes, c’est faire un usage illégitime de la raison.
2.6. Une révolution « copernicienne » en philosophie
Lorsqu’il a affirmé que ce n’était pas la Terre, mais le Soleil qui était le centre immobile du mouvement circulaire des planètes, Copernic a opéré un changement radical de point de vue.
Kant va opérer un bouleversement similaire dans le domaine de la philosophie : ce n’est pas l’esprit qui doit se régler sur les objets, mais l’inverse : les objets eux-mêmes doivent se régler sur les structures a priori de la sensibilité et de l’entendement. Cette « révolution copernicienne en philosophie » doit permettre à la métaphysique de s’engager enfin dans la voie sûre d’une science.
2.7. La critique de la métaphysique
L’âme, le monde et Dieu sont les préoccupations traditionnelles de la métaphysique classique. D’après Kant, ces réalités ne pourraient constituer un quelconque objet de connaissance. Autrement dit, il est impossible de faire l’expérience de l’âme, du monde comme totalité, et de Dieu. Ainsi, il ne s’agit pour Kant que d’Idées de la raison. Lorsqu’elle se penche sur ces notions, la raison est dite dialectique : elle « tourne à vide » sans jamais pouvoir échapper à la contradiction.
En voulant transformer ces Idées en objets, la métaphysique se rend ainsi illusoire et peu fiable. Mais cet élan illusoire de la raison est pourtant nécessaire : ces Idées de la raison représentent chacune un inconditionné dont la connaissance permettrait d’achever l’unité du savoir. Autrement dit, ces Idées représentent pour la raison l’espoir d’une connaissance totale, pourtant à jamais inaccessible.
2.8. Renoncer à la métaphysique ?
Kant ne renoncera pas pour autant à la métaphysique. Il s’agit simplement pour lui d’en modifier l’objet. Celle-ci ne portera plus sur ces Idées mystérieuses que sont l’âme, Dieu et l’Univers, mais consistera en une activité critique dont la fonction sera de veiller à ce que les sciences ne dépassent jamais les limites de la raison. La Critique de la raison pure est en ce sens le projet d’un système de la raison pure qui, à terme, représentera la métaphysique future.
3. La raison pratique : Kant et la réflexion morale
Kant part d’un constat : ce qu’on tient pour véritablement moral, c’est une bonne volonté. Les autres dispositions comme les talents de l’esprit, les qualités de caractère, ne peuvent jamais être considérées comme bonnes en elles-mêmes, mais dépendent de l’usage que notre volonté en fait : il est en effet possible de faire usage de son talent, de son intelligence ou de son courage à des fins malveillantes. Ainsi, seule une volonté bonne saurait vraiment avoir une valeur pour elle-même : une volonté bonne, c’est une volonté qui entraîne une action accomplie simplement par devoir.
3.1. L'action par devoir et l'action conforme au devoir
François Boucher, la Marchande de mode
Pourquoi le marchand qui pratique les mêmes prix pour tous ses clients se refuse-t-il à la malhonnêteté ? Si on examine les mobiles de son action, on n’y trouvera certainement pas de sentiment humanitaire. Est-il alors inspiré par un respect pour la loi morale qui prescrit l’honnêteté ? Malheureusement, il semble plutôt que c’est par un calcul d’intérêt qu’il procède ainsi : une réputation de voleur lui ferait perdre sa clientèle.
Ce cas particulier, présenté par Kant dans les Fondements de la métaphysique des mœurs, montre que le marchand n’agit pas par devoir mais seulement conformément au devoir. Un acte simplement conforme au devoir, en tant qu’il n’obéit à aucune loi universelle de la raison, ne peut être considéré comme bon.
3.2. L’impératif catégorique
Le véritable devoir est à la fois distinct de tout mobile sensible et indépendant de tout contexte ou conditions particuliers. Il se présente sous la forme de ce que Kant appelle l’impératif catégorique, qui s’oppose à l’impératif hypothétique.
L’impératif hypothétique est conditionnel.
Il subordonne l’impératif à une fin et n’a de valeur que si on cherche à atteindre cette fin. Il prend donc la forme d’une règle de prudence : « si tu veux être en bonne santé, ne commets pas d’excès » ; « si tu ne veux pas les perdre, alors sois honnête avec tes clients ».
L’impératif catégorique est un impératif moral.
Philippe de Champaigne, Moïse et les Tables de la Loi
Il est inconditionnel, au sens où il n’est subordonné à aucune fin. Il a une valeur en soi et commande absolument, toujours et partout. L’impératif catégorique prend donc la forme de la loi morale qui s’énonce comme suit : « Agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse toujours valoir en même temps comme principe d’une législation universelle » (Critique de la raison pratique) ou encore « Agis uniquement d’après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu’elle devienne une loi universelle » (Fondements de la métaphysique des mœurs.)
Ainsi, pour Kant, agir par devoir, c’est avoir l’intention désintéressée de bien faire, avec pour seul motif le respect de la loi morale.
3.3. L’autonomie et l’hétéronomie de la volonté
Lorsqu'elle obéit à des mobiles sensibles extérieurs à la raison, l’action ne peut être véritablement considérée comme morale. Il faut donc que la volonté soit autonome.
L’autonomie peut se définir chez Kant comme absence de contrainte extérieure (il s’agit de la définition négative de la liberté), mais aussi et surtout comme la législation propre de la raison pure pratique. Comme l'indique l’étymologie même du mot (auto – soi-même ; nomos – la loi, la règle), l’autonomie désigne alors la capacité d’être soi-même l’auteur de sa propre loi.
Par exemple « traiter l’humanité en ma personne et en la personne de tout autre toujours en même temps comme une fin et jamais comme un moyen » est une maxime rationnelle exigible universellement (quel que soit mon sentiment sur l’humanité). Parce qu’elle se soumet librement à la loi de la raison pure pratique, la volonté qui détermine son action à partir de cette maxime est autonome.
Au contraire, lorsqu’elle découle d’une inclination ou d’un sentiment, la volonté n’obéit à aucune loi rationnelle. En effet, par nature, l’affect s’impose au sujet : si ce dernier agit sous l’effet d’une émotion (par colère, amour ou désir charnel), sa volonté ne pourra jamais être considérée comme autonome, car elle est alors sous le joug de la passion. Parce qu’elle obéit à des mobiles sensibles extérieurs à la raison, on dira de cette volonté qu’elle est hétéronome.
Par exemple, si j’agis par amour de l’humanité, je n’agis pas par devoir, mais pour un sentiment. Or une action dont la maxime repose sur un sentiment ne peut ni prétendre à l’universalité, ni servir de loi à un être raisonnable.
En somme, le propre d’une volonté hétéronome est d’agir en suivant ses inclinations ou ses intérêts, « car ce n’est pas alors la volonté qui se donne à elle-même la loi, c’est l’objet qui la lui donne par son rapport à elle. » (Fondements de la métaphysique des mœurs, deuxième section).
3.4. Un cas pratique : le droit de mentir
Le thème du devoir est mis en scène lors d’une fameuse polémique opposant Kant à Benjamin Constant, sur le problème du mensonge. Pour ce dernier (Des réactions politiques, 1797), il est certes du devoir du chacun de dire la vérité, mais ce devoir ne saurait être pris en un sens absolu : il peut être de mon devoir de cacher chez moi une personne victime d’injustice ; si on m’interroge, je sauverai une vie en niant avoir caché quiconque.
L’argument de Constant consiste à nier l’universalité du devoir de vérité : le mensonge peut avoir une valeur morale dans certains cas. Son raisonnement est le suivant : pris en un sens strict, l’interdiction de mentir rendrait la vie en société impossible. Le devoir n’existe que là où il y a un droit réciproque. Lorsqu’il n’y a pas le droit à la vérité, il n’y a pas non plus de devoir de vérité. Ainsi, je ne dois la vérité qu’à celui qui la mérite, qui en est digne, qui me respecte et ne me nuit pas.
Pour Kant (D’un prétendu droit de mentir par humanité, 1797), un tel arrangement du devoir est inadmissible ; il est pour lui impossible de mentir « par devoir ». Il va contredire tour à tour chacun des arguments de Benjamin Constant :
1) Par définition, un devoir est un impératif catégorique absolu : il vaut pour tous les cas sans exception, en vertu de la loi morale qu’énonce la raison. Faire son devoir en l’adaptant aux circonstances, en l’atténuant, cela n’a aucun sens. Ainsi, loin d’empêcher la vie sociale, le devoir, appliqué rigoureusement, la rend possible.
2) Il n’y a pas de réciprocité systématique entre le droit et le devoir.
3) Si la vérité fait l’objet d’un devoir, alors elle est due à tous sans exception. Il est impossible de diviser l’humanité entre ceux qui seraient dignes de la vérité et ceux qui en seraient indignes.
Cette controverse montre à quel point il est difficile de concilier le devoir le plus strict à la diversité des circonstances dans lesquelles se déploie l’action.
4. Kant et l’histoire
Dans son Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique (1784), Kant part d’un double constat :
– contrairement aux bêtes, les hommes n’agissent pas uniquement en suivant leurs instincts ;
– mais ils n’agissent pas non plus comme des citoyens absolument raisonnables.
Puisqu’il lui est impossible de supposer chaque homme animé d’un dessein rationnel, le philosophe n’a d’autre choix que de chercher dans les conduites absurdes des hommes un dessein de la nature.
4.1. Le dessein de la nature
Kant est convaincu que l’homme ne peut se réaliser pleinement que dans la société. « Se réaliser », c’est atteindre le développement complet de toutes ses dispositions. Pour cette raison, la nature a, dans toute sa sagesse, mis au monde un homme nu pour le forcer à s’élever par lui-même – par le travail et la culture ; cette élévation doit se faire au cours de l’histoire.
L’histoire est donc le terreau de la civilisation humaine : conçue comme progrès, elle est l’éducatrice de l’humanité, laquelle s’améliore sans cesse en vue de la liberté partagée. En un sens, on pourrait donc penser qu’il y a une finalité de l’histoire pour Kant : le devenir de l’humanité s’oriente vers le règne de la paix universelle et du cosmopolitisme.
4.2. Le cosmopolitisme
En philosophie, le cosmopolitisme désigne la doctrine suivant laquelle tout homme doit être avant tout considéré comme représentant du genre humain dans son ensemble. Kant n’ira pas jusqu’à promouvoir un monde indifférencié dans lequel les diverses cultures seraient diluées. En effet, le Projet de paix perpétuelle de Kant (1795) ne préconise pas d’abolition des frontières, mais une libre association des nations pour le bien de l’humanité. Seul l’établissement d’une société des nations soumise à une législation internationale, permettra à l’homme d’accéder à la paix et à l’ordre juridique et de surmonter sa sauvagerie originelle.
5. L’œuvre d’art et le beau, l'esthétique kantienne
Même si cela fait l’objet de nombreuses discussions et controverses, il est d’usage d’affirmer que l’art vise à créer de la beauté. Le beau est en ce sens la seule fin de toute œuvre d’art, ce qui permet de l’affranchir de toute dimension d’utilité. La beauté offre une impression de complétude, de totalité ; et l’artiste capable de susciter de tels sentiments a du génie.
5.1. Le génie
« Le génie est la disposition innée de l’esprit par laquelle la nature donne ses règles à l’art » (Critique du jugement ou Critique de la faculté de juger). Pour Kant, le génie est plus que le simple talent : il crée des formes susceptibles d’être imitées, sans se référer par principe à quelque chose d’existant. Une œuvre d’art correspondant à un modèle cherche toujours à appliquer laborieusement des règles prédéfinies. Un tel travail pourra certes susciter un agrément, mais rien de plus. L’art du génie, lui, consiste non seulement à actualiser sa créativité, mais surtout à procurer le sentiment esthétique.
5.2. Le sentiment esthétique
Du grec aisthesis, « sensation » ou « sentiment », le terme « esthétique » est couramment associé à l’étude du beau. En 1750, dans son ouvrage Aesthetica l’auteur Baumgarten inaugure une telle doctrine de la formation du goût et de l’appréciation de l’œuvre d’art.
Dans la Critique de la raison pure, Kant avait déjà utilisé la notion d’« esthétique transcendantale » pour traiter des conditions a priori de la sensibilité (cf. paragraphe 1.5.), mais il n’était pas encore question du jugement de goût et du beau. C’est dans la Critique de la faculté de juger, troisième grand volet de sa philosophie transcendantale, que Kant va se consacrer à l’étude du jugement d’appréciation de la beauté.
L’antinomie du jugement de goût
On peut dire qu’une chose est « belle » lorsque la perception de celle-ci est accompagnée d’un certain plaisir. Mais, comme on l’a vu, le beau ne se réduit pas au simple agrément. Lorsqu’on dit « ceci est beau », on ne dit pas « cela me plaît », mais on prétend à une certaine objectivité, voire à un potentiel accord unanime sur ce sujet. En ce sens, le jugement de goût est un jugement dit « universel ».
Cependant, comme ce jugement s’appuie avant tout sur un sentiment, il ne peut contenir la même universalité et la même nécessité qu’une démonstration logique. Il faut donc concilier ces deux propositions contradictoires :
1) Soit le jugement de goût ne se fonde pas sur des concepts ; car autrement on pourrait disputer de la question (décider par des preuves).
2) Soit le jugement de goût se fonde sur des concepts, car sinon on ne pourrait même pas, en dépit des différences qu'il présente, en discuter (prétendre à l'assentiment nécessaire d'autrui à ce jugement).
Jugement déterminant et jugement réfléchissant
Tout jugement est une proposition affirmative ou négative reliant un sujet « S » à un prédicat « P ». Il est toujours de la forme « S est P ». On peut distinguer deux sortes de jugements :
– le jugement déterminant : dans ce cas, l’universel est connu, on y « subsume » le particulier (un phénomène particulier), – on voit de quelle catégorie de l'entendement il relève. Par exemple, un météorologue exerce un jugement déterminant quand il reconnaît dans un nuage un cumulo-nimbus ou un cirrus.
– le jugement réfléchissant : ici, seul le particulier est donné. Ce jugement prend pour point de départ l’expérience, ainsi lorsqu’on dit d’un nuage qu’il est beau ou menaçant.
La solution de l’antinomie
Il y a donc deux types de jugements : un jugement qui détermine une expérience par un concept, et un jugement qui relie une expérience à un sentiment.
Ainsi on ne saurait dire que le jugement de goût s’appuie sur des concepts déterminés (auquel cas, il ferait place à la dispute et au raisonnement logique). En revanche, il s’appuie bien sur un concept indéterminé associé à un sentiment. Kant rend ainsi possible le partage d’un jugement de goût porté sur une œuvre d’art.
5.3. Une définition du beau
Pour souligner la spécificité du jugement esthétique, Kant définit le beau comme « ce qui plaît universellement sans concept ».
Ce sentiment est le critère du beau dans l’esthétique kantienne ; la contemplation désintéressée du beau naturel ou du beau artistique procure une satisfaction qui ne peut être réduite au simple agrément. Le beau demande certes l’assentiment d’autrui (« ce qui plaît universellement »), mais un tel accord ne saurait en aucun cas se faire par une démonstration logique. Le jugement de goût tend donc à l’universalité, sans qu’aucun concept puisse être en mesure de prouver cette universalité.
5.4. Autres définitions du beau
• Selon le point de vue de la qualité : « Le goût est la faculté de juger d'un objet ou d'un mode de représentation sans aucun intérêt, par une satisfaction ou une insatisfaction. On appelle beau l'objet d'une telle satisfaction » (Critique de la faculté de juger).
• Selon le point de vue de la relation : « La beauté est la forme de la finalité d'un objet, en tant qu'elle est perçue en celui-ci sans représentation d'une fin » (ibid.).
• Selon le point de vue de la modalité : « Est beau ce qui est reconnu sans concept comme objet d'une satisfaction nécessaire » (id.).
6. L'apport de Kant
Kant transforme le sens de la démarche philosophique en imposant une méthode nouvelle à la fois dans la théorie de la connaissance et dans l'ensemble des questions philosophiques, morales, esthétiques et anthropologiques. En recherchant les conditions a priori (qui précèdent l'expérience) qui déterminent les jugements théoriques, pratiques aussi bien qu'esthétiques, il dégage la raison humaine du rationalisme dogmatique, pour lui ouvrir, par l'idéalisme transcendantal, de nouvelles voies.
6.1. L'influence de Kant
Kant marquera avant tout le xixe siècle : les philosophies comme celles de Nietzsche, de Hegel se présenteront, en partie, comme critique de la philosophie transcendantale. Mais il aura aussi une influence très importante sur l’histoire de la philosophie contemporaine : beaucoup de philosophes s’opposeront à lui, notamment dans le champ de la philosophie analytique et de la phénoménologie. Parmi eux, on compte Wittgenstein, Quine et Husserl, qui remettront en question le bien-fondé de la philosophie transcendantale plutôt que de la prolonger.
6.2. Petit glossaire kantien
Antinomie
signe d'un conflit de la raison avec elle-même qui, dans son exercice, excède les limites de l'expérience et à propos duquel elle (la raison) avance deux solutions contradictoires, à l'occasion d'un problème dont elle est seule responsable, sans pouvoir choisir au profit de l'une ou de l'autre.
Catégories
concepts a priori de l'entendement, qui assurent l'unité synthétique du divers qui se trouve dans l'intuition.
Connaissance a posteriori
connaissance qui a sa source dans l'expérience. Elle prend la forme d’une proposition synthétique du type : « Cette rose est rouge ». Le prédicat (rouge) est extérieur au sujet (la rose).
Connaissance a priori
connaissance indépendante de l'expérience et même de toute impression sensible. Elle prend la forme d’une proposition analytique du type : « Le triangle est une figure qui possède trois angles » . Le prédicat (trois angles) est contenu dans le sujet (triangle)
Criticisme
« Je n'entends point par là une critique des livres et des systèmes, mais celle du pouvoir de la raison en général, par rapport à toutes les connaissances auxquelles elle peut aspirer indépendamment de toute expérience, par conséquent la solution de la question de la possibilité ou de l'impossibilité d'une métaphysique en général et la détermination aussi bien de ses sources que de son étendue et de ses limites, tout cela suivant des principes » (Critique de la raison pure).
Critique de la faculté de juger
activité de la raison qui s'efforce de déterminer si la faculté de juger (terme intermédiaire dans l'ordre de nos facultés de connaissance entre l'entendement et la raison), possède ou non, considérée en elle-même, des principes a priori.
Critique de la raison pratique
activité de la raison qui analyse les conditions a priori de la détermination de la volonté.
Critique de la raison pure
activité de la raison qui s'attache à rassembler dans toute leur étendue les principes de la synthèse a priori et, surtout, à fixer des limites aux prétentions de la raison dans son usage théorique.
Entendement
faculté discursive permettant d'ordonner, de regrouper sous des concepts la multiplicité des intuitions sensibles. L’entendement est structuré par des concepts purs, dits catégories.
Expérience
« Que toute notre connaissance commence avec l'expérience, cela ne soulève aucun doute. En effet, par quoi notre pouvoir de connaître pourrait-il être éveillé et mis en action si ce n'est par des objets qui frappent nos sens […] ? » (Critique de la raison pure).
Si, chronologiquement, aucune connaissance ne précède en nous l'expérience, cela ne signifie pas que toute connaissance dérive de l'expérience.
Formes a priori de la sensibilité
cadres purs de l'intuition sensible repérés dans l'espace et le temps.
À l'aide du sens externe, nous nous représentons les objets hors de nous et tous situés dans l'espace.
Au moyen du sens interne, nous saisissons des objets dans l'ordre de la simultanéité ou de la succession dans le temps.
Idée
fruit de l'activité de la raison, qui perd le caractère absolu que lui prêtait la philosophie dogmatique, qui se confond avec l'idéal et qui bénéficie d'un rôle régulateur des connaissances.
Impératif catégorique
principe qui ne fait que déterminer la volonté, qu'elle soit suffisante ou non pour l'effet. L'impératif catégorique peut seul prétendre au titre de loi pratique ; il lie la volonté à la loi.
Impératif hypothétique
précepte d'efficacité, de savoir-faire, un impératif de l'habileté dans lequel la volonté des moyens dépend de la volonté de la fin.
Intuition
mode par lequel la connaissance se rapporte immédiatement aux objets.
Jugement analytique
relation dans laquelle le prédicat appartient au sujet comme quelque chose qui y est contenu implicitement. Kant donne comme exemple : « Tous les corps sont étendus » et affirme qu'un tel jugement est explicatif et n'accroît nullement notre connaissance.
Jugement synthétique
relation dans laquelle le prédicat, extérieur au sujet, augmente notre connaissance du sujet. Il opère une synthèse du sujet et du prédicat.
Loi morale
principe objectif, dont la condition est reconnue comme valable pour la volonté de tout être raisonnable.
Maxime
principe subjectif, dont la condition est considérée par le sujet comme valable seulement pour sa volonté.
Noumène
ce qui ne peut être que pensé ; ce que la pensée suppose être en soi, par-delà ce qui apparaît (synonyme : chose en soi) ; envers du phénomène.
Phénomène
ensemble des objets qui relèvent de l'intuition sensible, dans l'espace et le temps. Le phénomène est ce qui apparaît ; aussi n'est-il qu'une représentation.
Principes pratiques
propositions renfermant une détermination générale de la volonté, à laquelle sont subordonnées plusieurs règles pratiques.
Pur
sans aucun élément empirique.
Schème
produit de l'imagination qui rend possible l'application des concepts purs de l'entendement aux intuitions sensibles.
Subsumer
aller de l'intuition sensible particulière au schème.
Sensibilité
capacité de recevoir des représentations dans la mesure où nous sommes affectés par les objets extérieurs.
Transcendantal
Se dit de ce qui se rapporte aux conditions a priori de la connaissance, c'est-à-dire hors de toute détermination empirique.
La philosophie transcendantale pose la question suivante : à quelle condition la sensibilité est-elle possible ? à quelle condition la connaissance est-elle possible ?
Ainsi, l’espace et le temps sont des conditions de possibilité de la sensibilité, les catégories de l’entendement.
Volonté
« pouvoir ou de produire des objets correspondant aux représentations ou de se déterminer soi-même à réaliser ces objets (que le pouvoir physique soit suffisant ou non), c'est-à-dire de déterminer sa causalité » (Critique de la raison pratique).
Volonté pathologique
volonté soumise aux besoins et aux désirs : le principe qui la détermine lui est extérieur. Elle est hétéronome.
Volonté pure
volonté déterminée par la simple forme de la loi de la raison ; elle manifeste son autonomie.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ] - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
