|
| |
|
|
 |
|
Une protéine anti-oxydante pour lutter contre les altérations du microbiote intestinal et contrôler lâinflammation |
|
|
| |
|
| |
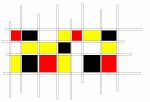
Une protéine anti-oxydante pour lutter contre les altérations du microbiote intestinal et contrôler l’inflammation
06 DÉC 2017 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE) | CANCER
©AdobeStock
Des équipes de l’hôpital Paul-Brousse AP-HP, de l’Inserm et de l’Université Paris-Sud viennent de mettre en évidence un mécanisme de modulation du microbiote intestinal impliquant une molécule aux pouvoirs antioxydant et anti-inflammatoire appelée REG3A. Celle-ci protégerait la barrière intestinale et les bactéries les plus sensibles à l’oxygène formant le microbiote améliorant ainsi la survie et la croissance de « bonnes » bactéries. La transplantation de microbiote fécal dans des souris modèles de colite sévère ou l’administration d’une protéine recombinante REG3A à des souris sauvages révèle une franche diminution de leur susceptibilité à la maladie. Ces résultats sont publiés dans la revue Gastroenterology et constituent une nouvelle approche de manipulation du microbiote intestinal à but thérapeutique, de restauration de la symbiose hôte-microbiote et d’atténuation de l’inflammation intestinale.
Un des facteurs clés de déséquilibres dans la composition du microbiote ou « dysbiose » est le stress oxydatif intestinal. Combiné aux réponses immunitaires, il est capable d’amplifier la production de radicaux libres, l’activation de cellules inflammatoires (macrophages), les déséquilibres de composition du microbiote en faveur de bactéries aérotolérantes et les lésions de la barrière intestinale.
Le Dr Jamila Faivre du service d’Onco-Hématologie de l’hôpital Paul-Brousse, AP-HP et son équipe de l’unité 1193 « Physiopathogenèse et Traitement des Maladies du Foie » du Centre Hépatobiliaire (Inserm/Université Paris-Sud) étudient le stress oxydatif comme cible thérapeutique pour prévenir ou traiter les maladies et/ou les désordres liés à une dysbiose.
Dans cette étude, les chercheurs montrent qu’une protéine recombinante humaine appelée REG3A est capable de modifier le microbiote intestinal en diminuant les niveaux de radicaux libres. Ce mécanisme de régulation est basé sur l’activité anti-oxydante de cette molécule.
REG3A protège les bactéries commensales intestinales du stress oxydatif en piégeant les radicaux libres et en améliorant la survie et la croissance des « bonnes » bactéries de l’intestin connues pour être très sensibles à l’oxygène.
En accord avec les données obtenues dans des cultures bactériennes in vitro, la molécule délivrée dans la lumière digestive de souris transgéniques modifie la composition du microbiote intestinal avec surreprésentation de symbionts Gram positif tels que les Clostridiales et améliore la fonction barrière et la résistance des souris dans deux modèles de colite expérimentale sévère.
En allant plus loin, les chercheurs ont observé que la transplantation de microbiote fécal provenant de souris transgéniques qui expriment fortement REG3A protège les souris sauvages conventionnelles ainsi que des souris germ-free colonisées de la colite sévère induite. De plus, l’administration intrarectale de protéine recombinante humaine REG3A à des souris sauvages diminue significativement leur susceptibilité à la colite induite.
Ces résultats suggèrent qu’une thérapie biologique basée sur l’administration de protéine recombinante REG3A est une approche originale de (re)modelage du microbiote intestinal, d’atténuation de l’inflammation intestinale voire de prévention du cancer colorectal.
Par rapport aux stratégies actuelles l’originalité de cette approche est double : utiliser une protéine humaine produite de manière endogène dans l’intestin et renforcer la proportion de bactéries intestinales à potentialité anti-inflammatoire en augmentant la concentration intra-luminale de REG3A pour préserver la symbiose hôte-microbiote et ainsi mieux combattre l’inflammation intestinale, voire extra-intestinale.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Un manque dâhormones placentaires pourrait jouer un rôle dans lâapparition de déficits neurodéveloppementaux |
|
|
| |
|
| |
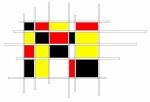
Un manque d’hormones placentaires pourrait jouer un rôle dans l’apparition de déficits neurodéveloppementaux
06 SEP 2021 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE) | GÉNÉTIQUE, GÉNOMIQUE ET BIO-INFORMATIQUE
Image de coupe sagittale de cervelet de souris acquise en microscopie électronique montrant la substance blanche avec ses axones myélinisés et la substance grise avec la couche des grains. Claire-Marie Vacher (Columbia University Medical Center)/Cheryl Clarkson-Paredes and Anastas Popratiloff (The George Washington Nanofabrication & Imaging Center).
Plusieurs études ont montré que la prématurité augmentait le risque d’apparition de désordres neurodéveloppementaux tels que les troubles du spectre autistique (TSA). Plus la naissance est prématurée, plus le risque d’apparition de déficits moteurs ou cognitifs est élevé. Comment expliquer cela ? Des chercheurs de l’Université de Columbia à New York et du Children’s National Hospital de Washington, D.C., en collaboration avec l’Inserm et l’Université Paris-Saclay, se sont penchés sur cette question et ont fait l’hypothèse que la perte prématurée du placenta pourrait jouer un rôle dans les déficits observés. Grâce au développement d’un nouveau modèle préclinique chez la souris, ils ont montré que la diminution significative d’une hormone placentaire, dont le cerveau en développement devrait normalement bénéficier dans la seconde moitié de la gestation, pourrait favoriser le risque d’apparition de troubles comportementaux qui pourraient s’apparenter aux troubles du spectre de l’autisme. Ces effets sont principalement observés chez les mâles. L’étude fait l’objet d’une publication dans la revue Nature Neuroscience.
Le placenta est un organe qui permet l’alimentation du fœtus en oxygène et nutriments et élimine les déchets. Il produit également des hormones, notamment des taux élevés d’alloprégnanolone ou ALLO (une hormone dérivée de la progestérone) à la fin de la grossesse. Environ un nouveau-né sur 10 naît prématurément et de fait est privé de taux normaux de cette hormone.
Des chercheurs américains à l’Université de Colombia, en collaboration avec les équipes françaises de l’Inserm au sein de l’unité Maladies et Hormones du Système Nerveux (U 1195 Inserm) se sont intéressés au rôle du placenta dans le développement cérébral pour tenter notamment d’expliquer le lien entre prématurité et risque élevé d’apparition de déficits moteurs ou cognitifs. Dans le cadre de cette étude, les chercheurs ont créé un modèle de souris dans lequel ils ont été en mesure de réduire de manière sélective la production placentaire d’ALLO au cours de la gestation, afin que les souriceaux soient exposés à des taux placentaires d’ALLO insuffisants.
L’équipe de chercheurs a ainsi découvert que la diminution de la concentration de cette hormone dans le placenta altérait le développement du cerveau sur le long terme, entraînant l’apparition de comportements de type autistique chez les descendants mâles.
En effet, bien que les fœtus mâles et femelles aient été, les uns comme les autres, soumis à une insuffisance d’ALLO, seuls les souriceaux mâles ont présenté des comportements de type autistique après la naissance, notamment des difficultés d’interaction avec les autres animaux et des stéréotypes moteurs. Les chercheurs ont ensuite analysé leur développement cérébral et suivi les conséquences de cette insuffisance sur leur comportement jusqu’à l’âge adulte.
Les souris mâles ayant reçu des taux placentaires d’ALLO insuffisants présentaient des modifications structurelles du cervelet, une région du cerveau impliquée dans la coordination des mouvements et qui a également été liée à l’autisme.
« En particulier, nous avons observé un épaississement de la gaine de myéline, le revêtement qui protège les fibres nerveuses et accélère la propagation de l’influx nerveux », a indiqué Claire-Marie Vacher, PhD, professeure associée en néonatalogie dans le département de Pédiatrie du Vagelos College of Physicians and Surgeons de l’Université de Columbia et première auteure de l’article. « On sait que des changements comparables ont été observés de manière transitoire dans le cervelet de certains enfants de sexe masculin souffrant d’autisme. »
« Chez l’animal, l’établissement d’un lien entre une modification de la fonction placentaire au cours de la gestation et des effets persistants sur le développement ultérieur du cerveau est un résultat particulièrement frappant », indique Anna Penn, MD, PhD, cheffe du service de néonatologie à l’Université de Colombia et dernière auteure de l’étude.
Des similarités avec les tissus humains
Afin de déterminer si des modifications similaires peuvent survenir chez les nourrissons, les chercheurs ont également procédé à des examens post-mortem de tissus cérébelleux de prématurés et de nourrissons arrivés à terme, décédés peu de temps après la naissance. Leur analyse a permis de mettre en évidence des modifications similaires au niveau de la gaine de myeline spécifiquement pour les nourrissons masculins lorsque le cervelet de prématurés était comparé au cervelet de nourrissons nés à terme. Cette étude est une première étape importante pour comprendre comment les hormones placentaires peuvent contribuer au développement cérébral et comportemental chez l’homme.
L’injection de l’ALLO réduit les symptômes autistiques
L’étude a également permis de mettre en évidence que les changements affectant la structure du cervelet et les comportements chez les souris pouvaient être évités par l’injection d’ALLO à la fin de la gestation.
Les chercheurs ont constaté qu’une injection d’ALLO chez la mère au cours de la gestation pouvait prevenir les comportements de type autistique dans leur modèle préclinique. Des résultats similaires ont été observés après une injection de muscimol, un composé qui active les récepteurs GABA-A — les mêmes récepteurs qui réagissent à l’ALLO. Avec ces traitements, les chercheurs ont également constaté une normalisation des niveaux de protéines de la myéline dans le cervelet.
« Notre étude offre de nouvelles perspectives intéressantes sur l’implication de la perte d’hormones placentaires—qui se produit en cas de naissance prématurée ou si le placenta ne fonctionne pas correctement au cours de la grossesse—sur le risque de désordres neurodéveloppementaux et comportementaux chez l’enfant», indique l’auteure principale, Claire-Marie Vacher.
« On pourrait désormais également envisager des études rétrospectives en réalisant un suivi longitudinal pour corréler des défauts endocriniens pendant la grossesse avec des troubles cognitifs et/ou comportementaux des enfants. Cela permettrait d’identifier le stade de la grossesse où l’insuffisance hormonale intervient afin d’envisager une éventuelle intervention thérapeutique », ajoute Philippe Liere, PhD, ingénieur de recherche et responsable du plateau technique analytique de spectrométrie de masse de l’U1195.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Une thérapie génique à lâétude contre la maladie de Steinert |
|
|
| |
|
| |
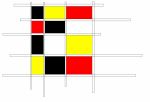
Une thérapie génique à l’étude contre la maladie de Steinert
COMMUNIQUÉ | 10 FÉVR. 2022 - 17H00 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
BASES MOLÉCULAIRES ET STRUCTURALES DU VIVANT | GÉNÉTIQUE, GÉNOMIQUE ET BIO-INFORMATIQUE
La maladie de Steinert est due à une répétition anormale d’une petite séquence d’ADN au niveau du gène DMPK. © Unsplash
La dystrophie myotonique de type 1 (DM1) ou maladie de Steinert est une maladie neuromusculaire génétique rare et invalidante, qui touche de nombreux organes et dont l’issue est fatale. Aucun traitement n’est disponible à ce jour pour les malades. Forts de précédentes recherches sur les causes moléculaires de la maladie, des chercheurs et chercheuses de l’Inserm, du CNRS, de Sorbonne Université, du CHU Lille et de l’Université de Lille, en partenariat avec l’Institut de myologie, au sein du Centre de recherche en myologie et du centre Lille neuroscience & cognition, ont développé et testé une thérapie génique prometteuse qui agit directement sur l’origine de la maladie. Les premiers résultats publiés dans Nature Biomedical Engineering montrent, chez la souris, une correction des altérations moléculaires et physiologiques du muscle squelettique[1].
La dystrophie myotonique de type 1 (DM1) ou maladie de Steinert est une maladie neuromusculaire génétique et héréditaire rare qui touche environ 1 personne sur 8 000. Invalidante et mortelle, cette affection est dite « multisystémique » car, elle touche à la fois les muscles (affaiblissement et atrophie des muscles appelés « dystrophie », défaut de relaxation musculaire appelé « myotonie »), mais aussi d’autres organes (appareil cardiorespiratoire, système digestif, système nerveux…). Elle s’exprime et évolue très différemment d’un malade à l’autre et n’a pour l’heure pas de traitement.
Elle est due à une répétition anormale d’une petite séquence d’ADN (triplet CTG[2]) au niveau du gène DMPK (Dystrophie Myotonine Protéine Kinase) situé sur le chromosome 19. Chez un individu sain, cette séquence est présente mais répétée 5 à 37 fois. En revanche, chez les patients atteints de DM1, on observe une mutation qui se traduit par une augmentation du nombre de triplets, pouvant atteindre plusieurs milliers de répétitions.
À propos des mécanismes permettant l’expression des gènes
Pour conduire à la production d’une protéine, un gène (localisé dans le noyau de la cellule) est d’abord transcrit en une molécule d’ARN. Pour devenir un ARN messager (ARNm), il va subir une maturation, passant notamment par un épissage : schématiquement, la molécule est coupée en morceaux dont certains sont éliminés et d’autres joints. Grâce à ce processus finement régulé, un seul gène peut conduire à la synthèse de différents ARNm, et donc de différentes protéines. Après l’épissage, l’ARNm mature sera finalement traduit en protéine, à l’extérieur du noyau cellulaire.
Dans la maladie de Steinert, le gène muté est transcrit mais les ARNm mutants sont retenus dans le noyau des cellules sous forme d’agrégats caractéristiques. En effet, dans les cellules des personnes atteintes de DM1, les protéines MBNL1 qui se lient normalement à certains ARN pour réguler leur épissage et leur maturation, sont « capturées » par les ARN porteurs de la mutation.
Ainsi séquestrées dans les agrégats, il leur est impossible d’exercer leurs fonctions, ce qui entraîne la production de protéines non, ou moins, fonctionnelles, dont certaines ont été associées à des symptômes cliniques.
L’équipe dirigée par Denis Furling, directeur de recherche CNRS, au sein du Centre de recherche en myologie (Inserm/Sorbonne université/Institut de myologie), en association avec celle de Nicolas Sergeant, directeur de recherche Inserm du centre Lille neuroscience & cognition (Inserm/Université de Lille/CHU Lille), s’est intéressée à une stratégie thérapeutique visant à restaurer l’activité initiale de MBNL1 dans les cellules musculaires squelettiques exprimant la mutation responsable de la maladie de Steinert.
Pour cela, les scientifiques ont conçu par ingénierie des protéines modifiées présentant, comme la protéine MBNL1, des caractéristiques de liaison aux ARN porteurs de la mutation et agissant par conséquent comme un leurre pour ces ARN.
Ils ont observé en exprimant ces protéines leurres in vitro dans des cellules musculaires issues de patients atteint de DM1, qu’elles étaient capturées par les ARN mutés en lieu et place des protéines MBNL1. Ces dernières, étaient alors libérées des agrégats d’ARN mutés et retrouvaient leur fonction normale. Ainsi, les erreurs d’épissage présentes initialement dans ces cellules disparaissaient. Enfin, l’ARN muté lié aux protéines leurres s’avérait moins stable et pouvait être plus facilement et efficacement éliminé par la cellule.
Agrégats d’ARN-DMPK mutant contenant des répétitions pathologiques de triplets (rouge) visualisées par FISH/IF dans les noyaux (bleu) de cellules musculaires (vert) isolées de patients atteint de Dystrophie Myotonique de type 1. ©Denis Furling et Nicolas Sergeant
L’équipe de recherche a ensuite transposé cette technique dans un modèle animal afin de vérifier la validité de cette approche in vivo. À l’aide des vecteurs viraux utilisés en thérapie génique, les protéine leurres ont été exprimées dans le muscle squelettique de souris modèles de la maladie de Steinert. Chez ces dernières, une seule injection a permis de corriger efficacement, sur une longue durée et avec peu d’effets secondaires, les atteintes musculaires associées à la maladie, en particulier les erreurs d’épissage, la myopathie et la myotonie.
« Nos résultats soulignent l’efficacité contre les symptômes de la maladie de Steinert, d’une thérapie génique fondée sur la production par bio-ingénierie de protéines leurres de liaison à l’ARN possédant une forte affinité pour les répétitions pathologiques présentes dans l’ARN muté, afin de libérer les protéines MBNL1 et de retrouver leurs fonctions régulatrices », déclare Denis Furling. Cependant les auteurs pointent que des études additionnelles sont nécessaires avant de pouvoir transposer cette thérapie en étude clinique.
« Ces travaux ouvrent la voie au développement de solutions thérapeutiques dans le cadre d’autres maladies dans lesquelles des répétitions pathologiques dans l’ARN entraînent une dysfonction de la régulation de l’épissage », conclut Nicolas Sergeant.
[1] Le muscle strié squelettique est le muscle qui est attaché au squelette par les tendons et qui, par sa capacité à se contracter, permet d’effectuer des mouvements précis dans une direction bien définie.
[2] La séquence de codage d’un gène est composée d’un enchaînement de différentes combinaisons de 4 acides nucléiques : adénine, guanine, cytosine et thymine (remplacé par uracile dans l’ARN). Ceux-ci sont organisés en triplets (ou codons), dont la bonne « lecture » par la machinerie cellulaire permet l’expression d’une protéine.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Les effets de la réduction du mouvement sur les cellules souches du cerveau |
|
|
| |
|
| |

CERVEAU ET PSY
Les effets de la réduction du mouvement sur les cellules souches du cerveau
Par Camilla de Fazio le 29.05.2018 à 20h00
Lecture 3 min.
Limiter le mouvement des souris a un impact sur la neurogènes, la production des cellules neuronales dans le cerveau. C'est la découverte d'une équipe italienne qui met en lumière le lien entre l'activité physique et le métabolisme et la prolifération des cellules souche neurales
ANNA ENGLER / WIKIMEDIA COMMONS
L'inactivité physique est nuisible pour le cerveau. C'est ce que montre une étude conduite par l'équipe du Dr. Bottai, à Milan, et dont les résultats sont publiés dans la revue frontiers in Neuroscience. Cette étude a a été conduite sur des souris, dont les chercheurs ont surveillé le bon déroulement de la neurogénèse. C'est à dire la capacité du cerveau à produire de nouveaux neurones à partir de cellules immatures, les cellules souches neurales (CSN). Un phénomène connu depuis la fin des années 90, grâce aux études menées par Fred Gage et Peter Eriksson. Chez l'homme les CSN ne se trouvent que dans deux régions du cerveau : l'hippocampe et la zone sous-ventriculaire. Plusieurs études ont montré que l'activité physique augmente la neurogenèse et chez la souris induit une amélioration de l'apprentissage. À l'inverse, l'équipe du Dr Bottai s'est penchée sur les effet de l'inactivité physique prolongée sur ces cellules souches neurales.
Pour mener l'étude, les chercheurs ont suspendu les pattes postérieures des souris, en attachant leur queue à une corde. Les animaux ont été laissés libres de se déplacer dans la cage en utilisant seulement les pattes antérieures pendant 14 jours, une période comparable à des mois d'inactivité pour les humains. Les pattes postérieures n'étaient pas immobiles, mais suspendues, donc "elles ne bougeaient pas contre la gravité", a expliqué Daniele Bottai, directeur de l'étude, dans une interview à Sciences et Avenir. Une fois ce délai passé, l'équipe a ensuite analysé les cellules souches neurales des animaux. Résultat : dans le cerveau des animaux suspendus, et fournissant donc moins d'efforts pour se déplacer, la prolifération et la différenciation en neurones matures des cellules souches neurales était bien moindre.
Des travaux préliminaires
Leur étude montre également des changements dans le métabolisme - en termes de production d'énergie - ainsi que dans l'expression des gènes. En particulier, les chercheurs ont observé que les gènes impliqués dans la division cellulaire et le métabolisme étaient exprimés -c'est à dire traduits en protéines - de manière anormale. Un, Cdk5 était moins exprimé, un'autre, Cdk6, plus exprimé que chez les souris non suspendues.
Partant de ces résultats, il est possible supposer, selon Daniele Bottai, que l'activité physique implique en quelque sorte une stimulation des cellules souches neurales, avec une altération de l'expression génétique, en particulier des gènes impliqués dans la prolifération et le métabolisme. Ce travail préliminaire chez la souris ouvre des pistes de recherche chez l'humain des plus intéressantes. Par exemple en ce qui concerne les astronautes qui pâtissent d'atrophie musculaire lors de long séjours en impesanteur ou pour les patients atteints de maladies chroniques qui limitent les mouvements. Reste toutefois de nombreuses zones d'ombre à éclaircir. Par exemple, quelle est la nature du messager qui assure la communication entre les muscles et les cellules souches neurales. ou encore comment l'expression génétique peut influencer le métabolisme cellulaire.
DOCUMENT sciences et avenir.fr LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
