|
| |
|
|
 |
|
MÃSOPOTAMIE |
|
|
| |
|
| |
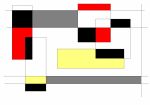
DOCUMENT larousse.fr LIEN
Mésopotamie : histoire
(littéralement « le pays entre les deux fleuves »)
Cet article fait partie du dossier consacré à la Mésopotamie.
Bassin alluvial d'Asie, en contrebas du Taurus et du Zagros, à l'est du désert syrien, où coulent les cours inférieurs du Tigre et de l'Euphrate (réunis en aval dans le Chatt al-Arab) et celui du Karun.
Vaste région de 375 000 km2, qui comprend toutes les terres basses des bassins de l'Euphrate et du Tigre, et correspond en gros aux pays actuels de l'Iraq et du nord-est de la république de Syrie, la Mésopotamie est le plus ancien et, du VIe au Ier millénaire avant J.-C., le plus important des foyers de la civilisation.
Employé pour la première fois, semble-t-il, par l'historien grec Polybe au iie siècle avant J.-C., le terme de Mésopotamie, loin de désigner la totalité du bassin, ne dénommait alors que le territoire compris entre l'Euphrate et le Tigre au nord de la Babylonie centrale ; ce n'est que très progressivement, et essentiellement à une époque très récente, qu'il a été employé pour désigner la totalité de la région.
HISTOIRE
1. AVANT L'HISTOIRE (JUSQUE VERS 3500 AVANT J.-C.)
1.1. DU PALÉOLITHIQUE AU MÉSOLITHIQUE (XIIe-IXe MILLÉNAIRE AVANT J.-C.)
Cet ensemble de plaines et de collines, limité à l'est et au nord par les montagnes de l'Iran occidental et de l'Anatolie orientale, au sud-ouest par le désert syro-arabe, au sud-est par le golfe Persique, connaît jusqu'à la fin de la dernière période glaciaire (il y a 12 000 ans) des climats et une végétation naturelle très différents de ceux de l'époque historique. Les hommes du paléolithique y ont sans doute vécu, mais, dans ce pays où les fleuves arrachent, puis déposent d'énormes masses de sédiments, il n'y a guère de chances que l'on retrouve un de leurs habitats minuscules.
Vers le IXe millénaire avant notre ère, le climat commence à se rapprocher des conditions actuelles, et les groupes du mésolithique (stade intermédiaire entre le paléolithique des chasseurs et le néolithique des agriculteurs) abordent la Mésopotamie à partir des hautes vallées du pourtour montagneux, qui sont fréquentées par les humains depuis 60 000 ans au moins et qui possèdent à l'état sauvage des animaux précieux (ovins, caprins, bovins, porcins) et des céréales (blé, orge).
1.2. NAISSANCE DE L’AGRICULTURE (VIIIe MILLÉNAIRE AVANT J.-C.)
EN HAUTE MÉSOPOTAMIE
Au VIIIe millénaire avant notre ère, le genre de vie agricole apparaît dans les vallées proches du pays des Deux Fleuves et sur le piémont, avant de s'étendre en haute Mésopotamie ; cette région, qui comprend le nord du pays des Deux Fleuves jusqu'au point où l'Euphrate et le Tigre se rapprochent pour la première fois en plaine, peut porter des cultures sèches dans la bande proche de la montagne ; au-delà, les pluies sont insuffisantes pour ce type de culture et les fleuves trop encaissés pour permettre l'irrigation en grand, et l'on doit s'y contenter de la vie pastorale. Au pied des montagnes, au contraire, des communautés ont bientôt l'idée d'utiliser les eaux de ruissellement, puis de creuser des canaux.
EN BASSE MÉSOPOTAMIE
Cette technique nouvelle trouve son plein emploi quand l'homme colonise la Susiane – pays plat aux nombreuses rivières, qui fait partie de l'Élam (sud-ouest de l'Iran) – et la basse Mésopotamie. Celle-ci est d'abord une plaine basse, puis, plus au sud-est, un delta intérieur, où les sédiments s'enfoncent lentement ; là, avant d'atteindre la mer, les fleuves abandonnent la majeure partie de leurs alluvions et de leurs eaux – ces dernières s'évaporant ou s'accumulant dans des lacs ou des marais. Les vents de sable ou de poussière, l'aridité et les inondations brutales font un enfer de ce pays, qui attira peut-être ses premiers habitants par la richesse de ses eaux en poissons et de sa forêt-galerie en fruits. On ne risque guère, là non plus, de retrouver les tout premiers habitats, et les archéologues n'y ont rencontré que de gros établissements agricoles.
1.3. LES PREMIÈRES SOCIÉTÉS (VIIe MILLÉNAIRE AVANT J.-C.)
LES CONTRAINTES DE L’IRRIGATION
En effet, l'irrigation pose ici des problèmes plus complexes qu'en Égypte : la crue des fleuves intervient au printemps ; il faut retenir alors les eaux et les redistribuer ensuite sur le reste de l'année pour que les cultures ne soient pas noyées au printemps, quand elles sortent de terre, ni brûlées par l'aridité de l'été et de l'automne.
Seule une communauté de fort effectif peut construire un système d'irrigation avec digues, bassins de retenue, canaux d'amenée et d'évacuation des eaux. Moyennant un énorme travail, l'argile fertile des alluvions donne des récoltes de dattes, d'orge, de blé et de sésame abondantes et relativement régulières, qui, à leur tour, contribuent à l'entretien d'un cheptel important. Malgré son étendue limitée (40 000 km2, dont plus de la moitié sont couverts par les eaux), le Bas Pays nourrit une population plus nombreuse qu'en haute Mésopotamie.
UNE NÉCESSAIRE ORGANISATION
L'absence de matières premières, en dehors de l'argile et du roseau, en basse Mésopotamie, contraint les agglomérations à développer leurs échanges de denrées alimentaires, de laine et de produits de l'artisanat contre le bois, les pierres dures ou rares et le cuivre, qui viennent des montagnes de la périphérie ou même des régions plus lointaines. Très tôt, l'artisanat et le commerce occupent une part importante de la population, la spécialisation professionnelle et la hiérarchie sociale se précisent, et le Bas Pays devient le foyer culturel de l'ensemble mésopotamien.
1.4. LES PREMIÈRES CIVILISATIONS (VIIe-IVe MILLÉNAIRE AVANT NOTRE ÈRE)
Le terme de « civilisations » est employé ici, faute de mieux, s'applique à une région étendue dont les agglomérations ont en commun une céramique caractéristique pendant une longue période. De plus, toutes ces civilisations débordent sur les pays voisins (Iran, Anatolie, couloir syrien, Arabie), et l'on ignore encore quel est leur point de départ.
Si on laisse de côté les groupes pionniers, d'étendue limitée, comme ceux de l'Euphrate moyen (fin du VIIe millénaire avant notre ère), dont la céramique foncée polie (dark burnished) vient d'Anatolie, et ceux du piémont (comme celle du site de Jarmo), la série des civilisations commence avec les poteries peintes.
HASSOUNA ET SAMARRA (VERS 7000-5500 AVANT J.-C.)
La civilisation de Hassouna (au sud de Ninive, à l'ouest du Tigre) est limitée aux pays d'agriculture sèche du bassin du Tigre en haute Mésopotamie (VIe millénaire avant notre ère). Celle de Samarra (sur le Tigre moyen, au nord-ouest de Bagdad), qui se situe dans la seconde moitié du VIe millénaire avant notre ère, est le propre d'agriculteurs qui colonisent toute la haute Mésopotamie utile et affrontent à l'est, dans la vallée du Tigre moyen et sur le piémont, les sols humides, où ils creusent les premiers canaux ; des outils de cuivre martelé, des perles de turquoise et de cornaline témoignent d'un commerce avec l'intérieur de l'Iran ; et, au tell es-Sawwan (ou al-Suwan ; 10 km au sud de Samarra), un établissement protégé par un fossé possède déjà un temple.
Avant la fin du VIe millénaire avant notre ère, les premiers établissements connus de la basse Mésopotamie fabriquent des céramiques (celles d'Éridou, de Hadjdji Muhammad, d'Obeïd, dans la basse vallée de l'Euphrate) qui auraient une parenté avec celle de Samarra.
TELL HALAF ET EL-OBEÏD (VERS 5500-3500 AVANT J.-C.)
Après 5500 avant J.-C., la partie de la haute Mésopotamie consacrée à la culture sèche connaît la diffusion de la céramique de tell Halaf (un tell – « colline » de la partie nord-ouest du bassin du Khabur), qui dure en certains sites jusque vers le milieu du IVe millénaire avant notre ère, mais qui, la plupart du temps, est remplacée par celle d'Obeïd (6 km à l'ouest d'Our), venue du sud (vers 4300 avant J.-C.) et destinée à durer en quelques agglomérations du nord jusque vers 3500 avant J.-C.
OUROUK ET DJEMDET-NASR (À PARTIR DE 3750 AVANT J.-C.)
La poterie d'Obeïd est finalement remplacée par celle d'Ourouk (sur l'Euphrate inférieur), qui est diffusée à partir du sud de la basse Mésopotamie (vers 3750-3150 avant J.-C.) et qui, produite en masse, n'a pas de décor peint. La poterie peinte de Djemdet-Nasr (15 km au nord-est de Babylone) apparaît dès 3150 avant J.-C. et dure jusqu'au début du IIIe millénaire.
LES PRINCIPALES AVANCÉES
Durant cette longue période, l'organisation économique et les techniques progressent dans l'ensemble de la Mésopotamie : après le milieu du Ve millénaire avant notre ère, le sceau se répand, mais nous ne savons pas quel type de propriété il sert alors à marquer. Le commerce s'amplifie avec l'Iran, riche en minerais, et, à la fin du Ve millénaire avant notre ère, avec le cuivre martelé pour l'outillage au pays des Deux Fleuves. La concentration de la population en grosses agglomérations et l'enrichissement, qui vont de pair, se traduisent par l'édification de temples en briques crues, rebâtis et agrandis de siècle en siècle. On connaît deux séries de temples : celle d'Éridou (depuis 5300 avant J.-C. environ), au Bas Pays, et celle de tepe Gaura (depuis 4300 avant J.-C. environ), au nord-est de Ninive ; et la construction du temple sur une plate-forme à laquelle on accède par une rampe (à Éridou, vers 4300 avant J.-C.) est peut-être la première étape vers la réalisation de la ziggourat.
2. L'ENTRÉE DANS L'HISTOIRE (VERS 3450-3000 AVANT J.-C.)
Le changement essentiel se fait lors de la période (vers 3450-3300 avant J.-C.) que l'on nomme « Ourouk 4-3 » (deux niveaux du grand sondage de l'Eanna, temple de la déesse d'Inanna à Ourouk), « Protoliterate » (débuts de l'écriture) ou « Prédynastique final » (l'époque suivante étant le « Dynastique archaïque »), dénominations qui n'ont pas fait disparaître la division en périodes d'Ourouk (vers 3750-3150 avant J.-C.) et de Djemdet-Nasr (vers 3150-2900 avant J.-C.).
2.1. UN BOND DÉCISIF
C'est dans la partie méridionale de la basse Mésopotamie (le pays historique de Sumer), le delta intérieur, où les crues sont moins dangereuses et les travaux d'irrigation moins difficiles, que se trouve le foyer de la civilisation nouvelle qui différencie ce pays du reste de l'Orient. Celle-ci naît de l'interaction de l'augmentation de la population, de sa concentration en agglomérations plus importantes (peut-être déjà de véritables villes), des découvertes qui se situent à la fin d'Obeïd et au début d'Ourouk (cuivre moulé, tournette, puis tour à potier, chariot), de l'accroissement des échanges avec le reste de l'Orient (l'or et le lapis se répandent au pays des Deux Fleuves).
2.2. LES PREMIÈRES CITÉS-ÉTATS
Cette nouvelle civilisation se traduit par un essor rapide des arts. Chaque centre élève des temples, qui sont rapidement remplacés et que l'on décore de peintures murales et de mosaïques faites des têtes peintes de cônes de terre cuite enfoncés dans la muraille ; ces édifices atteignent parfois de vastes dimensions (le temple C d'Ourouk mesure 54 m sur 22 m). Cette époque voit aussi les débuts de la sculpture (reliefs de vases, stèles, figurines), qui donnent parfois des chefs-d'œuvre, comme la Dame d'Ourouk. Les artisans de la glyptique (art de tailler les pierres précieuses), également habiles, gravent sur les cylindres-sceaux une extraordinaire variété de sujets.
Toute cette activité est destinée à la divinité ou aux plus importants de ses serviteurs. La population est déjà organisée en cités-États, possédant leur conseil des Anciens et leur assemblée, et, si l'on en juge par certaines œuvres d'art, un roi guerrier est plus influent que les prêtres et que ceux qui gèrent le domaine du dieu.
2.3. L'INVENTION DE L’ÉCRITURE (VERS 3300 AVANT J.-C.)
Cette grande unité économique, qui comporte champs, troupeaux, ateliers, greniers et magasins, n'englobe ni toute la terre de la cité ni toute sa main-d'œuvre, mais elle est la seule à avoir laissé des traces : c'est pour ses comptes et ses contrôles que l'on invente la première de toutes les écritures et le sceau de forme cylindrique qui, mieux que le cachet plat, couvre le tampon d'argile des portes et des récipients d'une empreinte continue qui en garantit l'intégrité. Attesté à Ourouk dès 3400 avant J.-C. environ, ce système graphique, qui est l'ancêtre de l'écriture cunéiforme, emploie dès avant 3000 avant J.-C. les signes phonétiques qui permettent d'y lire du sumérien.
2.4. LE PROBLÈME SUMÉRIEN
Pour cette raison, bien que Sémites et Sumériens soient déjà mêlés dans toute la basse Mésopotamie, on est porté à attribuer aux Sumériens l'invention de l'écriture. Mais les spécialistes ne sont pas d'accord sur la date d'arrivée de ce peuple au Bas Pays : les uns pensent que c'est lui qui a colonisé la région dès le VIe millénaire avant notre ère, puisque, à partir de cette période, il n'y a là aucune rupture culturelle liée à des destructions qui indiqueraient une invasion ; d'autres, remarquant qu'il y a dans le vocabulaire sumérien des termes techniques qui sont étrangers aux langues sumérienne et sémitique, estiment que les Sumériens sont venus tardivement submerger sous leurs infiltrations un peuple plus évolué et plus anciennement installé au Bas Pays.
2.5. L'EXTENSION DE LA CIVILISATION MÉSOPOTAMIENNE
Sumérienne ou non, la civilisation qui apparaît vers le milieu du IVe millénaire avant notre ère dans le sud de la basse Mésopotamie manifeste après 3300 avant J.-C. davantage de dynamisme. Dans son pays d'origine, s'il n'y a plus d'inventions, les techniques découvertes précédemment sont mises plus largement au service de la production ; les objets d'art sont moins soignés, mais plus nombreux. La civilisation de la haute Mésopotamie, elle, qui prolongeait celle d'Obeïd, recule après la destruction (vers 3400 avant J.-C.) de tepe Gaura, la ville aux trois temples, qui était la principale bénéficiaire du commerce entre l'Iran et le pays des Deux Fleuves.
Au contraire, le foyer culturel du Sud englobe rapidement le nord de la basse Mésopotamie, la plaine fluviale, plus tardivement colonisée parce que plus difficile à irriguer. Et des traces de l'influence du Sud, plus ou moins importantes suivant la distance, se retrouvent en Susiane, en haute Mésopotamie, en Iran, en Syrie septentrionale et jusqu'en Anatolie et en haute Égypte.
2.6. LE PROBLÈME DE LA CHRONOLOGIE
L'entrée dans l'histoire s'accompagne de celle dans le temps mesuré. Or, la reconstitution de la chronologie de l’Asie occidentale ancienne par les modernes comporte de terribles difficultés, dues avant tout au fait que la notion d'ère est inconnue dans cette région culturelle avant l'installation de la dynastie gréco-macédonienne des Séleucides à Babylone, dont la date initiale (312 / 311 avant J.-C.) est le point de départ d'une ère – innovation probablement due à des Grecs.
TROIS SYSTÈMES DE DATATION
Auparavant, les scribes des États les plus évolués (d'abord ceux de la Mésopotamie) ont employé trois systèmes élémentaires :
1. Depuis le xxve siècle avant J.-C. au moins, dans certaines cités-États, chaque année reçoit officiellement le nom d'un événement important (en fait qui se situe l'année précédente), par exemple : « année (où) le pays de Simourrou fut détruit », ou bien un numéro la situant par rapport à une année du type précédent, ainsi : « année II suivant (celle où) il construisit la grande muraille de Nippour et d'Our » ; et chaque début de règne donne une « année (où) X devient roi ».
2. Depuis le xxvie siècle avant J.-C. au moins, certaines cités-États, comme Shourouppak, en Sumer, ou Assour, donnent à chaque année le nom d'un magistrat éponyme.
3. À partir du xive siècle avant J.-C. au moins, en Babylonie, on attribue à chaque année le nombre ordinal qui la situe dans un règne : « année 8e » (de tel roi), par exemple.
DES LISTES ROYALES INSATISFAISANTES
Très tôt, on a dressé des listes d'années, dont on a tiré des listes royales, qui ne comportent que la suite des souverains avec le nombre d'années de chaque règne. Mais rien n'est plus décevant que ce genre de textes. Ou bien les listes sont incomplètes, par suite d'une cassure de la tablette, ou bien, à cause d'erreurs des scribes, elles sont contradictoires dans le cadre d'un même État. À cela s'ajoute le fait que les dynasties parallèles abondent dans ce monde toujours politiquement morcelé et que la confrontation des listes correspondantes nous vaut de nouvelles divergences. Les découvertes de textes chronologiques, encore fréquentes en Mésopotamie et dans les pays voisins employant les cunéiformes, permettent cependant de rétrécir la marge d'incertitude.
UN Ier MILLÉNAIRE AVANT J.-C. MIEUX CONNU
Mais seule la conservation d'une liste de 263 magistrats éponymes assyriens consécutifs fournit une base solide (pour la chronologie du Ier millénaire avant J.-C.), car l'indication d'une éclipse de soleil sous l'un d'eux permet de situer son année en 763 avant J.-C. et l'ensemble de la liste de 911 à 648 avant J.-C.
Les scribes égyptiens nous ont laissé également des listes royales avec des noms d'année et des durées de règne, remontant jusqu'à la Ire dynastie (fin du IVe millénaire avant notre ère). Quelques textes donnant pour l'année x de tel règne la valeur du décalage de l'année usuelle de 365 jours par rapport à celle, plus exacte, qui comprend 365 jours 1/4, permettent de situer à trois ans près, des dynasties, dont la plus ancienne est la XIIe (xxe-xixe s. avant J.-C.). Mais les lacunes et les contradictions se rencontrent également dans les listes égyptiennes, et les divergences chronologiques sont donc accrues pour les périodes où Égyptiens et Asiatiques sont en contact et citent des événements qui leur sont communs.
RÉFÉRENCES CHRONOLOGIQUES
Donc, si chaque spécialiste construit sa chronologie personnelle, les ouvrages de grande diffusion ont intérêt à employer la chronologie donnée pour chaque grande aire culturelle par les œuvres savantes les plus répandues (par exemple la nouvelle édition de la Cambridge Ancient History, ou le Proche-Orient asiatique de Paul Garelli). On pourra particulièrement consulter les articles « Datenlisten » (1934) et « Eponymen » (1938) par A. Ungnad dans le Reallexikon der Assyriologie (Berlin-Leipzig, volume II, p. 131-194 et 412-457) et le fascicule « Chronology » (1964) par William C. Hayes et M. B. Rowton de la Cambridge Ancient History.
3. LE « DYNASTIQUE ARCHAÏQUE » (VERS 2750-2350 AVANT J.-C.)
3.1. DES CITÉS PROSPÈRES
Dans cette période dite « Dynastique archaïque », la basse Mésopotamie continue à progresser rapidement, surtout au « Dynastique archaïque III » (vers 2600-2350 avant J.-C.), en dépit de son morcellement politique en cités rivales.
Dès le début, il y a eu une diminution du nombre des agglomérations et une augmentation de la taille de celles qui survivent. Il n'y a plus maintenant de doute : ce sont de véritables villes, ceintes d'une muraille. Leurs relations, qui s'étendent alors au sud-est de l'Iran (tepe Yahya) et à la vallée de l'Indus, leur valent toujours plus de matières premières et de recettes techniques. La métallurgie du cuivre accroît sa production et améliore ses procédés : dès 2500 avant J.-C., on réalise pour des objets d'art un véritable bronze d'étain. Les offrandes des temples et de certaines tombes montrent la richesse du pays et l'habileté de ses artisans : si la sculpture est en déclin, sauf pour la représentation des animaux, la métallurgie et l'orfèvrerie témoignent d'un goût raffiné.
3.2. LES DIVINITÉS CIVIQUES
Les villes continuent à élever des temples, où les notables déposent des offrandes et des orants (figurines qui les représentent en prière). Chaque cité a plusieurs temples (chacun d'eux pouvant héberger les idoles d'une divinité seule, d'un couple divin ou d'une famille de dieux) ainsi qu'un panthéon hiérarchisé et dominé par la divinité protectrice de la ville. Les représentations conventionnelles des dieux, les symboles qui les désignent et les premières inscriptions permettent d'identifier des divinités qui étaient sans doute en place aux âges précédents et se maintiennent jusqu'à la fin de la civilisation mésopotamienne : ainsi, chez les Sumériens, Inanna (déesse de la Fécondité), Enlil (le Vent), Enki (l'Eau bienfaisante), An (le Ciel).
3.3. DES ROIS-PRÊTRES À LA SÉPARATION TEMPLE-PALAIS
Les inscriptions historiques qui apparaissent au xxviie siècle avant J.-C. et les archives de Tello (un site du royaume de Lagash, sur le Tigre inférieur), du xxvie au xxive siècle avant J.-C., révèlent les institutions que l'on entrevoyait seulement pour le IVe millénaire avant notre ère. Chaque cité-État est gouvernée par un roi héréditaire (en « seigneur » ou lougal, « grand homme »), qui est vicaire (ou bien ensi « délégué », « gouverneur ») du grand dieu local et le chef des guerriers. À la même époque, semble-t-il, ce souverain cesse d'habiter le temple, et l'on construit les premiers palais, tandis que l'on se met à distinguer l'unité économique dépendant du dieu de celle qui appartient au roi (les historiens les nomment temple et palais). Parfois, le pouvoir sacerdotal (représenté par un « comptable », ou prêtre), séparé du pouvoir royal, se heurte à ce dernier.
3.4. LES GUERRES ENTRE CITÉS
En dehors de l'édification des temples et du creusement des canaux, le roi de la cité s'occupe de faire la guerre à ses voisins et essaie d'imposer à quelques-uns d'entre eux sa prédominance. Ces dominations éphémères et géographiquement limitées sont exercées à partir de villes de basse Mésopotamie (→ Kish, Our, Ourouk, Lagash, Oumma, etc.) par des rois à noms sumérien ou sémitique (comme Mesanepada, fondateur de la Ire dynastie d’Our, ou Eannatoum de Lagash, dont la victoire sur Oumma est commémorée par la magnifique stèle des Vautours du musée du Louvre, ou encore ce Gilgamesh d'Ourouk, source de la plus fameuse épopée mésopotamienne, couchée par écrit dans la première moitié du IIe millénaire avant J.-C.), de l'Euphrate moyen (la sémitique Mari) ou d'Élam (Suse). En effet, si les Élamites ont leur civilisation et leur organisation politique propres, ils ne cessent, durant toute leur histoire, d'avoir des rapports culturels et économiques avec le Bas Pays et d'être en conflit avec ses cités.
3.5. RETARD PERSISTANT DU NORD
Durant cette période, la haute Mésopotamie reste en retard par rapport au Sud. Le meilleur critère en est l'usage de l'écriture, dont les signes prennent peu à peu l'allure de paquets de clous ou de coins (d'où le terme de « cunéiforme ») ; elle n'est adoptée au Dynastique archaïque que dans les agglomérations de la basse vallée de la Diyala et à Mari, sur l'Euphrate moyen. D'autres centres (Assour sur le Tigre moyen, tell Brak dans le bassin du Khabur), s'ils n'emploient pas l'écriture, ont pourtant reçu un tel apport technique et artistique du Bas Pays que l'on a cru y voir des comptoirs ou des dépendances de centres du Sud.
3.6. GRANDEUR ET DÉCLIN DU DYNASTIQUE ARCHAÏQUE
Pendant un certain temps, les guerres n'empêchent pas le progrès de la civilisation. C'est ce que montrent les trésors artistiques (vers 2500 avant J.-C.) trouvés à Our dans des tombes mystérieuses (pour des rois terrestres, comme le lougal Meskalamdoug, des substituts de dieux ou de vicaires ?), véritables monuments (fait rare dans le monde mésopotamien, où l'on n'attend rien d'un au-delà désolant) qui renferment des foules de serviteurs et surtout de servantes exécutés pour accompagner leur maître dans la mort.
Puis au xxive siècle avant J.-C. vient le temps des destructions sauvages et du premier Empire mésopotamien.
4. LES PREMIERS EMPIRES MÉSOPOTAMIENS (VERS 2350-2004 AVANT J.-C.)
4.1. L'EMPIRE DE LOUGAL-ZAGESI (VERS 2350-2325 AVANT J.-C.)
Parti d'Oumma (cité voisine de Lagash), le Sumérien Lougal-zagesi impose sa domination brutale (vers 2350 avant J.-C.) du golfe Persique à la Méditerranée. C’est le premier « empire » constitué en Mésopotamie. Il ne dure pas vingt-cinq ans.
4.2. L’EMPIRE AKKADIEN (VERS 2325-VERS 2190 AVANT J.-C.)
Vers 2325 avant J.-C., Lougal-zagesi est renversé par le Sémite Sargon, qui a fondé dans le nord de la basse Mésopotamie une cité-État, Akkad (ou Agadé), dont l'emplacement n'a pas encore été retrouvé. Son triomphe est aussi celui de son peuple, le dernier groupe sémitique sorti du désert. Sous la dynastie d'Akkad, on constate d'ailleurs un antagonisme entre ces Sémites d'Akkad et les citadins de Sumer (Sémites et Sumériens mêlés depuis longtemps), fiers de l'ancienneté de leur civilisation.
UNE POLITIQUE IMPÉRIALE
Sargon (début du xxiiie siècle avant J.-C., qui se dit « roi de Sumer et d’Akkad », se constitue un domaine encore plus vaste que celui de son prédécesseur, guerroyant dans les régions périphériques et étendant son contrôle sur une bonne partie des étapes et des voies du commerce de l'Asie occidentale. Et, si son empire fournit l'exemple à suivre pour tous ceux qui par la suite essaieront d'unifier le pays des Deux Fleuves, c'est qu'à la différence des rois du « Dynastique archaïque », vainqueurs de leurs voisins, et sans doute aussi de Lougal-zagesi, il a pratiqué une véritable politique impériale. Les rois d'Akkad, qui ont laissé souvent les vicaires vaincus à la tête de leurs villes, les font surveiller par des officiers de la cour akkadienne et colonisent les terres des vieilles villes en y constituant soit des établissements pour des groupes de leurs soldats, soit de grands domaines pour leurs principaux serviteurs. Et, pour mieux asseoir l'idée d'une domination supérieure à celle des rois de l'époque précédente, ils donnent un caractère divin à leur pouvoir : on les appelle « dieux » et on les représente avec la tiare à cornes (symbole de puissance jusque-là réservé à la divinité).
L’ENRICHISSEMENT MATÉRIEL
Le bouleversement politique s'accompagne d'une multiplication des grands domaines privés au détriment des communautés et des familles vivant dans l'indivision. Le commerce et l'artisanat profitent des facilités que l'unification politique apporte à la circulation. Disposant de ressources plus étendues que les chefs des cités-États, les rois d'Akkad peuvent susciter le progrès artistique : sans rompre avec la tradition, la sculpture et la glyptique produisent des chefs-d'œuvre (stèle de Naram-Sin, petit-fils de Sargon, commémorant sa victoire sur les montagnes du Zagros, tête de Ninive, sceau de Sharkali-sharri, fils de Naram-Sin).
LES MUTATIONS CULTURELLES
La substitution partielle de l'akkadien (parler sémitique employé au pays d'Akkad) au sumérien comme langue écrite est à l'origine d'importants progrès culturels. Les scribes ne se contentent pas de lire en akkadien les idéogrammes d'origine sumérienne, comme on avait pu le faire jusque-là ; transcrivant leur langue sémitique où les mots sont généralement polysyllabiques (à la différence du sumérien, où prédominent les monosyllabes), ils sont amenés à étendre l'usage des signes phonétiques, qui rend l'écriture moins difficile. Les cunéiformes se répandent alors dans les pays soumis par Sargon ou chez ses adversaires : ils transcrivent de l'élamite, du hourrite (en haute Mésopotamie) et surtout de l'akkadien.
Pour en savoir plus, voir l'article cunéiforme.
LE NORD SORT DE L’OMBRE
En haute Mésopotamie, l'écriture, rare jusque-là, apparaît à Gasour (→ Nouzi au IIe millénaire avant notre ère, près de Kirkuk), à l'est du Tigre moyen, à Ninive, à Assour, au tell Brak, à Chagar Bazar (dans le bassin supérieur du Khabur) et dans les cités saintes du peuple hourrite, et elle contribue à restaurer l'unité culturelle de la Mésopotamie, qui avait disparu au Prédynastique final. Le nord de la Mésopotamie, qui porte alors le nom de Soubarou, commence à sortir de l'obscurité. Il est peuplé, pour une bonne part, de Sémites apparentés à ceux du pays d'Akkad et qui reconnaissent assez facilement la prédominance de la dynastie de Sargon : c'est le cas de ceux d'Assour (qui donnera son nom à l’Assyrie), fondée au xxvie siècle avant J.-C. comme cité sainte des tribus pastorales de la steppe qui s'étend à l'ouest du Tigre.
Quant aux Hourrites, généralement en guerre avec Akkad, descendus des montagnes, ils sont nombreux dans tout le piémont, et certains de leurs rois revendiquent la domination sur toute cette zone.
4.3. CHUTE D’AKKAD ET RETOUR AUX CITÉS-ÉTATS (VERS 2190-2120 AVANT J.-C.)
L’ARRIVÉE DES GOUTIS
Parvenue à un haut degré de richesse, la Mésopotamie ne cesse alors plus de susciter la convoitise des populations moins évoluées qui vivent dans les montagnes et les steppes désertiques de sa périphérie. Certains de ces voisins pratiquent surtout l'infiltration, venant par petits groupes se proposer comme soldats ou hommes de peine ; ils ont le temps d'assimiler la culture mésopotamienne avant de constituer une majorité dans la région où ils se fixent. D'autres peuples procèdent par des attaques brutales et viennent saccager les villes. Les rois d'Akkad ne peuvent cependant pas indéfiniment conjurer cette menace, car ils sont bien souvent occupés à réprimer les soulèvements des cités-États de Mésopotamie, qui renoncent difficilement à leur indépendance. S'ils endiguent la poussée des Sémites occidentaux, ou Amorrites, qui sortent du désert de Syrie, ils finissent par succomber devant les expéditions des peuples du Zagros, Loulloubi et Goutis, qui ruinent l'Empire akkadien (vers 2190 avant J.-C.).
LE RETOUR AUX CITÉS-ÉTATS
Tandis que les rois goutis imposent leur domination à une partie des centres mésopotamiens, le reste du pays des Deux Fleuves retourne au régime des cités-États indépendantes, parmi lesquelles Akkad, qui garde sa dynastie jusque vers 2154 avant J.-C. (voire 2140, selon Jean-Jacques Glassner, La Mésopotamie, Les Belles lettres, 2002).
C'est peut-être au temps des Goutis que se situe le règne de Goudea (2141-2122 avant J.-C.) à la tête de l'État de Lagash ; ce vicaire (ishshakou), qui ne paraît dépendre d'aucun souverain, a des relations commerciales avec une bonne partie de l'Asie occidentale, et sa richesse lui permet de multiplier les sanctuaires, d'où proviennent les dix-neuf statues en diorite noire que l'on a conservées de lui et qui inaugurent cet art habile et froid qui dure la majeure partie du IIe millénaire avant notre ère.
Vers 2120 avant J.-C., le roi d'Ourouk, Outou-hegal, bat et expulse le peuple détesté des Goutis, et le prestige de cette victoire lui vaut la prédominance sur tout le pays de Sumer.
4.4. LA IIIe DYNASTIE D’OUR (VERS 2110-2004 AVANT J.-C.)
LA « RENAISSANCE NÉO-SUMÉRIENNE »
À la mort d'Outou-hegal, c'est le roi Our-Nammou, fondateur de la IIIe dynastie d'Our, qui impose sa domination aux cités de basse Mésopotamie. C'est le point de départ d'un empire dont les limites sont mal connues : il doit comprendre toute la Mésopotamie et s'étend, sous le règne de Shoulgi, successeur d'Our-Nammou, à la Susiane et à une partie de l'Élam montagneux. On a qualifié cette période de néo-sumérienne. En fait, si la langue de Sumer est de nouveau employée dans les textes administratifs, le peuple de Sumer a disparu sous l'afflux massif des Sémites ; les populations de l'empire emploient des parlers sémitiques ou le hourrite, et le sumérien n'est plus que la langue de culture d'une élite sociale. Les rois d'Our reprennent et perfectionnent la politique impériale des maîtres d'Akkad. Dieux, ils reçoivent un culte de leur vivant et un hypogée monumental pour leur au-delà. C'est également à ce titre qu'Our-Nammou donne à son peuple un code qui est le plus ancien recueil de lois connu à ce jour.
L’EMPIRE D’OUR
Les souverains d'Our multiplient les constructions sacrées, en particulier dans leur capitale, où ils développent l'ensemble consacré à Sin, le dieu-lune, y ajoutant une ziggourat (bâtiment fait de terrasses de taille décroissante superposées et couronné par un temple), la plus ancienne connue. L'empire d'Our se caractérise encore par un énorme appareil administratif qui contrôle les temples et les villes. Il y a encore dans chaque cité un vicaire, mais ce n'est plus qu'un fonctionnaire nommé par le roi, qui peut le muter. En revanche, sur le plan économique, les agents commerciaux des temples et du palais commencent à réaliser des affaires pour leur compte.
LA CHUTE D’OUR
Les rois d'Our n'ont guère cessé de guerroyer dans le Zagros, mais un péril plus aigu s'annonce à l'ouest : à l'infiltration continue des Amorrites s'ajoutent leurs attaques. Et l'empire est déjà plus qu'à moitié perdu lorsque les Élamites prennent Our, qui est saccagée et dont le dernier roi est déporté (2004 avant J.-C.).
5. LES ROYAUMES AMORRITES (VERS 2004-1595 AVANT J.-C.)
Le mouvement des peuples se poursuit pendant deux siècles au moins : tandis que les Hourrites progressent en haute Mésopotamie vers le sud et vers l'ouest, les Amorrites arrivent en bandes successives, qui se fixent un peu partout au pays des Deux Fleuves, et finissent par adopter un dialecte akkadien.
5.1. LA PÉRIODE D'ISIN-LARSA
Ishbi-Erra, qui, comme gouverneur de Mari, avait trahi et dépouillé son maître, le dernier roi d'Our, bien avant la catastrophe finale, fonde à Isin, en Sumer, une dynastie qui prétend continuer la domination impériale des rois d'Our en reprenant le titre de « roi de Sumer et d'Akkad » ; mais cette dynastie se heurte à une dynastie amorrite installée à Larsa dans la même région. D'où le nom de période d'Isin-Larsa que l'on a donné à cette époque, où la Mésopotamie retourne au morcellement politique. Un peu partout, des chefs de guerre, le plus souvent des Amorrites à la tête de leur tribu, se proclament vicaires ou rois d'une cité. Il ne se passe pas de génération sans qu'un ou plusieurs de ces souverains n'entament la construction d'un empire qui s'écroule avant d'avoir achevé la réunification du pays des Deux Fleuves.
5.2. L’ANCIEN ÂGE ASSYRIEN
Mais l'histoire retient surtout les villes qui ont été des centres culturels ou économiques. Assour, redevenue indépendante à la chute de la IIIe dynastie d'Our, est gouvernée par des vicaires du dieu local Assour, portant des noms akkadiens (le dialecte assyrien est une forme dérivée de la langue d'Akkad). Ces princes participent au commerce fructueux que leurs sujets pratiquent en Anatolie centrale et dont témoignent les fameuses tablettes assyriennes de Cappadoce (xixe-xviiie siècle avant J.-C.). Leur dynastie est renversée (vers 1816 avant J.-C.) par un roitelet amorrite du bassin de Khabur, Shamshi-Adad Ier, qui se constitue un empire en haute Mésopotamie en dépouillant ou en soumettant les maîtres de nombreuses cités. En particulier, il met la main sur Mari (vers 1798 avant J.-C.), le grand centre commercial de l'Euphrate. Mais, à la mort du conquérant (vers 1781 avant J.-C.), son héritier, Ishme-Dagan Ier est réduit à la possession d'Assour. Zimri-Lim, le représentant de la dynastie précédente à Mari, se rétablit dans la royauté de ses pères et se rend célèbre par l'achèvement d'un palais qui est le plus beau de son temps.
5.3. L’ANCIEN EMPIRE BABYLONIEN
HAMMOURABI ET LA Iere DYNASTIE DE BABYLONE
La prédominance politique passe alors aux mains de Hammourabi (1793-1750 avant J.-C.), sixième roi de la dynastie amorrite (2004-1595 avant J.-C.), qui s'est établie à Babylone, grand centre économique du Bas Pays. Le Babylonien, qui avait d'abord été un allié subordonné de Shamshi-Adad Ier, finit par détruire, entre 1764 et 1754 avant J.-C., les principaux royaumes du pays des Deux Fleuves – Larsa, Mari, Eshnounna (à l'est de la basse Diyala) – et constitue un empire étendu à la majeure partie de la Mésopotamie ; mais c'est son code (282 articles reproduits sur une colonne de basalte de 2,25 m de haut et 70 cm de rayon à la base) et ses archives administratives qui l'ont rendu célèbre (→ code de Hammourabi).
LE DÉCLIN DE L'EMPIRE
En effet, dès le règne de Samsou-ilouna, le fils de Hammourabi le royaume de Babylone est réduit au pays d'Akkad. L'obscurité tombe sur la haute Mésopotamie, de nouveau morcelée, et sur le pays de Sumer, qui, gouverné par une dynastie du Pays de la Mer (région de Basse Mésopotamie, proche du golfe ; vers 1735-1530 avant J.-C.), souffre du déclin provoqué par la remontée des sels, qui ruine la culture des céréales, et par la fin du commerce avec la civilisation de l'Indus, ruinée au xviiie siècle avant J.-C. Les peuples de la périphérie se remettent en mouvement, et, en 1595 avant J.-C., une expédition du roi hittite Moursili Ier met fin à la Ire dynastie de Babylone.
LE RAYONNEMENT CULTUREL DE BABYLONE
À la fin de la période qui s'achève ainsi, la grande ville du bas Euphrate est devenue le centre culturel de la Mésopotamie. C'est d'elle que rayonne maintenant le mouvement intellectuel né en Sumer, à la fin de la dynastie d'Our, au moment où l'on avait cessé de parler le sumérien. Les scribes avaient alors entrepris de mettre par écrit, pour la conserver, la tradition religieuse, scientifique et littéraire élaborée au cours des âges précédents dans le Bas Pays, et qui était restée presque entièrement orale. À partir du xviiie siècle avant J.-C., ils traduisent ces textes en akkadien, puis ils les adaptent au goût nouveau ou les complètent à l'aide des découvertes récentes. C'est l'époque où se développent les techniques divinatoires et en particulier l'astrologie et les autres sciences (mathématiques, médecine).
Pour en savoir plus, voir l'article Babylone.
6. LE TEMPS DES INVASIONS : HOURRITES, KASSITES ET ASSYRIENS (VERS 1595-934 AVANT J.-C.)
Les envahisseurs venus du Zagros à la fin de la période précédente se fixent en Mésopotamie. Les Aryens et le groupe hourrite qui leur est lié dans le Nord, les Kassites dans le Sud fondent ainsi deux États, le Mitanni et le Kardouniash, tandis qu’un Empire assyrien renaît peu à peu de ses cendres.
6.1. LES HOURRITES ET L’EMPIRE DU MITANNI
Le Mitanni, qui reste très mal connu, est le premier à sortir de l'obscurité. C'est un empire à l'ancienne mode, où le roi d'un État plus puissant, le Mitanni, qui devait se trouver dans le bassin du Khabur, impose sa prédominance aux rois plus faibles dans une vaste étendue, du Zagros à l'Oronte, de l'Araxe au moyen Euphrate. Si elle ne correspond à une unité géographique, cette domination s'appuie sans doute sur l'appartenance de la plupart des rois qui y sont regroupés aux aristocraties aryenne et hourrite.
Le Mitanni s'est développé probablement dès le xvie siècle avant J.-C., à la faveur des migrations et de la disparition ou du recul des États plus anciens, et c'est au début du xve s.siècle avant J.-C. la principale puissance de l'Orient. Trop composite, il s'écroule lorsque ses voisins s'entendent contre lui : les Hittites, qui lui enlèvent son domaine syrien, et les Assyriens, qui annexent ses dépendances du bassin du Tigre moyen, se disputent après 1360 avant J.-C. la protection de ce qui reste de l'Empire mitannien, un État tampon dans l'ouest de la haute Mésopotamie, qui finit, vers 1270 avant J.-C., détruit et annexé par les Assyriens.
6.2. LES KASSITES ET LE KARDOUNIASH
UNIFICATION DE LA BABYLONIE
L'État du Kardouniash (ou Karandouniash) a été fondé à Babylone (peut-être à la disparition de la dynastie amorrite) par des Kassites. Ce peuple du Zagros avait tenté d'envahir le pays des Deux Fleuves en 1741 avant J.-C. et, battu par le fils de Hammourabi, il avait, semble-t-il, fondé un royaume quelque part en Mésopotamie. Après leur installation à Babylone, les Kassites réunifient le Bas Pays – que l’on peut, désormais, appeler la Babylonie – en détruisant la dynastie du Pays de la Mer (vers 1530 avant J.-C.).
UNE PUISSANCE FAIBLE
On ne connaît aucun texte ni monument des rois kassites avant le xive siècle avant J.-C., ce qui indique une économie affaiblie et probablement une monarchie sans grand pouvoir. C'est d'ailleurs avec ce caractère qu'elle se manifeste ensuite : les rois kassites concèdent de grands domaines immunitaires à leurs officiers et accordent le même privilège aux cités ; on comprend alors qu'aucune d'elles ne conteste plus la suprématie de Babylone ni ne tente de sécession. Les Kassites, aristocratie militaire issue d'un peuple peu évolué, abandonnent assez vite leur culture propre, et le monde babylonien, dès le retour à la prospérité économique, reprend son activité intellectuelle. Du xive au xie siècle avant J.-C., les scribes constituent les collections, désormais canoniques, de textes rituels, divinatoires ou se rapportant aux autres sciences du temps et donnent également une forme définitive aux œuvres littéraires, comme le Poème de la Création ou l’Épopée de Gilgamesh.
6.3. LE MOYEN EMPIRE ASSYRIEN
UNIFICATION DE L'ASSYRIE
La cité-État d'Assour était entrée dans l'obscurité dès la mort de Shamshi-Adad Ier (vers 1781 avant J.-C.). Morcelée entre des dynasties rivales, elle avait dû subir des dominations étrangères. Assour venait à peine de se libérer de l'emprise du roi mitannien quand Assour-ouballit Ier (1366-1330 avant J.-C.) entreprend d'exploiter la crise dynastique du Mitanni et, retournant la situation, devient le protecteur du nouveau roi mitannien. Assour-ouballit, qui a pris le titre de roi pour les territoires étrangers au domaine de la cité d'Assour qu'il a conquis, et ses premiers successeurs dépassent le cadre de la cité-État originelle et créent ce que les modernes appellent l'Assyrie, un royaume centralisé comme celui de Hammourabi, bientôt un empire comprenant, outre Assour, les villes du « triangle assyrien » (entre le Tigre et le Zab supérieur), dont la plus importante est Ninive, puis tout le bassin du Tigre moyen et, au xiiie siècle avant J.-C., ce qui reste du Mitanni. Les Hourrites, qui formaient une part importante de la population des pays conquis, se laissent sémitiser.
UNE ROYAUTÉ FRAGILE
Cette expansion s'accompagne de cruautés ostentatoires et de déportations inspirées par le nationalisme et destinées à détruire toute volonté de résistance. Ces succès ne diminuent guère l'instabilité politique à Assour : la royauté est sacrée, mais non la personne du roi, qui doit déjouer les intrigues de ses parents, des prêtres, qui désignent le nouveau souverain, et de l'aristocratie guerrière, qui monopolise les offices auliques et les gouvernements provinciaux, et dont la guerre accroît la richesse et la puissance.
6.4. LA RIVALITÉ ENTRE ASSYRIENS ET BABYLONIENS (VERS 1320-1120 AVANT J.-C.)
UNE LUTTE INTERMINABLE
Dans la seconde moitié du xive siècle avant J.-C., alors que la Mésopotamie ne compte plus que deux grands États, s'amorce le vain conflit qui va affaiblir ces royaumes. Pour des raisons de prestige, pour imposer chacun sa prédominance à l'autre, les rois de Babylone et d'Assour se lancent dans une série de guerres décousues auxquelles participe bientôt l'Élam, à peine libéré de la tutelle babylonienne et qui, pour des raisons géographiques, réserve ses coups au Bas Pays. Même le triomphe de l'Assyrien Toukoulti-Ninourta Ier (1245-1208 avant J.-C.), qui a capturé le souverain kassite et s'est proclamé roi de Babylone, n'a pas de lendemain. De même, après que les raids successifs des Assyriens et des Élamites ont mis fin à la dynastie kassite (1153 avant J.-C.), la Babylonie se relève sous une dynastie à noms sémitiques, la 2e dynastie d'Isin, et une victoire de son roi Naboukoudour-outsour Ier (appelé par les modernes Nabuchodonosor Ier) provoque la fin du grand royaume d'Élam (vers 1115-1110 avant J.-C.).
L’ÉMULATION CULTURELLE
Ces conflits n'entravent ni le commerce ni les échanges culturels. La Babylonie exerce une influence puissante sur tout l'Orient, et surtout sur son voisin du Nord. Les Assyriens, qui montrent une certaine originalité dans l'élaboration de leur premier art, sont par contre les admirateurs et les fidèles disciples des scribes babyloniens et les adorateurs fervents des divinités du Sud.
6.5. LE TEMPS DE LA CONFUSION (VERS 1120-934 AVANT J.-C.)
L’ARRIVÉE DES ARAMÉENS
Le mouvement migratoire des Sémites du désert de Syrie à destination des pays agricoles, qui n'avait jamais complètement cessé, reprend toute sa force avec un nouveau groupe linguistique, les Araméens. Affaiblis par leur interminable conflit, mal préparés à combattre ces pillards insaisissables, les royaumes de Babylonie et d'Assyrie déclinent sous l'effet du harcèlement des nomades. L'Assyrie, en particulier, qui portait encore la guerre sous Toukoultiapil-Esharra Ier (→ Téglath-Phalasar Ier) [1116-1077 avant J.-C.] jusqu'au lac de Van et en Phénicie, perd peu après tout l'ouest de la haute Mésopotamie. Bientôt, la situation est la même pour les deux États : les citadins sont bloqués dans les villes, les bandes araméennes courent les campagnes, dont ils massacrent les habitants terrorisés et transforment les riches zones de culture en steppes pastorales.
LES PETITS ROYAUMES ARAMÉENS
Puis, à la fin du xie siècle ou au xe siècle avant J.-C., les groupes araméens se fixent, chacun formant la garnison d'une cité dont son chef devient le roi. En Babylonie, ce phénomène a été facilité par l'attitude des notables des villes livrées à elles-mêmes par une royauté que dégradent des usurpations répétées : ceux-ci cèdent en échange de leur tranquillité une partie de leurs terres aux envahisseurs ; en certains districts de Sumer, l'afflux des Araméens, auxquels des Arabes se joignent au viiie siècle avant J.-C., ne cesse jamais et absorbe les populations plus anciennes ; mais, partout, les petits royaumes tribaux qui se forment reconnaissent pour souverain le roi de Babylone.
7. LES NOUVEAUX EMPIRES ASSYRIEN ET BABYLONIEN (934-539 AVANT J.-C.)
7.1. LE NOUVEL EMPIRE ASSYRIEN (934-605 AVANT J.-C.)
UNE POLITIQUE DE CONQUÊTES SYSTÉMATIQUES
Au xe siècle avant J.-C., les deux États mésopotamiens connaissent un renouveau économique et intellectuel. Mais les Assyriens ne s'en tiennent pas là et se consacrent à la conquête, montrant dès le règne d'Assour-dân II (934-912 avant J.-C.) plus de méthode qu'on ne leur en prête pour cette époque. Outre les opérations de police contre les Araméens qui infestaient les campagnes et la guerre de prestige contre Babylone, traitée avec mansuétude par respect pour ses dieux, l'armée assyrienne attaque les peuples guerriers et arriérés des montagnes ainsi que les riches cités araméennes. Pour ces dernières, elle opère progressivement, ne les annexant qu'après des années d'extorsion du tribut.
Cependant, la conquête assyrienne comporte des pauses et des reculs qui semblent liés à la faiblesse de tel roi, mais qui sont dus plus probablement à une crise interne, qui n'est résolue que provisoirement par l'arrivée au pouvoir d'un prince énergique. Au ixe siècle avant J.-C., Assurnazirpal II (883-859 avant J.-C.) est le premier à franchir l'Euphrate et à aller rançonner les cités du couloir syrien, mais il faut encore plus d'un demi-siècle pour que ses successeurs achèvent l'annexion des États araméens de la haute Mésopotamie occidentale.
LES FAIBLESSES DE L'EMPIRE
Depuis Assurnazirpal II, les rois résident à Nimroud, au sud-est de Ninive, ville neuve peuplée de déportés dont on n'avait pas à craindre qu'ils exigent des immunités. Cette fragilité du pouvoir royal, que la propagande dissimule aux yeux des étrangers, impressionnés par les reliefs des palais montrant la majesté du souverain, est mise en lumière par la guerre civile assyrienne (828-823 avant J.-C.), qui oppose deux groupes sociaux se disputant les profits de la guerre et divise la famille royale. Durablement affaiblie, l'Assyrie a beaucoup de mal à endiguer la poussée du royaume d'Ourartou, qui, par le bassin du Tigre supérieur, menace le cœur de l'Assyrie.
LA SOUMISSION DE LA BABYLONIE
Toukoultiapil-Esharra III (745-727 avant J.-C.), le Téglath-Phalasar III de la Bible, qui restaure le pouvoir royal et réforme l'armée, reprend la conquête avec plus d'acharnement. Mais il est sans doute mal inspiré quand, inquiet de la faiblesse croissante de la monarchie babylonienne, qui pourrait tenter un Élam en plein renouveau, il s'empare de la Babylonie et se proclame roi dans sa capitale (728 avant J.-C.). Au lieu d'un État miné par l'anarchie, ses successeurs doivent affronter les révoltes des citadins et des Araméens, soutenus par les Élamites. Les rois assyriens essaient toutes sortes de solutions : tantôt le titre de roi de Babylone est porté par le souverain d'Assyrie, par un de ses fils ou par un Babylonien dont on escompte la docilité, tantôt on supprime ce titre et avec lui les dernières apparences d'indépendance. Les révoltes exaspèrent les Assyriens et, par deux fois (689 avant J.-C. et 648 avant J.-C.), Babylone est dévastée.
UN COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILE
Sous Sargon II (722/721-705 avant J.-C.) et ses descendants les Sargonides, Sennachérib (705-680 avant J.-C.), Assarhaddon (680-669 avant J.-C.) et Assourbanipal (669-v. 627 avant J.-C.), l'Empire assyrien paraît à son apogée avec un domaine de plus d'un million de kilomètres carrés, qui va jusqu'à Suse en Élam et à Thèbes en Égypte, avec ses palais ornés de reliefs et de fresques, où les rois entassent leurs collections d'ivoire et de tablettes. Une civilisation impériale où domine l'apport babylonien se répand dans toute l'Asie occidentale, effaçant les particularismes locaux. Mais le peuple assyrien, décimé par la guerre, ne fournit plus que l'encadrement de ces foules de prisonniers de guerre avec lesquels on remplit les rangs de l'armée ou des chantiers et de ces déportés qui constituent maintenant la majorité de la population dans chacune des régions de l'Empire.
LA FIN DE L’ASSYRIE (626-605 AVANT J.-C.)
En 626 avant J.-C., Nabopolassar, membre de la grande tribu araméenne des Chaldéens, se révolte contre la domination assyrienne et devient roi de Babylone, fondant la dernière dynastie de la grande cité. Cependant, il faut l'intervention du roi mède Cyaxare pour que les capitales de l'Assyrie soient détruites (Assour en 614 avant J.-C., Ninive en 612 avant J.-C.) et que son armée soit dispersée (605 avant J.-C.). Le peuple assyrien anéanti, son héritage va essentiellement à la dynastie chaldéenne de Babylone, qui reconstitue un empire en Asie occidentale, tandis que les Mèdes, dominant l'Iran, se contentent de la moitié nord de la haute Mésopotamie, où ils campent au milieu des ruines.
7.2. LE DERNIER EMPIRE BABYLONIEN (605-539 AVANT J.-C.)
Pour lire la suite, consulter le LIEN ( haut de page ).
|
| |
|
| |
|
 |
|
siècle des Lumières ou les Lumières |
|
|
| |
|
| |
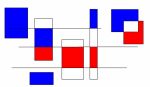
siècle des Lumières ou les Lumières
Cet article fait partie du dossier consacré à la Révolution française.
Mouvement philosophique qui domina le monde des idées en Europe au xviiie s.
Le mouvement des Lumières tire son nom de la volonté des philosophes européens du xviiie siècle de combattre les ténèbres de l'ignorance par la diffusion du savoir. L'Encyclopédie, dirigée par Diderot et d'Alembert, est le meilleur symbole de cette volonté de rassembler toutes les connaissances disponibles et de les répandre auprès du public – d’un public éclairé.
Ce mouvement, qui connut une intensité plus marquée en France, en Angleterre (sous le nom d'Enlightenment) et en Allemagne (Aufklärung), est né dans un contexte technique, économique et social particulier : ascension de la bourgeoisie, progrès des techniques, progrès de l'organisation de la production et notamment des communications, progrès des sciences souvent appliquées au travail des hommes.
Confiants en la capacité de l'homme de se déterminer par la raison, les philosophes des Lumières exaltent aussi la référence à la nature et témoignent d'un optimisme envers l'histoire, fondé sur la croyance dans le progrès de l'humanité. L'affirmation de ces valeurs les conduit à combattre l'intolérance religieuse et l’absolutisme politique.
Certains philosophes interviennent dans des affaires judiciaires (Voltaire défend entre autres Calas, un protestant injustement accusé d'avoir tué son fils) et militent pour l'abolition des peines infamantes, de la torture et de l’esclavage. Diffusées dans les salons, les cafés et les loges maçonniques, les idées des Lumières sont consacrées par les œuvres des philosophes, des écrivains et des savants. Les principaux représentants des Lumières sont, en Grande-Bretagne, J. Locke, D. Hume, I. Newton ; en Allemagne, C. Wolff, Lessing, Herder ; en France, Montesquieu, Voltaire, Diderot, J.-J. Rousseau, tous les Encyclopédistes, Condillac et Buffon.
1. UN MOUVEMENT EUROPÉEN
On attribue généralement un rôle prééminent à la France dans l'essor de la civilisation européenne du xviiie s. Cependant l'Angleterre est la première instigatrice des grands mouvements idéologiques et des mutations économiques qui caractérisent ce siècle.
L'Angleterre offre l'image d'un pays libre : deux révolutions (1642-1649, avec Cromwell, et 1688-1689, avec la Déclaration des droits ou Bill of Rights) y ont détruit le régime de l'absolutisme et de l'intolérance. De telles idées se répandent en Europe grâce aux philosophes français, fascinés par cette application du libéralisme. Par ailleurs, les Anglais sont également à l'origine de diverses transformations technologiques et scientifiques qui débouchent sur ce que l'on appelle aussi des « révolutions » – dans l’agriculture et l’industrie – et bouleversent les données économiques.
1.1. UN CONTINENT EN MUTATION
UNE RÉVOLUTION SCIENTIFIQUE
La France du xviiie s. ne peut s'enorgueillir d'avoir donné à la physique ou aux mathématiques des génies tels que Newton, Euler ou Gauss, mais l'apport français aux progrès des sciences est néanmoins indéniable. Tous les domaines sont représentés par de grands savants novateurs : en chimie, Lavoisier ; en mathématiques, Lagrange, Monge et Legendre ; ou encore en botanique, la famille Jussieu.
Dès lors, l'esprit humain se délivre des contraintes théologiques et formelles pour s'intéresser à la nature, dans une nouvelle démarche de recherche des connaissances, caractéristique de l'esprit même des Lumières.
DES ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES
Cette nouvelle conception du monde inclut une réflexion sur le gouvernement des sociétés humaines, qui sont elles-mêmes en mutation. Un essor démographique accompagne les progrès de cette époque. Une baisse générale de la mortalité, due au recul des trois principaux fléaux que sont la famine, la guerre et la peste, explique ce phénomène. La durée de vie s'allonge en moyenne de dix ans dans la seconde moitié du xviiie s. Ce type de changement structurel, associé aux mutations économiques, ébranle les équilibres sociaux.
L'ESSOR DE LA BOURGEOISIE
Vers 1740, partout en Europe, existe une société d'ordres fondée sur les privilèges. Alors qu'en Angleterre aucun obstacle juridique n'empêche la mobilité sociale, la France donne l'exemple opposé : des groupes sociaux entiers, tels que les paysans, restent ignorés de la nation. Par contre, au sein du tiers état, la bourgeoisie constitue une classe en pleine ascension dès lors qu'elle profite des développements industriels et commerciaux de cette période. L'essor urbain – généré par le surcroît de population – offre un cadre à ces nouveaux possédants qui cherchent à faire reconnaître leurs avantages en allégeant les entraves politiques et en évoluant vers une nouvelle société : on constate ainsi que beaucoup de philosophes et d'écrivains du xviiie s. (Voltaire, Beaumarchais…) sont issus de familles bourgeoises aisées.
1.2. LE FRANÇAIS, LANGUE DES LUMIÈRES
Les Lumières ne connaissent pas de frontières. Le mouvement touche toutes les élites cultivées d'Europe, et sa langue est le français, qui remplace le latin comme langue internationale de communication.
À la cour de Vienne ou de Saint-Pétersbourg, les Français sont à l'honneur ; et leurs livres, à la mode. Cette prépondérance tient au poids particulier de la France en Europe depuis Louis XIV, mais aussi au modèle de modernisme qu'elle incarne, à travers ses écrivains et ses savants, aux yeux des étrangers. Et, de fait, c'est en France que le mouvement des Lumières conquiert la plus large audience intellectuelle dans l'opinion.
Dans les autres États d'Europe continentale, il n'a entraîné qu'une partie des élites. Le cas de l'Angleterre est singulier : elle a précédé et influencé les Lumières françaises naissantes, mais ses élites n'ont pas prétendu se substituer au gouvernement ou à l'Église ; sa classe dirigeante est restée imprégnée de puritanisme et s'est plus préoccupée de commerce que de philosophie : elle s'est satisfaite des acquis de sa révolution de 1689.
2. QUE SONT LES LUMIÈRES ?
La pensée du siècle des Lumières se développe autour de deux thèmes majeurs : le retour à la nature, la recherche du bonheur. Les philosophes dénoncent dans les religions et les pouvoirs tyranniques des forces obscurantistes responsables de l'apparition du mal, dans un monde où l'homme aurait dû être heureux. Ils réhabilitent donc la nature humaine, qui n'est plus entachée par un péché originel ou une tare ontologique ; ils substituent à la recherche chrétienne du salut dans l'au-delà la quête ici-bas du bonheur individuel. À la condamnation des passions succède leur apologie : l'homme doit les satisfaire, à condition qu'elles ne s'opposent pas au bonheur d'autrui.
2.1. DES PHILOSOPHES MILITANTS
Cette nouvelle vision de l'homme et du monde, les philosophes la défendent en écrivains militants. Leur combat s'incarne dans la pratique de formes brèves, faciles à lire et susceptibles d'une vaste diffusion : lettres, contes, pamphlets.
Création littéraire et réflexion philosophique se nourrissent mutuellement. À cet égard, l'année 1748 marque un tournant, avec la parution et le grand succès de l'Esprit des lois, dans lequel Montesquieu analyse tous les régimes politiques et établit les rapports nécessaires qui unissent les lois d'un pays à ses mœurs, à son climat et à son économie. Par là apparaît bien le caractère relatif du régime monarchique. L'année suivante, Diderot publie sa Lettre sur les aveugles, et Buffon le premier volume de son Histoire naturelle. En 1751 paraît le Siècle de Louis XIV de Voltaire.
DIFFUSER LA « RÉVOLUTION DANS LES ESPRITS »
Cette même année 1751, les idées des Lumières se mêlent et s'affinent dans un creuset : l'Encyclopédie de Diderot, dont paraît le premier volume. Il s'agit d'une œuvre qui met à la portée de l'homme nouveau – le bourgeois, l'intellectuel – une synthèse des connaissances conçue comme un instrument pour transformer le monde et conquérir le présent.
Entre 1750 et 1775, les idées essentielles des Lumières se cristallisent et se répandent. « Il s'est fait une révolution dans les esprits […]. La lumière s'étend certainement de tous côtés », écrit Voltaire en 1765. Si après 1775 les grands écrivains disparaissent (Voltaire et Rousseau en 1778, Diderot en 1784), c'est le moment de la diffusion maximale, tant géographique que sociale, des Lumières ; l'opinion se politise, prend au mot leurs idées : la philosophie est sur la place publique. L'œuvre de l'abbé Raynal (Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes, 1770), qui condamne le despotisme, le fanatisme et le système colonial, connaît un grand succès. Homme politique important autant que mathématicien, Condorcet publie des brochures contre l'esclavage et pour les droits des femmes, et prépare sa synthèse de l'histoire de l'humanité (Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain.
POUR UN DESPOTISME ÉCLAIRÉ…
En matière politique, les Lumières mettent en cause l'absolutisme et érigent le despotisme éclairé en modèle de gouvernement. Il s'agit de subordonner les intérêts privilégiés et les coutumes au système rationnel d'un État censé représenter le bien public, de favoriser le progrès économique et la diffusion de l'enseignement, de combattre tous les préjugés pour faire triompher la raison. Ce despotisme éclairé inspira Frédéric II en Prusse, Catherine II en Russie, Joseph II en Autriche. Mais les philosophes qui croyaient jouer un rôle positif en conseillant les princes, comme Voltaire auprès de Frédéric II et Diderot auprès de Catherine II, perdirent vite leurs illusions. Ce qu'ils avaient pris pour l'avènement de la raison et de l'État rationnel était en réalité celui de la raison d'État, cynique et autoritaire.
…OU UNE MONARCHIE MODÉRÉE ?
Montesquieu, lui, est favorable à une monarchie modérée, de type anglais, où la liberté est assurée par la séparation des trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. L'Angleterre est pour lui le royaume le mieux gouverné de l'Europe, parce que le citoyen y est protégé par la loi contre tout arbitraire et parce que le roi respecte la loi qu'il n'a pas élaborée lui-même, prérogative qui appartient aux représentants élus de la nation.
Pour autant, le rôle prééminent de la noblesse dans la nation et au Parlement n'est pas remis en cause. Montesquieu propose qu'en France les « pouvoirs intermédiaires » (clergé, noblesse, parlements judiciaires) exercent une forme de contrôle, comme représentants naturels de la nation, sur la monarchie : son libéralisme politique est donc limité aux élites.
UN CREUSET D'IDÉES NOUVELLES
Les écrivains-philosophes ne marchent pas tous du même pas. Des lignes de partage se dessinent entre un courant déiste (Voltaire) et un matérialisme convaincu (Diderot, d'Holbach), entre une revendication générale de liberté (Voltaire encore) et un souci d'égalité et de justice sociale (Rousseau). À la fin du siècle, une nouvelle génération – celle des Idéologues – tentera d'articuler théorie et pratique et de définir une science de l'homme qui, par la mise en œuvre de réformes politiques et culturelles, assure le progrès de l'esprit humain.
Mais, en réaction à l'affirmation de cette raison collective, le moi sensible revendique ses droits : Rousseau, qui a posé dans le Contrat social les conditions de légitimité de toute autorité politique, donne avec ses Confessions le modèle de l'expression authentique d'un être unique et fait de la remontée aux sources de l'enfance et du passé l'origine de toute création littéraire.
2.2. IDÉES ET IDÉAUX DES LUMIÈRES
Le fonds commun des Lumières réside dans un rejet de la métaphysique, selon laquelle la transcendance (Dieu) précède la réalité (le monde). Les termes en sont inversés : la transcendance est ce qui reste, ce qui résiste à toute analyse rationnelle, scientifique, historique. Par-delà leur diversité, les hommes des Lumières ont en commun cette attitude d'esprit inspirée de la méthode scientifique, de l'expérimentalisme de Newton et de Locke : chercher dans l'investigation empirique des choses les rapports, les corrélations, les lois qui les régissent, et qui ont été jusqu'à présent masqués par lespréjugés.
REJETER LES DOGMES
Du coup, la vérité est recherchée du côté du monde physique, de l'univers pratique. Avec les Lumières, le regard intellectuel curieux se détourne du ciel au profit du monde concret des hommes et des choses. Les dogmes et les vérités révélées sont rejetés. Les Lumières refusent la prétention de la religion à tout expliquer, à fournir les raisons ultimes ; elles veulent distinguer entre les différentes sphères de la réalité : le naturel, le politique, le domestique, le religieux, chacun ayant son domaine de pertinence et ses lois, chacun exigeant des savoirs et des méthodes de connaissance différents.
Rejet des dogmes mais pas rejet de Dieu. La plupart des intellectuels éclairés restent néanmoins déistes : pour eux, l'Univers est une mécanique admirablement réglée, dont l'ordre implique une intelligence ordonnatrice. « Je ne puis imaginer, dit Voltaire, que cette horloge marche et n'ait pas d'horloger. »
RECOURIR À LA RAISON EXPÉRIMENTALE
L'expérience occupe une place centrale dans la théorie de la connaissance du xviiie s. Cette méthode procède par l'observation, l'analyse, la comparaison. D'où l'importance du voyage comme moyen de connaissance ; d'où aussi le souci presque obsessionnel de la classification des faits, de la construction de tableaux : connaître, c'est décrire, inventorier, ordonner. Ainsi procède Buffon dans les trente-six volumes de son Histoire naturelle.
La raison expérimentale, dès lors, ne connaît pas de frontières : les Lumières opèrent une formidable expansion de la sphère de la connaissance scientifique. La raison est universelle ; à côté des sciences naturelles et des sciences de la vie se développent les sciences humaines : ethnologie, psychologie, linguistique, démographie. Dans l'Esprit des lois, Montesquieu invente une sociologie politique, en recherchant les rapports qui unissent les mœurs de chaque peuple et la forme de son gouvernement.
MARCHER VERS LE BONHEUR
La philosophie des Lumières procède d'un humanisme laïque : elle place l'homme au centre du monde, et entend œuvrer à son bonheur. Pour Voltaire, « le vrai philosophe défriche les champs incultes, augmente le nombre des charrues, occupe le pauvre et l'enrichit, encourage les mariages, établit l'orphelin. Il n'attend rien des hommes, mais leur fait tout le bien dont il est capable ».
Un tel humanisme se situe à rebours de l'espérance chrétienne : « La vertu consiste à faire du bien à ses semblables et non pas dans de vaines pratiques de mortifications », écrit encore Voltaire. Foin des prières et des cierges dans les églises, il faut des actes. Tout l'effort de connaissance est orienté vers l'utilité commune. Cette conception utilitariste fait du bonheur le bien suprême. Elle tourne le dos à l'idée chrétienne de purification par l'épreuve et la souffrance, ainsi qu'aux notions nobiliaires et militaires d'héroïsme et de gloire.
Il y a là un optimisme fondamental, aux effets mobilisateurs : les hommes des Lumières croient au progrès possible des connaissances, à la capacité de la raison de saper les conventions, les usages et les institutions qui contredisent la nature et la justice. Pour eux, l'avancée de la science garantit la marche vers le bonheur. Cette foi dans le progrès indéfini de l'humanité se trouve d'ailleurs confortée par les découvertes scientifiques et la croissance économique du siècle.
3. LA DIFFUSION DES LUMIÈRES
Le mouvement des Lumières se distingue des mouvements intellectuels qui l'ont précédé par son destinataire : l'opinion publique. Voltaire, Diderot et leurs amis sont des agitateurs d'idées ; ils veulent discuter, convaincre. Les progrès de l'alphabétisation et de la lecture dans l'Europe du xviiie s. permettent le développement de ce qu'on a appelé un « espace public » : les débats intellectuels et politiques dépassent le cercle restreint de l'administration et des élites, impliquant progressivement des secteurs plus larges de la société. La philosophie est à double titre « l'usage public de la raison », comme le dit Kant : à la fois le débat public, ouvert, contradictoire, qui s'enrichit de la libre discussion, et l'agitation, la propagande pour convaincre et répandre les idées nouvelles.
3.1. LES CAFÉS ET LES SALONS LITTÉRAIRES
Le siècle des Lumières invente, ou renouvelle profondément, des lieux propices au travail de l'opinion publique. Ce sont d'abord les cafés, où on lit et on débat, comme le Procope, à Paris, où se réunissent Fontenelle, Voltaire, Diderot, Marmontel, et qui sont le rendez-vous nocturne des jeunes poètes ou des critiques qui discutent passionnément des derniers succès de théâtre ou de librairie.
Ce sont surtout les salons mondains, ouverts par tous ceux qui ont quelque ambition, ne serait-ce que celle de paraître – et souvent, des femmes jouent un rôle essentiel dans ce commerce des intelligences, dépassant le simple badinage et la préciosité. Mais il faut y être introduit. Les grandes dames reçoivent artistes, savants et philosophes. Chaque hôtesse a son jour, sa spécialité et ses invités de marque. Le modèle est l'hôtel de la marquise de Lambert, au début du siècle. Plus tard, Mme de Tencin, rue Saint-Honoré, accueille Marivaux et de nombreux autres écrivains. Mme Geoffrin, Mme du Deffand, Julie de Lespinasse, puis Mme Necker reçoivent les encyclopédistes. Les gens de talent s'y retrouvent régulièrement pour confronter leurs idées ou tester sur un public privilégié leurs derniers vers. Mondaines et cultivées, les créatrices de ces salons animent les soirées, encouragent les timides et coupent court aux disputes. Ce sont de fortes personnalités, très libres par rapport à leurs consœurs, et souvent elles-mêmes écrivains et épistolières.
3.2. LES ACADÉMIES ET LES LOGES
Les académies sont des sociétés savantes qui se réunissent pour s'occuper de belles-lettres et de sciences, pour contribuer à la diffusion du savoir. En France, après les fondations monarchiques du xviie s. (Académie française, 1634 ; Académie des inscriptions et belles-lettres, 1663 ; Académie royale des sciences, 1666 ; Académie royale d'architecture, 1671), naissent encore à Paris l'Académie royale de chirurgie (1731) et la Société royale de médecine (1776). Le clergé et, dans une moindre mesure, la noblesse y prédominent. En province, il y a neuf académies en 1710, 35 en 1789.
Ces sociétés provinciales regroupent les représentants de l'élite intellectuelle des villes françaises. Leur composition sociale révèle que les privilégiés y occupent une place moindre qu'à Paris : 37 % de nobles, 20 % de gens d'Église. Les roturiers constituent 43 % des effectifs : c'est l'élite des possédants tranquilles qui siège là. Marchands et manufacturiers sont peu présents (4 %).
Toutes ces sociétés de pensée fonctionnent comme des salons ouverts et forment entre elles des réseaux provinciaux, nationaux, européens, échangeant livres et correspondance, accueillant les étrangers éclairés, lançant des programmes de réflexion, des concours de recherche. On y parle physique, chimie, minéralogie, agronomie, démographie.
Parmi les réseaux éclairés, le plus développé est celui de la franc-maçonnerie, quoique réservé aux couches supérieures et aux hommes. Née en Angleterre et en Écosse, la franc-maçonnerie, groupement à vocation philanthropique et initiatique, concentre tous les caractères des Lumières : elle est théiste, tolérante, libérale, humaniste, sentimentale. Elle connaît un succès foudroyant dans toute l'Europe, où l'on compte des milliers de loges en 1789. Les milieux civils, militaires et même religieux, liés aux appareils d'État, y sont tout particulièrement gagnés. Ni anticléricales (elles le seront au xixe s.) ni révolutionnaires, les loges ont contribué à répandre les idées philosophiques et l'esprit de réforme dans les lieux politiquement stratégiques. La discussion intellectuelle l'emporte sur le caractère ésotérique ou sectaire. Surtout, les élites y font, plus encore que dans les académies, l'apprentissage de l'égalité des talents, de l'élévation par le mérite et non par le privilège de la naissance.
3.3. LES BIBLIOTHÈQUES, LES LIVRES, LA PRESSE
Voisines des académies, souvent peuplées des mêmes hommes avides de savoir, les bibliothèques publiques et chambres de lecture se sont multipliées, fondées par de riches particuliers ou à partir de souscriptions publiques. Elles collectionnent les travaux scientifiques, les gros dictionnaires, offrent une salle de lecture et, à côté, une salle de conversation.
La presse enfin contribue à la constitution d'un espace public savant, malgré la censure, toujours active. Le Journal des savants, le Mercure de France, les périodiques économiques sont en fait plutôt ce que nous appellerions des revues. Par les recensions d'ouvrages et par les abonnements collectifs des sociétés de pensée, un public éloigné des centres de création peut prendre connaissance des idées et des débats, des découvertes du mois, sinon du jour.
4. L'ENCYCLOPÉDIE
Un ouvrage – ou plutôt un ensemble de 35 volumes auquel ont collaboré 150 savants, philosophes et spécialistes divers – incarne à lui seul la vaste entreprise humaniste et savante des Lumières : c'est l'Encyclopédie. Travail collectif mené sur près de vingt ans, le projet repose sur un animateur essentiel, Diderot, qui en définit ainsi l’objet : « Le but d'une Encyclopédie est de rassembler les connaissances éparses sur la surface de la Terre, d'en exposer le système général aux hommes avec qui nous vivons, et de le transmettre aux hommes qui viendront après nous, afin que les travaux des siècles passés n'aient pas été des travaux inutiles pour les siècles qui succéderont, que nos neveux, devenant plus instruits, deviennent en même temps plus vertueux et plus heureux... ». Mais cette somme est aussi un combat : sa rédaction et sa publication voient se heurter raison et religion, liberté et autorité.
4.1. UNE FORMIDABLE AVENTURE ÉDITORIALE
L’histoire de l’édition de L’Encyclopédie (ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers) est à la fois longue et complexe, jalonnée de succès et de revers pour les auteurs. Les hautes protections dont ceux-ci bénéficient ne sont d’ailleurs pas étrangères à la violence de la bataille : dans l’entourage même de Louis XV, Mme de Pompadour ou Guillaume de Malesherbes, directeur de la Librairie et responsable de la censure royale, soutiennent l’entreprise, tandis que la reine et les jésuites cherchent à la ruiner.
Les atteintes à la religion et les professions de foi matérialistes, nombreuses dans l’ouvrage, suscitent procès, demandes d’interdiction, pamphlets, arrêt du Conseil d’Etat. La parution des volumes est plusieurs fois interrompue et menacée. En cours de publication, l’imprimeur craint d’être enfermé à la Bastille, et supprime de sa propre initiative les passages qu’il juge les plus dangereux, ce qui complique un peu plus les choses.
4.2. UN MAÎTRE D’ŒUVRE : DIDEROT
Le succès final tient à la ténacité de Diderot, assisté les premières années de d’Alembert. Si l’ouvrage a pour point de départ la traduction et l’adaptation en français de la Cyclopaedia (1728) de l’Anglais Ephraim Chambers, le chantier, que leur a confié le libraire et éditeur Le Breton, va bien au-delà. L’idée de traduire Chambers est abandonnée : une œuvre originale s’annonce.
Diderot a le culte des idées, de la raison humaine et du progrès, ce qui fait de lui le représentant par excellence des Lumières. Il vise en fait à livrer un panorama complet des connaissances scientifiques et du débat philosophique au milieu du xviiie siècle. L’équipe des rédacteurs est nombreuse, car le principe retenu a été de s’adresser aux spécialistes des questions traitées, de façon à atteindre une exactitude technique irréprochable.
Mais derrière les noms plus ou moins illustres des contributeurs, Jean-Jacques Rousseau, ou Voltaire, l’architecte Blondel, l’astronome Le Roy, le juriste Toussaint, etc., c’est Diderot qui demeure maître d’œuvre et relit, corrige, et coordonne plus de 71 000 articles.
4.3. UNE PLACE DE CHOIX POUR L’ILLUSTRATION
La place qu’elle réserve aux illustrations est une caractéristique de l’Encyclopédie, et un fardeau supplémentaire dans une aventure éditoriale compliquée.
Certes les gravures sont moins sujettes à polémiques que les articles de fond sur des notions abstraites ou complexes telle que « Raison », « Homme », ou « Christianisme ». Mais l’abondance et la qualité d’exécution de ces gravures suscitent des frais importants, envisagés dès le départ dans un pari de rentabilité : en 1750, lors de la première offre aux souscripteurs de l’ouvrage, il est prévu 2 volumes de planches pour 8 volumes de textes.
L’Encyclopédie se compose finalement de 17 volumes de textes et de 11 volumes de planches (plus 2 volumes d’index et 5 de suppléments). Ainsi le principe de l’image est-il renforcé en cours de route, et l’illustration joue-t-elle sa part, considérable, dans la visée encyclopédique. Les machines qui sont démontées et détaillées, les outils qui sont présentés et expliqués contribuent à un éloge du génie humain à travers son expression la plus positive.
4.4. UN BEST-SELLER AU XVIIIe SIÈCLE
La masse des souscripteurs de l’Encyclopédie varie au cours des vingt et une années qui s’écoulent entre la sortie du premier volume et du dernier, de 1751 à 1772. Au moment où le livre va commencer à paraître, ils sont 1000 qui s’engagent à l’acheter et acceptent d’avancer 20 % du montant du prix total. Par la suite, ce nombre double, triple et même quadruple pour enfin se stabiliser autour de 2 500.
L’ouvrage ayant été imprimé à plus de 4 000 exemplaires – ce qui est considérable pour l’époque –, la vente ferme d’un peu plus de la moitié du tirage est faite avant l’arrivée du livre en librairie. Outre les esprits cultivés étrangers lisant le français, les imitations et traductions assureront la diffusion de l’œuvre dans toute l’Europe, y répandant l’esprit des Lumières.
PLAN
*
* 1. UN MOUVEMENT EUROPÉEN
* 1.1. Un continent en mutation
* 1.2. Le français, langue des Lumières
* 2. QUE SONT LES LUMIÈRES ?
* 2.1. Des philosophes militants
* 2.2. Idées et idéaux des Lumières
* 3. LA DIFFUSION DES LUMIÈRES
* 3.1. Les cafés et les salons littéraires
* 3.2. Les académies et les loges
* 3.3. Les bibliothèques, les livres, la presse
* 4. L'ENCYCLOPÉDIE
* 4.1. Une formidable aventure éditoriale
* 4.2. Un maître d’œuvre : Diderot
* 4.3. Une place de choix pour l’illustration
* 4.4. Un best-seller au xviiie siècle
Articles associés
Alexandre Ier.
Empereur de Russie...
athéisme.
Doctrine qui nie l'existence de Dieu.
Aufklärung (Zeitalter der).
Mouvement de pensée rationaliste, qui s'efforça de promouvoir une émancipation...
Beaumarchais.
Pierre Augustin Caron de Beaumarchais. Écrivain français...
Buffon.
Georges Louis Leclerc, comte de Buffon. Naturaliste et écrivain français...
Calas (affaire).
Erreur judiciaire due à l'intolérance religieuse et dont la victime fut...
Catherine II
la Grande. Impératrice de Russie...
Condillac.
Étienne Bonnot de Condillac. Philosophe français...
Condorcet.
Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet. Philosophe, mathématicien et homme politique français...
culture.
[PHILOSOPHIE] Connaissances dans un domaine particulier.
Voir plus
Chronologie
* 1721 Les Lettres persanes, roman philosophique de Montesquieu, où l'auteur réalise une critique des mœurs parisiennes et de la société française.
* 1747 Zadig ou la Destinée, conte philosophique de Voltaire.
* 1748 De l'esprit des lois, ouvrage de Montesquieu, dans lequel l'auteur montre les rapports qu'entretiennent les lois avec la constitution des États, les mœurs, la religion, le commerce, le climat et la nature des sols des pays.
* 1751-1772 Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, publication dirigée par D. Diderot, précédée du Discours préliminaire de d'Alembert, à laquelle participèrent outre Voltaire, Montesquieu et Rousseau, des médecins et des ingénieurs.
* 1754 Traité des sensations, ouvrage de Condillac.
* 1755 Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, par J.-J. Rousseau, où l'auteur montre comment la vie sociale, en créant des inégalités entre les hommes, a corrompu leur nature, qu'il affirme bonne à l'origine.
* 1757 Le Fils naturel, drame de D. Diderot, prototype du drame bourgeois.
* 1758 De l'esprit, ouvrage d'Helvétius, qui montre que nos idées proviennent de l'expérience sensible et l'inégalité, de l'éducation.
* 1759 Candide, conte de Voltaire.
* 1761 La Nouvelle Héloïse, roman épistolaire de J.-J. Rousseau.
* 1762 Du contrat social, ouvrage inachevé de J.-J. Rousseau.
* 1762 Le Neveu de Rameau, dialogue de D. Diderot, publié en 1821 en français.
* 1762 Émile ou De l'éducation, roman pédagogique de J.-J. Rousseau, où l'auteur part du principe que « l'homme est naturellement bon » et que, l'éducation donnée par la société étant mauvaise, il faut élever l'enfant loin d'elle pour qu'il la régénère quand il s'y intégrera.
* 1771-1773 Jacques le Fataliste et son maître, roman de D. Diderot.
* 1782-1789 Les Confessions, de J.-J. Rousseau.
DOCUMENT larousse.fr LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
LA TERRE |
|
|
| |
|
| |
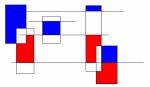
Terre
Consulter aussi dans le dictionnaire : terre
Cet article fait partie du dossier consacré au monde et du dossier consacré à l'histoire de la Terre.
Planète du système solaire habitée par l'homme (avec une majuscule).
ASTRONOMIE ET GÉOLOGIE
La Terre est la troisième, par la distance, des huit planètes principales qui tournent autour du Soleil. Cette situation orbitale ainsi que ses caractéristiques de masse concourent à en faire un astre « privilégié » : sa masse lui a permis de retenir une atmosphère suffisamment épaisse, qui la protège du rayonnement solaire ; son éloignement moyen du Soleil autorise la présence de l'eau sous forme liquide, condition impérative au développement de la vie. Car telle est bien l'originalité de la Terre : l'apparition de la vie à sa surface et son expansion dans une couche, la biosphère, inexistante sur les autres planètes du Système solaire.
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET ORBITALES DE LA TERRE
1. LES DONNÉES ASTRONOMIQUES DE LA TERRE
Prototype des planètes telluriques, la Terre décrit autour du Soleil une orbite elliptique à une distance moyenne de 149,6 millions de km. Le plan de cette orbite est l'écliptique. La Terre tourne aussi autour d'un axe passant par son centre de gravité (axe des pôles). La révolution autour du Soleil (en 365 jours) détermine la durée de l'année, et la rotation autour de l'axe des pôles (en 23 h 56 min), celle du jour, avec ses variations suivant les saisons.
La forme de la Terre est voisine de celle d'une sphère, légèrement aplatie aux pôles. Cette forme est conditionnée essentiellement par les forces de pesanteur auxquelles sont adjointes les actions dues à la rotation, ce qui détermine, en particulier, le géoïde.
La masse de la Terre peut se déduire de l'intensité du champ de pesanteur, de la connaissance de ses dimensions et de la valeur de la constante d'attraction universelle : elle est de 5,98.1024 kg, ce qui correspond à une masse volumique moyenne de 5,52.103 kg/m3, la répartition de cette masse se faisant par couches concentriques.
Parmi les caractères spécifiques de la planète Terre, il faut retenir : l'existence de son satellite naturel, la Lune, qui joue un rôle fondamental dans le phénomène des marées ; la propriété du globe terrestre de posséder un champ magnétique relativement intense (comparé à celui des autres planètes telluriques) qui a subi un grand nombre de renversements au cours de son histoire.
→ paléomagnétisme.
2. L’ÂGE ET L’ORIGINE DE LA TERRE
2.1. LA FORMATION DE LA TERRE
L'âge de la Terre est aujourd'hui estimé à 4,6 milliards d'années. La Terre se serait formée au sein d'une masse gazeuse, avec condensation et décantation progressives (→ accrétion), sous les effets combinés des forces de gravité et des divers processus de transformation énergétique (notamment la libération des énergies de « condensation » gravimétrique et de celles dues aux réactions d'ordre nucléaire).
Ces processus ne sont pas foncièrement différents de ceux que l'on fait intervenir dans la formation de la majorité des objets célestes. La Terre primitive, à très haute température, était sans doute en grande partie à l'état fondu. Dans cette matière en fusion, la gravité a engendré une différenciation entre un noyau très dense et des couches périphériques plus légères, ce qui explique la différence entre la densité moyenne du globe et la densité des roches de surface.
2.2. LA FORMATION DE LA CROÛTE TERRESTRE
Les théories de l'expansion des fonds océaniques et de la tectonique des plaques ont reçu un apport expérimental concret par la mise en évidence (depuis les années 1960) du rôle fondamental joué par les dorsales océaniques. Celles-ci sont le résultat d'un épanchement continu d'un magma sous-jacent, de caractère basaltique, qui, en se déversant de part et d'autre, reforme sans cesse de nouveaux fonds marins et repousse les fonds anciens.
Ce modèle rend bien compte de la faible épaisseur de la croûte terrestre, formée majoritairement de silice et d'alumine et dont la densité est de l'ordre de 2,7, par contraste avec les couches plus profondes, principalement du manteau, plus riche en magnésium, fer, etc., et plus dense, de l'ordre de 3,3 sous les océans.
Pour en savoir plus, voir l'article géologie.
La question des âges, périodes ou ères géologiques relève de la stratigraphie et de la géochronologie. En effet, reconstituer l'histoire de la Terre exige de dater les événements enregistrés dans les roches. Les datations peuvent être relatives et permettent de comparer deux roches ou situer un événement par rapport à un autre. Mais il faut aussi connaître l'âge absolu. La radiochronologie, fondée sur la radioactivité naturelle et la loi de décroissance radioactive des radionucléides, permet de donner un âge aux formations géologiques (→ ères géologiques). La combinaison des datations relatives et absolues a conduit à l'élaboration de l'échelle stratigraphique qui sert de référence aux études géologiques.
Pour en savoir plus, voir l'article histoire de la Terre.
3. LA STRUCTURE DE LA TERRE
La Terre est une succession de couches, solides, liquide et gazeuse, plus ou moins emboîtées.
L'enveloppe gazeuse constitue l'atmosphère, formée d'éléments légers volatils, qui proviennent du dégazage du globe solide.
L'enveloppe liquide, ou hydrosphère, comprend l'ensemble des mers, océans, rivières et glaciers, banquise ; sa composition moyenne est pratiquement celle de l'eau de mer (→ eau).
Les couches solides sont, en proportion de leur masse, les plus importantes. Schématiquement, la partie solide de la Terre se divise en trois zones concentriques qui sont : la croûte, le manteau (subdivisé en manteau supérieur et manteau inférieur) et le noyau (subdivisé en noyau externe et noyau interne ou graine).
Ces résultats sont déduits principalement de l'interprétation des observations sur la propagation des ondes sismiques (→ sismologie), renforcée par de puissants moyens informatiques qui permettent aujourd'hui de réaliser des tomographies sismiques. On fait aussi appel à des méthodes gravimétriques, géothermiques, magnétiques et électromagnétiques, etc., sans oublier les données géologiques.
3.1. LA CROÛTE TERRESTRE
De toutes ces zones, la croûte est à la fois la zone la plus connue et la moins connue de par sa complexité et sa variabilité. Globalement, on distingue : la croûte continentale, de 30 à 40 km d'épaisseur environ (atteignant 75 km parfois, sous les montagnes), comprenant des roches sédimentaires ou métamorphiques sur quelques kilomètres, « posées » sur une couche de type granitique ; la croûte océanique, d'environ 5 à 10 km d'épaisseur, composée en majorité de basalte. Le passage de la croûte au manteau se situe le long de la discontinuité de Mohorovičić (ou moho), liée à une variation brusque de vitesse des ondes sismiques la traversant, qui est considérée comme enveloppant le manteau d'une façon continue.
3.2. LE MANTEAU TERRESTRE
Sous cette discontinuité, le manteau s'étend jusqu'à une profondeur de 2 900 km environ. La viscosité des solides qui constituent le manteau terrestre conduit à de gigantesques mouvements de convection. La base du manteau est limitée par la discontinuité de Gutenberg. Le fait marquant à ce niveau est la disparition des ondes sismiques de cisaillement, montrant le passage de matériaux solides à un noyau fluide.
3.3. LE NOYAU
Le noyau se divise en noyau externe, fluide, jusqu'à une profondeur de 5 100 km, et noyau interne, solide, appelé graine, de 1 250 km d’épaisseur, où règne une température comprise entre 3 800 et 5 500 °C selon la profondeur. Le noyau externe, de 2 225 km d’épaisseur, composé en majorité de fer en fusion, serait le siège de phénomènes convectifs à l'origine du champ magnétique terrestre.
3.4. AUTRE DÉCOUPAGE
À cette décomposition de nature chimique et minéralogique se superpose une décomposition de nature physique qui traduit un changement de l'état cristallin de la matière. Ce découpage est le suivant :
– la lithosphère, enveloppe externe rigide pouvant atteindre 100 km d'épaisseur sous les continents (c'est la zone mise en jeu dans la théorie de la tectonique des plaques) ;
– l'asthénosphère, marquée par une faible résistance mécanique due à un état visqueux des matériaux la composant, jusqu'à 350 à 400 km de profondeur environ ;
– la mésosphère, rigide dans sa partie haute jusqu'à 650 km environ.
Pour en savoir plus, voir l'article géologie.
4. LE CHAMP MAGNÉTIQUE TERRESTRE
La Terre est affectée d'un champ magnétique dont l'axe est légèrement décalé (11,5°) par rapport à l'axe de rotation de la Terre. Le magnétisme est provoqué par le mouvement du magma métallique dans le noyau externe liquide qui tourne autour du noyau interne solide. Il n’est pas dû au fer qui compose le noyau. Ces mouvements font que le globe terrestre se comporte comme si un énorme aimant droit était placé en son centre.
→ géomagnétisme.
Cependant, les lignes de force magnétiques ne se développent pas symétriquement dans l'espace d'un pôle à l'autre : les sondes spatiales ont ainsi établi que la zone d'influence de ce champ dans l'espace est limitée par une frontière, la magnétopause, sur laquelle viennent buter les particules chargées qu'émet, en permanence, le Soleil.
Le champ magnétique terrestre présente également des variations à court terme (de l'ordre de la journée, du mois ou de l'année) de faible intensité (0,1 % du champ total), qui sont provoquées par des perturbations dans la magnétosphère (par exemple, les aurores polaires). Il existe aussi des variations séculaires, voire carrément des inversions du champ. Ces dernières sont notamment enregistrées par les roches éruptives durant leur refroidissement (aimantation thermorémanente).
La cartographie précise de la direction d'aimantation enregistrée par ces roches permet de dresser des cartes de la dérive des continents, de la dérive apparente des pôles, de l'expansion du plancher des océans, et d'étalonner les successions stratigraphiques de sédiments par référence aux données paléomagnétiques successives qui y ont été enregistrées sur une même verticale, donc dans le temps (magnétostratigraphie).
Pour en savoir plus, voir les articles géochimie, géologie, géophysique, roche.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
AFGHANISTAN |
|
|
| |
|
| |
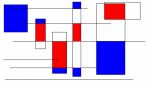
Afghanistan
DOCUMENT larousse.fr LIEN
État d'Asie centrale, l'Afghanistan est limité au nord par le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan, au nord-est par la Chine, au sud-est par le Pakistan et à l'ouest par l'Iran.
* Superficie : 650 000 km2
* Nombre d'habitants : 30 552 000 (estimation pour 2013)
* Nom des habitants : Afghans
* Capitale : Kaboul
* Langues : dari et pachto
* Monnaie : afghani
* Chef de l'État : Ashraf Ghani
* Chef du gouvernement : Ashraf Ghani
* Constitution :
* Adoption : 4 janvier 2004
* Entrée en vigueur : 26 janvier 2004
Pour en savoir plus : institutions de l'Afghanistan
GÉOGRAPHIE
C'est un pays en majeure partie montagneux (surtout au nord : Hindu Kuch) et aride (souvent moins de 250 mm de pluies), ouvert par quelques vallées (Amou-Daria au nord, Helmand au sud). Au pied des reliefs, relativement arrosés, se sont développées les cultures céréalières et fruitières et implantées les principales villes (Kaboul, Kandahar, Harat). Le reste du pays est surtout le domaine de l'élevage, souvent nomade, du mouton. La culture du pavot (opium), officiellement interdite, demeure florissante. Les richesses minières du sous-sol (cuivre, lithium) semblent prometteuses. La population, islamisée, présente une grande diversité ethnique, avec des éléments appartenant au groupe iranien (Pachtouns [40 %] et Tadjiks [30 %]) et d'autres d'origine turque (Ouzbeks, Turkmènes, Kirghiz). Elle a gravement souffert, en même temps que toute l'économie du pays, de l'occupation soviétique des années 1980, et des divers conflits qui se sont succédé depuis.
1. LE MILIEU NATUREL
L'Afghanistan est un haut pays dont l'ossature est constituée par un axe montagneux médian qui, de direction ouest-est, à l'ouest (où il est scindé en trois faisceaux parallèles, séparés par les hautes vallées du Mourgab et du Hari Rud) et au centre (où il se soude en une masse unique, le Kuh-e Baba), se redresse dans l'Est (vers une direction S.-O./N.-E.), dans l'Hindu Kuch, qui va se fondre dans le nœud orographique du Pamir. Sur le versant nord de l'arc montagneux médian, les collines et les plaines de piémont du Turkestan afghan descendent jusqu'à 250-300 m d'altitude vers l'Amou-Daria, qui délimite la frontière avec le Turkménistan et l'Ouzbékistan. Au sud-ouest, les cuvettes du Sistan, où se perd le Helmand, s'abaissent jusqu'à 460 m. La frontière avec le Pakistan est occupée par un autre axe montagneux (les chaînes du Paktia, 3 500 m), qui va se fondre à la hauteur du bassin de Kaboul (1 800 m) dans l'Hindu Kuch, dont le sépare au sud-ouest le fossé Kandahar-Ghazni. À l'est, la vallée de la rivière de Kaboul donne accès au Pakistan par le bassin de Djalalabad et la passe de Khaybar.
Le climat de ces hautes terres est très rude, extrêmement continental et en même temps fortement marqué par l'aridité, la plus grande partie du pays ne recevant guère que de médiocres pluies d'orages de printemps ou les dernières précipitations apportées par des dépressions hivernales d'origine méditerranéenne qui arrivent ici très effacées. Le Sud-Est reçoit seul les derniers effluves de la mousson indienne (pluies d'été qui constituent la majeure partie des précipitations jusque dans la région de Kaboul). Le total des précipitations tombe à moins de 100 mm par an dans le Sistan. Il se tient vers 200-400 mm sur les piémonts nord et sud des montagnes médianes et ne devient appréciable que sur les sommets de l'Hindu Kuch oriental, où il peut dépasser un mètre, et sur les chaînes du Sud-Est arrosées par la mousson. C'est là que se trouvent les seules véritables forêts du pays (étage inférieur de chênes et pins ; cèdres deodars en altitude), qui alimentent une exportation régulière et une contrebande active vers le Pakistan. Les montagnes centrales ne comportent, au-dessus des steppes à pistachiers des piémonts, qu'un étroit étage de forêts de genévriers (entre 2 000 et 2 700 m d'altitude, au-dessous de la steppe alpine), d'ailleurs presque complètement détruit aujourd'hui.
Trois décennies consécutives de guerre (depuis 1979) ont bouleversé la géographie économique et humaine de l'Afghanistan. Victime, en raison de sa situation géopolitique, du « grand jeu » entre les Britanniques et les Russes, puis entre les États-Unis et l'ex-U.R.S.S., le pays accuse un retard économique et social parmi les plus forts du monde.
2. LES POPULATIONS
Dans ce contexte aride, les montagnes médianes ont servi de refuge à des populations sédentaires, essentiellement de langue persane (parlée par environ le quart de la population du pays), qui s'y sont accrochées dans des terroirs irrigués de fond de vallée, aménagés en terrasses, et entourés de cultures pluviales sur les pentes, tandis que les piedmonts steppiques étaient submergés par des populations nomades lors des grandes invasions médiévales turco-mongoles. Mais l'axe montagneux a été d'autant plus imperméable au nomadisme qu'il était plus élevé et plus arrosé. Dans l'Est se sont maintenues des populations de langue darde (groupe intermédiaire entre les parlers indiens et iraniens), restées païennes (les Nurestanis ou Kafirs [infidèles]) jusqu'à la fin du xixe s., à côté des Tadjiks de langue persane qui y sont la population dominante, cultivateurs habiles et artisans, dans les bourgades et les villes (Kaboul) du piedmont. Les Tadjiks, qui constituent l'ancienne population aborigène persane, parlent un dialecte persan khorassanien (dari) ; ils sont sédentaires et détribalisés de longue date. Au centre, les Hazara, également de langue persane, ont subi une influence turco-mongole beaucoup plus prononcée, qu'ils ont assimilée linguistiquement, mais qui a laissé des marques dans le genre de vie (abris dérivés de la yourte comme habitats d'été). À l'O. (plus morcelé et plus sec), les Tchahar Aymaq (« les quatre tribus »), de langue également persane, mais franchement semi-nomades, ont été fortement influencés par la culture matérielle des nomades turcs. Sur le versant nord des montagnes médianes, ceux-ci ont totalement submergé les vieux agriculteurs autochtones du piedmont. Une importante minorité turcophone (15 à 20 % de la population totale du pays) se partage, dans ce qui est devenu le « Turkestan afghan », entre les deux peuples dominants de basse Asie centrale : Ouzbeks à l'E. et Turkmènes en cours de détribalisation à l'O.
Au sud des montagnes médianes, enfin, s'est individualisé le peuple des Pachtouns (ou Pathans), parlant une langue iranienne orientale (pachto), dont d'importantes fractions, à la suite du contrecoup des invasions médiévales, sont passées au nomadisme dans les déserts méridionaux et s'y sont organisées en grandes confédérations, Durrani au S. et la grande tribu nomade des Rhalzays (ou Ghalzays) qui estivent dans les montagnes centrales. Peuple dominant du pays, les Pachtouns ont été à l'origine de l'État afghan au xviiie siècle Abd-al-Rahman (1880-1901), puis ses successeurs, ont favorisé leur extension plus ou moins dans tout le pays, dans le but d'asseoir leur domination politique. Ils ont ainsi ouvert les hauteurs du Hazaradjat aux nomades du Sud comme pâturages d'été, puis ont installé dans le Turkestan d'importants groupes, nomades ou sédentaires.
Les principales minorités mixtes sont des Baloutches au S., des Kirghiz au N.-E., des Jats, des Kizil Bach, des sikhs, et des peuples dits « arabes ». La confession dominante est l'islam sunnite hanafite. Les Hazara et une partie de la population persane aborigène sont chiites duodécimains ou parfois ismaéliens. Les structures tribales sont généralement désagrégées, à l'exception des tribus pachtouns et, dans une moindre mesure, des Hazara. Le pouvoir politique traditionnel est assumé par le khan, ou mir, assisté d'un conseil tribal ou « des barbes blanches ». La propriété foncière est liée à celle de l'eau d'irrigation, les terres non irriguées étant collectives. La semi-nomadisation est répandue : réduite (campement d'été sur les champs en friche, assurant leur fertilisation) ou à moyenne et longue distance entre les pâtures de montagne, l'été, et les vallées, l'hiver. L'habitat d'hiver est généralement la maison de terre séchée à toit plat ou à dôme ; l'habitat d'été est, au N., la yourte mongole circulaire, au S., la tente noire de poils de chèvre (habitat unique des nomades). Les mariages interethniques sont rares ; les mariages entre cousins, ou mieux les mariages croisés, sont préférés en raison de la dot élevée. La monogamie domine. Avec 6,6 enfants par femme, le taux de fécondité du pays est l'un des plus élevés du monde, derrière celui du Niger. L'espérance de vie à la naissance, inférieure à 44 ans, est la plus faible du monde.
Turkmènes et Ouzbeks pratiquent de nombreux artisanats (tapis, feutre, métaux, etc.).
La répartition du peuplement opposait traditionnellement les piémonts du Nord aux terres méridionales, beaucoup moins peuplées. Mais les mouvements de population et le million de morts lié à la guerre avec l'Union soviétique ont contribué à la désertification de plusieurs régions : les régions frontalières du Pakistan et de l'Iran ont ainsi perdu plus de 80 % de leurs habitants, tandis que la région de Kaboul a connu une augmentation de 40 % de sa population.
3. LE SECTEUR AGRICOLE ET LE MONDE RURAL
L'Afghanistan constitue un cas extrême de sous-développement, qui s'explique en partie par l'isolement du pays, dû à la situation continentale, mais aussi au rôle d'État tampon entre les possessions russes et britanniques en Asie, qu'aucune grande puissance n'avait intérêt à ouvrir vers l'extérieur. C'est seulement depuis 1964 qu'un tunnel à travers le col du Salang, à plus de 3 000 m d'altitude, a permis la construction d'une route carrossable en hiver entre les deux versants de l'Hindu Kuch, et la route de rocade périphérique à revêtement stable qui fait le tour du pays n'est pas encore complétée au N.-O. L'Afghanistan, d'autre part, n'a pas de réseau ferroviaire.
Le secteur agricole occupe encore plus de la moitié de la population active et fournit le tiers du produit intérieur brut. Une des originalités de l'Afghanistan réside dans l'importance du nomadisme : environ 6 à 7 % de la population le pratique sur la quasi-totalité du territoire. Le nomadisme pastoral (moutons et chèvres), qui a longtemps dominé l'agriculture sédentaire, est aujourd'hui en net recul. Il n'aboutit pas toujours, cependant, à une sédentarisation mais se traduit, souvent, par la recherche de travaux saisonniers. Le reste de l'activité agricole se répartit entre les fonds de vallées et les oasis des piémonts. Ces dernières sont dépendantes, pour la plupart, de l'irrigation, qui y est très ancienne : on distingue les oasis à karez (galeries drainantes souterraines) des grandes oasis fluviales. La construction de barrages modernes (Dahla, Kadjakay, Darounta) ont permis une augmentation notable de la surface irriguée. La culture céréalière d'hiver (blé et orge) prédomine, tandis que le riz, le maïs et le coton (au nord) sont cultivés, l'été, lorsque l'eau est suffisante (ce qui n'est pas le cas de la majorité des oasis). Les fonds de vallées permettent une agriculture plus intensive, en terrasses irriguées, grâce à une pluviométrie plus importante.
4. LE SECTEUR INDUSTRIEL
Seulement le cinquième de la population afghane est urbaine. Kaboul, avec plus de 3 millions d'habitants, concentre la plupart des activités industrielles du pays. Les secteurs dominants sont l'agroalimentaire, le textile (coton) et les constructions mécaniques. L'artisanat (tapis, soieries, orfèvrerie, etc.) reste actif. La rivière de Kaboul, en aval de la capitale, permet son alimentation en énergie grâce à ses centrales hydroélectriques. Mais l'afflux de réfugiés (la ville ne comptait que 900 000 habitants en 1979) a profondément déséquilibré le réseau urbain en sa faveur. Le second pôle industriel du pays se trouve au nord, autour de Mazar-e Charif, qui comprend des usines chimiques (engrais) et textiles. Le sous-sol afghan ne recèle pas de pétrole mais possède un gisement de gaz naturel, au nord, dans le Turkestan afghan (Chebarghan). Les autres ressources minières sont très difficilement exploitables à cause du relief, mais elles semblent prometteuses (cuivre, lithium...). L'existence de lapis-lazuli dans le Badakhchan n'a guère qu'une importance symbolique, tandis que le charbon de l'Hindu Kuch, à l'est, produit environ 1 000 tonnes par an, une quantité négligeable. Le pays dispose d'un fort potentiel énergétique (électricité, gaz), encore inexploité.
L'état de l'économie afghane est catastrophique. Les exportations (gaz, fruits secs, dérivés du textile, peaux et cuirs) sont inférieures aux importations et le pays dépend largement de l'aide internationale et humanitaire. L'Afghanistan est redevenu en 2002 le premier producteur mondial d'opium. La culture du pavot a retrouvé le niveau record de la fin des années 1990, après avoir très fortement diminué sous le régime des talibans qui l'avaient interdite en 2000.
HISTOIRE
1. INTRODUCTION : UN CARREFOUR DE CIVILISATIONS
Situé au cœur de l'Asie, l'Afghanistan est le lieu de rencontre des nomades, Scythes, Huns, Turcs, Mongols, et des grandes civilisations sédentaires, souvent expansionnistes, d'Iran, de Chine et d'Inde. Des voies internationales, utilisées très anciennement, le traversent : la plus prestigieuse est la « route de la soie », qui évoque l'antique commerce entre la Chine et Rome ; d'autres, souvent des variantes de celle-ci, ont été, au cours des siècles, empruntées par les armées, les missionnaires et les commerçants. Aussi l'Afghanistan reçoit-il toutes les influences ; mais il ne se contente pas de les subir, il est un creuset et donne peut-être autant qu'il emprunte. Ainsi joue-t-il, par exemple, un rôle capital dans la diffusion du bouddhisme vers l'Est et de l'islam en Inde.
Relevant en définitive essentiellement du monde iranien, il ne forme un État qu'à une date récente ; pendant des siècles, il dépend de vastes empires, parfois créés par ses habitants, parfois les englobant seulement. De structure tribale, et ethniquement diversifié par les dépôts des invasions (turcophones et Mongols surtout), il professe néanmoins un nationalisme qui reflète le sens aigu de la communauté culturelle et l'amour des antiques traditions. Presque exclusivement musulman sunnite (→ sunnisme), il accorde une place essentielle au fait religieux.
2. DES ORIGINES À LA NAISSANCE DE L'AFGHANISTAN MODERNE
2.1. LES ARYENS
La préhistoire est encore mal connue. Les missions françaises ont cependant mis au jour, à Mundigak, sept niveaux de civilisation s'étageant du IVe millénaire aux alentours de l'an 500 avant J.-C. C'est à une époque indéterminée que les Aryens, venus de l'ouest, occupent le pays et fixent son ethnie de base.
DANS L'EMPIRE PERSE
Sous les Achéménides, l'Afghanistan, sans doute intégralement conquis par Cyrus, est divisé en cinq satrapies par Darios Ier. La pax iranica y règne pendant deux siècles, ce qui lui permet de participer au grand essor de l'Iran et de se laisser imprégner par la réforme religieuse de Zarathushtra.
CENTRE D'UNE CIVILISATION GRÉCO-BOUDDHIQUE
La conquête d'Alexandre (329 avant J.-C.) provoque, plus qu'ailleurs, une symbiose de la Grèce, de l'Iran et de l'Inde. Mais les satrapies subsistent et, à la mort d'Alexandre, entrent en lutte intestine. Les Séleucides, la dynastie indienne des Maurya et le royaume de Bactriane dominent tour à tour.
L'EMPIRE KUSHANA
À la fin du iie siècle avant J.-C., de nouvelles invasions aryennes amènent la prépondérance de la tribu kushana, qui atteint son apogée sous Kujula (en grec Kadphisês) au ier siècle après J.-C. et sous Kanishka au iie siècle. Malgré la présence d'autres courants religieux (autel du feu à Surkh Kotal), le pays se livre alors au bouddhisme (grand sanctuaire de Bamiyan). Son très grand essor est seulement freiné par le retour en force de l'Iran avec les Sassanides (iiie siècle) et les invasions des Huns Blancs ou Hephthalites (Turco-Mongols), qui font régner insécurité et oppression.
2.2. DES ARABES AUX SÉFÉVIDES
UNE LENTE ISLAMISATION
En 651 (conquête de Harat), les Sassanides sont vaincus par les armées arabes, qui occupent le pays. Elles se heurtent à une vive résistance qui empêche toute arabisation et rend l'islamisation fort lente : l'antique Kapisha (région de Kaboul) ne sera convertie qu'à la fin du ixe siècle, et, jusqu'au xiiie siècle, il subsistera de nombreuses principautés vassales ou indépendantes.
LES GHAZNÉVIDES
Dans le Nord, les Samanides, Iraniens originaires de Saman, près de Balkh, obtiennent la prépondérance. Les mercenaires turcs qu'ils recrutent amènent une ère nouvelle. En 962, l'un d'eux, Alp Tigin, se rend indépendant dans la région de Ghazni. Ses successeurs, et surtout Mahmud (999-1030), à la tête de la dynastie des Ghaznévides, étendent leur domination jusqu'à Ispahan et lancent dix-sept expéditions sur l'Inde. De Ghazni, rivale de Bagdad, ils font un centre remarquable, où brillent artistes et écrivains : parmi eux Ferdowsi (ou Firdusi), le poète national de l'Iran. Mais les Ghaznévides sont bientôt obligés de reconnaître la suprématie d'autres Turcs, les Grands Seldjoukides d'Iran, et disparaissent sous les coups de princes afghans, les Ghurides, qui se posent comme leurs héritiers : dès lors, Afghans et Turcs afghanisés fournissent princes et cadres des monarchies indo-musulmanes.
INVASIONS MONGOLES
Cette haute civilisation des xie et xiie siècles, égale à celle de l'Afghanistan bouddhique de jadis, sombre sous l'invasion de Gengis Khan, qui s'acharne particulièrement sur le pays (1221-1222).
LA RENAISSANCE TIMURIDE
Aux dévastations mongoles s'ajoutent celles de Timur Lang (Tamerlan), qui se fait couronner à Balkh en 1370 et est responsable, entre autres, de la ruine du riche système d'irrigation : le pays ne s'en relèvera jamais. Pourtant, autour de Harat s'épanouit la Renaissance timuride, commencée avec Chah Rokh (1405-1447) et conduite à son sommet par Hoseyn Beyqara (Husayn Bayqara) [1469-1506] et son ministre Mir Ali Chir Navai.
PARTAGÉ ENTRE L'INDE ET L'IRAN
L'Afghanistan oriental, enfermé sur lui-même, revient à l'actualité quand le Turc Baber s'installe à Kaboul (1504) et conquiert l'Inde, où il fonde la dynastie dite des Grands Moghols, mais il demeure pour ceux-ci une province lointaine, négligée. À la même époque, l'Afghanistan occidental passe aux mains des Séfévides d'Iran.
3. NAISSANCE DE L'AFGHANISTAN MODERNE
3.1. FONDATION DE LA PREMIÈRE DYNASTIE NATIONALE AFGHANE
La décadence moghole et l'affaiblissement des Séfévides, au début du xviiie siècle, rendent leurs libertés aux remuantes tribus afghanes et permettent la naissance de l'Afghanistan moderne, que préfigurent la révolte et la déclaration d'indépendance de Mir Veys (Mir Ways) [1707], chef de la tribu Ghalzay. Mais les Ghalzays doivent affronter le mouvement national de Nader Chah (ou Nadir Chah), qui prend Kandahar et Kaboul en 1738. Un officier de Nader, Ahmad Khan, de la tribu des Abdalis, se proclame roi à Kandahar dès que Nader Chah est assassiné (1747) et fonde la dynastie des Durrani, première dynastie afghane indépendante. Comme ses devanciers, il intervient à plusieurs reprises en Inde, et il constitue un royaume vaste mais instable. Son successeur, Timur Chah, qui transfère sa capitale à Kaboul, le garde en paix, mais, à sa mort, ses fils et ses féodaux se disputent sa succession (1793).
3.2. ENTRE LES IMPÉRIALISMES ANGLAIS ET RUSSE
Finalement, Dust Mohammad (Dust Muhammad), actif dès 1818, est reconnu émir à Kaboul (1838) et il fonde la dynastie des Barakzay (ou Muhammadzay). Renonçant aux provinces indiennes, il se consacre entièrement à l'Afghanistan, devenu État tampon entre les impérialismes anglais et russe. Tour à tour victime et bénéficiaire de l'intervention britannique, Dust Mohammad est, lors de la première guerre anglo-afghane (1839-1842), remplacé par Chodja al-Molk (Chudja al-Mulk) [1839], puis, à la suite d'une insurrection et de la destruction de l'armée anglaise d'Alexander Burnes (1842), il est replacé sur le trône mais contraint à subir un semi-protectorat.
La pression russe sur l'Asie centrale amène en 1878 l'Angleterre à une deuxième guerre afghane, et Abd al-Rahman (1880-1901) est obligé de reconnaître les frontières de la « ligne Durand » (1893). Les efforts de Habib Allah (1901-1919) et d'Aman Allah (1919-1929) pour sortir leur pays de son isolement sont annihilés par la volonté anglaise de le renforcer.
3.3. INDÉPENDANCE ET OUVERTURE
Seule la troisième guerre afghane, dite « guerre d'indépendance », consacre la pleine reconnaissance de la souveraineté de l'Afghanistan : armistice de Rawalpindi (8 août 1919), traité de Kaboul (22 novembre 1921).
Aman Allah entreprend la modernisation du pays : Constitution (1922), code administratif (1923), début de l'instruction féminine (1924) ; nouvelle Constitution (1928) ; il voyage en Europe et se fait nommer roi. La réaction conservatrice ne tarde guère. Le souverain est renversé et un aventurier, Habib Allah Khan, exerce pendant six mois une dictature sanguinaire.
Nader Khan (Nadir Khan), parent d'Aman Allah, abat l'usurpateur et se fait proclamer roi (1929). Instruit par l'expérience, il reprend avec prudence les réformes, mais n'en est pas moins assassiné en 1933. Son fils Zaher Chah (Zahir Chah) lui succède. De culture française et tout acquis aux idées nouvelles, il fait adhérer son pays à la Société des Nations (SDN) [1934], l'ouvre progressivement sur l'extérieur. En 1937, il signe le pacte de Sadabad avec la Turquie, l'Iran et l'Iraq, mais ne se laisse pas pour autant entraîner dans la Seconde Guerre mondiale.
3.4. PAUVRETÉ ET CONSERVATISME
Le retrait des Britanniques de l'Asie du Sud, avec l'indépendance de l'Inde et du Pakistan, en 1947, laisse l'Afghanistan dans une situation économique catastrophique : l'isolement du pays, voulue par le Royaume-Uni, et son archaïsme politique freinent sa modernisation, mais sa position géostratégique de première importance suscite la mobilisation des organisations internationales, qui vont lui fournir une assistance considérable.
Cependant, l'URSS et les États-Unis cherchent à y étendre leur influence ; les Soviétiques, depuis le Tadjikistan voisin, envoient des conseillers dans les régions septentrionales, tandis que les Américains sont présents dans le sud du pays. L'aide internationale cumulée, de 1957 à 1977, s'est élevée à 1,7 milliard de dollars, faisant alors de l'Afghanistan le pays le plus aidé du monde, eu égard à ses potentialités : mais les rivalités américano-soviétiques empêchent toute concertation quant à l'efficacité du soutien apporté. De plus, le conservatisme du pouvoir, malgré une tentative de démocratisation du pays entre 1963 et 1973, bride les initiatives de décollage économique. La famille royale, s'appuyant avant tout sur les Pachtouns, s'enlise dans sa revendication du Pachtounistan face à son voisin pakistanais : le nouvel État issu de la partition de l'Inde comprend en effet, dans ses marges occidentales, des populations pachtounes également présentes du côté afghan.
La nouvelle Constitution (1964), approuvée par le roi Zaher, permet l'émergence de nouveaux partis, mais le Parlement est rapidement paralysé, tandis que les récoltes de 1970 et 1971 sont catastrophiques. L'échec de la monarchie, sanctionné par le coup d'État républicain (16-17 juillet 1973) dirigé par Mohammad Daud Khan, cousin et beau-frère du roi, avec le soutien de l'URSS, suivi par l'arrivée au pouvoir des communistes, s'explique avant tout par son attachement profond à ses privilèges et son refus de la modernité ; c'est aussi le fait d'une jeunesse aristocratique formée en Occident ou en URSS et déçue par l'immobilisme du gouvernement.
4. L'AFGHANISTAN DANS LA GUERRE (1978-2001)
4.1. L'ARRIVÉE DES COMMUNISTES AU POUVOIR
Un coup d'État communiste, le 27 avril 1978, met fin à la république de Daud Khan. Le leader du parti démocratique du Peuple (PDP), Nur Mohammad Taraki, prend le pouvoir, instaure une dictature d'obédience marxiste et permet à l'URSS – grâce à la signature d'un traité d'amitié et de coopération (décembre 1978) –, d'étendre davantage son influence sur le pays. La montée de la gauche s'était opérée dès les années 1960, mais elle restait profondément divisée en raison de rivalités personnelles et claniques. Babrak Karmal, du parti de gauche Parcham (le Drapeau), qui avait au départ soutenu le prince Daud Khan, est poussé par les Soviétiques de s'unir avec le Khalq (le Peuple), autre formation marxiste, pour former le PDP et renverser Daud Khan.
L'influence des communistes est directement liée à l'éducation de nouvelles couches de la population, qui demeurent exclues du jeu clanique et politique et qui voient le pays s'enfoncer dans une arriération économique : toutefois, leur prise du pouvoir provoque l'exil de plus de 100 000 personnes et ravive les tensions entre les factions au sein du PDP. Babrak Karmal, écarté par Nur Mohammad Taraki, finit par prendre le pouvoir grâce à l'intervention de l'armée soviétique en décembre 1979, après l'assassinat de celui-ci, puis de son successeur, Hafezollah Amin. Le pays sombre alors dans une double guerre : la lutte contre l'Armée rouge, qui dure jusqu'en 1989, et la guerre civile, qui continue de déchirer le pays, malgré la profonde évolution de sa nature et de ses finalités sur les deux décennies.
4.2. L'INTERVENTION SOVIÉTIQUE (DÉCEMBRE 1979-1988)
LES MOUDJAHIDIN
Les raisons de l'intervention soviétique restent encore obscures. C'est sans doute en partie pour protéger ses nombreux ressortissants – dont une partie avait péri lors de massacres perpétrés par l'opposition islamiste – que l'Union soviétique décide d'envoyer l'Armée rouge. Le pouvoir est très vite assimilé au parti de l'étranger, et l'opposition (les moudjahidin) s'organise sur des bases claniques, ethniques et religieuses ; les Hazara (chiites), dans l'Ouest et le Centre, reprennent rapidement le contrôle de leur région ; les sunnites forment la majorité de la population.
L'ENLISEMENT DE L'INTERVENTION SOVIÉTIQUE
Contestée par une grande partie de la communauté internationale, l'armée soviétique s'enlise dans une « sale guerre » : elle est dépourvue de la logistique adéquate pour faire face à une guérilla mieux entraînée qu'elle au climat et au relief hostiles, et ne parvient pas à mobiliser la population soviétique pour envoyer au front sa jeunesse au nom d'une idéologie en déclin. L'intransigeance des dirigeants de l'URSS– malgré les demandes réitérées de l'ONU de retirer les troupes soviétiques – et l'importance des enjeux internationaux conduisent à une impasse de laquelle Mikhaïl Gorbatchev tente de sortir, dès son arrivée au pouvoir en 1985.
L'INGÉRENCE DES PUISSANCES ÉTRANGÈRES
Les États-Unis concentrent leur aide, par l'intermédiaire du Pakistan et avec le soutien actif de l'Arabie saoudite, vers les sunnites pachtouns, tandis que l'Iran chiite, qui vient d'achever sa révolution islamiste, soutient les Hazara. Dans ce contexte d'anarchie, le gouvernement de Babrak Karmal ne parvient pas à imposer son régime, et ses réformes brutales envers les paysans ne font que renforcer l'opposition. Parallèlement, des centaines de milliers d'Afghans émigrent vers le Pakistan, l'Iran et l'Occident.
LES ACCORDS DE GENÈVE (AVRIL 1988) ET LE RETRAIT DES TROUPES SOVIÉTIQUES (FÉVRIER 1989)
En mai 1986, l'échec de Babrak Karmal est patent et conduit à son remplacement par Mohammad Nadjibollah : celui-ci lance en 1987 un appel à la « réconciliation nationale » et fait adopter en novembre une Constitution qui n'a plus rien de socialiste. Le 14 avril 1988, un accord est signé, à Genève, entre le Pakistan, l'Afghanistan, les États-Unis et l'URSS. Il prévoit, outre le retrait sur neuf mois des troupes soviétiques du territoire afghan, des accords bilatéraux avec le Pakistan, garantissant l'intégrité politique de l'Afghanistan vis-à-vis de son voisin et formulant les modalités de retour des réfugiés.
4.3. LA GUERRE CIVILE
Mais le départ des troupes de l'Armée rouge est loin de mettre fin à la guerre civile, sur laquelle la présence soviétique jetait un voile, cachant la complexité des alliances et des divisions. La fracture entre nationalistes et communistes, vive durant l'occupation soviétique, s'estompe pour laisser place à des rivalités entre fondamentalistes islamistes, dirigés par Gulbuddin Hekmatyar, et modérés. Ces divisions sont la principale raison de la chute tardive du gouvernement de Mohammad Nadjibollah (16 avril). Après le départ des Soviétiques, celui-ci, en effet, ne contrôle que les grandes villes, alors que l'opposition des moudjahidin tient les campagnes. L'intervention de l'ONU, qui œuvre pour un règlement politique du conflit, l'engagement de l'URSS et des États-Unis d'arrêter leurs livraisons d'armes ne pourront empêcher la prise de Kaboul par l'opposition. Le régime tombe le 29 avril 1992.
L'ÉTAT ISLAMIQUE D'AFGHANISTAN
Cette victoire est cependant loin de mettre fin à la guerre civile : le factionalisme de l'opposition prend la forme d'une rivalité ethnique, selon la division classique entre Tadjiks du Nord, regroupés au sein du Djamiat-i Islami et dirigés par le commandant Ahmad Chah Masud, et Pachtouns du Sud, rassemblés autour du Hezb-i Islami et menés par Gulbuddin Hekmatyar. L'accord de Peshawar permet la création d'un État islamique d'Afghanistan le 28 avril 1992. Mais, si les ethnies du Nord obtiennent, par l'intermédiaire du commandant Masud, le ministère de la Défense du gouvernement intérimaire dirigé par Sibghbatollah Modjaddedi, les forces de G. Hekmatyar reprennent le combat durant l'été. La confirmation de Burhanuddin Rabbani, en décembre, au poste de président de la République islamique d'Afghanistan n'empêche pas une nouvelle « bataille de Kaboul » au début de l'année 1993. L'accord de paix signé en mars à Islamabad maintient B. Rabbani à son poste, tandis que G. Hekmatyar devient Premier ministre.
L'AVANCÉE DES TALIBANS
L'apparition des talibans, à l'automne 1994 dans la région de Kandahar, reste mystérieuse. Regroupés autour du mollah Omar, ils ne se distinguaient pas des autres mouvements anticommunistes durant l'invasion soviétique, mais leur présence était déjà attestée.
Soutenus par le Pakistan, qui joue un rôle prépondérant dans leur entraînement, ces étudiants de madrasa, majoritairement d'ethnie pachtoune, se réclament d'une idéologie ultrafondamentaliste prenant sa source dans l'école de Deoband, en Inde, qui prônait à la fin du xixe siècle un retour à l'islam pur afin de lutter contre l'influence de l'hindouisme.
Les talibans réussissent rapidement à prendre le contrôle du sud du pays. Leur succès n'est pas tant lié à leur force militaire qu'à un réel soutien de la population qui, lassée par vingt années de guerre, voit en eux une possible pacification du pays. Les talibans rétablissent effectivement l'ordre dans les régions qu'ils contrôlent, grâce à une application très stricte de la charia, mêlée à une pratique scrupuleuse des coutumes rigoristes pachtounes.
La prise de Mazar-e Charif, bastion de l'opposition du général Rachid Dostom, puis celle de Bamiyan, contrôlée jusqu'alors par les chiites, au cours de l'été 1998, permet aux talibans d'étendre leur conquête, facilitée par l'incapacité de l'opposition de s'unir : tout sépare en effet le général ouzbek R. Dostom des chiites de Karim Khalili et du Tadjik Masud.
En mars 1999 cependant, un accord intervient entre les forces d'opposition afghanes : le commandant Masud, à la tête de l'Alliance du Nord, a désormais la tâche de conduire toutes les opérations militaires contre les talibans. Mais ces derniers, après une succession de victoires militaires importantes (prise, notamment, de Taloqan), contrôlent la quasi-totalité du pays en septembre 2000.
À partir de 1999, le Conseil de sécurité des Nations unies adopte une série de sanctions votées à l'initiative des États-Unis à l'encontre des talibans afin d'obtenir l'extradition d'Oussama Ben Laden, d'origine saoudienne, tenu pour être le principal instigateur des attentats contre les ambassades américaines de Dar es-Salaam (Tanzanie) et de Nairobi (Kenya) en août 1998.
Par ailleurs, les conditions de vie déplorables imposées aux femmes (privées d'éducation et exclues du monde du travail) contribuent à propager à l'étranger une image passablement ternie du régime des talibans. En mars 2001, l'application d'un décret ordonnant la destruction de toutes les statues du pays, incluant les bouddhas de Bamiyan, site majeur de l'art pré-islamique en Afghanistan, provoque de vives protestations dans le monde, y compris dans des pays alliés, le Pakistan et l'Arabie saoudite.
4.4. LA GUERRE D'AFGHANISTAN ET LA CHUTE DES TALIBANS
La mort du commandant Masud (9 septembre 2001), victime d'un attentat probablement commandité par al-Qaida, suivie par les attentats du 11 septembre 2001 à New York et à Washington, provoquent un renversement rapide de la situation en Afghanistan.
Le président G. W. Bush lance immédiatement un ultimatum aux talibans, les enjoignant de livrer Ben Laden et le mollah Omar dans les plus brefs délais. Faute de réponses convaincantes, les États-Unis décident d'intervenir militairement en Afghanistan après s'être assurés du soutien du Pakistan – particulièrement impliqué dans la problématique régionale – et de celui de l'Ouzbékistan, susceptible de servir de base arrière aux troupes américaines. La Russie, la Chine, l'Iran et, afin d'éviter tout risque de dérapage au Proche-Orient, l'ensemble des États arabes, sont également consultés.
Opération « Liberté immuable », Afghanistan, 2001
Le 7 octobre débute l'opération « Liberté immuable » avec le soutien des Occidentaux. Les frappes « ciblées » de l'armée américaine (épaulée par les Britanniques), permettent une avancée rapide des troupes de l'Alliance du Nord, qui reconquiert, le plus souvent sans combattre, villes et villages abandonnés par les talibans (libération de Kaboul en novembre). Défaits, ces derniers, soit se replient dans quelques bastions, dont la région de Tora Bora, où les bombardements s'intensifient, soit se regroupent dans la vallée de Shawal, dans le Nord-Waziristan pakistanais.
4.5. LE PROCESSUS DE BONN (2001-2005)
UN GOUVERNEMENT INTÉRIMAIRE
Alors que la traque des terroristes se poursuit en vain (ni Ben Laden, ni le mollah Omar n'ont été capturés), le 27 novembre s'ouvre à Bonn une conférence interafghane destinée à organiser l'après-talibans.
Un accord intervient le 5 décembre. Il prévoit la création d'un gouvernement intérimaire, sous la direction d'un proche des États-Unis, le Pachtoun Hamid Karzai, et la tenue d'une assemblée traditionnelle ou Loya Djirga, afin de désigner un chef de l'État provisoire et de préparer la mise en place d'une Assemblée constituante. De retour dans son pays (avril 2002), après vingt-neuf années d'exil, l'ex-roi Zaher Chah convoque la Loya Djirga qui plébiscite, en juin, H. Karzai à la tête de l'exécutif afghan pour une période de dix-huit mois. Ce dernier entre en fonction après avoir présenté le nouveau gouvernement, au sein duquel de nombreux seigneurs de la guerre reviennent en force.
En dépit de la mise en place (décembre 2001) de la Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS) sous mandat de l'ONU dans la capitale et ses environs – le reste du pays demeurant de la compétence des forces américaines et de leurs alliés afghans –, l'insécurité prévaut (assassinat des ministres de l'Aviation civile et des Travaux publics en février et en juillet 2002 ; tentative d'assassinat d'H. Karzai en septembre 2002). À la veille de l'ouverture de la Loya Djirga qui doit décider de la future Constitution, le mandat de la FIAS, placée sous commandement de l'OTAN depuis août 2003, est élargi au-delà de Kaboul et renouvelé pour un an.
UNE NOUVELLE CONSTITUTION
Le 4 janvier 2004, au terme de difficiles tractations, les 502 délégués de la Loya Djirga approuvent une nouvelle Constitution, qui institue une république islamique (sans proclamation de la charia) à régime présidentiel fort, néanmoins tempéré par l'institution de deux vice-présidents élus sur le même ticket que le président. Elle ouvre la voie à l'organisation d'élections initialement prévues en juin 2004, mais reportées au 9 octobre compte tenu des difficultés à établir des listes d'électeurs, des menaces des talibans et de l'insécurité qui domine dans le sud et le sud-est du pays.
Après avoir écarté en juillet de son ticket, comme l'y invitaient les États-Unis, le puissant ministre de la Défense et vice-président Mohammad Fahim, H. Karzai est élu avec 55,4 % des suffrages contre 16,3 % à son rival immédiat, l'ancien ministre et leader de l'ex-Alliance du Nord, le Tadjik Yonous Qanooni. En décembre, H. Karzai nomme un nouveau gouvernement dont sont exclus la plupart des chefs de guerre.
Point d'orgue du processus de Bonn, les élections législatives et provinciales du 18 septembre 2005, les premières depuis 1969, sont marquées par un taux de participation de 50 % (inférieur à 30 % dans les régions pachtounes). Le nouveau Parlement bicaméral comprend la Chambre haute, composée de 102 membres élus par les collectivités locales et de personnalités nommées par le président, et la Chambre basse, dont les 249 députés sont, pour moitié d'entre eux, d'ex-moudjahidin, 68 sièges y étant réservés aux femmes.
5. VERS UNE STABILISATION (2005-2015)
Si le processus de Bonn semble s'être achevé avec succès, des défis majeurs attendent les nouvelles autorités afghanes pour une stabilisation complète du pays. À peu près réussie dans la région de Kaboul, la mise en place de l'administration est quasi inexistante dans le reste du territoire, État de non-droit où sévit une insécurité grandissante en raison essentiellement de la résurgence des talibans.
5.1. LA RÉSURGENCE DE L'INSURRECTION DES TALIBANS ET LA MENACE D'AL-QAIDA
Chassés du pouvoir fin 2001, les talibans, radicalisés, réinvestissent peu à peu leurs anciens bastions avec l'aide des populations pachtounes, des fondamentalistes du Pakistan, et des djihadistes d'al-Qaida. Dans les provinces du Sud essentiellement pachtounes où ils bénéficient de solidarités religieuses et tribales fortes, les talibans mettent à profit l'incurie et la corruption des autorités issues des élections pour recruter de nombreux jeunes dans leurs rangs. Ce ralliement leur est d'autant plus aisé que la désillusion est grande au sein d'une population déçue de ne voir se réaliser aucune des promesses annoncées par la communauté internationale en 2001 et heurtée par les nombreuses bavures des forces de la coalition internationale (en 2007, au moins 1 633 civils ont été tués, dont 321 par des bombardements). Formée dans les madrasas qui se sont multipliées dans les FATA (Federally Administred Tribal Areas) ou « zones tribales » pakistanaises le long de la frontière avec l'Afghanistan, cette génération de néo-talibans bénéficie de l'aide financière, technique et stratégique des djihadistes d'al-Qaida. L'organisation d'Oussama Ben Laden, mise en déroute par l'alliance de la guérilla sunnite irakienne avec l'armée américaine à Bagdad, a elle-même trouvé refuge à la frontière afghano-pakistanaise, grâce à la complicité des services secrets pakistanais (ISI) et à l'ambivalence du général-président Pervez Mucharraf. En reconstituant leurs forces dans le sanctuaire pakistanais, les talibans afghans inspirent même la création d'un mouvement taliban pakistanais.
5.2. UNE INSÉCURITÉ CROISSANTE
À partir du printemps 2006, les talibans afghans forment avec les djihadistes d'al-Qaïda, les fidèles de l'ancien Premier ministre G. Hekmatyar et les tribus pachtounes une coalition d'insurgés. Multipliant les opérations de guérilla contre la Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS), les forces de sécurité afghanes, les relais du gouvernement ou les acteurs de développement, ils parviennent rapidement à reprendre le contrôle des zones rurales dans la plupart des régions pachtounes et ont pour objectif l'encerclement de Kaboul. À partir de 2005, ils commettent leurs premiers attentats suicide puis des assassinats de personnalités politiques ou de représentants de la société publique, des prises d'otages et des enlèvements d'étrangers. Leurs attaques deviennent particulièrement meurtrières à partir de l'automne 2007 (75 morts à Pol-e-Khomri, dont 59 enfants et 6 parlementaires ; 100 morts dans la province de Kandahar, le 17 février 2008). Le nombre de pertes enregistrées par la FIAS malgré son renforcement (50 000 hommes en 2008, dont un tiers d'Américains), dépasse – pour la première fois en 2008 depuis le déclenchement des deux guerres – celui des pertes subies par la coalition internationale en Iraq.
Toutefois, la population civile afghane paie le plus lourd tribut à l'insurrection (1 600 morts en 2005, 4 000 en 2006, près de 6 000 en 2007). Elle subit en outre une grave détérioration de ses conditions de vie en raison de l'augmentation du prix des produits de première nécessité et du risque de pénurie alimentaire, de conditions climatiques rigoureuses (désertification croissante, plus de 1 000 morts lors de l'hiver 2008). Enfin, elle ne bénéficie pas de l'aide internationale.
5.3. UNE AIDE INTERNATIONALE « GASPILLÉE, INEFFICACE ET NON COORDONNÉE »
Promise depuis 2001 et destinée à la reconstruction (90 % des dépenses publiques de l'État), l'aide internationale s'avère insuffisante et inefficace.
Bien que les besoins du pays demeurent immenses, la distribution de l'aide internationale est inéquitable, mal ciblée ou dilapidée par une corruption endémique. Sur 25 milliards de dollars d'aide promise, 10 milliards n'ont pas été versés. Par ailleurs, l'aide destinée au financement de projets civils est largement inférieure à l'assistance liée à la sécurité telle que la formation de l'armée nationale afghane (ANA) et de la police nationale. Or la première, dont les effectifs croissent régulièrement pour atteindre 80 000 soldats en 2008, demeure inopérationnelle faute de moyens logistiques ; la seconde – 60 000 hommes formés en 2008 – est rongée par la corruption.
Alors que le pays enregistre d'incontestables progrès (accès plus larges à la santé et à l'éducation grâce notamment à la construction d'hôpitaux, d'écoles et de routes), il continue, malgré les coûteux programmes de lutte contre la drogue lancés par la communauté internationale, de battre des records de production d'opium (8 200 tonnes en 2007, soit une progression de plus de 30 % en un an et la quasi-totalité de la production mondiale) et de cannabis, la drogue représentant plus de la moitié de son PIB.
Adopté en janvier 2006 lors de la conférence internationale de Londres sur l'aide à l'Afghanistan, un nouveau « Pacte pour l'Afghanistan », prenant le relais du processus de Bonn, précise les modalités de la coopération entre l'Afghanistan et la communauté internationale jusqu'en 2010, encadrée par la Mission d'Assistance des Nations unies en Afghanistan (MANUA).
5.4. CHANGEMENTS DE STRATÉGIE
Les difficultés rencontrées par les troupes de l'OTAN face à la recrudescence des attaques des insurgés relancent la question de la stratégie des Occidentaux en Afghanistan.
Réunie le 12 juin 2008 à Paris à la demande des autorités afghanes, la Conférence de soutien à l'Afghanistan marque de la part de la communauté internationale l'amorce d'un changement notable de stratégie, perceptible dans l'octroi de nouvelles aides financières (promesse d'environ 20 milliards de dollars), dans l'annonce d'un mandat « renforcé » de la MANUA, mais surtout dans l'abandon de la stratégie du « tout militaire » au profit d'un investissement massif sur le terrain civil.
De leur côté, les autorités afghanes définissent une Stratégie nationale de développement pour l'Afghanistan (ANDS) pour la période 2008-2013, dans laquelle elles expriment le souhait de définir elles-mêmes leurs propres besoins et d'être davantage associées à la gestion de l'aide internationale. Dans cet esprit d'« afghanisation de la paix », H. Karzai lance avec l'aide de l'Arabie saoudite une offre de dialogue au mollah Omar en septembre. Celle-ci, toutefois, demeure sans succès. En revanche, l'arrivée au pouvoir au Pakistan d'Asif Ali Zardari (élu le 8 septembre), succédant à Pervez Mucharraf contraint à la démission en août, permet d'espérer l'ouverture d'une ère nouvelle dans les relations afghano-pakistanaises.
Les États-Unis pour leur part, après avoir pris conscience que le front central de la guerre contre al-Qaida ne se situe pas en Iraq mais au Pakistan et en Afghanistan, décident également de revoir leur stratégie. À partir de janvier 2009, le nouveau président américain, Barack Obama, place l'axe afghano-pakistanais au cœur de ses priorités. Cette approche « régionale » du dossier afghan reçoit le large soutien de la communauté internationale lors de la conférence internationale sur l'Afghanistan (La Haye, mars), mais bute sur des intérêts nationaux divergents, voire antagonistes, en particulier entre l'Inde et le Pakistan. Ce dernier, lui-même déstabilisé sur son propre territoire et allié des États-Unis mais dont l’armée et services secrets militaires (ISI) sont en même temps suspectés de double jeu, affiche officiellement sa volonté de lutter en collaboration avec Kaboul contre le « terrorisme ». De son côté l'Inde, craignant surtout un retour au pouvoir des talibans dans le cadre d’une alliance avec Islamabad à la recherche d’une « profondeur stratégique », resserre également ses liens avec le gouvernement Karzai par d’importants investissements dans la reconstruction du pays.
5.5. LA RÉÉLECTION DE H. KARZAI ET LE « PROCESSUS DE KABOUL »
Malgré les opérations d’intimidation des talibans (dont l’attentat contre le siège de la FIAS au cœur même de Kaboul), les élections présidentielle et provinciales se tiennent en août 2009. Mais la fraude massive avérée conduit à un recomptage des voix et ce n’est qu’après le retrait de son rival, Abdullah Abdullah – ex-ministre des Affaires étrangères limogé en 2006 et ancien proche du commandant Masud – que H. Karzai est finalement officiellement proclamé en novembre vainqueur de ce scrutin très contesté, avec moins de 50 % des suffrages.
Prenant notamment en considération l’engagement du gouvernement à lutter contre la corruption, la conférence internationale réunie à Kaboul (juillet 2010) confirme la décision adoptée à Londres en janvier de canaliser sur deux ans 50 % de l’aide internationale à travers le budget national et de l’aligner progressivement sur les « programmes de priorité nationale ». Elle approuve également l'objectif du gouvernement afghan d'assumer la sécurité du pays à partir de 2014 et appuie la ligne fixée en juin à l’occasion d’une « Loya Djirga pour la paix » prévoyant en particulier l’ouverture de négociations avec les insurgés qui renonceraient à la violence.
Parallèlement, tout en maintenant la date de juillet 2011 pour le début du retrait de leurs forces, les États-Unis – qui rapatrient au même moment leurs troupes combattantes d’Iraq – renforcent leur dispositif militaire en Afghanistan. Avec 30 000 soldats supplémentaires, l’engagement américain doit ainsi atteindre environ 90 000 hommes sur les 130 000 de la FIAS dont le commandement est par ailleurs confié, à partir de juillet, au général David Petraeus considéré comme le « pacificateur » de l’Iraq.
En septembre, alors que le président H. Karzai propose une nouvelle offre de dialogue au mollah Omar (celui-ci dément de son côté toute ouverture de pourparlers) ont lieu les élections législatives et, en octobre, un « Haut conseil pour la paix » présidé par l’ancien président de la République B. Rabbani est officiellement institué. À l’issue d’un long dépouillement, les résultats du scrutin, marqué par de nombreuses irrégularités, sont publiés le 24 novembre : autour de 4 millions d’électeurs se sont rendus aux urnes, soit un taux de participation d’environ 38 %. Peu avant, lors de son sommet tenu à Lisbonne le 20 novembre, l’OTAN a confirmé le transfert progressif entre 2011 et 2014 des responsabilités en matière de sécurité au gouvernement afghan, et précisé les termes de leur coopération future dans le cadre d’un « partenariat à long terme ».
5.6. L’ENLISEMENT APRÈS DIX ANS DE PRÉSENCE INTERNATIONALE
En septembre 2011, l’assassinat de B. Rabbani par un commando taliban est un nouveau coup porté au frêle processus de paix lancé l'année précédente. Intervenant après plusieurs attaques, dont celles lancées en juin et en août contre l'hôtel Intercontinental et le centre culturel britannique, il relance le débat sur la capacité des forces afghanes à assurer seules la sécurité et prendre la relève des troupes internationales après 2014.
Alors que la FIAS (dont les forces françaises) placées depuis juillet sous le commandement du général John Allen, continue d’essuyer des pertes à Kaboul ou sur le terrain, des négociations secrètes avec les talibans ne sont toujours pas écartées par les Américains.
Parallèlement, en octobre, reconnaissant par ailleurs l’échec de la lutte contre l’insurrection, le président Karzai conclut un pacte stratégique avec l’Inde dans la perspective du futur retrait des forces occidentales, un accord qui n’entraîne toutefois aucune réaction de la part du Pakistan. En revanche, ce dernier est le grand absent de la conférence internationale, réunie à Bonn en décembre, à l’issue de laquelle les Occidentaux assurent de leur soutien le président afghan qui demande le maintien de l’aide internationale jusqu’en 2024 et s’engage, une fois de plus et sans véritablement convaincre ses interlocuteurs, à lutter plus résolument contre la corruption.
5.7. VERS LE RETRAIT DES FORCES INTERNATIONALES
Le rapatriement effectif des forces françaises d’Afghanistan (autour de 4 000 militaires en 2011) à partir de juin 2012 anticipe la fin progressive de la mission de la FIAS.
Le 18 juin 2013, le président Karzai lance la dernière étape de la transition vers la prise en main de la sécurité par les forces nationales afghanes dans l’ensemble du pays. Formées et entraînées par la FIAS, ces dernières sont composées notamment de l’Armée nationale afghane (ANA), de la Force aérienne afghane et des forces de police nationale et locale. En juin 2014, les troupes occidentales ne comptent plus qu’environ 49 900 soldats dont 32 800 Américains.
La signature d’un accord bilatéral de sécurité (BSA), qui prévoit le maintien d’un appui militaire après le retrait prévu à la fin de l’année, ayant été reportée par H. Karzai, la succession de ce dernier constitue une importante étape politique.
5.8. LA SUCCESSION D’HAMID KARZAI
Pour lire la suite, consulter le LIEN ( haut de page ).
|
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
