|
| |
|
|
 |
|
Allergies respiratoires : découverte dâune molécule au rôle majeur dans le déclenchement de lâinflammation |
|
|
| |
|
| |
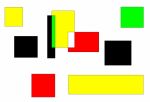
Allergies respiratoires : découverte d’une molécule au rôle majeur dans le déclenchement de l’inflammation
10 AVR 2024 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE) | IMMUNOLOGIE, INFLAMMATION, INFECTIOLOGIE ET MICROBIOLOGIE
Visualisation en microscopie de cellules immunitaires (en vert) activées par les alarmines TL1A et interleukine-33 lors du déclenchement de l’inflammation allergique au niveau des poumons. Les cellules immunitaires « ILC2s » produisent de grandes quantités d’interleukine-9, un médiateur clé de l’inflammation allergique. Elles sont localisées à proximité des fibres de collagène (en bleu) et des vaisseaux sanguins du poumon (en rouge). © Jean-Philippe GIRARD – IPBS (CNRS/UT3 Paul Sabatier).
L’inflammation est un processus au rôle majeur dans les maladies allergiques, qui touchent en France au moins 17 millions de personnes, dont 4 millions d’asthmatiques.
Une des molécules qui initie ce processus dans les voies respiratoires vient d’être identifiée.
Cette molécule, de la famille des alarmines, constitue une cible thérapeutique d’intérêt majeur pour le développement de nouveaux traitements des allergies respiratoires.
L’une des molécules responsables du déclenchement de l’inflammation à l’origine des maladies allergiques respiratoires telles que l’asthme et la rhinite allergique vient d’être découverte par des scientifiques du CNRS, de l’Inserm et de l’université Toulouse III – Paul Sabatier. Cette molécule de la famille des alarmines représente une cible thérapeutique d’intérêt majeur pour le traitement des maladies allergiques. Cette étude, co-dirigée par Corinne Cayrol et Jean-Philippe Girard, est publiée dans la revue Journal of Experimental Medicine le 10 avril1.
Le processus d’inflammation joue un rôle crucial dans les maladies allergiques respiratoires, telles que l’asthme et la rhinite allergique. Si l’épithélium pulmonaire, ce tapis de cellules qui constitue la surface interne des poumons, est reconnu comme un acteur majeur de l’inflammation respiratoire à l’origine de ces maladies, les mécanismes sous-jacents sont encore mal connus.
Une équipe de recherche vient d’identifier l’une des molécules responsables du déclenchement de la réaction allergique, dans une étude co-dirigée par deux scientifiques du CNRS et de l’Inserm travaillant à l’Institut de pharmacologie et de biologie structurale (CNRS/Université Toulouse III – Paul Sabatier). Cette molécule de la famille des alarmines, nommée TL1A, est émise par les cellules de l’épithélium pulmonaire quelques minutes après une exposition à un allergène de type moisissure. Elle coopère avec une autre alarmine, l’interleukine-33, pour alerter le système immunitaire de la présence d’un allergène. Ce double signal d’alarme stimulera l’activité de cellules immunitaires, qui déclencheront ensuite une cascade de réactions en chaîne responsables de l’inflammation allergique.
Les alarmines constituent donc des cibles thérapeutiques d’intérêt majeur pour le traitement des maladies allergiques respiratoires. Dans quelques années, des traitements à base d’anticorps bloquant l’alarmine TL1A pourraient bénéficier aux patients souffrant d’asthme sévère ou d’autres maladies allergiques. En France, au moins 17 millions de personnes sont concernées par les maladies allergiques2. Les formes d’asthme les plus graves sont responsables de plusieurs centaines de décès tous les ans3.
Cette étude a bénéficié du soutien de l’ANR
D’après le Ministère du travail, de la santé et des solidarités : https://sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/pollens-et-allergies/article/effets-des-pollens-sur-la-sante; 13/04/2023
D’après Santé Publique France : https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-liees-au-travail/asthme; 25/10/2023
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Comment le microbiote stimule la croissance |
|
|
| |
|
| |

Comment le microbiote stimule la croissance
23 FÉV 2023 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE) | BIOLOGIE CELLULAIRE, DÉVELOPPEMENT ET ÉVOLUTION | GÉNÉTIQUE, GÉNOMIQUE ET BIO-INFORMATIQUE | IMMUNOLOGIE, INFLAMMATION, INFECTIOLOGIE ET MICROBIOLOGIE
Visualisation du microbiote intestinal humain (rouge) au sein de la couche de mucus (verte) située à la surface de l’intestin. © Benoit Chassaing/Institut Cochin
Le microbiote intestinal est aujourd’hui considéré comme un organe à part entière. Une équipe pilotée par des scientifiques du CNRS et de l’ENS de Lyon, en collaboration avec l’Université Claude Bernard Lyon 1, l’Inserm, et l’Inrae ont travaillés sur ce sujet dans une publication à paraître dans la revue Science. Les scientifiques ont découvert, chez l’animal, comment une bactérie du microbiote pouvait stimuler la croissance juvénile dans des conditions nutritionnelles appauvries.
L’activité du microbiote est essentielle à une vie en bonne santé mais elle reste encore mal comprise. Dans de précédentes études, l’équipe de recherche avait révélé que le microbiote intestinal joue un rôle important dans la croissance des jeunes individus chez des espèces aussi distantes que l’insecte drosophile ou la souris domestique.
En particulier, une souche de la bactérie Lactiplantibacillus plantarum (LpWJL) est particulièrement efficace pour stimuler la croissance juvénile de ces animaux dans des conditions nutritionnelles appauvries. Dans cette nouvelle étude, l’équipe de recherche internationale1 dirigée par des scientifiques de l’Institut de génomique fonctionnelle de Lyon (CNRS/ENS de Lyon) a identifié l’un des mécanismes par lequel cette bactérie agit sur la croissance de souriceaux en sous-nutrition après le sevrage2.
L’administration quotidienne par voie orale de la bactérie LpWJL à ces souriceaux stimule localement la maturation de l’épithélium intestinal ce qui soutient la production d’hormones (insuline et IGF-13) essentielles à une croissance saine.
Les scientifiques ont identifié une molécule produite par la bactérie et un composant majeur des parois cellulaires bactériennes : le muramyldipeptide. Cette molécule est suffisante pour stimuler la production d’insuline et d’IGF-1 en se fixant à NOD2, un récepteur présent sur les cellules de l’épithélium intestinal chez la souris.
La bactérie LpWJL améliore la croissance de souris sous-alimentées via la reconnaissance du muramyldipeptide de sa paroi et la signalisation intestinale NOD2. © Amélie Joly
Ces résultats établissent que le muramyldipeptide et son récepteur NOD2 contribuent à atténuer des retards de croissance liés à une sous-nutrition chronique.
Ces travaux permettent d’envisager chez les enfants en sous-nutrition chronique des interventions bactériennes couplées à des interventions nutritionnelles afin d’améliorer leur dynamique de reprise de croissance. Enfin, ils offrent aussi des perspectives d’études sur d’autres populations nécessitant une nutrition optimisée telle que les personnes âgées ou les sportifs de haut-niveau.
1 En France, ont également participé des scientifiques du laboratoire Microbiologie intégrative et moléculaire (CNRS/Institut Pasteur), de l’Institut Micalis (Inrae/Agroparistech/Université Paris-Saclay), du laboratoire Physiologie cellulaire (Inserm/Université de Lille), du laboratoire Carmen (Inserm/Inrae/ Université Lyon Claude Bernard Lyon 1), du Service de gastroentérologie, hépatologie et nutrition pédiatriques des Hospices civils de Lyon. A l’étranger, ces recherches ont impliqué des scientifiques de l’Académie des sciences de République tchèque et de l’European Molecular Biology Laboratory (Allemagne).
2 Phase de développement post-natal correspondant à la fin de l’alimentation par le lait maternel et au début de l’alimentation autonome.
3 Le facteur de croissance IGF-1 (Insulin-like Growth Factor 1), produit principalement par le foie, présente une structure chimique proche de celle de l’insuline mais des fonctions distinctes. L’IGF-1 stimule la croissance tissulaire et squelettique et l’insuline régule le métabolisme énergétique nécessaire à la croissance.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Le cervelet, une région du cerveau clé pour la socialisation |
|
|
| |
|
| |
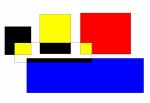
Le cervelet, une région du cerveau clé pour la socialisation
16 JUIN 2022 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE) | NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE
Cette image du cervelet d’une souris exprimant une protéine fluorescente dans les cellules de Purkinje exprimant les récepteurs à la dopamine D2. © Emmanuel Valjent, Institut de Génomique Fonctionnelle (Montpellier).
Situé à l’arrière du crâne, le cervelet est une région du cerveau essentielle au contrôle de la fonction motrice, mais il contribue également aux fonctions cognitives supérieures, notamment aux comportements sociaux. Dans une étude récente, un consortium de recherche international comprenant des scientifiques de l’Inserm, de l’Université de Montpellier, du CNRS, de l’Institut de Neurociències Universitat Autònoma de Barcelone (INc-UAB) (Espagne) et de l’Université de Lausanne (Suisse) a découvert comment l’action d’un neurotransmetteur dans le cervelet, la dopamine, module les comportements sociaux via une action sur des récepteurs à dopamine spécifiques appelés D2R. En utilisant différents modèles de souris et des outils génétiques, les chercheurs et chercheuses montrent que des changements dans les niveaux de D2R, dans un type spécifique de cellules du cervelet, modifient la sociabilité et la préférence pour la nouveauté sociale, sans pour autant affecter les fonctions motrices. Ces résultats, publiés dans le journal Nature Neurosciences, ouvrent la voie à une meilleure compréhension de certains troubles psychiatriques liés à la sociabilité, comme les troubles du spectre autistique (TSA), les troubles bipolaires ou la schizophrénie.
La dopamine (DA) est le neurotransmetteur clef dans le système de récompense du cerveau, impliquée dans le contrôle de la motivation, des états émotionnels et des interactions sociales. La régulation de ces processus repose en grande partie sur l’activation de circuits neuronaux intégrés dans les régions limbiques. Cependant, des preuves récentes indiquent que le cervelet, une région classiquement associée au contrôle moteur, peut également contribuer aux fonctions cognitives supérieures, y compris les comportements sociaux.
Pour aller plus loin et mieux comprendre le rôle du cervelet, des chercheurs et chercheuses de l’Inserm, de l’Université de Montpellier, du CNRS, de l’Institut de Neurociències UAB (Espagne) et de l’Université de Lausanne (Suisse) ont mis en évidence un nouveau rôle de la dopamine au niveau du cervelet, montrant qu’elle module les comportements sociaux chez la souris.
En combinant une analyse transcriptomique[1] spécifique au type de cellule, des analyses par immunofluorescence et de l’imagerie 3D, les chercheurs ont d’abord démontré la présence d’un type particulier de récepteurs de la dopamine (nommé D2R) dans les principaux neurones de sortie du cervelet, les cellules de Purkinje. Grâce à des enregistrements de l’activité neuronale, ils ont pu montrer que les D2R modulaient l’excitation des cellules de Purkinje.
« Cette première série de résultats était déjà déterminante pour nous, car elle dévoilait que les D2R étaient bien présents dans le cervelet, ce qui n’était pas clair jusqu’à ce jour, et que, malgré leur faible niveau d’expression, ils étaient fonctionnels », souligne Emmanuel Valjent, directeur de recherche à l’Inserm et coordinateur de l’étude.
Comprendre le rôle de la dopamine dans le cervelet
Les chercheurs se sont ensuite intéressés à la fonction de ces récepteurs D2R au sein de ces neurones du le cervelet. En utilisant des approches génétiques permettant de réduire ou d’augmenter la quantité des récepteurs D2R sélectivement dans les cellules de Purkinje, ils ont analysé l’impact de ces altérations sur les fonctions motrices et non motrices du cervelet.
Les scientifiques ont ainsi montré qu’il existe une association entre la quantité de D2R qui sont exprimés dans les cellules de Purkinje et la modulation des comportements sociaux.
« Réduire l’expression de ce récepteur spécifique de la dopamine a altéré la sociabilité des souris ainsi que leur préférence pour la nouveauté sociale, alors que leur coordination et leurs fonctions motrices n’ont pas été affectées » explique le Dr Laura Cutando, post doctorante à l’Inserm, aujourd’hui chercheuse à l’UAB, et première auteure de l’article.
Cette étude constitue un premier pas vers une meilleure compréhension du rôle de la dopamine dans le cervelet et des mécanismes sous-jacents aux troubles psychiatriques tels que la schizophrénie, le TDAH et les troubles anxieux, qui ont tous en commun une altération des niveaux de dopamine et des comportements sociaux altérés.
[1] La transcriptomique est l’analyse des ARN messagers transcrits dans une cellule, tissu ou organisme, permettant de quantifier l’expression des gènes.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Génétique : Les gènes sauteurs sous contrôle |
|
|
| |
|
| |

Génétique : Les gènes sauteurs sous contrôle
* PUBLIÉ LE : 18/04/2024 TEMPS DE LECTURE : 3 MIN ACTUALITÉ, SCIENCE
*
Les éléments transposables, également connus sous le nom de « gènes sauteurs », sont des séquences d’ADN capables de se répliquer dans notre génome. Très abondants, répétés et dispersés, ils sont maintenus sous un contrôle très strict. Une cartographie inédite des L1, la famille de gènes sauteurs la plus active chez l’humain, apporte un éclairage nouveau sur les mécanismes qui freinent leur expansion.
Un article à retrouver dans le magazine de l’Inserm n°60
Saviez-vous que 60 % de notre génome est composé de gènes dits « sauteurs » ? Ces gènes ont la capacité de se répliquer et de s’insérer à de nouvelles positions dans le génome. Comment ? Tout simplement parce qu’ils codent des enzymes capables de « couper-coller » ou de « copier-coller » l’ADN. Ce phénomène a toujours existé. On estime qu’une nouvelle copie de gène sauteur s’insère durablement dans le génome des humains toutes les 20 naissances. « Aujourd’hui, la plupart des gènes sauteurs qui se sont insérés au cours de l’évolution sont inactifs », précise Sophie Lanciano, chercheuse postdoctorale à l’Institut de recherche sur le cancer et le vieillissement de Nice, dans l’équipe de Gaël Cristofari, directeur de recherche Inserm. Autrement dit : ils ne sautent plus. Néanmoins, on imagine aisément que ce phénomène puisse mettre le désordre dans le génome. Car si l’insertion de ces séquences a souvent peu d’incidence sur le fonctionnement de l’organisme, elle peut avoir lieu dans des gènes ou à leur proximité, provoquant alors des pertes ou des gains de fonction. Elles constituent d’ailleurs un puissant moteur de l’évolution : c’est par un tel mécanisme que des fonctions essentielles, comme la formation du placenta chez les mammifères, sont apparues. Mais elles jouent également un rôle crucial dans le développement de certaines maladies, notamment le cancer, ou dans le vieillissement.
Parmi les gènes sauteurs, la famille des rétrotransposons LINE‑1 (L1) est particulièrement active chez l’humain. Ils représentent près de 20 % de notre génome. Comment savoir s’ils sont actifs ou non ? Il est connu que la méthylation, une modification chimique de l’ADN, peut bloquer leur activité de façon globale. Mais jusqu’à présent, il était impossible de savoir quelles copies sont méthylées ou non. Pour y remédier, l’équipe de Gaël Cristofari a mis au point une méthode de cartographie de la méthylation des L1. « Nous avons adapté une technique de séquençage visant à localiser les L1, que nous avons utilisée conjointement avec une technique de marquage de la méthylation, explique le chercheur. Cela nous permet d’identifier les bases méthylées et non méthylées de chacune des copies du génome. » Cette analyse a été réalisée dans une douzaine de types cellulaires différents, dont des cellules cancéreuses ou embryonnaires. C’est la première fois qu’une telle cartographie, qui plus est exhaustive, est réalisée.
Plusieurs verrous
Ces analyses ont donné lieu à plusieurs observations intéressantes, voire surprenantes : « Bien que très similaires entre eux, tous ces gènes sauteurs ne sont pas régulés de la même façon : il existe une forte hétérogénéité en fonction du type cellulaire considéré ou de la position du L1 », rapporte Sophie Lanciano, qui a mené ces travaux avec Claude Philippe, ingénieur dans l’équipe. Autre résultat important : « Ce n’est pas parce que les L1 ne sont pas méthylés qu’ils vont pour autant s’activer, poursuit la chercheuse. C’est un résultat étonnant car cela montre qu’il existe plusieurs mécanismes, plusieurs verrous, qui contrôlent leur activité. » Qu’il reste à découvrir. Ce sera l’un des prochains objectifs de l’équipe niçoise, ainsi que la compréhension de la dynamique de réactivation de ces gènes sauteurs. À terme, ces découvertes pourraient servir à des fins thérapeutiques, par exemple en réactivant des gènes sauteurs dans les tumeurs pour stimuler leur élimination par le système immunitaire.
Sophie Lanciano, postdoctorante, et Claude Philippe, ingénieur, travaillent dans l’équipe Rétrotransposons et plasticité du génome dirigée par Gaël Cristofari à l’Institut de recherche sur le cancer et le vieillissement de Nice (unité 1081 Inserm/Université Côte d’Azur).
Source : S. Lanciano et al. Locus-level L1 DNA methylation profiling reveals the epigenetic and transcriptional interplay between L1s and their integration sites. Cell Genomics, 14 février 2024 ; doi : 10.1016/j.xgen.2024.100498
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
