|
| |
|
|
 |
|
CLIMATOLOGIE |
|
|
| |
|
| |
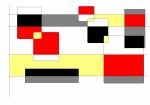
climatologie
Consulter aussi dans le dictionnaire : climatologie
Cet article fait partie du dossier consacré au climat.
Science qui étudie les climats.
Pour l'étude des effets néfastes ou bienfaisants des climats sur l'organisme, voir → Larousse Médical.
1. Définition et fonctionnement de la climatologie
1.1. Les objectifs de la climatologie
La climatologie est la science par laquelle on cherche à découvrir les régularités des phénomènes atmosphériques observés et à établir les lois qui les gouvernent – soit les répartitions géographiques et saisonnières des températures, des vents, des précipitations, etc. –, tout en sachant que la variabilité reste un aspect essentiel du climat.
Le climat change, et a changé. La climatologie s’attache ainsi également à comprendre les mécanismes climatiques du passé, et tente, à partir de données collectées et de modèles, de décrire les évolutions futures.
1.2. Le travail des climatologues
Inondations, Pologne, 2010
Étude des mécanismes climatiques passés, présents et futurs, la climatologie est une vaste discipline regroupant de nombreux spécialistes (météorologistes, modélisateurs de l'océan et de l'atmosphère, géographes, physico-chimistes, spécialistes de la végétation, géologues, paléontologues, astronomes, historiens, etc.) dont l'objectif majeur est de tirer les enseignements du climat passé, observé ou reconstitué, et de mettre à la disposition des décideurs politiques tous les éléments d'information appropriés pour préparer l'avenir en connaissance de cause. C'est dans cet esprit qu'un Comité intergouvernemental sur le changement climatique a été mis en place sous les auspices de l'O.N.U. ; il fait le point tous les cinq ans depuis 1990 sur l'état des connaissances dans le domaine.
Parmi les missions des climatologues figurent les mesures au sol, en altitude ou à distance (radars, satellites, etc.), ainsi que les tâches d'archivage pérenne de ces données, de constitution de séries chronologiques validées et homogénéisées. Ces informations sont essentielles pour caractériser le climat moyen et sa variabilité en un lieu donné, et pour cartographier sa variabilité spatiale. Elles sont primordiales pour la planification dans de nombreux domaines économiques, par exemple pour le calcul de la fréquence d'occurrence des événements extrêmes (tempêtes, inondations, vagues de froid ou de chaleur, etc.) afin de dimensionner correctement les ouvrages (ponts, bâtiments, réseaux hydrographiques, réseaux d'assainissement, etc.)
2. Les mécanismes du climat
2.1. Le devenir du rayonnement solaire
Effet de serre
Pour mieux comprendre ce qui gouverne le climat, et comment marche ce fameux « effet de serre », considérons la Terre dans son ensemble, comme un corps sphérique solide et liquide entouré d'une mince pellicule atmosphérique, évoluant dans le vide cosmique. Sa seule source d'énergie significative, le Soleil, éclaire notre planète et son atmosphère avec un flux de rayonnement (lumière visible, rayonnement proche infrarouge) équivalant à 1 368 W.m−2. Les nuages, l'air et la surface du globe réfléchissent environ 30 % de ce flux vers l'espace, ce rapport du flux réfléchi au flux incident s'appelant l'albédo ; les 70 % qui restent se trouvent absorbés et convertis en chaleur.
À côté de ce flux d'énergie solaire, tout ce qu'on « produit » sur Terre (dégagement d'énergies fossiles solaire et stellaire) est négligeable en moyenne globale.
2.2. Le rayonnement infrarouge et l'effet de serre naturel
La partie absorbée du rayonnement solaire, surtout à la surface du globe, doit en fin de compte être renvoyée vers l'espace, car c'est seulement par le rayonnement que la Terre peut échanger de l'énergie avec son environnement cosmique. Cela se fait en plusieurs étapes. La surface de la Terre prenant des températures entre − 70 °C et + 50 °C, elle rayonne dans l'infrarouge moyen, à des longueurs d'onde entre 4 et 40 micromètres. Cependant, les gaz de l'atmosphère absorbent le rayonnement à certaines de ces longueurs d'onde, comme le révèle l'analyse spectrale du rayonnement infrarouge qui s'évade réellement de l'atmosphère, observée à partir des satellites.
L'atmosphère, réchauffée par ce rayonnement qu'elle absorbe, renvoie une partie de celui-ci vers le bas ; finalement, la température moyenne au sol (+ 15 °C) est bien supérieure à celle qui régnerait (− 18 °C) s'il n'y avait pas cette absorption de l'infrarouge. C'est ce phénomène qui constitue l'effet de serre naturel.
L'effet de serre dépend essentiellement des gaz atmosphériques constitués de molécules à plusieurs atomes (3 ou plus), qui absorbent une partie importante du rayonnement infrarouge et qu'ils réémettent à la fois vers le haut et vers le bas. Ces gaz, très minoritaires dans l'atmosphère (moins de 1 %), comprennent notamment la vapeur d'eau (H2O), le gaz carbonique (dioxyde de carbone : CO2), l'ozone (O3), le méthane (CH4) et d'autres gaz encore. Si l'on augmente la quantité de ces gaz dans l'atmosphère, l'effet de serre doit se renforcer. Quant aux gaz qui constituent plus de 99 % de l'atmosphère, l'azote (N2) et l'oxygène (O2), leur structure moléculaire très simple fait qu'ils ne jouent pratiquement aucun rôle dans les transferts d'énergie par rayonnement.
2.3. La convection et le cycle de l'eau
L'analogie de l'atmosphère terrestre avec une serre n'est pas parfaite, car, si les serres fonctionnent en laissant passer le rayonnement solaire et en piégeant le rayonnement infrarouge, elles doivent une grande partie de leur efficacité au fait que d'une part elles empêchent les pertes de chaleur par convection, c'est-à-dire par courants d'air, et que d'autre part elles maintiennent une humidité élevée qui limite la perte de chaleur par l'évapotranspiration des plantes.
Ces deux processus, dont l'action est entravée dans une serre, jouent au contraire un rôle important sur Terre, limitant l'échauffement de la surface en transférant de la chaleur de celle-ci à l'atmosphère. Chaque gramme d'eau évaporée à la surface des océans, du sol, des stomates d'une feuille verte, emporte avec lui une quantité de chaleur « latente » (environ 540 calories) qui est libérée dans l'atmosphère au moment de la condensation. Les bilans d'énergie entre surface et atmosphère sont ainsi couplés au cycle de l'eau, mais en fin de compte l'énergie doit repartir vers l'espace dans le rayonnement infrarouge.
2.4. Le rôle des nuages
La condensation de la vapeur d'eau dans l'atmosphère donne généralement lieu à la formation de nuages, qui sont des collections de gouttelettes d'eau liquide (stratus, cumulus) ou de cristaux de glace (cirrus).
Les nuages, en augmentant l'albédo de la planète (partie du rayonnement solaire renvoyée vers l’espace), diminuent la quantité d'énergie solaire disponible pour échauffer la surface du sol et la basse atmosphère ; ils refroidissent la Terre. Cependant, de même qu'ils réfléchissent partiellement la lumière provenant du Soleil, les nuages bloquent aussi l'évasion du rayonnement infrarouge terrestre, contribuant à l'effet de serre naturel.
Les nuages élevés, à sommets froids, ne rayonnent que faiblement vers l'espace ; si leurs bases se trouvent à basse altitude, dans des couches relativement chaudes, ils rayonnent fortement vers le sol. D'où le faible refroidissement nocturne des nuits à ciel couvert, alors qu'il fait frais au lever du Soleil après une nuit à ciel dégagé. L'effet d'albédo des nuages paraît cependant prédominer en moyenne globale.
3. La carte des climats et leur modélisation
Climats du monde
Il y a un système climatique, mais de nombreux climats.
3.1. La répartition astronomique de l'énergie
Les lois astronomiques régissent le rayonnement solaire disponible au « sommet » de l'atmosphère selon la latitude, la date et l'heure, mais l'énergie solaire absorbée dépend en outre de l'albédo, donc de la couverture nuageuse et de l'albédo de la surface ; cette absorption est maximale sur les mers tropicales sans nuages. L'émission de rayonnement infrarouge vers l'espace dépend quant à elle des températures à la surface et dans l'atmosphère, de l'humidité, de la nature de la couverture nuageuse ; fort au-dessus des déserts sans nuages où il dépasse 400 W.m−2 ; le flux infrarouge est faible (160 W.m−2) au-dessus des grands amas de nuages convectifs aux sommets très froids.
Le bilan radiatif, qui est la différence du flux solaire absorbé et du flux infrarouge émis, ne s'équilibre qu'en moyenne sur tout le globe et sur l'année. Excédentaire dans les tropiques et aux latitudes tempérées en été, il est déficitaire en hiver et près des pôles. L'atmosphère et les océans transportent – en proportions à peu près égales – la chaleur excédentaire des tropiques vers les zones déficitaires, atténuant de ce fait les contrastes entre équateur et pôles, entre été et hiver. Les stockages de chaleur dans les océans donnent lieu au retard des saisons météorologiques par rapport aux saisons astronomiques.
3.2. Le cas du climat tropical
La circulation générale de l'atmosphère dépend de la répartition du bilan radiatif et de la rotation de la Terre. Elle explique à son tour la répartition des nuages, qui modulent l'albédo et l'émission infrarouge.
Les phénomènes sont particulièrement marqués dans la moitié du globe située entre 30 degrés de latitude sud et nord. Dans la zone peu éloignée de l'équateur (le front intertropical, ou FIT) où convergent les vents alizés chargés d'humidité après avoir balayé les mers chaudes des tropiques, l'air monte, l'humidité se condense, donnant lieu à des pluies torrentielles et à la formation des nuages convectifs (cumulonimbus) avec des sommets allant jusqu'à 18 000 mètres d'altitude. L'air qui est monté – désormais dépourvu d'humidité – doit redescendre ; cette subsidence se fait entre 20 et 30 degrés de latitude, où les nuages et les pluies sont rares, et où se situent de ce fait la plupart des déserts du globe.
3.3. Le cycle de l’eau
De manière générale, l'atmosphère transporte une partie de l'eau évaporée des océans vers les continents, d'où elle retourne, parfois après avoir été « recyclée » par l'évapotranspiration des plantes, vers l'océan. La possibilité d'existence de la vie sur les continents dépend ainsi du fonctionnement de ce cycle de l’eau énergisé par le rayonnement solaire absorbé à la surface des océans.
Vers les pôles, en revanche, de l'eau est stockée, en partie pour des millénaires, sous forme solide. Le fort albédo des surfaces de glace et de neige fait que, même pendant l'été, au soleil de minuit, peu de rayonnement solaire est absorbé, notamment sur les calottes du Groenland et de l'Antarctique. Des surfaces à fort albédo (neige sur les continents de l'hémisphère Nord, glaces de mer autour de l'Antarctique au sud) s'étendent énormément l'hiver, et leur persistance au printemps réduit fortement l'absorption d'énergie solaire. Une forte extension des surfaces de glace a donc tendance à renforcer le froid, le contraire à renforcer un réchauffement.
3.4. La modélisation numérique du système climatique
Pour comprendre cette complexité que nous connaissons d'autant mieux que les satellites d'observation de la Terre nous fournissent désormais une couverture globale, et pour estimer la sensibilité des climats à telle ou telle perturbation, les climatologues emploient la modélisation numérique, c'est-à-dire la mise en équations d'une représentation simplifiée du système physique constitué par la surface terrestre et par l'atmosphère, et des processus physiques qui s'y déroulent.
Dans les modèles de circulation générale de l'atmosphère, du même type que ceux utilisés par les grands services météorologiques pour la prévision du temps, on cherche à représenter les processus à l'échelle des régions. Pour ce faire, on découpe la surface du globe en cellules faisant typiquement de 200 à 500 km de côté ; on prend également en compte la structure verticale de l'atmosphère en la divisant en une dizaine de couches. On est ainsi conduit à considérer quelques dizaines de milliers de « boîtes » atmosphériques ; pour chacune d'elles on calcule l'évolution de la température, de la vitesse (du vent donc), du contenu en eau sous forme gazeuse (humidité) et sous forme liquide et solide (nuages, précipitations).
L'évolution de ces paramètres obéit aux lois de la physique (conservation de la matière, notamment de l'eau, lois du mouvement, conservation de l'énergie), qui se traduisent par des équations reliant les paramètres d'une boîte à ceux des boîtes autour d'elle. Cependant, on est obligé d'employer des simplifications grossières (des « paramétrisations ») dans la mise en équations de processus importants tels que la condensation, les précipitations et la formation des nuages, les interactions des nuages avec le rayonnement. C'est pourquoi même les modèles les plus avancés représentent très mal la formation et la persistance de nuages bas à grande étendue (stratus, stratocumulus).
Pour résoudre les équations, il faut tenir compte des « conditions aux limites » en haut et en bas. On connaît la répartition du rayonnement solaire au sommet de l'atmosphère. Mais au sol les calculs se compliquent, car il faut tenir compte de la topographie, des conditions de transfert d'eau et d'énergie, de la friction qu'exerce la surface sur le vent. Sur les continents, l'albédo de surface dépend de la couverture de neige, de l'état de la végétation et de l'humidité du sol ; la végétation influence l'évaporation et donc le transfert de chaleur latente à l'atmosphère. Sur la mer, les glaces flottantes augmentent l'albédo, et les températures à la surface conditionnent l'évaporation. Ces températures dépendent non seulement du rayonnement solaire absorbé localement, mais aussi des transports de chaleur par les courants marins, qui sont eux-mêmes animés par les vents. Pour pouvoir modéliser l'évolution des climats, il faut donc coupler le modèle de circulation générale de l'atmosphère à un modèle de l'océan. Ces études n'en sont qu'à leur début.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
VOLCAN |
|
|
| |
|
| |

volcan
(italien Vulcano, du latin Vulcanus, dieu du Feu)
Cet article fait partie du dossier consacré à la géologie.
Relief, en général de forme conique, formé par les produits magmatiques qui atteignent la surface du globe, aérienne ou sous-marine.
GÉOLOGIE
Un volcan est un point de sortie par lequel de la roche fondue appelée magma arrive en surface. L'accumulation des produits émis crée un édifice, parfois une véritable montagne. On a répertorié 10 000 volcans sur les continents (et encore plus sous les océans), dont plus de 1 500 ont fait une éruption au cours des 10 000 dernières années. En moyenne, on dénombre 40 éruptions par an sur les continents, qui durent de l'ordre de une à quelques semaines, mais parfois un jour ou plusieurs années.
1. Les régions volcaniques
La lithosphère terrestre est fragmentée en plaques, mobiles les unes par rapport aux autres. Les volcans se situent de façon très privilégiée aux frontières de plaques (volcans interplaques) et beaucoup plus rarement à l'intérieur d'une plaque (volcanisme intraplaque).
1.1. Les zones de rift
La cassure d'une plaque se traduit par la formation d'un fossé d'effondrement appelé rift. Le rift est-africain, occupé par de grands lacs (Kivu, Tanganyika, Malawi) est bordé de volcans (Nyiragongo, mont Kenya, Kilimandjaro) et se termine par la région volcanique des Afars (→ Éthiopie).
Ensuite, en plusieurs dizaines de millions d'années, par écartement, s'ouvre un océan (par exemple, d'abord la mer Rouge, puis l'océan Atlantique).
1.2. La dorsale médio-océanique
Une chaîne volcanique sous-marine (dorsale médio-océanique) parcourt l'ensemble des océans de la planète, sur une distance totale de 60 000 km. Elle mesure en moyenne 1 500 m de hauteur. Mais, comme elle repose sur des fonds à − 4 000 m, elle culmine en fait à − 2 500 m. Exceptionnellement, elle émerge en îles (Islande). Au niveau de la dorsale, l'écartement est compensé par l'émission de magma, qui contribue à l'édification des plaques. Ces volcans, les plus nombreux mais les moins connus, ne présentent quasiment aucun danger pour l'homme.
1.3. Les zones de subduction
Lors d'un rapprochement, une plaque peut plonger sous une autre, en un phénomène de subduction. Cela donne naissance à de très nombreux volcans, actifs et dangereux, tels ceux qui bordent l'océan Pacifique (« Cercle de feu » ou « Ceinture de feu ») et ceux des arcs insulaires (Caraïbes, Indonésie et, en Méditerranée, arcs tyrrhénien et égéen). Par contre, lorsque deux plaques entrent en collision, la compression interdit le volcanisme, mais crée une chaîne de montagnes, siège de nombreux séismes (Alpes, Himalaya).
1.4. Les volcans au sein des plaques
Enfin, quelques volcans occupent une position particulière au sein d'une plaque continentale (mont Cameroun, Yellowstone [États-Unis]) ou océanique (nombreuses îles : Hawaii, La Réunion, Polynésie française, Terres australes) : ils se situent à l'aplomb de zones du manteau profond à température particulièrement élevée, appelées points chauds. Ceux-ci prennent naissance probablement à la limite du noyau et du manteau, à 2 900 km de profondeur. Des instabilités thermiques s'y développent et forment des « panaches » (→ convection), qui montent à la vitesse de quelques centimètres à un mètre par an. Puis, près de la surface, du magma se forme par fusion du manteau, voire de la croûte.
En 2013, les études menées sur le massif sous-marin Shatsky Rise (à 1 500 km à l'est du Japon), un relief auparavant considéré comme le résultat de différentes éruptions volcaniques, ont montré qu'il s'agit d'un seul et même volcan. Renommé massif Tamu, ce volcan bouclier éteint depuis 140 millions d'années est le plus grand volcan observé sur Terre, avec une superficie de 310 000 km2.
2. Le magma, de sa formation à son émission
La Terre libère continuellement une grande quantité de chaleur. Celle-ci a deux origines : la chaleur originelle, liée à la formation de la planète, il y a 4,55 milliards d'années, qui continue à se dissiper, et la chaleur provenant de la désintégration continuelle d'éléments radioactifs (uranium, thorium, potassium) contenus dans la croûte et le manteau terrestres. On estime que la température au centre de la Terre dépasse 5 000 °C, néanmoins le globe reste en grande majorité solide du fait de l'énorme pression. Localement, à une profondeur comprise entre 50 et 400 km, le manteau terrestre (parfois, la croûte) fond partiellement pour des raisons diverses (température anormalement élevée, baisse de pression, rôle des fluides). Le magma produit, liquide et plus léger que l'encaissant solide, monte à la faveur de fractures. Souvent il séjourne plusieurs millénaires ou centaines de millénaires dans une vaste chambre magmatique d'un volume de plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres cubes. Puis, soit il cristallise en profondeur, provoquant la formation de roches plutoniques (granite, gabbro), soit il arrive en surface à la faveur d'une éruption volcanique.
→ roche magmatique.
Les magmas terrestres, silicatés, ont le plus souvent une composition de basalte, mais peuvent évoluer, par différenciation dans la chambre magmatique, vers d'autres types plus riches en silice et en matériaux alcalins (andésite, trachyte, rhyolite). Il existe en Tanzanie un volcan exceptionnel, l'Ol Doinyo Lengai, qui produit des laves noires, carbonatées.
3. Les éruptions volcaniques
Les volcans sont le siège d'éruptions variées. Un volcan donné peut faire des éruptions quasiment toujours du même type ou, au contraire, montrer une activité changeante. La forme de l'édifice en dépend directement.
3.1. Types d’éruptions
3.1.1. Les éruptions laviques ou effusives
Les éruptions laviques (ou effusives) libèrent des laves, fluides, le plus souvent à partir de fissures latérales du volcan. Lors des éruptions de type hawaiien, la température atteint 1 200 °C pour les laves de composition basaltique. Exceptionnellement, la lave stagne dans un cratère. On connaît quelques lacs de lave dans le monde, d'une durée de vie allant de quelques mois à quelques dizaines d'années : Kilauea à Hawaii, Erta-Ale en Éthiopie, Nyiragongo au Congo, Erebus dans l'Antarctique. Les volcans résultant d'une activité essentiellement lavique ont des pentes très faibles (de 3 à 4°) mais un diamètre à la base important, de plusieurs dizaines de kilomètres : on parle de volcans boucliers. Les laves sous-marines forment des boules de quelques dizaines de centimètres mimant des oreillers, d'où leur nom de pillow lavas (de l’anglais pillow signifiant oreiller).
3.1.2. Les éruptions explosives
Les éruptions explosives, complètement différentes, libèrent du magma pulvérisé hors du cratère. Les produits émis sont appelés roches pyroclastiques ou tephra. Selon la taille, on distingue les cendres (plus fines que 2 mm), les lapilli (de 2 à 64 mm), les bombes arrondies et les blocs anguleux, plus gros que 64 mm et atteignant parfois plusieurs mètres. Leur aspect aussi est très varié. Les scories se caractérisent par des vacuoles centimétriques, témoins des bulles de gaz piégées dans le magma. Les ponces contiennent une multitude de vacuoles de petite taille, de forme sphérique ou tubulaire, ce qui explique leur légèreté. Les termes descriptifs des tephra indiquent leur taille et leur aspect : cendre ponceuse, bombe scoriacée, etc.
La présence d'eau (nappe phréatique, lac de cratère, fonte de neige ou de glace) accroît le caractère explosif d'une éruption. L'eau, en se transformant en vapeur, augmente considérablement de volume, à l'origine d'une fantastique surpression. On parle alors d'hydrovolcanisme ou de phréatomagmatisme.
Il existe deux grands types d'éruptions explosives : les projections et les nuées ardentes.
Les projections
Dans le cas des projections, des fragments sont projetés en hauteur avant de retomber à des distances plus ou moins importantes.
• Le type strombolien (décrit au Stromboli, en Italie) expulse des bombes encore incandescentes à plusieurs centaines de mètres.
• Le type vulcanien (décrit au Vulcano, également en Italie) émet des cendres jusqu'à plusieurs kilomètres.
• Le type plinien (du nom de Pline l'Ancien et de Pline le Jeune, qui furent témoins de la dramatique éruption du Vésuve en 79 après J.-C.) libère un panache éruptif de cendres et de bombes ponceuses haut de 10 à 50 km.
Les nuées ardentes
Une nuée ardente est une émission brutale, et dirigée, souvent latéralement, d'un nuage de gaz brûlant transportant des blocs en suspension. L'ensemble, à haute température (de 200 à 500 °C), dévale les flancs du volcan à grande vitesse (de 100 à 600 km/h) et peut même remonter à contre-pente, constituant un risque volcanique humain majeur. L'éruption de la montagne Pelée en Martinique, qui fit 28 000 victimes à Saint-Pierre le 8 mai 1902, en est l'illustration dramatique, d'où le nom de type péléen donné à ce type d'éruption. Souvent le phénomène est suivi de la surrection d'un dôme de lave visqueuse riche en silice à 700 °C. Les dépôts d'ignimbrite connus dans le passé résultent d'éruptions de dynamismes voisins mais hypertrophiés.
3.2. Changements de type éruptif
Certains volcans sont le siège d'un seul type d'éruption pendant une longue période. Il peut s'agir, comme à Hawaii (→ Kilauea) ou à la Réunion (→ piton de la Fournaise), de volcans boucliers, aux pentes relativement faibles (quelques degrés) le long desquelles les coulées de lave se succèdent, ou bien de volcans essentiellement explosifs (volcans du pourtour du Pacifique), de forme conique et dont les pentes atteignent 30°.
Beaucoup d'autres volcans, au contraire, changent assez souvent de type éruptif (Etna, Vésuve). L'édifice, constitué alors d'une alternance stratifiée de produits volcaniques de différents types, s'appelle un strato-volcan.
3.3. Volumes des éruptions
Les volumes émis sont de plusieurs centaines de millions de mètres cubes pour les éruptions laviques et de plusieurs kilomètres cubes pour les éruptions explosives. L'éruption du Tambora en Indonésie a libéré, du 5 au 11 avril 1815, 175 km3 de tephra et une énergie estimée à 1,4 × 1020 J, soit 7 millions de fois l'équivalent de la bombe atomique d'Hiroshima. À Yellowstone, dans le Wyoming, aux États-Unis, trois éruptions très importantes ont eu lieu il y a respectivement 2,1 millions d'années, 1,3 million d'années et 630 000 ans. La première a produit 2 500 km3 de débris et la dernière, 1 000 km3, recouvrant de cendres un tiers des États-Unis. L'émission de grandes quantités de magma se traduit par un effondrement à l'origine d'une caldeira, gigantesque cratère de plusieurs kilomètres de diamètre (75 × 45 km pour une profondeur de plusieurs centaines de mètres à Yellowstone).
4. Les risques volcaniques
4.1. Ampleur des risques volcaniques dans le monde
Les volcans actifs situés près des régions habitées sont à l'origine de risques naturels importants. On dénombre 500 millions de personnes concernées dans le monde, en grande partie dans des pays pauvres. Des villes importantes sont directement menacées : Naples par le Vésuve et les champs Phlégréens, Puebla au Mexique par le Popocatépetl, Quito en Équateur par le Guagua Pichincha, Pasto en Colombie par le Galeras, Arequipa au Pérou par le Misti, Yogjakarta en Indonésie par le Merapi, etc.
4.2. Les catastrophes volcaniques majeures
Des catastrophes de grande ampleur ont eu lieu depuis l'Antiquité. Les vestiges de la ville minoenne d'Akrotiri recouverte par des ponces dans l'île de Santorin en mer Égée témoignent d'une éruption cataclysmique au xviie s. avant J.-C. ou au xvie s. avant J.-C. Le Vésuve a détruit Pompéi, Herculanum et Stabies en 79 après J.-C.
Depuis 1700, on dispose de statistiques fiables : 27 éruptions ont fait plus de 1 000 morts chacune et, au total, ont été dénombrées 265 000 victimes. L'éruption la plus meurtrière a été celle du Tambora (dans les Petites îles de la Sonde, en Indonésie) en 1815, qui fit 12 000 victimes directes, auxquelles se sont ajoutées 80 000 de famine à la suite de la mort du bétail et de la destruction des cultures.
Les coulées de lave, les projections de bombes et de cendres et les nuées ardentes sont des sources de risques d'intensité croissante. Il faut ajouter le rôle des gaz, émis quel que soit le type d'éruption. Parfois les gaz volcaniques peuvent à eux seuls causer une catastrophe. Le 21 août 1986, le lac Nyos, qui occupait un cratère au Cameroun, a libéré un nuage létal de gaz carbonique, qui asphyxia 1 746 personnes. Ces quatre types de risques, directement et immédiatement liés à l'activité volcanique, peuvent être qualifiés de primaires.
Trois autres types de risques, secondaires, sont différés dans le temps ou dans l'espace. La conjonction entre des dépôts volcaniques instables sur les flancs d'un volcan et une grande quantité d'eau (moussons, typhons, cyclones en climat intertropical, fonte de neige et de glace au sommet de volcans élevés, rupture des parois d'un lac de cratère) forme des coulées boueuses appelées aussi lahars (terme indonésien). Celles-ci dévalent les pentes et recouvrent les zones situées en contrebas. Ainsi, le 13 novembre 1985, le Nevado del Ruiz en Colombie a libéré des lahars qui ont enseveli 25 000 personnes dans des villes et villages situés à une distance de 60 à 80 km du sommet du volcan. Au Pinatubo, aux Philippines, des lahars se sont produits pendant plusieurs saisons des pluies après l'éruption de 1991. Des instabilités (éboulement de dôme, glissement de terrain) sont fréquentes sur les volcans, montagnes pour lesquelles ce risque est particulièrement élevé.
Enfin des volcans insulaires ou côtiers peuvent déclencher des raz de marée (appelés aussi tsunamis), qui déferlent sur des côtes parfois éloignées. En 1883, le Krakatoa, dans le détroit de la Sonde, en Indonésie, a ainsi entraîné la mort de 36 417 personnes par noyade sur les côtes de Java et de Sumatra distantes d'une quarantaine de kilomètres. Une éruption volcanique ou un séisme au Chili peut provoquer un tsunami à Hawaii, située à 15 000 km. Les vagues se propagent à 1 000 km/h mais elles ralentissent en arrivant sur les côtes où leur amplitude augmente et peut atteindre de 20 à 30 m de haut.
Enfin des risques encore plus indirects, tertiaires, résultent de l'impact d'une éruption volcanique sur des zones aménagées par l'homme (incendie de matériaux stockés inflammables, rupture de canalisations d'eau ou de gaz, de barrages, pollution des eaux, etc.).
Un volcan situé dans une zone désertique mais sur une trajectoire de circulation aéronautique (Alaska) peut constituer une gêne importante pour le trafic aérien.
Les éruptions majeures, qui injectent des particules (cendres, aérosols) dans la stratosphère, modifient le climat à l'échelle mondiale. L'éruption du Pinatubo, aux Philippines, en 1991, a été responsable d'une baisse de température de 0,3 °C dans l'hémisphère Nord, qui s'est amortie sur quatre ans.
→ climatologie.
Les éruptions peuvent avoir également des conséquences économiques majeures. Ainsi, en avril 2010, le volcan Eyjafjöll, situé sous la calotte glaciaire (Eyjafjallajökull) en Islande, a craché un nuage de particules fines, composées de minuscules morceaux de pierre et de verre, combinées à de grandes quantités de vapeur d’eau. Ce nuage menaçant le fonctionnement des réacteurs d’avion, le trafic aérien a été paralysé dans toute l’Europe du Nord pendant plusieurs jours et les pertes économiques se sont élevées à 1,74 milliard d'euros.
Au cours des temps géologiques, des crises volcaniques majeures ont, peut-être, provoqué l'extinction massive de faunes et de flores.
5. Surveillance, prévision et prévention
Surveiller les volcans et essayer d'en prévoir les éruptions pour prévenir d'éventuelles catastrophes constituent le défi majeur de la volcanologie moderne. Aujourd'hui, la centaine de volcans considérés comme très dangereux sont équipés d'un observatoire de surveillance, qui fonctionne en permanence. Des stations de surveillance sont placées sur le volcan pour enregistrer différents paramètres transmis par radio à l'observatoire.
Des sismographes enregistrent des microséismes, appelés tremors (terme anglais signifiant « frémissement »), témoins de la montée du magma à travers les couches profondes en direction de la surface. Ces vibrations du sol précèdent une éruption en général de 24 à 48 heures.
→ sismologie.
Parallèlement des mesures de déformations peuvent mettre en évidence un gonflement de l'édifice (de l'ordre de quelques millimètres sur une distance de plusieurs kilomètres) ou des variations de pentes (inclinométrie ou « tiltmétrie ») de quelques microradians. Les variations de la température ou de la composition chimique des fumerolles sont également des indications précieuses. Il faut aussi mesurer les champs magnétique, gravimétrique et électrique locaux. Les images envoyées par les satellites (par exemple Spot) donnent des informations immédiates et permettent un suivi de la situation.
Il est important de connaître les éruptions anciennes du volcan, qui donnent des informations sur les manifestations futures. Il s'agit en quelque sorte de dresser le « curriculum vitae » du volcan. Dans ce but, les dépôts anciens (coulées de lave pétrifiées, couches de cendres, etc.) sont identifiés et datés.
Il faut aussi informer les populations concernées, leur expliquer quoi faire ou ne pas faire en cas d'éruption : ne pas aller chercher les enfants à l'école car les enseignants s'en occupent, ne pas téléphoner pour ne pas saturer les lignes, écouter les informations à la radio, etc.). Des exercices de simulation doivent être organisés. Lors d'une crise éruptive, la protection civile aide les habitants dans le cadre de plans de type ORSEC. Des équipes de médecine d'urgence sont prêtes à intervenir pour soigner des traumatismes spécifiques : asphyxies, brûlures, œdèmes des yeux et des poumons, obstructions des voies respiratoires et digestives par les cendres, sans oublier un important choc psychologique.
Les dernières éruptions majeures (Pinatubo, Philippines, 1991 ; Soufrière de Montserrat, Antilles, depuis 1995) ont été relativement bien gérées, ce qui a permis de sauver des milliers de personnes.
6. Le volcan utile
Les volcans, bien connus pour leurs aspects nuisibles, apparaissent également utiles ; ils ont d'ailleurs été déifiés dans l'Antiquité (Héphaïstos chez les Grecs et Vulcain chez les Romains). Lors des premiers temps de la Terre, les émissions de gaz volcaniques ont contribué à la formation de l'atmosphère et, par condensation de la vapeur d'eau, à celle des océans, nécessaires à l'apparition de la vie. Les volcans forment des îles et des territoires nouveaux, colonisés par les êtres vivants et souvent par l'homme. Les sols en région volcanique sont particulièrement fertiles.
Depuis le début de la civilisation, les volcans ont joué un grand rôle dans l'habitat pour les régions concernées : abris sous coulées préhistoriques, habitats troglodytes (Cappadoce turque), matériaux de construction (pierre de Volvic), granulats (pouzzolane). Des minerais sont liés à une activité volcanique (gisements d'or, d'argent et de cuivre au Chili, exploitation du soufre au Kawah Idjen, à Java). L'énergie géothermique est puisée dans le sous-sol des régions péri-volcaniques. Les eaux thermales soignent certaines maladies. De nombreux volcans sont aujourd'hui intégrés et protégés dans des parcs nationaux.
Les volcans constituent des témoins de l'activité de la Terre. Leurs dynamismes éruptifs sont de mieux en mieux compris et leur surveillance devient de plus en plus efficace.
7. Les volcans sur les autres planètes du Système solaire
L'exploration du Système solaire a révélé que le volcanisme n'est pas l'apanage de la Terre, mais se rencontre aussi sur les autres planètes telluriques et sur les plus gros satellites naturels. Sur Mercure et sur la Lune, les volcans sont éteints depuis au moins 3 milliards d'années. Mars présente des édifices volcaniques spectaculaires (notamment Olympus Mons, le plus grand volcan du Système solaire, avec 600 km de diamètre à la base et 21,3 km de hauteur ; son activité, qui a commencé il y a 3,5 milliards d'années, s'est terminée il y a plusieurs centaines de millions d'années), également éteints. En revanche, Vénus abrite encore un volcanisme actif. Par ailleurs, les sondes spatiales Voyager ont photographié sur Io, l'un des principaux satellites de Jupiter, des volcans géants en pleine éruption, libérant des panaches explosifs jusqu'à 300 km d'altitude ; ce magmatisme, à base d'oxydes de soufre, diffère complètement du magmatisme terrestre, silicaté.
À ce volcanisme classique, où la lave est constituée de roche fondue, s'ajoute le cryovolcanisme (épanchement de glace fondue), ancien ou récent, de certains satellites de glace, comme Ganymède autour de Jupiter, Encelade et peut-être Titan autour de Saturne.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
ASIE CENTRALE |
|
|
| |
|
| |

Asie centrale
Cet article fait partie du dossier consacré à l'Asie.
Partie centrale de l'Asie, qui s'étend de la mer Caspienne à la Chine, correspondant essentiellement au sud du Kazakhstan, à l'Ouzbékistan, au Turkménistan, au Kirghizistan et au Tadjikistan, et englobant également la partie occidentale de la province chinoise du Xinjiang.
HISTOIRE
1. La période précoloniale
1.1. Une terre de passage
L'Asie centrale est une terre de passage dont l'histoire millénaire est caractérisée par une succession de conquêtes et vagues migratoires venues d'abord d'Asie puis d'Europe. À l'origine, des tribus sédentaires est-iraniennes occupent trois oasis : les Chorasmiens dans le delta de l'Oxus (actuel Amou-Daria), les Bactriens dans la moyenne vallée de l'Oxus et les Sogdiens dans le haut Iaxarte (actuel Syr-Daria). Le premier contact entre ces autochtones et les nomades Turcs a lieu au ve siècle de notre ère, avec l'installation des tribus Türük, arrivées de l'Altaï.
Lieux de rencontre des influences venues de l'Inde, de la Chine, de l'Iran et du monde méditerranéen grâce aux routes de la soie qu'empruntent pèlerins bouddhistes et marchands, ces régions sont atteintes au viie-viiie siècle par l'islam.
1.2. Premier âge d'or
Au xe siècle la dynastie des Samanides parvient à réunir les trois oasis de civilisation dans un unique émirat, qui marque le premier âge d'or de l'Asie centrale, autour de sa capitale Boukhara. Les Turcs karakhanides lui succèdent en 999 et initient le rapprochement des cultures turque et persane, notamment en favorisant la propagation de l'islam auprès des communautés nomades.
1.3. Second âge d'or
Au début du xiiie siècle, la conquête mongole de Gengis Khan est terriblement destructrice pour la civilisation sédentaire mais elle inclut l'Asie centrale dans le vaste empire des Mongols s'étendant de la Chine à l'Europe. Au sein de l'Asie centrale s'opère alors une symbiose entre les populations turques sédentarisées ou encore nomades et les conquérants mongols. Ce métissage est symbolisé par la figure de Tamerlan, qui établit à la fin du xive siècle son grand émirat avec Samarkand pour capitale et qui est le siège du second âge d'or de l'Asie centrale.
1.4. Le démembrement de l'empire chaybanide
En 1500, les tribus Özbegs marquent la dernière migration humaine précoloniale de la région, dont ils prennent les rênes avec la dynastie des Chaybanides (xve-xvie siècle). Mais dans l'intervalle, la découverte de nouvelles voies maritimes de circulation sonne le glas des routes de la soie et par la même la position stratégique de l'Asie centrale. À partir de 1599, la région se divise en trois entités politiques souveraines : le khanat de Khiva à l'ouest, l'émirat de Boukhara au sud, puis le khanat de Kokand (1710) au nord-est.
Au cours des xviiie et xixe siècles, l'Asie centrale subit la pression de forces étrangères : à l'est les Mandchous se rendent maîtres de la Chine, au nord les Russes occupent la Sibérie, au sud les Afghans constituent un État indépendant, et les Anglais organisent la colonisation des Indes.
2. La colonisation russe
La progression des troupes russes vers l'Asie centrale trouve son aboutissement avec la chute de Tachkent (1865), qui devient le centre du gouvernement général du Turkestan, division administrative de l'empire. Les Russes établissent leur protectorat sur Boukhara (1868) et Khiva (1873) avant d'annexer le khanat de Kokand (1876). La période coloniale est marquée par la mise en œuvre d'une politique de discrimination entre les colons russes et tatars, qui jouissent du statut de citoyens, et les populations autochtones considérées comme étrangères à l'empire et relevant du statut d'« allogènes ».
3. La période soviétique
3.1. L'instauration du régime soviétique : réorganisation sur des bases ethniques
Dans ce contexte ségrégationniste, la révolution russe de 1917 trouve un écho favorable auprès des populations d'Asie centrale. En avril 1918, le soviet de Tachkent décide son union libre à la Russie et devient la République socialiste soviétique autonome (RSSA) du Turkestan. Khiva et Boukhara deviennent des républiques populaires sous protectorat russe. L'instauration du régime soviétique provoque des bouleversements dans la société centrasiatique. D'abord, Moscou décide d'appliquer le concept d'ethnie pour diviser la population et mettre un terme aux velléités panturquistes et panislamiques qui menaçaient le projet soviétique : cinq groupes ethniques, ou « nationalités » dans le jargon soviétique, sont créées à partir d'identités tribales (Ouzbeks, Kazakhs, Kirghiz, Turkmènes) ou linguistique (Tadjiks).
Ensuite, un territoire national est attribué à chaque groupe pour lui permettre son plein développement dans le cadre fédéral de l'URSS. Ainsi, l'Asie centrale se trouve divisée pour la première fois de son histoire en cinq républiques socialistes soviétiques (RSS ethno-nationales : les RSS d'Ouzbékistan et du Turkménistan (1924), du Tadjikistan (1929), du Kirghizistan et du Kazakhstan (1936).
3.2. Collectivisation, migration forcée, déportation
Enfin, le projet économique communiste oblige à sédentariser les éleveurs transhumants et à collectiviser leurs troupeaux au sein de kolkhozes. Ce processus brutal entraîne la mort ou l'exil hors des frontières de l'URSS de près de la moitié des Kazakhs, des Kirghiz et des Turkmènes d'Asie centrale. La main d'œuvre nécessaire au développement de la région est alors fournie par la migration volontaire ou forcée de millions de Slaves (Russes, Ukrainiens, Biélorusses) et Tatars d'Oural, mais également par la déportation collective de Coréens, d'Allemands et de nombreux peuples du Caucase pendant la Seconde Guerre mondiale.
4. La dissolution de l'URSS et les indépendances
À la faveur de la perestroïka, des mouvements nationalistes s'affirment au Kazakhstan (1986), en Ouzbékistan (1989), au Tadjikistan et au Kirghizistan (1990). Mais l'indépendance auxquelles les RSS d'Asie centrale accèdent en décembre 1991 n'est pas le fait de luttes avec le pouvoir central. Elles sont le résultat de la dissolution de l'URSS et de l'exercice du droit à l'autodétermination que la Constitution soviétique reconnaissait alors à ses quinze sujets, dont les cinq républiques centrasiatiques. Les nouveaux États entrent dans le concert des nations en adhérant à l'Organisation des Nations Unies en 1992 et à la Communauté des États indépendants (CEI)., héritière de l'espace territorial couvert par l'URSS.
Abritant une importante minorité russe et largement russophone – bien que les Kazakhs forment désormais près des deux tiers de la population – le Kazakhstan reste l’allié le plus sûr de la Russie dans la région. De même que le Tadjikistan et le Kirghizistan, également proches de Moscou, il est membre signataire de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC, 2003), ces trois républiques adhérant également à la Communauté économique eurasiatique (Eurasec, 2001) dont le noyau est l’Union douanière formée à l’origine par la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan en 2010, le Kirghizistan s’apprêtant à la rejoindre en 2014.
De leur côté, l’Ouzbékistan et le Turkménistan adoptent une position plus réservée et autonome. Le premier suspend à deux reprises son adhésion à l’alliance militaire (en 1999 au traité de sécurité collective de la CEI et en 2012 à l’OTSC après l’avoir rejointe en 2006) et fait de même concernant l’Eurasec en 2008 avant de ratifier sous certaines conditions l’accord de libre échange de la CEI en 2013. Quant au Turkménistan, il n’est plus que membre observateur de la CEI depuis 2005 et reste à l’écart des organisations régionales prônées par Moscou dans le cadre de son projet d’Union eurasiatique.
Fortes de leurs richesses minières, les républiques d’Asie centrale – au premier rang desquelles le Kazakhstan et le Turkménistan – ont développé d’étroites relations économiques avec les grandes entreprises de ces secteurs, occidentales ou asiatiques, en particulier chinoises.
Par leur proximité avec l’Afghanistan et/ou la porosité des frontières avec ce dernier, les quatre républiques les plus méridionales d’Asie centrale tiennent une place géopolitique stratégique aussi bien pendant l’intervention occidentale contre les talibans (base aérienne de Manas au Kirghizistan notamment) que dans la perspective du futur retrait des forces américaines et de l’OTAN d’ici fin 2014.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
MOUSSON |
|
|
| |
|
| |

mousson
(néerlandais monçon, du portugais monção, de l'arabe mausim, saison)
Consulter aussi dans le dictionnaire : mousson
Cet article fait partie du dossier consacré à l'Asie et du dossier consacré au climat.
La mousson est un système de vents saisonniers alternés soufflant à des latitudes tropicales (essentiellement en Asie méridionale), de la mer vers le continent en été (mousson d'été), du continent vers la mer en hiver (mousson d'hiver).
1. La circulation atmosphérique
La mousson est un phénomène de la basse et moyenne troposphère. Elle est liée à des facteurs géographiques (juxtaposition de masses océaniques et continentales) et thermiques : l'échauffement estival entraîne la formation de basses pressions sur les continents aspirant l'air océanique humide ; le refroidissement hivernal plus rapide sur les continents amène une élévation des pressions et des vents dirigés vers l'océan. Ces différences de température entre océans et continents commandent ainsi la circulation atmosphérique dans la mesure où elles déterminent le positionnement des anticyclones et des dépressions.
Dans l'hémisphère Nord, les vents s'enroulent autour des anticyclones dans le sens des aiguilles d'une montre, dans l'hémisphère Sud, en sens inverse. En été, l'anticyclone de l'océan Indien remonte assez haut vers le nord et franchit l'équateur. Ce phénomène est lié au balancement des grands anticyclones tropicaux qui oscillent parallèlement au mouvement apparent du Soleil, de l'équateur vers le tropique du Cancer pendant l'été boréal, puis vers le tropique du Capricorne pendant l'été austral. Les vents qui soufflaient vers le nord-ouest sont détournés au nord de l'équateur par la force de Coriolis, et se mettent à souffler vers le nord-est, c'est-à-dire vers l'Inde et non plus vers l'Afrique. Ces vents chargés de l'humidité océanique provoquent sur tous les reliefs des pluies très abondantes : c'est la mousson.
2. Les moussons d’été et les moussons d’hiver
Les moussons les plus connues sont celles de l'océan Indien.
D'avril à septembre, on observe la mousson du sud-ouest, humide ; d'octobre à mars, la mousson du nord-est, sèche.
En hiver, le continent joue le rôle de centre froid et engendre une zone de hautes pressions. Ainsi, la Sibérie est le siège d'un anticyclone qui génère, sur sa face sud, un vent de nord-ouest. L'air expulsé de la zone anticyclonique vers la zone de dépression située au dessus de l'océan Indien est froid et sec ; franchissant l'Himalaya, il redescend vers l'Inde en subissant un effet de foehn, qui augmente sa sécheresse tout en le réchauffant. La mousson d'hiver est ce vent sec et relativement doux de nord-est.
En été inversement, le continent, plus chaud que l'océan, est le siège d'une dépression qui attire des vents de sud-ouest d'origine tropicale, très chauds, chargés d'humidité. Dès leur arrivée sur le sous-continent indien, ces masses d'air donnent naissance à des nuages et à des pluies d'autant plus abondantes que le relief – notamment les pentes sud de l'Himalaya – favorise des mouvements ascendants. On a enregistré à Cherrapunji (dans le Meghalaya, État fédéré du nord-est de l'Inde) 11 m d'eau par an (en réalité en six mois d'été), le seul mois de juillet en recevant 2,70 m (pour mémoire, la quantité moyenne de pluies recueillies annuellement à Paris est de 0,60 m).
On réserve parfois le terme de « mousson » à la seule mousson d'été, humide, dont l'importance est primordiale sur la vie humaine, agricole essentiellement. Les pluies de mousson apportent plus de 80 % des précipitations sur les régions habitées par la moitié de la population mondiale. (L'apport de la mousson d'été apparaît bien sur la carte des précipitations en Inde, pays situé à la latitude du Sahara et de l'Arabie [voir illustration ci-dessus].) Le climat de mousson est une composante saisonnière du climat tropical ; il varie d'une année à l'autre, tant dans sa date d'arrivée que dans son intensité. Ses anomalies sont catastrophiques : des pluies trop abondantes s'accompagnent d'inondations et de glissements de terrain ; des pluies trop faibles ou absentes prolongent la période de sécheresse.
3. Les différents domaines des moussons
Le phénomène de mousson est particulièrement bien représenté (mais non exclusivement) en Afrique occidentale, dans le sous-continent indien et à Ceylan ainsi que dans le Sud-Est asiatique (Indochine, archipel malais, sud de la Chine) ; il demeure perceptible, avec moins de valeur démonstrative, en Asie orientale (Chine du Centre, Chine du Nord et Japon), incluse parfois dans l'Asie de la mousson.
3.1. La mousson en Afrique occidentale
En Afrique occidentale, la masse d'air humide progresse en direction de la dépression thermique saharienne de surface (coiffée par l'anticyclone dynamique demeuré en altitude) depuis l'anticyclone de Sainte-Hélène et, à tout le moins, depuis les parages équatoriaux du golfe de Guinée. Il semble que la puissance expulsive des hautes pressions australes l'emporte sur la puissance aspiratrice de la dépression saharienne, maintenue, il est vrai, fort peu épaisse. Le coin de mousson passe sous le système de circulation du Sahara reporté en altitude. Le front de mousson exprime l'endroit où la mousson est si peu épaisse que les pluies qui accompagnent sa progression ne deviennent substantielles qu'à une distance respectable de sa trace au sol. Le renversement saisonnier se marque par l'emprise de la circulation saharienne et par l'intervention de l'alizé et survenu du continent (harmattan). Sauf en bordure du golfe de Guinée, l'alternance d'une saison sèche et d'une saison humide est bien respectée jusqu'à la latitude de Dakar ou de Saint-Louis-Tombouctou. Avec une période sèche qui occupe désormais les trois quarts de l'année, nous arrivons là aux limites du concept des tropiques humides. La poussée de mousson peut (rarement) remonter en été jusqu'au coeur du désert (Tamanrasset).
3.2. La mousson en Inde
En Inde, la répartition des pluies diffère selon la latitude, ce qui traduit d'abord la combinaison de la répartition des terres, des mers et des reliefs avec les processus pluvieux de mousson. La bordure indienne de l'Himalaya a de fortes précipitations (3 000 mm à Darjeeling). Mais ce sont, avec les 11 m de Cherrapunji, les reliefs de l'Assam qui connaissent les hauteurs d'eau les plus impressionnantes (pôle mondial de la pluviométrie). La plaine Indo-Gangétique, très sèche, voire aride à l'ouest (Pendjab), est fort arrosée à l'est (Bengale). Le Deccan inverse le sens de cette dissymétrie, avec des précipitations énormes sur les Ghâts occidentaux, et Bombay, plus au nord, illustre encore ces dispositions.
Les grands mécanismes de la mousson indienne sont indépendants de ceux qui règnent à l'est, sur le monde malais, et au nord-est, sur la Chine. En hiver, c'est le passage du jet-stream au sud de l'Himalaya qui assure la formation de l'anticyclone indigène, générateur d'un alizé que l'on convient d'appeler la mousson d'hiver. En été, le brusque effacement de la circulation d'altitude, qui remonte vers le nord, aboutit à la libération de toute contrainte dans l'élaboration de la dépression thermique du Pendjab (coiffée par l'anticyclone dynamique d'altitude) et à la réalisation du talweg de mousson, qui prolonge cette dépression vers l'est-sud-est. Pour l'essentiel, la mousson qui dessine ce talweg attaque le Deccan par l'ouest (d'où pluies orographiques de la côte de Malabar), puis, après la traversée de la péninsule, opère un changement de direction sur le golfe du Bengale. On comprend, dans ces conditions, que, combinée au détail des perturbations, l'application pluviométrique maximale se fasse sur l'ouest du Deccan et l'est de la plaine Indo-Gangétique. L'est du Deccan (côte du Coromandel) doit attendre le début du renversement du flux de mousson (avec intervention du bord oriental d'un anticyclone centré vers l'ouest de la péninsule) et aussi l'application de perturbations spécifiques du golfe du Bengale pour qu'interviennent les pluies dessinant le maximum d'automne.
À la forêt de mousson, formée d'arbres qui perdent leurs feuilles au cours de la saison sèche, succède la jungle, région de très hautes herbes parsemée de bouquets d'arbres (baobabs, bambous géants).
3.3. La mousson dans le sud-est de l'Asie
Dans le sud-est de l'Asie, la mousson d'hiver semble bien être essentiellement le fait de ces anticyclones mobiles qui glissent sur le Pacifique et irriguent de leur flux alizéen les îles et le continent dans sa partie indochinoise, tandis que la mousson d'été est un flux austral. Cela est évidemment un schéma très simplifié d'une réalité rendue complexe par la configuration du continent à cet endroit et aussi par l'allure des reliefs combinés à des expositions fort diverses aux vents marins. Le fait qui domine, cependant, est l'importance des abats apportés par la mousson d'été, dont le centre dépressionnaire attractionnel est constitué par les basses pressions de l'Asie centrale.
3.4. La mousson dans l'Asie orientale
L'Asie orientale (Chine du Centre, Chine du Nord et Japon), représente la limite du concept de mousson : il est probable que l'essentiel du flux pluvieux d'été arrive de l'hémisphère boréal en prenant naissance sur le Pacifique Nord. Quant à la mousson d'hiver, elle paraît être la seule que l'on ne puisse pas assimiler à un système alizéen.
La Chine du Sud et le Japon ont un climat caractérisé par des hivers doux parfois marqués de coups de froid et par des étés chauds et très humides. La forêt (conifères sur les hauteurs, ailleurs théiers, magnolias) couvre la majeure partie de ces pays, lorsqu'elle n'a pas encore fait l'objet d'un défrichement souvent intensif (Chine du Sud).
La Chine du Nord, où les hivers sont très froids et secs, connaît des pluies de mousson plus courtes et irrégulières. La forêt n'existe que sur les hauteurs, alors que les plaines ont une végétation de steppe et de prairie.
3.5. Les fleuves de l'Asie des moussons
Les fleuves de l'Asie des moussons, issus de la haute montagne, connaissent des crues énormes durant l'été, car aux eaux dues à la fonte des neiges s'ajoutent les eaux de pluie. Aussi ces fleuves ont-ils un énorme pouvoir érosif et ne sont-ils généralement pas navigables dans leur cours supérieur. En revanche, ils édifient d'immenses deltas qui constituent les régions les plus fertiles et par conséquent les plus peuplées d'Asie (Gange et Brahmapoutre).
4. La forêt de mousson
Assez ouverte, la forêt de mousson est constituée d'arbres massifs, trapus et sans contreforts, assez espacés ; il y a donc peu de compétition entre les plantes pour la lumière. Pendant la saison sèche, beaucoup d'espèces perdent leurs feuilles, la forêt prend alors un aspect hivernal, cependant, pour un certain nombre, cette saison est aussi celle de la floraison. Dans cette forêt, les grands arbres (30-35 m) forment un dôme irrégulier (shorea, tectona, terminalia) ; le sous-bois est dense, avec des feuilles petites et dures, et au-dessous de lui existe une strate herbacée. Les plantes grimpantes sont moins nombreuses et plus petites que dans la forêt tropicale humide. Lorsque les précipitations sont moins importantes, on est en présence d'une forêt de mousson sèche, dont les arbres, plus petits (15-20 m), se dépouillent tous, ainsi qu'une partie des arbustes ; la strate herbacée n'est alors visible que pendant la saison humide.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
