|
| |
|
|
 |
|
BOURGEOISIE |
|
|
| |
|
| |

BOURGEOISIE
PLAN
* BOURGEOISIE
* 1. L'émergence de la bourgeoisie au Moyen Âge
* 1.1. Une catégorie d’abord spatiale, jusqu’au xie siècle
* 1.2. Une nouvelle catégorie socio-économique aux xie-xiie siècles
* 1.3. L’épanouissement du patriciat au xiie siècle
* 1.4. L’émergence de la bourgeoisie d’offices au xive siècle
* 2. L'essor de la bourgeoisie à l'époque moderne (xvie-xviiie siècles)
* 2.1. La bourgeoisie française en quête de noblesse
* Les « bourgeois gentilshommes »
* Une bourgeoisie neutralisée par l’office et la terre
* 2.3. La grande bénéficiaire de la Révolution française
* Les frustrations bourgeoises, à la fin de l’Ancien Régime
* L’alliance tactique entre privilégiés et élites bourgeoises
* Une Révolution bourgeoise en 1789
* 3. L’accession au pouvoir (xixe siècle)
* 3.1. Grande bougeoisie et noblesse
* Le rapprochement par l’anoblissement et le mariage
* Le croisement des capitaux
* Un même mode de vie
* 3.2. Le temps des notables
* Un rôle public de premier plan jusque dans les années 1870
* Une large assise dans le monde rural
* 3.4. La montée politique des professions libérales après 1870
* 3.5. La contestation de la bourgeoisie
* Socialisme et mouvement ouvrier
* Communisme contre capitalisme
* 4. Mutations de la bourgeoisie au xxe siècle
* 4.1. L'apparition des cadres
* 4.2. Le déclin des petits patrons
* 4.3. L'adhésion à l'État
* L’attachement à l’État-providence
* Le rôle croissant de l’État
* Le vote à gauche d'une partie des bourgeoisies
* 4.4. L'âge des loisirs
* 4.5. Le retour des femmes dans la vie publique
* 4.6. La fin du particularisme
bourgeoisie
Consulter aussi dans le dictionnaire : bourgeoisie
Cet article fait partie du dossier consacré à la Révolution française.
Avant la Révolution française, ensemble des bourgeois.
1. L'émergence de la bourgeoisie au Moyen Âge
1.1. Une catégorie d’abord spatiale, jusqu’au xie siècle
À l'origine, le terme de « bourgeoisie » désigne l'ensemble des habitants d'un bourg (bourgeois), agglomération créée à côté d'une cité épiscopale, auprès d'un monastère ou d'un château, et initialement dévolue à l’artisanat et aux échanges. Il s'applique à une forme de vie passée non plus sur le domaine seigneurial mais à la ville. Le terme burgensis, dérivé de Burg (« place forte », en allemand), est attesté pour la première fois dans une charte de l'an 1007, et passe peu à peu dans le langage courant.
1.2. Une nouvelle catégorie socio-économique aux xie-xiie siècles
C'est au xie siècle que se constitue, dans une Europe marquée par un essor économique progressif, cette nouvelle catégorie socio-économique. Le bourgeois est avant tout un citadin qui assure son existence soit par le métier qu'il pratique, soit par le commerce. Le bourgeois est donc le contraire d'un terrien ; tout naturellement, il demande au seigneur les libertés nécessaires à l'exercice de ses fonctions et les obtient, parfois à la suite de conflits violents, sous la forme de chartes de franchises applicables à l'ensemble de la bourgeoisie d'une commune. Celle-ci peut ainsi nommer ses représentants (échevins, consuls dans le Midi, aldermen en Angleterre), dont les équivalents modernes sont les conseillers municipaux. Dans les Flandres, les « communes » s'émancipent de la tutelle féodale et se dotent d'institutions municipales propres. Le beffroi et le palais communal sont les symboles de l'indépendance fièrement affichée de ces villes franches.
1.3. L’épanouissement du patriciat au xiie siècle
À partir du xiie siècle, une élite se dégage : le patriciat, frange la plus riche de la bourgeoisie, qui monopolise le gouvernement de la ville et doit faire face à de nombreux soulèvements sociaux, particulièrement dans les régions d'Europe où le développement économique est le plus avancé (Flandres, nord de l'Italie). En Europe septentrionale, l'élite commerçante des ports les plus importants se regroupe dans une communauté économique (→ la Hanse) dont la puissance politique s'étend de la Baltique à la mer du Nord.
1.4. L’émergence de la bourgeoisie d’offices au xive siècle
Mais la bourgeoisie, c'est aussi le droit, et les robes noires des légistes qui entourent le roi et sa cour. Le renforcement progressif des États au xive siècle entraîne en effet le développement de leur appareil administratif. Les institutions monarchiques se spécialisent et font appel aux compétences des lettrés et des juristes formés au droit romain, théoriciens d'un pouvoir absolu et centralisé. En France, sous l'impulsion de Philippe le Bel, toute une bourgeoisie de fonction prospère à l'ombre de la monarchie, venant peupler les offices de juges, secrétaires, conseillers au Parlement et à la Chambre des comptes.
2. L'essor de la bourgeoisie à l'époque moderne (xvie-xviiie siècles)
À partir du xvie siècle, le commerce colonial offre à la bourgeoisie de nouvelles possibilités d'enrichissement, tandis que se développent les pratiques bancaires nées à la fin du Moyen Âge. Jouissant d'un pouvoir économique et culturel accru, celle-ci se heurte aux privilèges des membres du clergé et de la noblesse, et revendique un rôle politique à la hauteur de ses responsabilités économiques.
2.1. La bourgeoisie française en quête de noblesse
Les « bourgeois gentilshommes »
En France, l'ascension de la bourgeoisie est facilitée par le développement de l'administration royale, qui s'appuie sur elle contre la noblesse. Par les carrières anoblissantes qu'il propose, le service de l'État devient pour les bourgeois la voie obligée de l'affirmation sociale. Aussi voit-on les marchands et leurs fils se ruer sur les offices, les fonctions, les postes dans l'appareil d'État vendus par Louis XIV en France. Colbert, fils de négociant en drap devenu grand commis de l'État, illustre au plus haut point le cheminement des cohortes de « bourgeois gentilshommes » fraîchement anoblis par l'office.
Une bourgeoisie neutralisée par l’office et la terre
La montée de cette noblesse de robe ne manque d'ailleurs pas de provoquer la colère de la vieille noblesse militaire qui, avec Saint-Simon, dénonce le « règne de vile bourgeoisie ». L'achat par les bourgeois d'offices et de seigneuries, qui sont deux formes d'investissement dans le privilège, montre en fait leur soumission aux valeurs aristocratiques dominantes, leur « trahison » disait l’historien Fernand Braudel. Le négoce seul ne conduit pas à la réussite sociale, il faut en passer par la robe et la terre. En France, l'Ancien Régime canalise la fougue bourgeoise en monnayant l'intégration à la noblesse, seule élite reconnue, et en comptant sur la fidélité et la gratitude des robins.
Cependant, dans sa progression, l'absolutisme rencontre ailleurs la résistance des élites sociales qui veulent être associées à l'exercice du pouvoir et contrôler l'État. C'est le cas en Angleterre, très tôt, dès le xviie sièclle, où la bourgeoisie marchande se trouve aux côtés des fractions dynamiques de la gentry (petite et moyenne noblesse), dans un combat commun contre la « tyrannie » royale. Bien d'autres facteurs concourent aux révolutions anglaises de 1640 et 1688 (→ première révolution d'Angleterre, seconde révolution d'Angleterre), notamment les questions religieuses, mais on retient le rôle de la bourgeoisie : celle-ci n'a pas connu le modèle français d'intégration dans l'État et de neutralisation politique par l'office, et ses aspirations politiques libérales rencontrent aisément celles d'une aristocratie dont elle est proche socialement.
2.3. La grande bénéficiaire de la Révolution française
Les frustrations bourgeoises, à la fin de l’Ancien Régime
En France, le système louis-quatorzien a longtemps su faire taire les oppositions, mais bientôt son modèle intégrateur s'épuise : la « pompe aspirante » de l'office et de la robe se bloque quand la noblesse se ferme aux nouveaux venus. Les offices parlementaires anoblissants sont de fait interdits aux roturiers. Dans l'armée, les nobles les plus récents s'empressent de fermer la porte derrière eux et rejoignent la vieille noblesse militaire dans une ardente défense des privilèges : tel est le sens des édits de Ségur, en 1781, qui exigent des officiers quatre quartiers de noblesse.
C'est à ce titre que l'on peut parler d'une frustration de la bourgeoisie, socialement dévalorisée. Comme la noblesse, elle prospère largement par la rente, voire par le privilège royal qu'elle n'hésite pas à briguer, mais se voit refoulée dans ses tentatives d'intégration à l'aristocratie. Il y a là bien sûr un terrain favorable à la revendication politique, une fois épuisés tous les accommodements possibles.
L’alliance tactique entre privilégiés et élites bourgeoises
Précisément, la crise que traverse la monarchie française à la fin du xviiie siècle voit se nouer une alliance de fait (paradoxale, mais provisoire) des privilégiés et des élites bourgeoises, au nom de l'anti-despotisme. La défense des libertés cache des intérêts divergents : les uns entendent partager le pouvoir avec le roi pour faire échec aux projets de réforme fiscale menaçant leurs privilèges ; les autres aspirent à une égale représentation de tous les propriétaires, bourgeois comme nobles, au sein d'un régime de monarchie contrôlée. Libéralisme aristocratique d'un côté, libéralisme de « propriétaires » de l'autre : leur conjonction n'en fait pas moins chuter la monarchie absolue.
Une Révolution bourgeoise en 1789
Dès lors, le processus lancé en 1789 révèle la capacité de la bourgeoisie à prendre en marche le train de la Révolution. Poussée par l'événement, la bourgeoisie marchande et manufacturière, proprement capitaliste, se jette alors dans la brèche ouverte par la bourgeoisie officière et rentière : il s'agit pour elle de tirer parti de la situation, en se portant au pouvoir pour garantir l'ordre et la propriété, aussi bien contre l'aristocratie contre-révolutionnaire que face au mouvement populaire. Si la Révolution française est « bourgeoise », c'est en ce sens que la bourgeoisie en tire les plus grands profits et se trouve propulsée à la direction politique du pays, fondant un nouvel ordre social sur le droit et la propriété.
3. L’accession au pouvoir (xixe siècle)
Associée au développement du capitalisme, que favorise la révolution industrielle, la bourgeoisie étend alors son influence tout au long du xixe siècle, encourageant le libéralisme politique (régime parlementaire, libertés individuelles) et économique (plus ou moins poussé selon les pays).
3.1. Grande bougeoisie et noblesse
Le rapprochement par l’anoblissement et le mariage
Dans les décennies qui ouvrent le xixe siècle, les rapports entre la noblesse, ordre privilégié de l'Ancien Régime, et la bourgeoisie, instigatrice des mutations économiques, se modifient. En Grande-Bretagne, en France, mais aussi en Italie, en Autriche-Hongrie et en Pologne, le passage entre grande bourgeoisie et noblesse devient fréquent. L'anoblissement constitue la voie d'accès la plus directe – et la plus étroite – à un ordre qui garde partout son prestige : quatre cents nouveaux lords en Grande-Bretagne entre 1832 et 1914, d'abord des hommes politiques, puis, à partir des années 1880, des industriels.
Le mariage interclasses devient plus courant, dans la mesure où les familles y trouvent leur intérêt ; suivant une stratégie matrimoniale rigoureuse qui vise à préserver le lignage et le titre, la partie noble – donc masculine – apporte son nom, tandis que la partie roturière met sa fortune dans la corbeille.
Le croisement des capitaux
Plus important encore pour la préservation des patrimoines est le croisement des capitaux entre noblesse et bourgeoisie. Dans un siècle où la terre cesse d'être la source majeure des profits, la noblesse élargit le champ de ses investissements. En France, des aristocrates plus titrés que fortunés apportent la caution de leur nom au conseil d'administration de sociétés anonymes désirant rassurer les petits actionnaires. Certains nobles deviennent de véritables capitaines d'industrie, tels les maîtres de forges de la famille de Wendel, dont un ancêtre, Ignace, avait fondé Le Creusot peu avant la Révolution. À l'inverse, la terre constitue un placement stable que les entrepreneurs bourgeois ne négligent pas.
Un même mode de vie
Enfin, nobles et grandes bourgeoisies, les classes dirigeantes de France ou de Grande-Bretagne partagent le même mode de vie. Elles se retrouvent à Nice ou à Marienbad, à la cour de Victoria, de François-Joseph ou de Napoléon III. Jamais on n'a bâti autant d'hôtels particuliers ni de châteaux. Jamais les domestiques n'ont été aussi nombreux : autant que les ouvriers du textile en Grande-Bretagne en 1851.
3.2. Le temps des notables
Un rôle public de premier plan jusque dans les années 1870
À un degré inférieur dans l'échelle des fortunes, les notables, rentiers et hommes de loi, assurent la transition entre les élites de l'Ancien Régime et celles de la société capitaliste. En France comme en Italie, au début du siècle, cette bourgeoisie moyenne se retrouve à la tête d'un patrimoine foncier considérable acquis à partir de la Révolution. Jusque dans les années 1870, les notables contrôlent au moyen du patronage – la protection qu'ils apportent à leur clientèle politique – les fonctions publiques de leur province et accaparent les institutions représentatives : en 1840, sous la monarchie de Juillet, 63 % des députés paient plus de 1 000 F d'impôts et luttent évidemment contre l'élargissement du cens électoral (soit la quotité d'imposition minimale nécessaire pour être électeur et, plus encore, éligible).
Une large assise dans le monde rural
En Grande-Bretagne et en France, la bourgeoisie bénéficie d'une large assise dans le monde rural : les paysans votent pour les notables, riches propriétaires fonciers qui les représentent, dans le cadre du suffrage censitaire, au Parlement. Ces relations de dépendance sont accentuées en Grande-Bretagne par la concentration de la propriété foncière.
Paradoxalement, la crise des campagnes et l'exode rural à la fin du siècle ne minent pas l'influence de la bourgeoisie sur la paysannerie, les notables continuant d'exercer leur patronage. Ainsi, la Société nationale de l'encouragement agricole et la Société des agriculteurs de France, qui rassemblent pourtant les plus gros propriétaires fonciers, prônent l'effort individuel et la défense de la petite exploitation paysanne, fondements de l'ordre social.
3.3. De nouvelles couches sociales : les classes moyennes
De leur côté, les classes moyennes adhèrent volontiers aux valeurs de la bourgeoisie, et les défendent, surtout face aux ouvriers. Une telle solidarité prend toute sa valeur quand, aux catégories indépendantes de type ancien (petits patrons, boutiquiers, rentiers et professions libérales les plus modestes), les mutations économiques adjoignent les salariés du secteur tertiaire (employés de bureau en nombre croissant). Tous partagent avec la bourgeoisie le culte du travail, de l'épargne, de la famille, de la liberté individuelle. Tous cherchent à vivre bourgeoisement, en particulier en s'offrant les services d'un domestique. Paysannerie et classes moyennes reconnaissent d'autant mieux à la bourgeoisie son droit à faire respecter l'ordre social qu'elles se sentent menacées par les ouvriers, ces « nouveaux barbares » issus de la révolution industrielle.
3.4. La montée politique des professions libérales après 1870
Après la suppression du suffrage censitaire – en 1848 en France, et par étapes entre 1867 et 1918 en Grande-Bretagne –, paysannerie et classes moyennes de ces deux pays délèguent plus volontiers le rôle de représentant politique à la moyenne bourgeoisie des professions libérales. Médecins et avocats notamment, qui ne doivent leur réussite sociale qu'à leurs succès universitaires et à leurs talents, et non, comme les notables traditionnels, à la transmission d'un patrimoine, ont un grand prestige. De plus, leur autonomie financière vis-à-vis de l'État et des puissances d'argent les incite à s'ériger en défenseurs du libéralisme et du parlementarisme.
En France, où, en 1865, sous le Second Empire, Gambetta prédit « l'avènement de nouvelles couches [sociales] », la bourgeoisie intellectuelle constitue l'ossature du parti républicain ; elle formera le personnel politique de la IIIe République.
3.5. La contestation de la bourgeoisie
Socialisme et mouvement ouvrier
La bourgeoisie subit cependant les attaques des théoriciens socialistes, Proudhon et surtout Karl Marx, qui l'opposent, en tant que classe détentrice des moyens de production, à la masse ouvrière exploitée. Elle doit dès lors compter avec l'essor des mouvements socialistes et syndicalistes, dont l'action, fondée sur la lutte des classes, vise au renversement de l'ordre social. Les entrepreneurs allemands doivent ainsi faire face à une forte contestation ouvrière, à laquelle le parti social-démocrate d'Allemagne fournit, dès 1869, une organisation puissante. Ils font donc alliance avec l'aristocratie et le pouvoir politique, obtenant de Bismarck qu'il réprime le mouvement ouvrier.
Communisme contre capitalisme
Dans les régimes communistes mis en place après la révolution russe de 1917, la bourgeoisie, considérée comme « ennemi de classe », se voit dépossédée de ses pouvoirs. Ailleurs, son influence reste dominante dans les pays industrialisés, dont l'évolution est cependant avant tout caractérisée par une forte extension des « classes moyennes ».
4. Mutations de la bourgeoisie au xxe siècle
Les mutations technologiques et la croissance économique pendant la seconde moitié du xxe siècle ont provoqué une spectaculaire croissance des activités de services. En France, la part des emplois tertiaires passe de 48 % à 63 % de la population active en vingt ans (1970-1990). En Grande-Bretagne, 1,7 million d'emplois de services sont créés entre 1979 et 1986, soit l'équivalent du nombre d'emplois industriels supprimés dans le même temps.
4.1. L'apparition des cadres
Les postes de gestion dans les entreprises et la fonction publique sont désormais confiés à des personnes ayant reçu un enseignement professionnel supérieur, qui forment une nouvelle catégorie de salariés : les cadres. Le terme naît dans les années 1930, et recouvre toute une hiérarchie qui va des cadres moyens ou techniques aux cadres supérieurs ou dirigeants. En 1954, ils forment seulement 8 % de la population active en France, alors qu'ils atteignent 20 % en 1982.
Inspirés du modèle américain, les cadres dirigeants ont le culte de la compétence et de la rationalité, qu'ils voudraient voir substituées aux idéologies politiques. Ils appliquent ces règles à leur propre carrière : le curriculum vitae, commenté lors de l'entretien d'embauche par le candidat, doit révéler un parcours cohérent, toujours tourné vers la recherche de l'efficacité.
4.2. Le déclin des petits patrons
Si elle accroît la classe moyenne des salariés, l'évolution économique défavorise la petite bourgeoisie indépendante. Alors qu'en 1930, en France, les petits patrons du commerce et de l'industrie représentaient 17 % de la population active, ils n'en forment plus que 7,8 % en 1975, à l'issue de la grande période de croissance de l'après-guerre. Se sentant menacés par les mutations de la technologie et des techniques de vente, ils se retournent contre l'État dans lequel ils avaient jusque-là placé leur confiance pour les défendre contre les « gros ». En 1956, Pierre Poujade cristallise les tendances antiparlementaires, autoritaires, antisémites et antifiscales déjà apparues dans les années 1930 chez certains d'entre eux, et les canalise contre celui qui incarne la modernisation de l'économie et de l'État : Pierre Mendès France.
Un peu partout en Europe, les petites bourgeoisies indépendantes, sur le déclin, manifestent leur mécontentement par une semblable hostilité à l'État et aux législations contraignantes.
4.3. L'adhésion à l'État
L’attachement à l’État-providence
En revanche, une partie des bourgeoisies européennes se distingue, des années 1930 au début des années 1980, par une adhésion croissante à l'intervention de l'État. Même en Grande-Bretagne où, à partir de l'accession de Margaret Thatcher au poste de Premier ministre, en 1979, le sentiment contraire semble s'imposer, les sondages montrent avec constance l'attachement des Britanniques à l'État-providence (Welfare State) dans l'éducation, la santé et les systèmes de retraite.
Le rôle croissant de l’État
De fait, après 1945, en Grande-Bretagne comme en France, à travers les nationalisations, la planification et l'aménagement du territoire, l'État joue un rôle croissant, y compris dans les relations professionnelles (loi de 1968 portant création des sections syndicales d'entreprise, loi de 1978 sur la mensualisation des salariés). En République fédérale d'Allemagne, le principal parti de gouvernement, la CDU-CSU, pourtant acquis dès 1949 à l'économie de marché, encourage la cogestion entre employeurs et salariés sous l'arbitrage de l'État. Enfin, la demande d'intervention des pouvoirs publics s'étend aux orientations culturelles, avec les Art Councils en Grande-Bretagne, les maisons de la culture en France, etc.
Le vote à gauche d'une partie des bourgeoisies
Cette acceptation du rôle de l'État amène une partie des bourgeoisies européennes à voter à gauche, surtout après que certains partis ont laissé de côté leurs traditions ouvrières, comme le parti social-démocrate allemand dès 1959 ou le Labour Party britannique en 1964.
4.4. L'âge des loisirs
La réduction du temps de travail, la hausse du niveau de vie, la diffusion de moyens de communication de masse développent une véritable culture des loisirs qui valorise la nature et le corps. Des activités jusqu'alors cantonnées aux pelouses des public schools britanniques, tennis ou golf, se démocratisent. Le nombre des titulaires de licences sportives double en France entre 1970 et 1980. La bourgeoisie, grâce à ses revenus, est la classe qui en profite le plus : en 1983, 85 % des cadres supérieurs français partent en vacances l'été, et 30 % l'hiver, contre respectivement 50 % et 5 % chez les ouvriers.
4.5. Le retour des femmes dans la vie publique
La croissance des emplois tertiaires et l'évolution des mentalités redonnent aux femmes de la bourgeoisie une place dans la vie publique : elles accèdent à des responsabilités importantes dans les entreprises et dans l'administration, et participent davantage à la vie politique. Mais cette place reste minoritaire. C'est un des thèmes de revendication des mouvements féministes européens qui, du xixe siècle au début du xxie, recrutent surtout parmi les femmes des milieux les plus cultivés.
4.6. La fin du particularisme allemand après 1945
La bourgeoisie allemande participe à ce mouvement de convergence. Après son consentement au nazisme, qui prolonge la faiblesse du parlementarisme et du libéralisme du xixe siècle, et la véritable révolution culturelle provoquée par la défaite en 1945, elle rejoint les pratiques et les valeurs des bourgeoisies de l'Europe occidentale, dont la propriété, le droit et les libertés restent les points cardinaux.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
ASSEMBLÃE CONSTITUANTE |
|
|
| |
|
| |
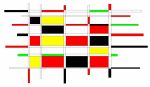
PLAN
* ASSEMBLÉE CONSTITUANTE
*
* 1. L'Assemblée nationale constituante (1789-1791)
* 1.1. La naissance de la Constituante
* 1.2. La première assemblée politique
* Les divisions politiques
* La nuit du 4 août : l'abolition des privilèges
* 1.3. Les premières mesures législatives
* 2. L'œuvre de la première Constituante
* 2.1. La Constitution de 1791
* 2.2. Le mode électoral
* 2.3. La nouvelle organisation territoriale
* 2.4. Le décret Le Chapelier et la Constitution civile du clergé
* 3. Les autres Constituantes
* 3.1. L'Assemblée de 1848
* 3.2. Les Constituantes de la IVe République
Assemblée constituante
1. L'Assemblée nationale constituante (1789-1791)
L'Assemblée nationale constituante de 1789 est née des états généraux convoqués à Versailles le 5 mai 1789 par Louis XVI. Les états étaient, selon le droit public de l'ancienne monarchie, des « plaignants, remontrants et, s'il plaît au roi, des proposants », porteurs des cahiers de doléances. Ils n'avaient aucun pouvoir propre, étaient convoqués, ajournés ou dissous selon la volonté du roi, qui réglait leur composition et leur ordre du jour.
1.1. La naissance de la Constituante
Dès le 11 mai 1789, alors que les délibérations des états généraux étaient au point mort depuis le 6 mai, le tiers état décida de vérifier les pouvoirs de l'ensemble des députés des trois ordres et se réunit seul sous le nom de Communes. Le 12 juin, il adressa une ultime invitation aux deux autres ordres afin qu'ils se joignent à lui pour vérifier en commun les mandats ; quelques curés répondirent à l'appel le 13. Le 17 juin, par 490 voix contre 90, les Communes décidèrent de se constituer en Assemblée nationale. Le 19 juin, le clergé se réunit au tiers.
Dès le 17 juin, l'Assemblée avait décidé que les impôts ne seraient plus perçus le jour où elle serait forcée de se séparer. En outre, elle dénia au roi le droit d'exercer son veto sur ses décisions présentes et à venir.
Mais le roi et la noblesse intransigeante cherchèrent à empêcher l'Assemblée de se réunir. Elle trouva refuge le 20 dans la salle du Jeu de paume, à Versailles, et prononça le serment du Jeu de paume. Le 23, le roi tenta de disperser l'Assemblée ; le 27, il invita enfin le clergé et la noblesse à se réunir au tiers, afin de « protéger sa personne », mais il accumula les maladresses et dut, après la prise de la Bastille, se rendre à l'Assemblée nationale, où il annonça le renvoi des troupes qui stationnaient à Paris.
L'Assemblée nationale, qui s'était proclamée « constituante » le 9 juillet, commença à gouverner la France et à préparer une Constitution. Ces transformations révolutionnaires ne s'étaient pas faites à l'unanimité des députés élus. Les députés n'étaient pas organisés par groupes parlementaires, mais des tendances les divisaient, de même que leurs origines différentes. Le tiers état avait fourni des bourgeois, souvent avocats ou juges, hostiles aux privilèges du clergé et de la noblesse mais incertains sur les réformes à entreprendre. Les élus de la noblesse étaient en général dévoués à l'autorité royale et désireux de conserver l'existence propre de leur ordre. Quant aux représentants du clergé, il s'agissait surtout de curés, proches du tiers état.
1.2. La première assemblée politique
Ces hommes n'avaient aucune expérience politique car la Constituante était la première assemblée de ce type en France depuis les états généraux de 1614. Les députés aimaient l'éloquence, s'épuisant parfois en discours interminables, sans que l'on puisse cependant leur reprocher un travail législatif insuffisant.
Les divisions politiques
Dans les débats, aux « aristocrates » s'opposaient les « patriotes » (la grande majorité). Mais les « patriotes » étaient eux-mêmes très divisés et le furent de plus en plus à mesure que la Révolution précipita sa marche.
On distingua les monarchiens, royalistes modérés effrayés du désordre naissant et que Mirabeau rejoignit en 1790, des constitutionnels avec Bailly et La Fayette, le maire de Paris et le chef de la garde nationale parisienne depuis le 14 juillet 1789. Ces constitutionnels dominèrent l'Assemblée.
La nuit du 4 août : l'abolition des privilèges
Pour calmer les paysans en proie à la Grande Peur, l'Assemblée décréta dans une extraordinaire atmosphère d'exaltation, le 4 août 1789, le rachat des droits féodaux (seuls la dîme et les droits féodaux honorifiques étaient abolis gratuitement). Sur sa lancée, elle abolit les corporations, supprima tous les privilèges des individus, des corps et des provinces. En une nuit, l'ancienne société avait péri et de nombreuses lois particulières ne firent que le préciser par la suite (→ nuit du 4 août).
1.3. Les premières mesures législatives
Le 26 août 1789, l'Assemblée vota la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen en préface à la future Constitution. Le 11 septembre, l'Assemblée accorde au roi un droit de veto, qui ne peut cependant s'appliquer ni aux lois constitutionnelles, ni aux lois fiscales.
En octobre 1789, elle suivit le roi à Paris et s'installa dans l'ancien manège du palais des Tuileries. Les députés les plus modérés se groupèrent à la droite du président tandis que leurs collègues les plus révolutionnaires se placèrent à sa gauche. C'est l'origine du sens politique des mots « gauche » et « droite ».
Le 2 novembre 1789, l'Assemblée décréta la « mise à la disposition de la nation » des biens du clergé et inventa la politique monétaire des assignats, papier-monnaie gagé sur les biens du clergé. Les protestants, le 24 décembre 1789, puis les juifs, le 28 janvier 1790, sont admis au droit de cité.
Ce fut le début d'une œuvre législative accomplie dans le tumulte et l'agitation. L'Assemblée était soumise aux pressions des clubs politiques et du peuple parisien présent et manifestant dans les tribunes ; elle était assaillie de pétitions que l'on venait lui présenter dans la salle des séances. Elle fit face en 1791 à la fuite du roi à Varennes et le suspendit de ses fonctions du 25 juin au 14 septembre 1791. Mais, profondément monarchique encore, craignant les nouvelles tendances républicaines et démocratiques, la majorité refusa de le traduire en jugement et l'on avalisa la fiction de son enlèvement malgré lui.
2. L'œuvre de la première Constituante
2.1. La Constitution de 1791
Cette Constitution, la première Constitution écrite de la France, n'a été appliquée qu'un peu moins de un an. Mais son importance politique est considérable car elle est restée la source de toute une tradition constitutionnelle française : celle de la souveraineté nationale incarnée par une Assemblée omnipotente. L'Assemblée nationale législative exerçait seule le pouvoir législatif dans son entier et en toute indépendance. Elle siégeait en permanence, et le roi ne pouvait ni l'ajourner, ni la dissoudre ; seuls les représentants pouvaient déposer un projet de loi, le roi ne conservant qu'un veto suspensif. Le souverain, « par la grâce de Dieu et la loi constitutionnelle de l'État, roi des Français », et ce depuis le 10 octobre 1789, n'était plus que le délégué de la nation. Ses ministres, qu'il nommait et révoquait mais qu'il devait choisir en dehors de l'Assemblée, devaient rendre compte de leur administration à la Législative.
2.2. Le mode électoral
Deux pouvoirs se faisaient face, rigoureusement isolés l'un de l'autre, avec l'avantage à l'Assemblée législative, élue au suffrage censitaire indirect (cens).
Pour être citoyen actif, électeur au premier degré, il fallait payer une contribution directe au moins égale à trois journées de travail ; cela représentait 4 300 000 personnes. Les électeurs du second degré étaient élus parmi les citoyens actifs payant une contribution égale à dix journées de travail ou plus. Ce sont ces derniers qui élisaient les députés, lesquels devaient payer une contribution directe au moins égale à un marc d'argent et posséder en outre une propriété foncière. Ainsi, l'aristocratie de fortune remplaçait l'aristocratie de naissance.
2.3. La nouvelle organisation territoriale
L'Assemblée organisa une nouvelle division territoriale en départements, districts, cantons et communes. Elle pratiqua une décentralisation très poussée : tous les fonctionnaires furent remplacés par des élus locaux à tous les échelons de l'Administration. C'était anéantir des siècles de centralisation monarchique. Les juges furent de même élus comme les receveurs chargés de lever les nouveaux impôts que l'Assemblée créa.
Ainsi, le pouvoir exécutif n'avait aucune autorité sur ses agents. L'armée demeurait le seul corps de l'État dont le roi nommait les chefs ; mais la Garde nationale élisait ses officiers.
2.4. Le décret Le Chapelier et la Constitution civile du clergé
Dans le domaine économique, la Constituante, après avoir aboli les entraves à la liberté du commerce et de l'industrie, prohiba par le décret Le Chapelier – nom de son initiateur – les coalitions ouvrières, disposition appliquée jusqu'en 1884.
Dans le domaine religieux, elle vota et appliqua la Constitution civile du clergé. Ce fut la partie sans doute la plus contestée de son œuvre ; une œuvre qu'elle couronna par un acte unique de désintéressement : sur proposition de Robespierre, elle déclara ses membres inéligibles à l'Assemblée législative.
L'Assemblée se sépara le 30 septembre 1791, après que Louis XVI eut juré solennellement devant elle de respecter la Constitution votée le 3 septembre, et après avoir voté une amnistie générale pour toutes les personnes condamnées pour faits d'émeute à partir de 1788.
Pour en savoir plus, voir l'article Révolution française.
3. Les autres Constituantes
3.1. L'Assemblée de 1848
L'Assemblée nationale constituante de 1848 fut convoquée par le gouvernement provisoire issu de la révolution de février. Élue au suffrage universel masculin, elle se réunit le 4 mai 1848 et compta, sur 880 représentants, une majorité de républicains modérés contre des minorités socialistes et monarchistes. L'Assemblée confia le pouvoir à une commission exécutive présidée par Lamartine ; puis après l'émeute du 15 mai – des manifestants envahirent la salle de séances – et les journées de juin, elle confia la dictature au général Cavaignac. Elle vota le 4 novembre 1848 une Constitution assez proche de celle de 1791 avec une Assemblée unique et un président élu au suffrage « universel » (les femmes sont toujours exclues), et disposant d'une Administration très centralisée, ce qui assurait dans les faits sa prépondérance et permit le coup d'État du 2 décembre 1851 par Louis Napoléon.
3.2. Les Constituantes de la IVe République
La première, élue le 21 octobre 1945, élabora un projet de Constitution qui fut refusé par le référendum du 5 mai 1946. Elle siégea du 6 novembre 1945 au 26 avril 1946.
La seconde, élue le 2 juin 1946, prépara la Constitution de la IVe République, adoptée, malgré le refus du général de Gaulle, par le référendum du 13 octobre 1946. Elle organisait un régime d'Assemblée avec un gouvernement étroitement dépendant des députés, et un président de la République sans pouvoirs.
Pour en savoir plus, voir l'article IVe République.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
LOUIS XVI |
|
|
| |
|
| |

DOCUMENT larousse.fr LIEN
PLAN
* LOUIS XVI
* 1. Duc de Berry
* 1.1. Une enfance dans l'ombre du duc de Bourgogne
* 2. L’homme qui n’était pas fait pour être roi
* 2.1. Le refuge dans la prière et dans l'étude
* 2.2. Bon père de famille, passionné de serrurerie
* 3. Les débuts du règne : Turgot ou l’introuvable réforme fiscale
* 3.1. Le problème de l'iniquité fiscale
* 3.2. Le projet de Turgot : régénérer l'État et la société
* Liberté du commerce
* Égalité devant l'impôt
* 3.3. La disgrâce de Turgot
* La guerre des Farines
* La versatilité du roi
* Les réalisations de Turgot
* 4. De Necker à la prérévolution
* 4.1. Necker ou le temps de l’illusion
* 4.2. J.-F. Joly de Fleury et Lefèvre d'Ormesson
* 4.3. Calonne ou l’échec ultime
* Le rétablissement de la confiance dans l'État
* Les grands travaux
* Dernière tentative : retour aux plans de Necker et de Turgot
* L'échec de Calonne
* 4.4. Loménie de Brienne : la riposte du parlement
* 5. De 1787 à 1789
* 5.1. L’opposition du parlement
* Déclaration de guerre à la monarchie absolue
* Les réformes tardives du roi
* 5.2. La journée des Tuiles
* 5.3. La demande de convocation des états généraux
* Le roi cède
* 5.4. Le « parti » des patriotes
* 6. La Révolution
* 6.1. Antagonisme entre les privilégiés et le tiers état
* 6.2. La déchéance du roi : « Louis Capet »
* 6.3. La mort du roi
Louis XVI
Cet article fait partie du dossier consacré à la Révolution française.
1. Duc de Berry
1.1. Une enfance dans l'ombre du duc de Bourgogne
Le futur Louis XVI, d'abord titré duc de Berry, naît le 23 août 1754 de Marie-Josèphe de Saxe et du pieux Louis, seul fils de Louis XV, qui est la figure dominante du parti dévot à la cour de Versailles. Le duc de Berry est modestement fêté par la cour, car ses parents portent depuis février 1754 le deuil de leur deuxième fils, le petit duc d'Aquitaine.
À l'image de cette naissance effacée, l'enfance du futur roi se déroule dans l'ombre de son grand frère, le duc de Bourgogne, dauphin brillant, capricieux et autoritaire qui accapare tout l'amour de ses parents. Tout destine, en effet, le duc de Bourgogne à être roi. Le sort en décide autrement puisque le dauphin s'éteint à Pâques 1761, à l'âge de dix ans. Louis XV et les parents du dauphin ne se consolent pas de cette perte.
Le duc de Berry, désormais héritier direct du trône après son père, ne bénéficie pas pour autant d'un regain d'affection familiale ; surtout, il n’est pas éduqué comme il convient pour le préparer au métier de roi.
2. L’homme qui n’était pas fait pour être roi
2.1. Le refuge dans la prière et dans l'étude
Il a vingt ans, l'âge des espérances, quand à travers la Cour retentissent les cris : « Le roi est mort, Vive le roi ! » Les courtisans le trouveront agenouillé, dans le refuge de la prière. Il y a là peut-être une des dimensions fondamentales du personnage. Dans un monde où il est de bon ton de railler une trop grande pratique religieuse et de tenir pour superstition ce qui est parfois quête sincère, Louis XVI est « austère et sévère ; il remplit exactement les lois de l'Église, jeûnant et faisant maigre tout le carême ». Pieux dans son cœur, il tolère les incartades de son entourage. Mais les voit-il toujours ? La qualité de sa foi ne le rend-elle pas plus étranger encore à un monde où tout l'a fait souffrir et qu'il a fui très jeune ?
Étranger, il l'est aussi par cette éducation qu'il reçut et le coupa du monde. L'un de ses précepteurs, l'abbé de Radonvilliers (1710-1789), lui a donné le goût de l'étude et il a tout seul acquis des connaissances étendues. « Il entend le latin et sait parfaitement la langue anglaise ; il connaît la géographie et l'histoire. » Mais, savant aimable et doux, son professeur n'a guère lutté contre cette peur que firent naître, peut-être, en lui les modèles qu'on lui donnait : Saint Louis, Louis XIV et cet aïeul, Louis XV, qui lui en imposait tant. À donner une décision, il se montrera tout le temps dans l'embarras.
Il a de ses ancêtres le solide appétit et l'amour de la chasse, dérivatif à ses velléités. Il mange et boit beaucoup, et « ses traits assez nobles empreints d'une teinte de mélancolie » s'empâteront trop vite. Et l'on rira de sa « démarche lourde », de sa mise négligée et du son aigu de sa voix.
2.2. Bon père de famille, passionné de serrurerie
Puis il y a ce mariage (1770) avec Marie-Antoinette, cette princesse trop belle dont il ne saura que tardivement être l'amant. Il l'aimera profondément. « Quand elle lui parlait, raconte un témoin, dans ses yeux et dans son maintien il se manifestait une action, un empressement que rarement la maîtresse la plus chérie fait naître. » C’est en fonction des impératifs de sa politique extérieure, afin de renforcer l'alliance franco-autrichienne, que Louis XV avait décidé, sur le conseil de Choiseul, de marier le dauphin avec Marie-Antoinette, fille de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche.
La reine donna au roi un premier enfant, une fille, « Madame Royale », en 1778, puis un dauphin, qui mourut en 1789, enfin un autre fils, le futur Louis XVII, et une princesse qui mourut avant d'atteindre l'âge d'un an.
« Marie-Antoinette, c'est le seul homme de la famille », dira d'elle Mirabeau. L'ascendant qu'elle prit sur Louis XVI le retint à jamais d'exercer un métier, celui de roi, pour lequel il manifesta toujours de la répugnance. Désormais, il montrera « le goût le plus vif pour les arts mécaniques, pour la maçonnerie et la serrurerie ». Seul le bonheur que lui donnent ses enfants saura supplanter la joie qu'il y trouve. Il sut être un bon père, non pas un chef d'État que les circonstances réclamaient.
3. Les débuts du règne : Turgot ou l’introuvable réforme fiscale
3.1. Le problème de l'iniquité fiscale
Ce gros homme, inconscient à demi du drame qui autour de lui se joue, n'est point arbitre entre les nobles et le tiers état levé pour sa dignité. Quand il sort de ses refuges, il est un aristocrate. Ce n'est pas passion partisane que de reconnaître ce fait dont il n'est qu'à moitié responsable et que toute sa vie proclame. Le Louis XVI qu'une hagiographie intéressée représente faisant l'aumône aux pauvres est aussi celui au nom duquel sont étranglés en place de grève ces hommes qui, lors de la guerre des Farines (1775), réclament un peu de pain pour que vivent leurs enfants.
Car la faim réapparaît dans les campagnes et les villes. La longue période de prospérité commencée quarante ans auparavant est, pour un temps, hachée de crises. En 1773 et 1774, les mauvaises récoltes font flamber les prix. Le petit exploitant en est le premier défavorisé, il n'a pas de surplus à vendre, et l'alimentation d'appoint qu'il doit acheter est hors de prix. Il restreint ses achats auprès des artisans, et ce manque à gagner oblige plus d'un maître à se séparer de ses compagnons. Quand la récolte est de nouveau abondante en 1781 et 1782, les prix s'effondrent et c'est le petit paysan qui en fait de nouveau les frais. Or, dans la France de l'époque, ses frères sont nombreux, et, dans les communautés rurales qu'ils forment, les conflits deviennent âpres avec le privilégié qui réclame les droits seigneuriaux, mais laisse ses gens payer seuls l'impôt.
3.2. Le projet de Turgot : régénérer l'État et la société
La question fiscale pousse le gouvernement monarchique, aujourd'hui comme hier, à la réforme ; mais cette réforme passe par une transformation de la société tout entière. Un homme semble l'avoir compris : Turgot. C'est cet homme de cinquante ans, qui s'est construit une solide réputation de bon administrateur quand il était intendant dans le Limousin, que Louis XVI choisit comme contrôleur des Finances, après avoir renvoyé le triumvirat Maupeou-Terray-d'Aiguillon et rappelé les parlements, mesures qui ont plu à l'opinion publique.
Avec Turgot, ce sont les économistes et les philosophes qui font leur entrée dans un poste clé de l'État. Il a un projet qui dépasse la seule amélioration de l'appareil financier de l'État : arrêter le gaspillage de la Cour, anéantir l'iniquité fiscale, mais aussi appeler l'ensemble des propriétaires qu'il affranchit des contraintes qui pèsent sur le marché à régénérer avec la royauté le corps politique.
Liberté du commerce
La dette exigible est de 220 millions. Pour la réduire, Turgot, reprenant la politique de Terray, refuse de faire de nouveaux impôts qui retomberaient une fois encore sur les plus déshérités. Il entreprend de contrôler les dépenses des principaux ministères et d'exiger partout l'économie. Au bout d'un an (1775), il réduit la dette de près de 20 millions.
Dans le même temps, il commence la réalisation de son vaste projet. D'abord permettre la multiplication des biens et l'enrichissement de la classe la plus utile du royaume : celle des propriétaires fonciers. Pour cela, il faut abolir les servitudes qui pèsent sur la production (suppression des corvées royales) et créer un vaste marché dans lequel s'établira le juste prix que le producteur est en droit d'attendre (liberté du commerce des grains). Cette liberté génératrice de progrès n'est pas seulement donnée aux propriétaires fonciers, l'artisanat se trouve aussi concerné par la suppression des corporations (jurandes).
Égalité devant l'impôt
Mais la liberté qui est responsabilité touche aussi l'ordre social tout entier et le transforme. Dans chaque paroisse, une municipalité élue par les propriétaires fera comme d'autres assemblées consultatives (municipalités d'arrondissement et de province) « des sujets que l'on traitait jusqu'ici comme des enfants » des hommes qui coopéreront « comme des frères » et avec le roi à la bonne marche des affaires du pays. Les privilèges – et surtout les privilèges fiscaux – disparaîtront. Le gouvernement recevra une meilleure part de l'enrichissement général et sortira fortifié de la participation de citoyens dont la seule mesure sociale sera la propriété.
« Liberté, Égalité, Fraternité » : la patrie des possédants, des « hommes utiles », est-elle possible sans révolution ? C'est compter sans les aristocrates et sans les masses populaires. La conjonction de l'inconscience des uns et de la misère des autres va ruiner le projet. Mais celui-ci n'est-il pas mort-né ? Comment un gouvernement d'essence aristocratique pourrait-il survivre à une telle modification ?
3.3. La disgrâce de Turgot
La guerre des Farines
Le fait historique, c'est la guerre des Farines(1775). La récolte est mauvaise, la liberté du commerce des grains gonfle encore leur prix, c'est-à-dire celui du pain. Des queues qui s'allongent à la porte du boulanger s'élève le murmure des femmes ; il gagne le foyer, la chaumière et l'atelier et se transforme dans la rue en émotion et en révoltes populaires. Le ministre du roi veut affamer le peuple ! Nobles d'épée ou parlementaires laissent dire ou attisent les propos de leur clientèle. Les marchés sont envahis, et les boulangeries saccagées. On arrête, on condamne et on tue les émeutiers. Le désordre s'installe. Paris et bientôt Versailles même reçoivent la visite des manifestants.
La versatilité du roi
L'ordre rétabli, un moment, Turgot poursuit son programme libéral, et la lutte se transporte au parlement. Menée par Jean-Jacques Duval d'Eprémesnil (1746-1794), la « robe » attaque les décrets sur la suppression de la corvée des routes et sur l'abolition des corporations. Elle fait au roi des remontrances. Celui-ci tente de briser l'opposition (lit de justice du 12 mars 1776), puis renonce sous les pressions conjuguées de la reine, des courtisans et des propres collègues de Turgot : dans le ministère, Maurepas s'inquiète de mesures auxquelles il répugne. Turgot est renvoyé (mai), la monarchie abdique.
Les réalisations de Turgot
Le temps des réformes ne semble pourtant pas clos. Les innovations dont l'armée est le théâtre peuvent faire illusion : la suppression de la vénalité des charges, la création d'écoles militaires, la réforme de la milice, l'endivisionnement de l'armée, la discipline « à la prussienne », la dotation en machines de guerre modernes créent un instrument dont bénéficiera la future république.
Mais il y a aussi derrière tout cela l'action aristocratique qui pénètre et corrompt les transformations : le roi cherche à façonner un outil, l'aristocratie tend à le lui ravir en se réservant les postes de direction. Cette armée rénovée va servir à soutenir les insurgents américains (→ guerre de l'Indépendance américaine). L'entreprise enthousiasme la jeunesse libérale du royaume et elle compte de nombreux nobles dans ses rangs. Elle est un gouffre financier pour le Trésor royal (1778). Mais déjà Necker est là et le temps des faux remèdes commence.
4. De Necker à la prérévolution
4.1. Necker ou le temps de l’illusion
Choisi en 1776, le nouveau directeur général du Trésor royal, Necker, est un banquier, un protestant, un étranger. Il émerveille. On craignait la banqueroute, et il trouve de l'argent ; on disait les économies impossibles, et il semble les réaliser, car tout n'est qu'artifice.
Il abandonne les réformes fiscales et arrête le mécontentement de l'aristocratie. Les hommes éclairés le louent de mettre de l'ordre dans la complexité des droits perçus par la Ferme générale. La sensibilité du siècle est touchée par l'abolition de la « question préparatoire ». Il fait disparaître le servage sur le domaine du roi. Il ne rompt pas totalement avec l'expérience précédente, puisqu'il crée des assemblées provinciales des trois ordres. N'est-ce pas de nouveau une tentative d'association des élites au gouvernement monarchique ?
Mais n'est-ce pas de la poudre aux yeux ? Des historiens le soutiennent encore à notre époque ; ils font remarquer qu'il « élude en fait la question fiscale », qui est fondamentale, et, qu'ayant donné confiance, « il retourne à une politique systématique d'emprunts placés à des taux exorbitants auprès de banques amies » (G. Chaussinand-Nogaret). Il aidera ainsi le gonflement de la dette. La situation est malsaine ; le « compte rendu au roi » masque la réalité et fait croire pour longtemps à l'opinion publique qu'une bonne gestion a équilibré le budget (1781). Pourtant, une coalition s'est formée contre lui, et son « compte rendu » n'est qu'une manœuvre ou un dernier « coup d'éclat » contre elle. Elle rassemble les financiers traditionnels du roi ; les fermiers généraux, apeurés de voir le banquier genevois commencer à les éliminer ; les intendants qu'il a injustement attaqués, et, ennemis redoutables, les parlementaires inquiets des réformes judiciaires et administratives. De nouveau, Maurepas craint le prestige d'un rival. Il décide le roi à le renvoyer le 19 mai 1781.
4.2. J.-F. Joly de Fleury et Lefèvre d'Ormesson
La conjoncture redevient favorable. De 1782 à 1787, la situation économique se rétablit. À l'extérieur, la France semble triompher de la Grande-Bretagne : la paix de Versailles (3 septembre 1783) assure l'indépendance des États-Unis, consolide la position française à Terre-Neuve, et les articles du traité de Paris (1763) relatifs à Dunkerque disparaissent. Le nouveau contrôleur des Finances, Calonne, saura, un temps, tirer avantage de cette situation.
Avant qu'il ne parvienne aux affaires, deux contrôleurs se succèdent encore à la tête des Finances : J.-F. Joly de Fleury (mai 1781-mars 1783) et Lefèvre d'Ormesson (avril-novembre 1783). Le premier recourt aux augmentations d'impôt et aux emprunts sans parvenir à combler le déficit. Il a le tort de ne pas le cacher et de demander des économies dont les courtisans risquent de faire les frais. Il est renvoyé.
Lefèvre d'Ormesson, jeune homme embarrassé de sa personne et qui ne prend jamais une décision sans consulter son maître, Vergennes, emprunte à la Caisse d'escompte. Le public, craignant l'appropriation par l'État de fonds privés, se presse en foule aux guichets pour retirer son argent.
Seconde maladresse : il cherche à transformer la Ferme générale en régie ; les fermiers réagissent en menaçant d'interrompre leur versement au Trésor. Ils soutiennent que son départ et son remplacement par Calonne sont nécessaires. Le roi n'aime guère ce dernier, mais une coterie se forme à la Cour autour des Polignac ; elle gagne finalement à sa cause la reine ; le roi cède.
4.3. Calonne ou l’échec ultime
Le rétablissement de la confiance dans l'État
Avec Calonne, ce sont les financiers de Cour qui accèdent au contrôle. Titulaires d'offices qui les mettent à même de manier l'argent des impôts, ils confondent parfois leurs deniers avec ceux de l'État tout en sachant d'ailleurs l'aider quand la situation est difficile. Mais ces « capitalistes » ont la hardiesse d'investir leur argent dans l'industrie et le commerce, dont ils poussent la modernisation. C'est aussi le plan de Calonne : enrichir le pays pour que l'État puisse mieux trouver par l'impôt les espèces qui lui manquent. Mais l'État doit aider à cet enrichissement en drainant les capitaux et en les redistribuant aux commerçants et aux manufacturiers.
Avant tout, il faut emprunter : pour emprunter, il faut donner confiance. Calonne paye exactement les rentes venues à échéance. Puis il manœuvre pour que les emprunts d'État priment sur le marché. Il organise à cet effet une véritable publicité, Mirabeau étant son intermédiaire auprès de la presse. Il crée ainsi un courant à la hausse pour les valeurs d'État, tandis que baissent les valeurs concurrentes. Le ministre se fait agioteur : il s'entend avec les financiers qui placent l'emprunt dans le public : leur zèle est récompensé, le contrôleur aide leur spéculation. Enfin, le ministre reçoit de l'argent des détenteurs d'offices, des fermiers généraux, dont il perçoit un supplément de cautionnement. Ainsi, en trois ans, il réussit à rassembler 300 millions.
Les grands travaux
Mais cette somme n'est pas, comme trop souvent jusqu'ici, utilisée pour des dépenses improductives. Elle aide l'œuvre de rénovation industrielle entreprise par des hommes soucieux de lutter à armes égales avec la Grande-Bretagne. Ainsi, l'État seconde les entreprises privées à la pointe du progrès technique : manufactures textiles ou sidérurgiques des Oberkampf, des Perier ou des de Wendel. L'État protège aussi les commerçants qui cherchent à évincer les Scandinaves dans le commerce français des matières premières pour la construction navale.
Toute une administration économique soutient l'activité des marchands et des fabricants. La réforme monétaire de 1785, rendue indispensable par la réévaluation de l'or, arrête la spéculation et débloque les espèces que les particuliers thésaurisaient. D'autres moyens sont en outre donnés pour que la production progresse. Les ports de la façade atlantique sont améliorés, et Marseille agrandit ses quais. La politique de construction routière commencée à l'époque de Louis XV est reprise et amplifiée. Les canaux de Bourgogne sont entrepris.
Dernière tentative : retour aux plans de Necker et de Turgot
Mais la crise économique vient briser une expérience qui demandait du temps pour porter fruit. De nouveau, les difficultés ressenties par le monde agricole ralentissent la demande au secteur industriel, dès lors en crise. Un à un, les financiers qui travaillaient avec Calonne font faillite, et le crédit se contracte au moment où les impôts, étant donné la misère, rentrent mal.
Dans le même temps où l'État connaît de nouveau des embarras financiers, le scandale lié à l’affaire du Collier de la reine éclaire d’un jour cruel l'attitude équivoque des courtisans et ternit le prestige du roi et de la royauté.
Calonne, faute d'une hausse continue de la prospérité, doit retrouver les projets de ses prédécesseurs : l'égalité devant l'impôt, un impôt unique reposant sur toutes les terres, « la subvention territoriale ». On avait accusé Turgot de la projeter ; elle avait en partie causé sa perte. Calonne la reprend à son compte.
Mais l'homme est habile, et il sait qu'il aura contre lui le front des privilégiés, et que le parlement, en s'opposant à l'enregistrement des édits fiscaux, se fera leur porte-parole comme il l'a fait jadis sous le feu roi. Il commence par créer un courant d'opinion en sa faveur : aux paysans, il promet d'abolir les corvées et de diminuer la taille ; aux commerçants, de supprimer les douanes intérieures ; à l'élite, il promet la participation, par l'intermédiaire d'assemblées provinciales. Puis, pour tourner le parlement, il songe à réunir – comme Henri IV l'avait fait jadis –, une assemblée de notables. Les princes du sang encadreront des nobles, des membres du haut clergé, quelques représentants du tiers, tous triés sur le volet. Leur accord reçu, le roi s'en prévaudra pour faire appliquer le projet.
L'échec de Calonne
Le calcul se révèle faux. Les notables réunis à Paris (22 février 1787) sont très vite sous l'emprise des courtisans hostiles à Calonne. Celui-ci, dépourvu de l'aide et des conseils de Vergennes, qui meurt quelques jours avant l'ouverture de l'assemblée des notables, commet la maladresse de présenter son projet en condamnant l'ordre existant. Traitant des causes profondes du malaise financier, il dénonce d'emblée « les abus des privilèges pécuniaires, les exceptions à la loi commune qui ne peuvent affranchir une partie des contribuables qu'en aggravant le sort des autres », il condamne « l'inégalité générale dans la répartition des subsides », il proteste contre « le déshonneur imprimé au commerce des premières productions », contre « les bureaux de traites intérieures et ces barrières qui rendent les diverses parties du royaume étrangères les unes aux autres », contre « les droits qui découragent l'industrie, ceux dont le recouvrement exige des frais excessifs et des préposés innombrables… ».
À travers son plaidoyer, c'est tout ce que la génération révolutionnaire va qualifier d'« ancien régime » qui est accusé. Prévenus contre le ministre, les notables voient leur crainte renforcée : n'est-ce pas leur position, leur prééminence sociale qui est en jeu ? L'ordre par excellence, le clergé, se sent directement menacé dans la possession de ses biens. Groupés autour de l'archevêque de Toulouse, Loménie de Brienne, les évêques contre-attaquent. Ils peuvent compter sur l'appui, du moins couvert, des propres frères du roi. Le comte de Provence, qui sera Louis XVIII, discrédite sa belle-sœur, projetant de faire déshériter un jour ses neveux. Le cousin du roi, le duc d'Orléans, croit en une monarchie à l'anglaise dont il serait le souverain.
D'autres coteries se forment ou se recréent. Il y a celle de Necker, qui agit « par vengeance, et dans l'espérance de le voir revenir en place » ; il y a celle de M. de Miromesnil, garde des Sceaux, « qui veut à toute force faire contrôleur général M. de Neville, sa créature » (Mémoires du baron J. de Besenval).
Calonne se tourne alors vers l'opinion publique. Imprimant tous les mémoires qu'il a remis aux notables, il l'informe que « le roi est arrêté dans le soulagement qu'il veut donner à ses peuples par ceux-là même qui devraient l'assister ». En vain. Le roi est troublé par l'opposition grandissante à Calonne. Il le renvoie le 8 avril 1787 et fait appel à celui qui est le chef de file de l'opposition, Loménie de Brienne.
« Le renvoi de Calonne fit apprécier le caractère du roi ; et, dès cet instant, les prétentions et la ténacité des notables n'eurent plus de bornes » (Besenval).
4.4. Loménie de Brienne : la riposte du parlement
On a dit de l'archevêque de Toulouse qu'il « était l'égal de Calonne pour la moralité sans en avoir les talents, étant mieux à sa place dans un cercle de femmes qu'au timon des affaires : depuis vingt ans, il visait au ministère, et, dans l'assemblée des notables, dont il faisait partie, il n'avait combattu Calonne que pour le remplacer ».
Loménie de Brienne reprend les projets de l'homme qu'il a contribué à abattre ; il réclame un impôt territorial, un impôt du timbre, la suppression des corvées, la libre circulation des grains et des assemblées provinciales. Il n'obtient rien dans le domaine fiscal. On se décide à renvoyer l'assemblée qui venait ainsi de siéger durant trois mois (22 février-25 mai 1787). Brienne et le roi se retrouvent devant le parlement.
Celui-ci, de l'été 1787 au printemps 1788, se pose en champion des libertés du royaume. Habilement, les nobles de robe assortissent leur refus de la subvention territoriale d'une demande de convocation des états généraux, seuls aptes à voter les impôts nouveaux. Le 6 août 1787, l'enregistrement des édits a lieu de force, en lit de justice. Le lendemain, le parlement réuni proteste contre « la violence » qui lui a été faite. Le roi répond en exilant ses membres à Troyes. À travers la France, les autres parlements se déclarent solidaires, et le monde de la basoche (ensemble des notaires, avoués, huissiers), clientèle des magistrats, excite le peuple contre les agents de l'autorité royale. Devant l'ampleur que prend le mouvement, le roi rappelle le parlement, le 4 septembre 1787.
5. De 1787 à 1789
5.1. L’opposition du parlement
Mais il faut trouver de l'argent, et vite : l'impôt étant écarté, on en revient à l'emprunt. Pour obtenir cette fois l'enregistrement d'un édit prévoyant un emprunt de 420 millions, le gouvernement accepte de convoquer pour 1792 les états généraux. La séance royale où l'édit est présenté se transforme en lit de justice (19 novembre 1787). À la protestation du duc d'Orléans : « C'est illégal », le roi répond par le dernier cri de la monarchie absolue : « C'est légal, parce que je le veux. » Le duc est exilé en même temps que plusieurs conseillers. Puis le gouvernement prépare ce que certains appelleront son « coup d'État » : réduire le rôle du parlement.
Déclaration de guerre à la monarchie absolue
Mais les nobles de robe sentent la menace et de nouveau intéressent l'opinion publique à leur sort par des prises de position libérales : ainsi, le 4 janvier 1788, ils condamnent solennellement les lettres de cachet, dont l'emploi les menace directement. C'est surtout le 3 mai 1788 que leur déclaration a le plus de résonance. Ils attaquent les ministres et les accusent de vouloir instaurer le despotisme ; ils rappellent que « la France est une monarchie gouvernée par le roi, suivant les lois ; que ces lois… embrassent et consacrent le droit de la nation d'accorder librement les subsides par l'organe des états généraux, régulièrement convoqués et composés ; les coutumes et les capitulations des provinces ; l'inamovibilité des magistrats ; le droit des cours de vérifier, dans chaque province, les volontés du roi, et de n'en ordonner l'enregistrement qu'autant qu'elles sont conformes aux lois constitutives de la province, ainsi qu'aux lois fondamentales ; le droit de chaque citoyen, de n'être jamais traduit en aucune manière, par devant d'autres, que les juges naturels qui sont ceux que la loi lui désigne ».
Un mois après, l'assemblée du clergé, réunie pour fournir au roi un « don gratuit », prend fait et cause pour le parlement. Le haut clergé – car c'est lui qui tient la plume à ces remontrances au roi – souligne que « le peuple français n'est pas imposable à volonté. La propriété est un droit fondamental et sacré et cette vérité se trouve dans nos annales, quand même elle ne serait pas dans la justice et dans la nature… Depuis les premiers états généraux jusqu'à ceux d'Orléans et de Blois, le principe ne se perd jamais de vue que nulle imposition ne peut se lever sans assembler trois états et sans que les gens desdits états n'y consentent ». Nulle part, il n'est question de l'abolition des privilèges. Il s'agit pour les aristocrates de parvenir à réunir des états qu'ils domineront et qui seront un moyen de subjuguer la royauté. Mais les thèmes et le langage employé peuvent séduire le tiers ; liberté individuelle et liberté de consentir ou non l'impôt.
Les réformes tardives du roi
Après s'être heurtée au refus du parlement de livrer ses meneurs, – d'Éprémesnil et Monsabert – la royauté tente de briser cette opposition aristocratique. En même temps qu'ils réduisent le parlement, les édits du 8 mai 1788 s'essayent à de profondes réformes. L'enregistrement des actes royaux sera désormais le fait d'une cour plénière formée de dignitaires de la couronne. Quarante-cinq « grands bailliages » reçoivent une partie des attributions judiciaires du parlement. L'organisation de la justice est simplifiée, rationalisée, et son exercice dépouillé de certains traits barbares comme la torture qui précédait l'exécution des criminels.
Pourtant cette réforme de Lamoignon, garde des Sceaux du roi, vient trop tard. Déjà, la province s'agite, mais, en prenant le relais de Paris, elle révèle que la bourgeoisie a, elle aussi, un programme de réformes et qu'elle n'entend pas être à la remorque des aristocrates. Encore est-elle prête à s'entendre avec eux, car elle craint les masses populaires que, apprenti sorcier, l'aristocratie a mises en branle dans l'été de 1788. La bourgeoisie accepterait le maintien des droits seigneuriaux et des privilèges honorifiques en échange de la liberté et de l'égalité politiques. Elle a fait l'apprentissage de celle-ci dans les assemblées provinciales, elle entend la maintenir lors des futurs états généraux. Mais ce compromis est-il possible ? Des notables comme Jean-Joseph Mounier ou Antoine Barnave, dans le Dauphiné, le croient. La parole va leur être donnée.
5.2. La journée des Tuiles
Durant l'été 1788, l'aristocratie pousse le peuple à la révolte ouverte pour soutenir le parlement. À Dijon, à Toulouse, à Rennes, à Pau et à Grenoble, des troubles éclatent. Dans cette dernière ville, les parlementaires refusent d'enregistrer les édits du 8 mai. Ils reçoivent des lettres de cachet. Le 7 juin, les boutiques se ferment, des hommes s'assemblent, ils sont armés de barres, de pierres, de haches et de bâtons. Beaucoup sont des « clients » des magistrats, car leur départ signifierait le ralentissement accentué des affaires. La troupe intervient. Du toit des maisons, des gens font pleuvoir une grêle de pierres, de briques et de tuiles. Cette journée des Tuiles aboutit au maintien des magistrats dans leur ville. Mais sept jours plus tard, les notables se réunissent : il y a là 9 membres du clergé, 33 nobles, 59 membres du tiers état. S'ils espèrent que les parlementaires seront réinstallés par le roi, ils demandent aussi la réunion des « états particuliers de la province », où les membres du tiers état siégeront en nombre égal à celui des membres du clergé et de la noblesse réunis. Cette assemblée sera le prélude à celle des états généraux du royaume.
5.3. La demande de convocation des états généraux
Puis, le 21 juillet, à quelque distance de Grenoble, dans le château d'un gros industriel, Claude Perier, à Vizille, a lieu l'assemblée générale des municipalités du Dauphiné. Ecclésiastiques, nobles, tiers état mêlés arrêtent : « qu'empressés de donner à tous les Français un exemple d'union et d'attachement à la monarchie, prêts à tous les sacrifices – que pourraient exiger la sûreté et la gloire du trône –, ils n'octroieront les impôts par dons gratuits ou autrement que lorsque leurs représentants en auront délibéré dans les états généraux du royaume. Que dans les états de la province, les députés du tiers état seront en nombre égal à ceux des deux premiers ordres réunis ; que toutes les places y seront électives ; et que les corvées seront remplacées par une imposition sur les trois ordres ».
Ils arrêtent en outre « que les trois ordres du Dauphiné ne sépareront jamais leur cause de celle des autres provinces, et qu'en soutenant leurs droits particuliers ils n'abandonneront pas ceux de la nation ». Voilà qui dépasse le projet de l'aristocratie au début de sa révolte : il y a l'égalité politique, un premier pas de fait dans l'égalité fiscale, et surtout cette volonté d'échapper au cadre étroit des libertés provinciales pour s'élever jusqu'à la liberté de la patrie tout entière.
Le roi cède
Les caisses sont vides, les assemblées provinciales n'acceptent pas d'augmentation d'impôt, l'alliance semble se faire entre bourgeoisie et aristocratie, enfin les forces de répression échappent au roi. Tantôt les régiments (c'est le cas notamment de la cavalerie) sont dévoués à leurs chefs aristocrates, tantôt ils sont formés d'hommes sortis du peuple qui se rebellent contre la discipline indigne qu'on leur impose ou qui sont les victimes d'une réaction aristocratique qui leur bouche toute possibilité d'ascension sociale. Dans un cas comme dans l'autre, ils sont peu sûrs. Dans quelques mois, ils vont déserter en masse pour rejoindre le peuple en révolution.
N'étant plus maître de la situation, Brienne annonce la réunion des états généraux (5 juillet 1788), et un édit (8 août) les convoque pour le 1er mai 1789. Le même édit suspend la cour plénière. Le 24 août, Brienne se retire ; le 25, le roi appelle pour le remplacer Necker. La réforme de Lamoignon est abolie, les parlements rétablis. Mais si la royauté capitule, l'impossible alliance des aristocrates et de la bourgeoisie se défait.
5.4. Le « parti » des patriotes
Dès septembre 1788, le parlement signifie au tiers qu'il n'entend pas lui donner l'égalité politique demandée ; il estime en effet que les prochains états devront se réunir dans la forme qu'ils avaient en 1614 : les ordres séparés et chacun disposant d'une voix. Face aux aristocrates se forme alors le « parti » des patriotes.
Il groupe des bourgeois, surtout des banquiers ou des avocats, et des nobles libéraux. Quelques têtes s'en détachent : Mirabeau, La Fayette et surtout le duc d'Orléans. Il a à sa solde des publicistes, tel Pierre Choderlos de Laclos, qui répandent les idées du parti à Paris et en province : égalité civile, judiciaire et fiscale.
Dans l'immédiat, les patriotes se battent pour le doublement du tiers et le vote par tête et non par ordre aux états généraux. Des milliers de pamphlets ou de journaux circulent librement dans les salons, les sociétés de lecture et les cafés. Placardés dans les rues, ils suscitent le rassemblement et la discussion : les sujets du roi font mutuellement leur éducation politique et se découvrent, les uns les autres, membres solidaires d'une même communauté, des citoyens désireux d'établir la liberté et l'égalité, la fraternité qui leur procureront le bonheur.
Mais de cette « patrie », les nobles s'excluent en majorité ; s'accrochant à leurs privilèges, ils posent au roi la question : « Votre Majesté pourrait-elle se déterminer à sacrifier, à humilier sa brave, antique et respectable noblesse ? ».
Un premier coup semble lui être en effet porté le 27 décembre 1788 : le « Résultat du Conseil » du roi tenu à Versailles, ce jour, admet le doublement du tiers. En fait le principal est, pour l'aristocratie, sauvegardé : le roi ne se prononce pas sur le vote par tête. Le règlement électoral paraît le 24 janvier 1789.
6. La Révolution
6.1. Antagonisme entre les privilégiés et le tiers état
La préparation des élections, leur déroulement ainsi que la rédaction des cahiers de doléances se font, dans beaucoup de régions, au milieu des émeutes du « quatrième ordre », celui des pauvres artisans ou paysans. Depuis 1778, le vin se vend mal. En 1789, les prix remontent, car la vendange a été insuffisante, mais le petit paysan n'a pas un contingent commercialisable, il reste dans la gêne. Dans le même temps, le prix du grain s'élève, mais la production du métayer n'est pas telle qu'il puisse en tirer profit. Dans les villes, le compagnon est souvent réduit au chômage ; la concurrence anglaise permise par le traité de 1786 accroît encore le malaise des fabricants français, notamment des textiles.
Des émeutes éclatent : c'est le cas à Paris, au faubourg Saint-Antoine, le 28 avril 1789. Des ouvriers prêtent au propriétaire d'une manufacture de papiers, Réveillon, l'intention de baisser les salaires de ses employés à 15 sous par jour. Malgré la force armée, la foule enfonce les portes et jette au feu registres de comptabilité, meubles et effets. La troupe tire, les émeutiers se dispersent (→ affaire Réveillon).
Il n'y a pas là le signe d'un affaiblissement de la fidélité à la monarchie. Les cahiers de doléances révèlent au contraire que, dans l'ensemble du corps social, c'est le loyalisme qui domine. Ils montrent aussi l'antagonisme entre les privilégiés et le tiers. De cette lutte, de jour en jour plus âpre, la brochure de Sieyès porte témoignage :
« Qu'est-ce que le tiers état ? Tout. La prétendue utilité d'un ordre privilégié pour le service public n'est qu'une chimère […] sans lui, tout ce qu'il y a de pénible dans ce service est acquitté par le tiers ; sans lui, les places supérieures seraient infiniment mieux remplies ; si les privilégiés sont parvenus à usurper tous les postes lucratifs et honorifiques, c'est en même temps une iniquité odieuse pour la généralité des citoyens et une trahison pour la chose publique. »
C'est la spécificité de la Révolution française que d'être cette lutte sans merci entre une aristocratie qui défend par tous les moyens ses « droits » et la bourgeoisie poussée en avant par les masses populaires. Dans ce combat, la monarchie peut-elle être d'un autre côté que celui de l'aristocratie ? À qui en doute, il faut rappeler la séance du 2 mai 1789, où les députés aux états généraux furent présentés au roi : il reçut le clergé à huis clos dans son cabinet, ceux de la noblesse, selon le cérémonial, les portes grandes ouvertes ; les représentants du tiers défilèrent dans sa chambre à coucher.
6.2. La déchéance du roi : « Louis Capet »
Le 5 mai, les états généraux s'ouvraient. Le règne de Louis XVI allait s'achever, celui du peuple souverain commençait. Avec la mise à bas de l'Ancien Régime et son retour de force de Versailles à Paris le 6 octobre 1789, le roi ne trouve plus la volonté politique suffisante pour affronter les événements. Louis XVI se replie sur la défense des principes de la monarchie de droit divin, ceux de son éducation, ceux que lui ont légués ses pères. Ses résistances et ses revirements ruinent le compromis institutionnel élaboré par la Constituante. Devenu monarque constitutionnel, le roi s'efforce, par l'application du veto, de freiner le mouvement révolutionnaire.
Prisonnier de sa famille et surtout de celle de Marie-Antoinette, il met finalement son espoir dans les émigrés (échec de la fuite à Varennes, juin 1791). Formant un ministère girondin, en mars 1792, le roi voit dans la guerre, pour des raisons inverses de celles des révolutionnaires, le moyen de sortir de la situation où il s'est enfermé. Mais le veto qu'il met aux décrets de salut public, après les premières défaites françaises, soulève contre lui le peuple de Paris. Le 20 juin 1792, les Parisiens envahissent les Tuileries, l'obligent à coiffer un bonnet rouge et à boire du vin à la santé de la Nation. Le peuple de Paris l'appelle dès lors « Louis le Dernier ».
L'insurrection du 10 août 1792, qui fait plusieurs centaines de morts, oblige le roi à se placer sous la protection de l'Assemblée. Le 13 août, le roi et sa famille sont emprisonnés au Temple. Le 21 septembre, la royauté est abolie, et Louis, désormais rétrogradé au rang de simple particulier et appelé du nom de Capet, est considéré comme « traître » à la nation.
Le 13 novembre, alors que la Convention examine le rapport de son Comité de législation sur l'éventuel jugement de l'ex-roi, Saint-Just présente les arguments pour une exécution sans jugement : « Les citoyens se lient par le contrat ; le souverain ne se lie pas, ou le prince n'aurait point de juge et serait un tyran. […] Le pacte est un contrat entre les citoyens […]. Conséquemment, Louis, qui ne s'était pas obligé, ne peut pas être jugé civilement. » Il se prononce pour la mort immédiate : « Il opprima une nation libre ; il se déclara son ennemi ; il abusa des lois : il doit mourir pour assurer le repos du peuple, puisqu'il était dans ses vues d'accabler le peuple pour assurer le sien. » La Convention ne le suit pas ; cependant, après la découverte par Roland des papiers personnels de Louis contenus dans l'armoire de fer, le 20 novembre, qui fournisse des pièces permettant d'étayer la trahison du roi, elle décide, le 3 décembre, de juger elle-même l'ex-roi.
6.3. La mort du roi
Le procès s'ouvre le 11 décembre. L'ex-roi est conduit à la Convention où il entend l'acte d'accusation dressé contre lui : organisation de la contre-révolution, conspiration, responsabilité dans le massacre du Champ-de-Mars et dans d'autres événements où des patriotes trouvèrent la mort, soutien de l'émigration…
Louis désigne comme avocat Tronchet et Target, mais ce dernier se récuse et Malesherbes s'offre à le remplacer. Puis, devant l'ampleur de leur tâche, les deux avocats s'adjoignent Romain Desèze.
Le 26 décembre, Louis est de nouveau entendu par la Convention. Desèze demande que l'ex-roi soit jugé en citoyen : « Prenez garde que si vous ôtiez à Louis l'inviolabilité de roi, vous lui devriez au moins les droits de citoyen ; car vous ne pouvez pas faire que Louis cesse d'être roi quand vous déclarez vouloir le juger, et qu'il le redevienne au moment de ce jugement que vous voulez rendre. Or, si vous voulez juger Louis comme citoyen, je vous demanderai où sont ces formes conservatrices que tout citoyen a le droit imprescriptible de réclamer. » Il présente ainsi une argumentation fondamentale sur la séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire, et s'écrie : « Je cherche parmi vous des juges, et je n'y vois que des accusateurs. Vous voulez prononcer sur le sort de Louis, et c'est vous-mêmes qui l'accusez ! »
Le 17 janvier, le procès s'achève sur le vote des députés. À la première question, « Louis est-il coupable ? », 694 députés sur 721 répondent oui. « Le peuple doit-il voter pour décider du sort de l'ex-roi ? » : 423 voix répondent non, contre 281 oui. Enfin, à la question « Quelle peine sera infligée à Louis ? », 361 députés sur 721 répondent la mort, soit une voix de majorité ; il faut cependant ajouter 26 députés qui se prononcent pour la mort tout en demandant si la Convention doit ou non faire différer l'exécution. Cette position entraîne un quatrième vote sur le sursis, qui est repoussé par 380 voix contre 310.
Louis XVI est guillotiné le 21 janvier 1793, à 10 heures 20, sur la place de la Révolution (aujourd'hui place de la Concorde). La portée symbolique de cette mort dépasse de beaucoup la personnalité du roi : elle illustre la politique dite de la table rase, qui, de nos jours encore, suscite les interrogations des penseurs et théoriciens politiques de toutes tendances. |
| |
|
| |
|
 |
|
PREMIER EMPIRE |
|
|
| |
|
| |
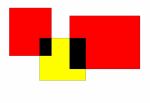
premier Empire
Cet article fait partie du dossier consacré à Napoléon Ier.
1. Les origines
Le coup d'État des 18 et 19 brumaire an VIII (9 et 10 novembre 1799) institue le Consulat et porte le général Bonaparte au pouvoir. En théorie, la République continue : elle inscrit son nom sur les pièces de monnaie et sur les documents officiels. Son effigie, ses emblèmes, ses chants, son drapeau demeurent. Mais en cinq ans, la France devient un vaste chantier où les finances, l'administration, l'État, l'économie et la société sont reconstruits. Bonaparte établit la paix à l'intérieur et à l'extérieur ; les Français, d'abord réticents, se rallient à sa personne jusqu'à en faire un nouveau monarque, un empereur, un « roi du peuple ».
L'établissement de la monarchie impériale résulte du sénatus-consulte organique du 28 floréal an XII (18 mai 1804) [ou Constitution de l'an XII], approuvé massivement par plébiscite (6 novembre), qui confie le gouvernement de la République au Premier consul avec le titre d'Empereur des Français, et proclame la dignité impériale héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime de Napoléon Bonaparte. Le nouveau régime complète ses attributs par le sacre à Notre-Dame de Paris de Napoléon Ier (2 décembre 1804), par la création d'une cour avec sa hiérarchie (grands dignitaires, grands officiers civils et militaires, dont dix-huit maréchaux) et d'une noblesse d'Empire (1806, 1808).
2. Le despotisme
2.1. Des libertés bafouées
L'Empire se veut l'aboutissement de la Révolution, désormais close, dont il est chargé de préserver les conquêtes essentielles (égalité civile, respect de la propriété, abolition de la féodalité). Il est la garantie contre le retour de la Contre-Révolution et de l'anarchie jacobine. À ce titre, il justifie la mise en place d'un despotisme centralisateur. Napoléon maintient le système hérité du Consulat qui assure la primauté de l'exécutif sur un législatif impuissant et partagé entre le Conseil d'État, le Corps législatif et le Sénat. Le Tribunat, seule assemblée délibérative, est supprimé en 1807. Les ministres sont de simples agents d'exécution.
La police, confiée à Fouché puis (1810) à Savary, forte de ses multiples informateurs officiels et secrets, est l'instrument du règne par excellence. Elle viole le secret des correspondances, fait comparaître des suspects devant des magistrats serviles ou bien les enferme arbitrairement ; cependant, l'on ne dénombre guère que 2 500 arrestations « politiques » durant tout l'Empire. La liberté individuelle n'est pas respectée.
La liberté d'opinion est abolie : journaux, livres, pièces de théâtre sont objet de censure. La direction des esprits est complétée par la mainmise sur l'Église de France, chargée d'enseigner le catéchisme impérial (publié en 1806) imposant le devoir d'obéissance à l'Empereur (« honorer l’Empereur, c'est honorer et servir Dieu lui-même »), et sur l'enseignement, dont le monopole est donné à l'Université impériale (loi du 10 mai 1806 et décret du 17 mars 1808) qui décerne les grades, baccalauréat et licence, règle la vie et les programmes des professeurs de l'enseignement public ou de l'enseignement privé, toléré mais surveillé, et doit modeler l'opinion morale de la jeunesse.
2.2. Noblesse d’Empire
La cour impériale, formée des princes membres de la famille de Napoléon, des grands dignitaires, des grands officiers de la couronne, et secondée d'une cohorte d'écuyers, de hérauts d'armes et de pages, est destinée à glorifier l'Empereur aux yeux des Français et des étrangers. Elle est un moyen d'attirer les nobles de l'Ancien Régime et de contrôler les grands de l'Empire. Mais Napoléon échoue dans sa volonté de renouveler les fastes de Louis XIV : la cour, où tout se règle « au tambour et au pas de charge », sue l'ennui.
En 1808, Napoléon crée une noblesse impériale. Aux princes et aux ducs s'ajoutent des comtes, des barons et des chevaliers. Napoléon argumente : la nouvelle noblesse, contrairement à l'ancienne, est largement ouverte au mérite et au talent, elle ne dispose pas de privilèges, hormis ceux, honorifiques, qui marquent l'utilité sociale de quelques-uns, premiers dans une société d'égaux. Le raisonnement ne convaincra qu'à moitié les Français, qui estimeront que Napoléon viole ainsi un des principes fondamentaux de la Révolution. Pour le choix des membres de cette noblesse, les critères appliqués sont la fortune ou le mérite acquis au service de l'État : 59 % des 3 263 personnages annoblis sous l'Empire furent des militaires, 22 % des hauts fonctionnaires, préfets, évêques ou magistrats, 17 % des notables, membres des collèges électoraux, maires ou sénateurs. La part laissée au monde du commerce et de l'industrie fut restreinte, comme le fut celle des artistes et des hommes de lettres. Les milieux sociaux les plus représentés furent la noblesse de l'Ancien Régime, les « comtes refaits » (22 %), et la petite et la moyenne bourgeoisie française, belge ou hollandaise. Cette noblesse est un instrument politique : Napoléon espère de cette manière confondre la noblesse d'Ancien Régime dans la nouvelle ; il cherche là encore à rapprocher l'ancienne et la nouvelle élite. Elle est aussi un outil fidèle et dévoué du despotisme.
3. La société
3.1. Une France de notables
L'essor de la bourgeoisie
La bourgeoisie voit sa prépondérance consolidée. Les institutions politiques et universitaires lui réservent l'accès aux fonctions administratives. La multiplication de ces fonctions lucratives, les encouragements donnés par l'Empereur aux industriels, aux négociants, aux financiers, et la prospérité générale concourent à son essor. Les notables, maîtres d'un peuple immense de fermiers et de métayers – en 1812, sur 31 851 000 Français, 22 251 000 sont des ruraux –, d'ouvriers, de domestiques et de fournisseurs, rassemblent des nobles de l'Ancien Régime et des propriétaires jadis roturiers ; les notables remplacent les gentilshommes d'autrefois.
La fortune foncière
La société nouvelle est fondée sur la fortune foncière et, dans une certaine mesure, sur le talent et le mérite. Jusqu'en 1808 et la guerre d'Espagne, les notables seront les piliers du régime ; l'aventure guerrière et la crise économique et religieuse de 1810-1811 rompront leur alliance avec l'Empire. Posséder une propriété foncière importante fait le notable : tradition ancienne ancrée dans les mentalités. Beaucoup d'hommes d'affaires, de négociants et d'industriels disposent d'une partie de leur capital pour l'investir dans la terre. Jusqu'en 1811, les conditions climatiques sont favorables aux récoltes, qui se vendent bien. Il n'y a pas de révolution agricole, les techniques anciennes ne se modifient pas, mais les grands propriétaires mettent plus de soin à gérer leurs domaines. C'est le cas notamment des nobles rentrés d'émigration qui retrouvent pour la plupart leurs biens. Le gouvernement pousse aux défrichements, aux assèchements, à l'amendement des terres. Il incite aussi à l'introduction ou au développement de cultures nouvelles comme le maïs et la betterave à sucre pour suppléer les matières jusqu'alors importées et que le Blocus continental interdit d'acquérir.
Le développement du commerce
Les notables qui, à côté de leurs terres, exploitent des maisons de commerce souffrent du blocus des côtes. Ceux de la façade atlantique, jadis prospère, abandonnent ou bien transfèrent leurs affaires vers Paris, le nord et l'est de la France. Jusqu'en 1809, c'est là que se développe le commerce en relation avec le marché européen : la conquête l'ouvre aux entrepreneurs. Le régime facilite ces échanges par la construction de routes dans le Nord-Est, dans les Alpes ou vers l'Espagne : elles ont un but essentiellement militaire, mais elles désenclavent des régions et rendent plus aisées les communications avec le reste de l'Europe.
Naissance de l'industrie contonnière et chimique
Si le paysage industriel reste encore marqué plus par les petits ateliers que par les usines, celles-ci se multiplient. La guerre continuelle n'interdit pas la croissance de certains secteurs qui connaissent un « démarrage » annonciateur de la révolution industrielle du xixe siècle. C'est le cas de l'industrie cotonnière ou de l'industrie chimique qui lui est en partie liée. Là sont à l'œuvre « les aventuriers du siècle », comme les frères Ternaux, qui ont plusieurs fabriques de draps à travers la France et concentrent dans leurs usines machines à filer le coton, à le tisser et à le blanchir. Richard Lenoir fabrique, à Paris et en Normandie, du coton filé, des calicots, des basins et des piqués. Faisant travailler plusieurs milliers d'ouvriers, il dispose d'un capital de 6 millions de francs et d'un revenu de 50 000 F. Il fait partie du Conseil général du commerce, créé par le régime pour développer l'économie, et participe aux expositions qu'organise le gouvernement.
3.2. Paysans et ouvriers
Les gros fermiers connaissent, pour la plupart, une relative aisance, due à l'achat de biens nationaux et à la hausse du prix du grain. Le nombre des propriétaires ruraux s'est élevé de 4 millions en 1789 à 7 millions en 1810. Mais la plupart des paysans ne possèdent pas leur terre. La culture du blé l'emporte toujours sur la prairie artificielle et l'élevage, d'autant que le prix du blé n'a cessé de monter entre 1800 et 1812. Les journaliers ou les domestiques, grâce à la conscription qui allège le poids des jeunes, trouvent plus facilement que jadis du travail. Mais il suffit qu'une crise survienne et ils sont mendiants.
Les ouvriers, soumis à une législation reprise de celles de l'Ancien Régime et de 1791 (interdiction des grèves et des coalitions, livret ouvrier délivré par la police), améliorent, en revanche, leur condition économique, la hausse des salaires dépassant celle du prix du pain (50 % contre 28 %). Malgré la loi, on fait parfois grève, mais la plupart du temps le « pain du despotisme » n'est pas cher, et chacun l'a sur sa table. Là aussi les besoins de l'armée ont raréfié la main-d'œuvre, ce qui a permis une diminution du chômage et une augmentation des salaires. Quelques compagnons parviennent à gravir l'échelle sociale. Des ouvriers qualifiés réussissent à s'établir à leur compte.
Essor démographique
L'élévation du niveau de vie de l'ensemble de la société se traduit par un accroissement de la population, qui augmente de 1 700 000 habitants. Cet essor démographique contribue à la prospérité économique, que favorisent aussi la stabilité de la monnaie (assurée par la loi du 7 germinal an XI [28 mars 1803] qui fixe le poids du franc), le soutien du gouvernement à l'économie et la politique extérieure de Napoléon.
4. Le Grand Empire
Les objectifs de la politique extérieure napoléonienne sont divers et circonstanciels : abattre la Grande-Bretagne, puissance économique concurrente et animatrice des troisième, quatrième et cinquième coalitions contre la France ; renforcer les frontières naturelles ; construire le Grand Empire par la conquête, qui s'explique par la volonté de puissance de Napoléon, et aussi par l'hostilité de l'Europe des rois envers un homme qui demeure, à ses yeux, le soldat de la Révolution.
4.1. La Grande Armée
La conquête de l'Empire est d'abord l'œuvre de l'armée. L'armée de Napoléon est une armée de conscription. Les jeunes âgés de 20 à 25 ans sont inscrits ensemble (« conscrits ») sur les registres militaires. Tous ne partent pas. Un contingent est fixé chaque année. Les soldats sont les hommes qui ont tiré au sort un mauvais numéro. Ils peuvent, s'ils sont riches, se faire remplacer : il leur en coûte jusqu'à 6 000 F. De 1800 à 1814, on voit partir ainsi 2 millions d'hommes, soit 36 % des mobilisables et 7 % de la population. Napoléon fait de plus en plus appel à des contingents étrangers et l'armée de la campagne de Russie en sera composée pour moitié.
Napoléon n'innove guère : les armes données à l'infanterie comme à l'artillerie sont copiées sur les modèles de l'Ancien Régime. Napoléon n'utilisera ni le ballon d'observation ni le sous-marin de Robert Fulton. L'armée est divisée en corps, mêlant infanterie, artillerie et cavalerie légère, aux ordres des maréchaux. La cavalerie lourde donne les coups de boutoir. La Garde impériale forme une masse de manœuvre de plusieurs dizaines de milliers d'hommes. On surnomme les gardes les « immortels », car Napoléon ne les utilise qu'en cas de péril extrême.
Les cadres sont instruits dans des écoles militaires. Le temps manque pour accroître le nombre de ces élèves officiers et, à 90 %, les gradés sortent de la troupe, où ils ont fait preuve de courage et d'initiative. Ce sont des hommes jeunes, bons entraîneurs d'hommes, mais de piètres tacticiens.
La tactique de Napoléon est inspirée de celle des stratèges du xviiie siècle et de l'expérience des guerres de la Révolution : tout dépend « du coup d'œil et du moment ». L'armée est comme une gigantesque main s'ouvrant sur le théâtre des opérations et laissant l'ennemi dans l'incertitude sur le point d'attaque. L'action décidée, la main se referme avec rapidité et le poing frappe et écrase. Les deux manœuvres les plus courantes sont celles que résument les batailles d'Ulm – une action sur les arrières de l'adversaire le coupe de ses zones d'approvisionnement et une attaque de flanc le pousse dans une nasse – et d'Austerlitz, où une masse centrale, obtenue en dégarnissant les secteurs secondaires, fractionne l'armée adverse et accable tour à tour ses divers éléments.
Pour en savoir plus, voir l'article Grande Armée.
4.2. L’Europe comme champ de bataille
De 1805 à 1810, après le désastre naval de Trafalgar (21 octobre 1805), la Grande Armée (200 000 hommes en 1805, 900 000 en 1809 dont 160 000 sont fournis par la conscription) remporte les victoires d'Austerlitz (2 décembre 1805), d'Iéna (14 octobre 1806), de Friedland (14 juin 1807), du col de Somosierra (30 novembre 1808) et de Wagram (6 juillet 1809), qui permettent à Napoléon de dominer l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et de s’être fait une alliée de la Russie, après Friedland, lors de l’entrevue de Tilsit (→ traités de Tilsit, 1807).
Mais, dès l’origine, la conquête de l’Espagne tourne au désastre. Napoléon s’est persuadé que les Espagnols accepteraient un roi français. Le 23 mars 1808, Murat entre à Madrid. Le 2 mai , la population se soulève (→ El dos de mayo de 1808. L'armée française réprime la révolte dans le sang. Convoquant à Bayonne la famille royale espagnole et jouant de ses dissensions, Napoléon obtient du roi et de son fils une double abdication. Le 10 juillet, il fait de son frère Joseph un roi d'Espagne et de Murat le roi de Naples. Mais l'armée française est mise en échec par les guérilleros espagnols (capitulation, le 19 juillet, du général Dupont à Bailén) et Joseph Bonaparte se retire derrière l'Èbre.
Après l'entrevue d'Erfurt (septembre-octobre 1808), où il consolide ses liens avec la Russie, Napoléon intervient lui-même en Espagne et réinstalle son frère à Madrid, le 4 décembre 1808. Mais Talleyrand et Fouché complotent contre l'Empereur : l'armée, engagée dans une guerre atroce, est en fait prise dans un guêpier ; la bourgeoisie française commence à se méfier de l'« aventurier corse ».
Le Blocus continental (1806-1807), qui vise à acculer la Grande-Bretagne à la négociation par la ruine économique et à donner à la France l'hégémonie sur le marché européen, est aussi une arme de guerre. Cette politique profite jusqu'en 1808 au commerce français. Mais le Royaume-Uni a des atouts pour vaincre le Blocus : sa flotte de guerre qui protège les vaisseaux qui font de la contrebande, la possession de marchés en Méditerranée, en Extrême-Orient et en Amérique. Il parviendra à surmonter la crise, mais le Blocus entraîne Napoléon dans une guerre perpétuelle contre les États qui sont dans la nécessité de commercer avec Londres. Le Blocus distend l'Empire aux dimensions du continent.
4.3. L'Empire des Bonaparte
En 1811, l'Empire français s'étend de Lübeck à Rome sur 130 départements peuplés de 45 millions d'habitants. Autour de lui gravitent des États vassaux (royaumes d'Italie, d'Espagne, de Westphalie et de Naples, Confédération du Rhin et Confédération helvétique) qui lui fournissent argent, hommes, matières premières.
Ces États vassaux sont gouvernés par des parents ou des serviteurs de Napoléon, ou placés sous la protection de l'Empereur. Napoléon a mis en place un système continental fondé sur des alliances matrimoniales. En 1806, Eugène de Beauharnais, fils d'un premier mariage de l'impératrice Joséphine et adopté par Napoléon, a épousé la fille du roi de Bavière. Eugénie de Beauharnais, la cousine d'Eugène, adoptée elle aussi par l'Empereur, s’est mariée avec l'héritier du duché de Bade. Le royaume de Hollande a été confié à Louis Bonaparte, la Westphalie au plus jeune frère de l’Empereur, Jérôme. Depuis 1805, Élisa Bonaparte est princesse de Lucques et de Piombino. Murat, marié à Caroline Bonaparte, a été fait grand-duc de Berg et de Clèves en 1806.
Ces États appliquent le Blocus continental comme les États alliés (Russie, Prusse, Autriche, Danemark, Suède). Une partie de l'Europe est ainsi soumise au système de gouvernement napoléonien et régie par le Code civil. Le Grand Empire qu'elle forme avec la France semble même devoir se perpétuer avec la naissance du roi de Rome (1811), fils de Marie-Louise d’Autriche et de Napoléon, mariés un an plus tôt après que celui-ci ait divorcé de Joséphine de Beauharnais.
Pour en savoir plus, voir l'article Bonaparte.
4.4. L'Empire miné
Mais l'édifice impérial est un géant aux pieds d'argile. En 1810, Napoléon est maître de l'Europe, mais son pouvoir est miné : à l'intérieur par la crise économique, sociale et religieuse ; à l'extérieur par l'éveil des nations, dont les rois de l'Europe se servent bientôt pour l'abattre. Les premières fissures de l'Empire apparaissent. Crise financière et industrielle en 1810 : des banques font faillite, les entreprises, qui ont trop emprunté, sont aux abois, le marché intérieur se dérobe. Le commerce français en Europe est de plus en plus concurrencé par la contrebande anglaise. En 1811, de mauvaises récoltes appauvrissent les campagnes et la crise se répercute sur le commerce et l'industrie.
Crise religieuse aussi : le pape, spolié de ses États et prisonnier à Savone, refuse de donner l'investiture aux nouveaux évêques et suspend la vie de l'Église. Napoléon, pour tourner le pouvoir pontifical, réunit un concile national des évêques (juin-août 1811) ; c'est un échec : les évêques résistent, certains sont emprisonnés, le pape est déporté à Fontainebleau en 1812. Désormais, le clergé prêche l'insoumission contre le César qui maltraite le pape et la religion. Napoléon voit dans la guerre un dérivatif au mécontentement, un moyen de remplir son trésor de guerre et de rétablir ses finances.
Enfin, la guerre est nécessaire pour soutenir sa politique en Europe. Le tsar Alexandre Ier, poussé par les magnats russes liés aux commerçants britanniques, n'applique pas le Blocus. Il reproche aussi à Napoléon de ne pas tenir ses promesses et de ne pas l'aider à agrandir sa zone d'influence en Europe orientale et méridionale.
5. La chute de l'Empire
À partir de 1811, plusieurs événements (conjoncture économique défavorable, éveil des nationalismes dans les États vassaux, rupture de l'alliance franco-russe, opposition en France de la bourgeoisie à la guerre, hostilité des catholiques à la politique religieuse de Napoléon) se conjuguent donc pour provoquer la chute de l'Empire.
5.1. La campagne de Russie ou le début de la fin
Le 24 juin 1812, Napoléon franchit le Niémen avec 620 000 hommes appartenant à 20 nations. Il pense mener, comme à l'accoutumée, une campagne éclair. Mais l'armée russe se dérobe, jouant de son premier atout : le vaste espace de l'Empire. Deuxième atout du commandement russe : la religion orthodoxe ; l'armée qui se bat commence d'abord par prier, ce qui l’unifie. Enfin, au bord de la Moskova, le général Koutouzov accepte le combat pour protéger Moscou. Du 5 au 7 septembre, Napoléon l'emporte à Borodino, dans une bataille acharnée qui lui coûte 30 000 hommes (→ bataille de la Moskova). Le 14 septembre, il entre à Moscou, mais y attend en vain les envoyés du tsar. Celui-ci dispose d'un troisième atout : le « général hiver » qui approche. Moscou brûle, incendiée sur ordre du gouverneur russe selon les Français, par les soldats français ivres, selon les Russes exaspérés par le ravage de la ville sainte. Napoléon ordonne la retraite. Dans le froid (− 30 °C), sans habits chauds, sans nourriture, harcelée par les cosaques et les paysans, l'armée franchit la Berezina, les 27 et 29 novembre, grâce au sacrifice des pontonniers. Elle a perdu près de 500 000 hommes.
Napoléon à Fontainebleau, lors de la première abdication
En Europe, les nations s'éveillent. Déjà, de 1806 à 1809, la haine du despotisme français avait agité les populations : dans le Tyrol, par exemple, une révolte paysanne avait été animée par Andreas Hofer. À Berlin, en 1807, Fichte avait appelé la nation allemande à se rebeller. S'appuyant sur ce mouvement pour le contrôler, la Prusse entre en guerre le 17 mars 1813, bientôt rejointe par l'Autriche et la Suède, dont Bernadotte est devenu le prince héritier. À Leipzig, du 16 au 19 octobre 1813, dans la « bataille des Nations », 160 000 Français affrontent 320 000 coalisés et sont obligés de reculer jusqu'au Rhin. En Espagne, en Hollande, partout l'ennemi progresse. En Italie, Murat, par ambition ou fidélité « à ses peuples », se tourne contre son beau-frère. Avec une armée improvisée de 175 000 jeunes, les Marie-Louise, Napoléon mène la campagne de France et y retrouve son génie de capitaine. En vain. Les notables et les ministres complotent. Les maréchaux le pressent d'abdiquer. Il s'y résout le 6 avril 1814. Les Alliés entrent dans Paris et établissent Louis XVIII roi de France. Napoléon n'est plus le souverain que d'une île de la Méditerranée : l'île d'Elbe.
5.2. « Le vol de l’aigle »
Si Louis XVIII est assez habile pour « octroyer » une charte libérale qui reconnaît les acquis de la Révolution, les émigrés de retour choquent les Français par leur volonté de revanche.
Napoléon sait ce retournement de l'opinion et la désunion installée dans le camp des vainqueurs. Avec une petite troupe, il débarque le 1er mars 1815 à Golfe-Juan, et, comme il l'avait prédit, « l'aigle impérial vole de clocher en clocher jusqu'aux tours de Notre-Dame ». Il est à Paris le 20 mars, sans avoir fait tirer un coup de feu, l'armée se ralliant et les populations ouvrières acclamant en lui l'héritier de la Révolution. Il ne veut pourtant pas être le « roi de la rue ». Il se tourne à nouveau vers les notables, et Benjamin Constant rédige un Acte additionnel aux Constitutions de l'Empire qui instaure une monarchie constitutionnelle.
5.3. Septième coalition (mars 1815)
Napoléon croit la paix possible, mais les grandes puissances, toujours occupées au congrès de Vienne à réorganiser l'Europe, se coalisent à nouveau contre lui. Avec une armée de vétérans, il se porte à la rencontre des Anglo-Prussiens. Le 18 juin 1815, il livre bataille à Waterloo, sur la route de Bruxelles, aux troupes de Wellington. Ce dernier a tiré la leçon de ses luttes en Espagne contre les Français : il accroche ses troupes au terrain et multiplie les feux croisés. Napoléon attend pour l'assaut final l'arrivée d'un de ses lieutenants, Grouchy. Celui-ci tarde et ce sont les Prussiens qui apparaissent sur le champ de bataille. On entraîne l'Empereur, tandis que la Garde se sacrifie.
À Paris, Fouché, la Chambre des représentants et les notables le forcent à une nouvelle abdication, le 22 juin. Napoléon demande l'asile aux Britanniques, mais ceux-ci le déportent à l'île de Sainte-Hélène. Il y mourra le 5 mai 1821.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
