|
| |
|
|
 |
|
HOMMES ET HOMINIDÃS |
|
|
| |
|
| |
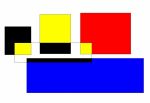
HOMMES ET HOMINIDÉS
Il s'agit d'explorer la dichotomie entre les grands singes et l'Homme et comment comprendre cette divergence aujourd'hui. En consultant les médias, on voit souvent évoquer le fait que l'Homme partage 99% de son matériel génétique avec le chimpanzé. Les Hommes et les chimpanzés, mais aussi les gorilles, sont extrêmement similaires. Les travaux en biologie moléculaire nous permettent de dire qu'il y a environ 7 millions d'années, à la fin du miocène, les ancêtres des humains, des chimpanzés et des gorilles actuels sont partis sur leurs propres chemins évolutifs et leurs propres régions géographique.
Quelles sont les certitudes, les interrogations concernant cette évolution ? Il est impossible de vraiment trancher pour savoir qui du chimpanzé ou du gorille et plus proche de l'Homme. Il s'agirait plutôt d'une trichotomie au sein d'une même population. Le problème peut être abordé sous plusieurs aspects : anatomique, géographique et climatique, environnemental qui façonnent les êtres fossiles et qui ont fait ce que nous sommes avec nos variabilités physiques et culturelles.
HOMMES ET HOMINIDÉS
Texte de la 439e conférence de l'Université de tous les savoirs donnée le 18 juillet 2002
Grands singes - Hommes : histoire d'une divergence
Par Brigitte Senut,
La divergence entre les grands singes et l'homme est un des sujets les plus discutés de la paléontologie humaine, probablement car il touche directement à nos origines. Les données permettant d'appréhender cette séparation sont fournies par toute une série de disciplines allant de la paléontologie, la géologie, la sédimentologie à la biologie moléculaire. Car il faut, en effet, resituer cette question évolutive dans un cadre bio-éco-géographique plus vaste, plutôt que de se limiter à un cadre anatomique. Les résultats des différents domaines ne concordent pas toujours, c'est ainsi souvent le cas de la biologie moléculaire et de la paléontologie, car les données néontologiques ne prennent pas la dimension essentielle de l'évolution, la quatrième dimension : le temps. L'étude des grands singes et des hommes actuels nous permet de clarifier les relations de parenté, mais le tempo de leur histoire ne nous est fourni que par la paléontologie. Les données de terrain très fructueuses ces dix dernières années nous obligent à remonter au-delà de 6-7 millions d'années, pour comprendre la manière dont la lignée des grands singes s'est isolée de celle de l'homme. Quelles sont ces nouvelles découvertes? Quels sont les nouveaux enjeux? C'est à ces questions que nous allons essayer de répondre dans la suite de cet exposé.
L'apport de la biologie moléculaire
La phylogénie en question
Les molécularistes et les paléontologues s'accordent aujourd'hui sur le fait que les grands singes asiatiques sont des parents relativement éloignés de nous, alors que leurs cousins africains semblent nous être plus proches ; mais au sein de ces derniers, peut-on isoler un genre une espèce plus privilégiée? En d'autres termes, le chimpanzé est-il notre plus proche cousin ? Est-ce le bonobo (ou chimpanzé nain) ? Ou bien l'ensemble gorille-chimpanzé ? Ou bien les chimpanzés, les gorilles et les hommes sont-ils aussi éloignés les uns des autres ? Selon les méthodes d'analyses, il apparaît que tous ces schémas sont possibles. Toutefois, certains auteurs ont largement médiatisé un rapprochement exclusif chimpanzés-hommes. Ceci serait conforté par les études sur l'ADN et l'ADN mitochondrial, alors que d'autres travaux révèlent des branchements différents. Ce qui reste sûr aujourd'hui est que les plus proches parents de l'homme sont africains et que leur ancêtre est, lui aussi, plus vraisemblablement africain.
L'horloge moléculaire
Le concept d'horloge moléculaire est basé sur la constatation que la mesure des divergences des séquences d'acides aminés est corrélée au temps. Les changements sont censés s'opérer à des rythmes constants à partir d'une date de divergence paléontologique donnée (soit celle des ruminants, soit celle des cercopithèques, etc.) ; ce n'est donc pas une méthode indépendante. Or, selon les auteurs, ou selon les groupes utilisés pour calibrer, les résultats sont très différents et on a obtenu des dates variant de 2 millions d'années à plus de 15 millions d'années pour la dichotomie hommes/grands singes. Toutefois, il a été démontré que l'horloge moléculaire ne marche pas, en fait, à vitesse constante. Le taux auquel les changements sont incorporés dans les populations varient en fonction des temps de génération, l'isolation génétique etc. C'est pourquoi, l'horloge est différente entre les éléphants et les souris, il est évident que la souris se reproduisant plus vite, le renouvellement génétique est plus rapide. Par ailleurs, il y a une variation au sein d'une même espèce. La même chose est vraie au sein des primates si on compare des lémuriens ou des chimpanzés. Enfin, il apparaît que sur de longues périodes, l'horloge devient imprécise. L'horloge moléculaire ne marche pas donc pas à la même vitesse dans tous les groupes de mammifères et pour dater les divergences, il convient donc d'utiliser les données temporelles fournies par les fossiles.
Les grands singes et leurs caractères de vie.
Dimorphisme sexuel
Les grands singes de grande taille se caractérisent généralement par de forts dimorphismes de taille et de morphologie liés au sexe. Un des caractères les plus utilisés chez les primates est la canine. Chez les mâles, la racine est massive et a pratiquement la même taille que la base de la couronne. Chez les femelles, la racine plus petite est rétrécie à la base de la couronne. Ce caractère s'observe chez les grands singes actuels et fossiles. Par ailleurs, chez les mâles, les racines étant beaucoup plus grandes, le museau est gonflé et aussi plus projeté vers l'avant, ce qu'on appelle le prognathisme. Quelquefois, cette projection est si importante que la morphologie faciale des mâles et des femelles est aussi très différente. C'est ce qui rend souvent l'interprétation des fossiles isolés difficile. C'est le cas notamment du fameux Kenyapithèque du Kenya considéré longtemps comme un hominidé ancien car sa canine était petite et sa face peu projetée. Or, la une nouvelle études de ces matériels a montré que les spécimens incriminés appartenaient en fait à des individus femelles et Kenyapithecus était une forme éteinte de grand singe, pas placée en position particulière dans notre arbre phylogénétique. La même chose est arrivée avec les Ramapithèques asiatiques. Mais il est intéressant de constater que de nombreux spécimens sensés être nos ancêtres étaient en fait des femelles de grands singes et que les ancêtres de grands singes étaient de mâles... ! C'est le cas typique du groupe des Sivapithèques et Ramapithèques: les premiers ont été considérés comme des ancêtres des orangs-outans et les Ramapithèques, ancêtres de l'homme. Toutefois, lorsque les études sur le dimorphisme sexuel ont été développées au début des années 1980, on s'est rendu compte que les ramapithèques étaient les femelles des sivapithèques, ancêtres des grands singes de Bornéo et Sumatra. Cela allait même plus loin, car le genre Sivapithecus ayant été créé bien avant que celui de Ramapithecus, ce dernier nom devait être abandonné. Les ramapithèques qui avaient eu leur heure de gloire dans les années 1960 à 1980, disparaissaient du paysage paléontologique par le coup du dimorphisme sexuel.
Alimentation
Les primates actuels sont parmi les mammifères les plus diversifiés dans leur alimentation. Ayant accès à toutes les strates des canopées, comme au milieu terrestre, ils se nourrissent de feuilles, et/ou de fruits, et/ou de viande. Il n'est pas rare que les chimpanzés mangent des petites antilopes ou des petits cercopithèques. La morphologie dentaire observée reflète le mode d'alimentation le plus fréquent, mais un animal peut de temps à autres adapter son régime à ce que lui offre son environnement. Les gorilles sont inféodés à des milieux forestiers et se nourrissent de végétaux variés, herbacées et fruits. Le régime alimentaire peut être déduit non seulement des dents, mais aussi des os maxillaire et mandibulaire et de leurs insertions musculaires. Sur l'anatomie des dents, la morphologie des cuspides est assez typée chez les chimpanzés avec des tubercules placés à la périphérie de la couronne et montrant un grand bassin central ; et chez les gorilles avec des tubercules placés à la périphérie mais plus acérés et un bassin central moins élargi. Chez l'homme, qui est un hominoïde à part entière, les tubercules sont globuleux, assez bas et plus centraux. Un autre aspect de la morphologie dentaire concerne l'émail : la variation de son épaisseur reflète également la qualité de ce que l'animal ingère ; ainsi si l'animal consomme plus fréquemment des fruits, l'émail est plus fin et s'il consomme des aliments plus coriaces, l'épaisseur de l'émail est plus épais. En gros, cela semble vrai, mais il faut aussi prendre en compte la surface triturante de la dent, sa croissance et donc sa taille. Les replis de l'émail plus prononcé chez les chimpanzés nous apportent aussi des informations sur le style de nourriture qu'ingurgitent les grands singes. On voit tout l'intérêt de bien comprendre les morphologies actuelles pour déduire des interprétations sur les fossiles.
Locomotion
Les modes de locomotion sont aussi très diversifiés chez les grands singes puisqu'ils varient de la suspension, au grimper vertical, marche sur les branches sur les quatre pattes arrière ou sur les deux pattes arrière. Mais les grands singes pratiquent aussi une marche particulière appelée le knuckle-walking, littéralement la marche sur l'articulation des phalanges antérieures repliées.
C'est le mode classique de déplacement des chimpanzés, qui est un peu modifié chez les gorilles, beaucoup plus lourds. Le mode de déplacement est lié en grande part à la taille de l'animal : ainsi, un gorille mâle de plus de 200 kgs peut difficilement se suspendre aux branches d'arbres, alors que le petit beaucoup plus léger en sera capable. Mais aucun de ces grands singes n'est assez léger pour pratiquer le déplacement acrobatique adopté par les gibbons d'Asie du Sud-Est. Un mode de déplacement utilisé par tous les grands singes plus ou moins fréquemment ou plus ou moins occasionnellement est la marche bipède. Aujourd'hui, le seul hominoïde capable de se déplacer pour la plus grande partie de son temps sur ses deux pattes arrière est l'homme. L'adaptation à la bipédie permanente est un des caractères qui est généralement utilisé pour définir le genre Homo. Chez les fossiles, on observe des bipédies différentes de celles de l'homme actuel, celle des Oréopithèques de Toscane étant probablement la plus éloignée de la nôtre, celle des Australopithèques en étant la plus proche. Les paléontologues n'ont pas à leur disposition tous les ligaments, muscles, etc... , mais l'os enregistre le mouvement le plus fréquemment réalisé ; et par comparaison avec les animaux actuels on peut reconstituer des types de mouvements, puis des associations de mouvements qui débouchent sur des scénarios locomoteurs. Pendant près d'un siècle, les anthropologues ont focalisé leurs travaux sur les restes crâniens et dentaires, parties nobles du squelette pour reconstituer les scénarios de nos origines, mais depuis la fin des années 1970, on s'aperçoit que les modes de locomotion apporte eux aussi des informations à cette quête, et ils sont aujourd'hui considérés comme des éléments à part entière. En fait, la reconstitution des modes locomoteurs passés est essentielle.
Les grands singes fossiles
Les grands singes fossiles sont connus dès l'Oligocène supérieur en Afrique orientale et sont représentés par quelques pièces dentaires attribuées à Kamoyapithecus. Mais c'est au Miocène inférieur que les grands singes vont s'épanouir en Afrique. Si pendant longtemps, on les a cru confinés à l'Afrique orientale, on les a retrouvés au début des années 90 en Egypte, puis en Afrique du Sud en 1996. Les restes extérieurs à l'Afrique orientale sont très peu nombreux : un humérus en Egypte au Wadi el Moghara et une demi-dent supérieure dans la mine de diamants de Ryskop en Afrique du Sud. En raison de leur faible nombre, ils n'ont pas pu être nommés formellement.
En Afrique orientale, par contre, on connaît de très nombreux grands singes de grande taille (dont certains équivalents à un gorille) et de petite taille (proche de celle des gibbons). Nous nous focaliserons sur ceux de grande taille parmi lesquels nous recherchons nos ancêtres.
Les plus connus des grands singes de la période de 22 à 17 Millions d'années environ sont les Proconsul. Très bien représentés au Kenya et en Ouganda par plusieurs formes qui ont la taille des chimpanzés et colobes actuels. Ce sont des grands singes généralisés par leur dentition et leur locomotion. Probablement adaptés à un régime plutôt frugivore, ils habitaient dans des environnements de forêt sèche où ils se déplaçaient à quatre pattes sur les branches, ou au sol. Ces reconstitutions sont basées sur les restes de plantes, de grands mammifères, de micromammifères et ceux d'escargots fossiles, notamment des très riches gisements de l'île de Rusinga au Kenya.
A la même époque les Ugandapithecus, de la taille du gorille, vivaient sur les pentes des volcans de Napak en Ouganda et à Songhor au Kenya. Assez lourds, ils vivaient probablement en partie au sol, mais ils pratiquaient également un grimper vertical. Leurs canines présentent un caractère tout particulier : le sommet de la dent est en forme de lame plutôt que conique. Leurs dents assez massives suggèrent qu'ils se nourrissaient de nourritures assez coriaces. Les Ugandapithèques sont connus jusqu'à la base du Miocène moyen (16-17 Millions d'années) en Afrique orientale, et spécialement sur le gisement de Moroto en Ouganda où ils côtoient les Afropithèques, de taille plus modeste, découverts également sur la rive occidentale du Lac Turkana au Kenya. Entre 17 et 12 millions d'années les grands singes connaissent un second buissonnement avec les Turkanapithèques du Lac Turkana, les Nacholapithèques des Collines Samburu. Dans les gisements de l'île de Maboko on trouve les Kenyapithèques, dont l'espèce présente à Fort Ternan ( Kenyapithecus wickeri) sera considérée, dès sa découverte, comme un hominidé ancien. Cependant, les caractères utilisés à l'époque (petite canine, face plate, émail épais) se sont avérés, pour les premiers, des caractères de dimorphisme sexuel et, pour le dernier, un caractère classique des grands singes du Miocène moyen dont les l'alimentation est basée sur des végétaux plutôt durs. Le Kenyapithèque de Fort Ternan avait aussi été considéré comme un hominidé sur la base de présence de galets utilisés trouvés avec les fossiles. Toutefois, ces cailloux « utilisés » se sont avérés être des pierres de lave brisés naturellement. Par ailleurs, on sait aujourd'hui que d'autres primates utilisent des outils ou manipulent et cela ne leur donne pas automatiquement le statut d'hominidé.
Après avoir longtemps été considérés comme des animaux typiquement est-africains, les grands singes voyaient leur aire de répartition considérablement augmentée par la découverte d' Otavipithecus namibiensis au nord-est de la Namibie. Ils avaient toutefois été signalés en 1975 en Arabie saoudite qui, à l'époque où ils vivaient, était rattachée à l'Afrique orientale. L'Otavipithèque ne ressemble à aucun des grands singes classiques est-africains de l'époque, par sa mâchoire étroite, ses dents aux cuspides gonflées, mais cela n'est pas surprenant car il vivait dans une région très excentrée, par rapport à celle où vivaient les autres grands singes de la même époque.
C'est probablement vers ce moment-là que les grands singes vont émigrer vers l'Eurasie; ainsi, on les retrouve en France, en Espagne, en Hongrie, en Grèce, en Inde, au Pakistan, en Turquie, en Chine... où ils prennent les noms de Dryopithèques, Ankarapithèques, Sivapithèques, Ouranopithèques, Lufengpithèques, etc... Certains d'entre eux, bien que considérés par plusieurs auteurs comme des ancêtres potentiels des Hominidés, semblent plus probablement se rapprocher des grands singes asiatiques modernes. Les caractères utilisés pour en faire des Hominidés se sont avérés être souvent des caractères hérités des grands singes africains antérieurs et non pas dérivés d'Hominidés, et dans certains cas dérivés d'Orangs-outans ou même encore liés au dimorphisme sexuel observé classiquement chez les grands singes actuels et fossiles.
Le trou noir- la divergence
Le trou noir correspond à cette période pendant laquelle nous ne connaissions pratiquement rien au début des années 1990 entre les grands singes du Miocène et les premiers Hominidés avérés, les Australopithèques, c'est à dire environ entre 10-12 millions d'années et 4,2 millions d'années. A l'époque, les quelques pièces fossiles, toutes kenyennes, pouvaient se compter sur les doigts des deux mains: un fragment de maxillaire trouvé au début des années 80 dans les Samburu Hills et vieux de 9,5 millions d'années, une dent isolée dans la Formation de Lukeino datée de 6 millions d'années, un fragment d'humérus vieux de 5,1 millions d'années, un fragment de mandibule à Tabarin vieille de 4,5 millions d'années, un fragment de mandibule à Lothagam (aujourd'hui redatée à 4,2 millions d'années environ). Les nombreuses expéditions menées en Afrique depuis la dernière décennie ont pratiquement triplé le matériel connu au début des années 1990; il n'est donc pas surprenant que les scénarios de nos origines soient largement discutés. A part le maxillaire des Samburu, tous ces fossiles étaient rapportés aux Hominidés. Dans tous les scénarios évolutifs ces restes ont été considérés comme appartenant obligatoirement à des ancêtres des Australopithèque et donc des Hominidés. En fait, les chercheurs dans leur grande majorité ont focalisé leurs travaux sur les Australopithèques et toute pièce hominidée trouvée dans des niveaux plus anciens était systématiquement considérée comme un ancêtre de ceux-ci et donc des hommes. L'évolution était linéaire, ce qui malheureusement ne semble pas très biologique. En effet, jusqu'à 12 millions d'années environ, les grands singes sont largement représentés en Afrique; il faudrait donc admettre que ces derniers disparaissent pour laisser la place à une seule lignée et que celle-ci soit obligatoirement ancestrale à l'homme. Cette interprétation nie le phénomène de radiation chez les grand singes et les hominidés anciens. Vers 6 millions d'années environ, on sait que les grands groupes de mammifères sont très diversifiés et il est probable que les primates (grands singes et hommes inclus) n'ont pas échappé à la règle.
Samburupithecus
Le premier acteur dans ce trou noir est Samburupithecus; découvert au début des années 1980 dans les Samburu Hills au Kenya (mais publié seulement en 1994), il est connu exclusivement par un fragment de maxillaire portant les 2 prémolaires et les 3 molaires. Par certains aspects, il rappelle les gorilles, notamment pas la morphologie de son museau, la position de l'arcade zygomatique relativement basse et antérieure sur la mâchoire. Les tubercules de ses dents sont, en revanche, gonflés; il s'agit sans doute d'une femelle comme le suggère l'alvéole préservée de la canine qui indique que la racine de cette dernière était petite. Par ses caractères, cette pièce pourrait être considérée comme un ancêtre des grands singes et de l'homme, ou un ancêtre de gorilles, mais il faut plus de matériel pour conclure.
Ardipithecus ramidus
En 1994/1995, Ardipithecus ramidus, vieux de 4,4 millions d'années venait combler une lacune dans l'histoire de la dichotomie des grands singes et de l'homme. Découverts en Ethiopie dans la Vallée moyenne de l'Aouache, les restes attribués à cette espèce se composent de dents isolées, de quelques os postcrâniens fragmentaires un petit fragment crânien et un squelette partiel qui n'est toujours pas publié. Ces éléments furent rapportés à un hominidé, mais si certains caractères de ses canines l'en rapprochent effectivement, toute une suite d'autres l'en isolent comme l'épaisseur de l'émail dentaire ou la taille de la canine par rapport aux dents jugales. Le squelette indiquerait une adaptation à la bipédie, mais les restes publiés à ce jour ne permettent pas cette affirmation. Ardipithecus ramidus est-il un hominidé ou un grand singe? Il est bien difficile de conclure à la lueur des éléments disponibles.
Orrorin tugenensis
A l'automne 2000, une douzaine de restes dentaires, mandibulaires et postcrâniens d'un hominidé étaient trouvés dans la Formation de Lukeino au Kenya qui avait déjà livré une dent isolée en 1974. Les gisements qui ont livré les fossiles s'échelonnent dans le temps entre 6,0 et 5,7 millions d'années; le gisement le plus riche étant celui de Kapsomin situé à la base de la formation. Les dents en général sont petites, proches en taille de celles de chimpanzés et des hommes actuels, mais leur forme plus carrée les rapproche des seconds. La morphologie de la canine supérieure portant une gouttière verticale ou la première prémolaire inférieure avec ses racines décalées rappelle la morphologie observée chez les grands singes actuels et fossiles. Toutefois, les tubercules dentaires ne présentent pas les ridulations d'émail classique chez les grands singes, la morphologie de la canine inférieure est intermédiaire entre celle des grands singes et celle de l'homme, l'émail est épais, la face interne des molaires est verticale. La partie antérieure de la mandibule est droite et on n'observe aucun espace (diastème) entre la canine et la première prémolaire inférieures. L'ensemble des caractères dentaires rapprochent Orrorin des hominidés.
La découverte d'Orrorin était importante également par le fait que des restes postcrâniens étaient signalés, dont des fémurs relativement bien conservés. C'est l'étude du fémur qui a montré que Orrorin était bipède. Ceci s'exprime par un col fémoral allongé et aplati antéro-postérieurement, la position de la tête fémorale, la position des insertions musculaires, la distribution de l'os cortical (épaissi à la partie inférieure et plus mince à la partie supérieure) sur la coupe du col fémoral, et la présence en vue postérieure d'une gouttière pour le muscle obturator externus. La plupart de ces caractères sont présents chez les Australopithèques et l'homme et sont classiquement associés à la bipédie. Cependant, certaines différences d'avec les Australopithèques (en particulier, orientation de la tête fémorale, position du petit trochanter) et une meilleure ressemblance avec les hommes indiquent que cette bipédie est plus humaine que celles de Australopithèques. Cet hominidé pratiquait donc probablement habituellement la bipédie; toutefois, il n'est pas encore affranchi du milieu arboré, comme le montrent son humérus et ses phalanges de main.
Orrorin n'est pas un être petit puisque les mesures de son humérus et de son fémur indiquent qu'il était une fois et demie plus grand que Lucy, la célèbre Australopithèque de l'Afar. Cette dernière est de taille modeste, mais possède des dents assez grosses (mégadonte); en revanche, chez Orrorin, l'inverse est vrai, le corps est plus grand mais les dents plus petites (microdonte). Si Orrorin devait être un ancêtre des Australopithèques, eux-mêmes ancêtres de l'homme, il faudrait admettre que des êtres microdontes auraient donné naissance à des mégadontes, qui eux-mêmes auraient donné naissance à des microdontes. Ces aller-retours anatomiques qui touchent à la fois le système masticateur et le système locomoteur semblent douteux et c'est pour cela que nous considérons les Australopithèques comme une branche à part de notre famille. Lors de sa découverte en 2000, Orrorin était le premier Hominidé connu antérieur à 5 millions d'années et sa présence si ancienne remettait en cause les données moléculaires en suggérant une dichotomie entre les grands singes et l'homme très ancienne (bien antérieure à 6 millions d'années).
Ardipithecus ramidus kadabba
Le débat sur nos origines était relancé en juillet 2001 avec la publication d'une sous-espèce d'Ardipithèque, Ardipithecus ramidus kadabba, découverte en Ethiopie dans des niveaux vieux de 5,7 à 5,2 millions d'années. Elle est représentée par des dents et os isolés (notamment fragment d'humérus et phalanges du pied et de la main). Elle se différencie des grands singes actuels par la tendance des canines à être incisiformes et la morphologie générale de ces dernières; mais, elle s'isole également d' Ardipithecus ramidus ramidus par la morphologie des P3 et M3 supérieures et de la canine inférieure. Les caractères des éléments post-crâniens rappellent ceux des grands singes et de certains spécimens de Hadar et suggéreraient des adaptations à la vie arboricole. Même si selon les auteurs, on peut considérer cette sous-espèce d'Hominoïde comme un Hominidé, il n'en reste pas moins qu'un certains nombre de caractères rappellent les grands singes et que les différences d'avec l'autre sous-espèce méritent clarification.
Sahelanthropus tchadensis
Puis, un an après la découverte éthiopienne étaient publiés les restes d'un hominoïde vieux de 6 à 7 millions d'années, trouvés au Tchad, très loin à l'Ouest de la fameuse faille est-africaine. La pièce la plus médiatique est un crâne légèrement écrasé rapporté par ses inventeurs à un Hominidé sur la base en particulier de la petite taille de la canine, le mode d'usure de cette dernière, l'aplatissement de la face, la position dite « plus antérieure » du foramen magnum. Selon les auteurs, le bourrelet sus-orbitaire très massif indiquerait que le crâne appartenait à un individu mâle. Les autres caractères incluent entre autres: des dents jugale (molaires et prémolaires basses), l'émail intermédiaire en épaisseur entre celui des chimpanzés et des Ardipithèques, une morphologie supra-orbitaire robuste (probablement mâle selon les auteurs), un plancher nuchal plat et des insertions musculaires puissantes dans la région nuchale.
La petite canine n'est pas un caractère d'Hominidé sensu stricto comme signalé plus haut; en effet, chez les grands singes miocènes et modernes, la taille de la canine est le plus souvent l'expression du dimorphisme sexuel. La canine du mâle étant beaucoup plus développée, il s'ensuit un gonflement de la région faciale qui reçoit la racine de la dent, alors que chez la femelle, le gonflement est réduit en liaison avec une racine de taille plus modeste; d'où l'aspect plus plat de la face.
La taille du bourrelet sus-orbitaire n'est pas classiquement utilisé pour sexer des crânes isolés. Chez les chimpanzés ou les gorilles actuels, le bourrelet sus-orbitaire apparaît fort chez les mâles, comme chez les femelles au sein d'une même population; il est en général un peu plus fort chez les mâles. Sur un crâne isolé, il est très difficile de déterminer le sexe de l'individu à partir de ce seul caractères. En dehors du fait que la position antérieure du foramen magnum n'est pas confirmée, il faut être prudent car celle-ci n'est pas liée exclusivement à la bipédie, elle aurait, pour certains, un lien avec le développement cérébral Parmi les caractères décrits, certains semblent rapprocher plus volontiers la pièce des grands singes : aplatissement du plancher nuchal, systèmes des crêtes postérieures et le spécimen, probablement femelle n'apparaît pas très différent de celui des grands singes actuels, en particulier des gorilles. Si cette hypothèse s'avérait confirmée, cela rendrait la découverte tchadienne encore plus intéressante scientifiquement, car elle commencerait à combler l'immense lacune de l'histoire des grands singes africains entre 12 millions d'années et aujourd'hui.
L'origine de l'homme : une histoire de climat ?
Si on veut comprendre l'histoire de nos origines, on ne peut pas se limiter à l'étude des modifications anatomiques de nos ancêtres potentiels. Ces derniers ont vécu dans un environnement qui s'est transformé au cours des temps géologiques en liaison avec les modifications climatiques, géographiques, tectoniques et autres. Un vieux mythe qui encombre encore certains de nos ouvrages est la naissance de l'homme et de sa bipédie dans un milieu ouvert de savane. Or, les dernières données suggèrent que le milieu dans lequel vivait Orrorin ou ses parents Ardipithecus était plutôt humide. En particulier, dans l'environnement d' Orrorin, les colobes et les impalas dominaient la faune; ces espèces ne vivent pas en milieu ouvert : les colobes sont des animaux très arboricoles et les impalas vivent plutôt dans des fourrés. D'où probablement les adaptations à la vie arboricole encore bien marqués chez eux comme chez les premiers australopithèques.
Une hypothèse séduisante a été proposée par Coppens au début des années 1980 : la fameuse « East Side Story ». Dans cette hypothèse éco-climatico-géographique, le rift jouait un rôle majeur: des grands singes auraient été largement distribués en Afrique au Miocène, puis vers 8 millions d'années, une réactivation de la faille aurait engendré la coupure en deux de cette population ancestrale, l'une à l'Ouest aurait donné les grand singes actuels africains restés inféodés au milieu forestier et l'autre aurait évolué vers l'homme dans un milieu plus sec (mais pas forcément de savane sèche, ni de désert). Toutefois, vers 8 millions d'années, il y a une modification du climat à l'échelle du monde. L'établissement de la calotte polaire arctique a entraîné le mouvement vers le Sud des ceintures climatiques mondiales, affectant ainsi la température de l'eau de océans, la répartition des faunes et leur composition. Les grands singes faisant partie de cette faune n'ont probablement pas échappé à ce grand remaniement. L'événement a été ressenti à l'échelle du globe de l'Amérique à l'Europe en passant par l'Afrique. C'est à cette époque que se met en place le Sahara. Le changement faunique a aussi coïncidé avec l'effondrement du rift et des changements à l'échelle locale ont pu avoir lieu. Si l'hypothèse de l'East Side Story a souvent été caricaturée, elle n'en demeure pas moins valide dans l'état actuel de nos connaissances d'un point de vue chronologique et climatique.
Quel(s) ancêtre(s)
Selon certains auteurs, les hominidés antérieurs à 3,5 millions d'années sont les ancêtres des Australopithèques, eux-mêmes ancêtres des hommes. Les découvertes réalisées récemment dans le Miocène supérieur et le Pliocène suggèrent que la diversité des formes a été plus importante et en fait, il semble bien qu'il y ait eu une lignée mégadonte Australopithèque qui s'est éteinte vers 1,4 Millions d'années avec peut-être certains ardipithèques à sa base et une lignée plus microdonte avec Orrorin, Praeanthropus et les Homo anciens. L'origine de ces lignées est à rechercher au-delà de 6 millions d'années et peut-être jusqu'à 12-13 Millions d'années. Qui sont les ancêtres des grands singes africains modernes ? Des fossiles découverts récemment au Kenya suggèrent que des formes proches des chimpanzés auraient pu être présents dès 12,5 millions d'années dans la Formation de Ngorora, Certains Ardipithèques en seraient-ils les descendants? Une dent fragmentaire de 6 millions d'années trouvée au Kenya semble proche des gorilles et à la même époque ces derniers auraient pu être au Tchad. Quoiqu'il en soit, il apparaît que la dichotomie entre les grands singes africains et l'homme est plus ancienne que ne le suggèrent les données moléculaires et que la découverte de tout jalon sur la lignée des premiers sera un apport essentiel à la compréhension des autres. Mais où se situe l'origine des hominidés ? est-elle donc à l'Est ? ou ailleurs ? Si on en croit l'Abbé Breuil, le berceau est à roulettes. Si on s'en tient aux données actuelles, l'Afrique orientale semble renfermer les plus anciennes traces d'hominidés. Si le matériel tchadien était confirmé dans son statut d'hominidé, l'Afrique centrale tiendrait peut-être le flambeau. Mais finalement, cela n'a pas grande importance lorsqu'on réalise que 3% peut-être du continent africain sont aujourd'hui prospectés. Nos scénarios sont forcément voués à changer. En revanche, on peut affirmer aujourd'hui que des êtres bipèdes très anciens sont connus vers 6 millions d'années en Afrique et qu'ils vivaient dans un milieu plus humide qu'on ne le pense généralement.
Bibliographie
M. Brunet, F. Guy, D. Pilbeam, H. Mackaye, A. Likius, D. Ahounta, A. Beauvilain, C. Blondel, H. Bocherens, J-R. Boisserie, L. De Bonis, Y. Coppens, J. Dejax, C. Denys, P. Duringer, V. Eisenmann, G. Fanone, P. Fronty, D. Geraads, T. Lehmann, F. Lihoreau, A. Louchar, A. Mahamat, G. Merceron, G. Mouchelin, O. Otero, P. Campomanes, M. Ponce De Leon, J-C. Rage, M. Sapanet, M. Schuster, J. Sudre, P. Tassy, X. Valentin, P. Vignaud, L. Viriot, A. Zazzo, C. Zollikofer, « A new hominid from the Upper Miocene of Chad, Central Africa », Nature, 418, 145-151, 2002
Y. Coppens, « Hominoïdés, Hominidés et Hommes », La Vie des Sciences, Comptes rendus, série générale, 1, 459-486, 1984
Y. Coppens & B. Senut (Eds.), Origine(s) de la bipédie chez les Hominidae, Cahiers de Paléoanthropologie, Paris, CNRS, 1991
H. Ishida, M. Pickford, « A new Late Miocene hominoid from Kenya : Samburupithecus kiptalami gen et sp. nov », C. R Acad. Sci. Paris, IIa , 325, 823-829, 1998
M. Pickford, H. Ishida, « Interpretation of Samburupithecus, an Upper Miocene hominoid from Kenya », C. R Acad. Sci, Paris, IIa 326, 299-306, 1998
M. Pickford, B. Senut, « The geological and faunal context of Late Miocene hominid remains from Lukeino, Kenya », C. R. Acad. Sci, Paris, sér IIa, 332, 145-152, 2001
M. Pickford, B. Senut, D. Gommery, J. Treil, Bipedalism in Orrorin tugenensis revealed by its femora. C. R. Palevol 1, 191-203, 2002
Y. Sawada, T. Miura, M. Pickford, B. Senut, T. Itaya, C. Kashine, M. Hyodo, T. Chujo, H. Fujii, « The age of Orrorin tugenensis, an early hominid from the Tugen Hills, Kenya », C. R. Palevol, 1, 293-303, 2002
B. Senut, « Les grands singes fossiles et l'origine des Hominidés : mythes et réalités », Primatologie, 1, 93-134, 1998
B. Senut, M. Pickford, D. Gommery, P. Mein, K. Cheboi, Y. Coppens, « First hominid from the Miocene (Kukeino Formation, Kenya) », C. R. Acad. Sci, Paris, série IIa, 332, 137-144, 2001
T.D. White, G. Suwa, B. Asfaw, « Australopithecus ramidus, a new species of early hominid from Aramis, Ethiopia », Nature, 371, 306-312, 1994
T.D. White, G. Suwa, B. Asfaw, « Corrigendum - Australopithecus ramidus, a new species of early hominid from Aramis, Ethiopia », Nature, 375, 88, 1995
G. WoldeGabriel, T.D. White, G. Suwa, P. Renne, J. de Heinzelin, W. K. Hart, G. Helken, « Ecological and temporal palcement of early Pliocene hominids at Aramis, Ethiopia », Nature, 371, 330-333, 1994
M. Wolpoff, B. Senut, M. Pickford, J. Hawks, « Sahelanthropus or Sahelpithecus ? », Nature, 419, 581-582.
VIDEO canal U LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
HOMMES ET HOMINIDÃS |
|
|
| |
|
| |

HOMMES ET HOMINIDÉS
Il s'agit d'explorer la dichotomie entre les grands singes et l'Homme et comment comprendre cette divergence aujourd'hui. En consultant les médias, on voit souvent évoquer le fait que l'Homme partage 99% de son matériel génétique avec le chimpanzé. Les Hommes et les chimpanzés, mais aussi les gorilles, sont extrêmement similaires. Les travaux en biologie moléculaire nous permettent de dire qu'il y a environ 7 millions d'années, à la fin du miocène, les ancêtres des humains, des chimpanzés et des gorilles actuels sont partis sur leurs propres chemins évolutifs et leurs propres régions géographique.
Quelles sont les certitudes, les interrogations concernant cette évolution ? Il est impossible de vraiment trancher pour savoir qui du chimpanzé ou du gorille et plus proche de l'Homme. Il s'agirait plutôt d'une trichotomie au sein d'une même population. Le problème peut être abordé sous plusieurs aspects : anatomique, géographique et climatique, environnemental qui façonnent les êtres fossiles et qui ont fait ce que nous sommes avec nos variabilités physiques et culturelles.
HOMMES ET HOMINIDÉS
Texte de la 439e conférence de l'Université de tous les savoirs donnée le 18 juillet 2002
Grands singes - Hommes : histoire d'une divergence
Par Brigitte Senut,
La divergence entre les grands singes et l'homme est un des sujets les plus discutés de la paléontologie humaine, probablement car il touche directement à nos origines. Les données permettant d'appréhender cette séparation sont fournies par toute une série de disciplines allant de la paléontologie, la géologie, la sédimentologie à la biologie moléculaire. Car il faut, en effet, resituer cette question évolutive dans un cadre bio-éco-géographique plus vaste, plutôt que de se limiter à un cadre anatomique. Les résultats des différents domaines ne concordent pas toujours, c'est ainsi souvent le cas de la biologie moléculaire et de la paléontologie, car les données néontologiques ne prennent pas la dimension essentielle de l'évolution, la quatrième dimension : le temps. L'étude des grands singes et des hommes actuels nous permet de clarifier les relations de parenté, mais le tempo de leur histoire ne nous est fourni que par la paléontologie. Les données de terrain très fructueuses ces dix dernières années nous obligent à remonter au-delà de 6-7 millions d'années, pour comprendre la manière dont la lignée des grands singes s'est isolée de celle de l'homme. Quelles sont ces nouvelles découvertes? Quels sont les nouveaux enjeux? C'est à ces questions que nous allons essayer de répondre dans la suite de cet exposé.
L'apport de la biologie moléculaire
La phylogénie en question
Les molécularistes et les paléontologues s'accordent aujourd'hui sur le fait que les grands singes asiatiques sont des parents relativement éloignés de nous, alors que leurs cousins africains semblent nous être plus proches ; mais au sein de ces derniers, peut-on isoler un genre une espèce plus privilégiée? En d'autres termes, le chimpanzé est-il notre plus proche cousin ? Est-ce le bonobo (ou chimpanzé nain) ? Ou bien l'ensemble gorille-chimpanzé ? Ou bien les chimpanzés, les gorilles et les hommes sont-ils aussi éloignés les uns des autres ? Selon les méthodes d'analyses, il apparaît que tous ces schémas sont possibles. Toutefois, certains auteurs ont largement médiatisé un rapprochement exclusif chimpanzés-hommes. Ceci serait conforté par les études sur l'ADN et l'ADN mitochondrial, alors que d'autres travaux révèlent des branchements différents. Ce qui reste sûr aujourd'hui est que les plus proches parents de l'homme sont africains et que leur ancêtre est, lui aussi, plus vraisemblablement africain.
L'horloge moléculaire
Le concept d'horloge moléculaire est basé sur la constatation que la mesure des divergences des séquences d'acides aminés est corrélée au temps. Les changements sont censés s'opérer à des rythmes constants à partir d'une date de divergence paléontologique donnée (soit celle des ruminants, soit celle des cercopithèques, etc.) ; ce n'est donc pas une méthode indépendante. Or, selon les auteurs, ou selon les groupes utilisés pour calibrer, les résultats sont très différents et on a obtenu des dates variant de 2 millions d'années à plus de 15 millions d'années pour la dichotomie hommes/grands singes. Toutefois, il a été démontré que l'horloge moléculaire ne marche pas, en fait, à vitesse constante. Le taux auquel les changements sont incorporés dans les populations varient en fonction des temps de génération, l'isolation génétique etc. C'est pourquoi, l'horloge est différente entre les éléphants et les souris, il est évident que la souris se reproduisant plus vite, le renouvellement génétique est plus rapide. Par ailleurs, il y a une variation au sein d'une même espèce. La même chose est vraie au sein des primates si on compare des lémuriens ou des chimpanzés. Enfin, il apparaît que sur de longues périodes, l'horloge devient imprécise. L'horloge moléculaire ne marche pas donc pas à la même vitesse dans tous les groupes de mammifères et pour dater les divergences, il convient donc d'utiliser les données temporelles fournies par les fossiles.
Les grands singes et leurs caractères de vie.
Dimorphisme sexuel
Les grands singes de grande taille se caractérisent généralement par de forts dimorphismes de taille et de morphologie liés au sexe. Un des caractères les plus utilisés chez les primates est la canine. Chez les mâles, la racine est massive et a pratiquement la même taille que la base de la couronne. Chez les femelles, la racine plus petite est rétrécie à la base de la couronne. Ce caractère s'observe chez les grands singes actuels et fossiles. Par ailleurs, chez les mâles, les racines étant beaucoup plus grandes, le museau est gonflé et aussi plus projeté vers l'avant, ce qu'on appelle le prognathisme. Quelquefois, cette projection est si importante que la morphologie faciale des mâles et des femelles est aussi très différente. C'est ce qui rend souvent l'interprétation des fossiles isolés difficile. C'est le cas notamment du fameux Kenyapithèque du Kenya considéré longtemps comme un hominidé ancien car sa canine était petite et sa face peu projetée. Or, la une nouvelle études de ces matériels a montré que les spécimens incriminés appartenaient en fait à des individus femelles et Kenyapithecus était une forme éteinte de grand singe, pas placée en position particulière dans notre arbre phylogénétique. La même chose est arrivée avec les Ramapithèques asiatiques. Mais il est intéressant de constater que de nombreux spécimens sensés être nos ancêtres étaient en fait des femelles de grands singes et que les ancêtres de grands singes étaient de mâles... ! C'est le cas typique du groupe des Sivapithèques et Ramapithèques: les premiers ont été considérés comme des ancêtres des orangs-outans et les Ramapithèques, ancêtres de l'homme. Toutefois, lorsque les études sur le dimorphisme sexuel ont été développées au début des années 1980, on s'est rendu compte que les ramapithèques étaient les femelles des sivapithèques, ancêtres des grands singes de Bornéo et Sumatra. Cela allait même plus loin, car le genre Sivapithecus ayant été créé bien avant que celui de Ramapithecus, ce dernier nom devait être abandonné. Les ramapithèques qui avaient eu leur heure de gloire dans les années 1960 à 1980, disparaissaient du paysage paléontologique par le coup du dimorphisme sexuel.
Alimentation
Les primates actuels sont parmi les mammifères les plus diversifiés dans leur alimentation. Ayant accès à toutes les strates des canopées, comme au milieu terrestre, ils se nourrissent de feuilles, et/ou de fruits, et/ou de viande. Il n'est pas rare que les chimpanzés mangent des petites antilopes ou des petits cercopithèques. La morphologie dentaire observée reflète le mode d'alimentation le plus fréquent, mais un animal peut de temps à autres adapter son régime à ce que lui offre son environnement. Les gorilles sont inféodés à des milieux forestiers et se nourrissent de végétaux variés, herbacées et fruits. Le régime alimentaire peut être déduit non seulement des dents, mais aussi des os maxillaire et mandibulaire et de leurs insertions musculaires. Sur l'anatomie des dents, la morphologie des cuspides est assez typée chez les chimpanzés avec des tubercules placés à la périphérie de la couronne et montrant un grand bassin central ; et chez les gorilles avec des tubercules placés à la périphérie mais plus acérés et un bassin central moins élargi. Chez l'homme, qui est un hominoïde à part entière, les tubercules sont globuleux, assez bas et plus centraux. Un autre aspect de la morphologie dentaire concerne l'émail : la variation de son épaisseur reflète également la qualité de ce que l'animal ingère ; ainsi si l'animal consomme plus fréquemment des fruits, l'émail est plus fin et s'il consomme des aliments plus coriaces, l'épaisseur de l'émail est plus épais. En gros, cela semble vrai, mais il faut aussi prendre en compte la surface triturante de la dent, sa croissance et donc sa taille. Les replis de l'émail plus prononcé chez les chimpanzés nous apportent aussi des informations sur le style de nourriture qu'ingurgitent les grands singes. On voit tout l'intérêt de bien comprendre les morphologies actuelles pour déduire des interprétations sur les fossiles.
Locomotion
Les modes de locomotion sont aussi très diversifiés chez les grands singes puisqu'ils varient de la suspension, au grimper vertical, marche sur les branches sur les quatre pattes arrière ou sur les deux pattes arrière. Mais les grands singes pratiquent aussi une marche particulière appelée le knuckle-walking, littéralement la marche sur l'articulation des phalanges antérieures repliées.
C'est le mode classique de déplacement des chimpanzés, qui est un peu modifié chez les gorilles, beaucoup plus lourds. Le mode de déplacement est lié en grande part à la taille de l'animal : ainsi, un gorille mâle de plus de 200 kgs peut difficilement se suspendre aux branches d'arbres, alors que le petit beaucoup plus léger en sera capable. Mais aucun de ces grands singes n'est assez léger pour pratiquer le déplacement acrobatique adopté par les gibbons d'Asie du Sud-Est. Un mode de déplacement utilisé par tous les grands singes plus ou moins fréquemment ou plus ou moins occasionnellement est la marche bipède. Aujourd'hui, le seul hominoïde capable de se déplacer pour la plus grande partie de son temps sur ses deux pattes arrière est l'homme. L'adaptation à la bipédie permanente est un des caractères qui est généralement utilisé pour définir le genre Homo. Chez les fossiles, on observe des bipédies différentes de celles de l'homme actuel, celle des Oréopithèques de Toscane étant probablement la plus éloignée de la nôtre, celle des Australopithèques en étant la plus proche. Les paléontologues n'ont pas à leur disposition tous les ligaments, muscles, etc... , mais l'os enregistre le mouvement le plus fréquemment réalisé ; et par comparaison avec les animaux actuels on peut reconstituer des types de mouvements, puis des associations de mouvements qui débouchent sur des scénarios locomoteurs. Pendant près d'un siècle, les anthropologues ont focalisé leurs travaux sur les restes crâniens et dentaires, parties nobles du squelette pour reconstituer les scénarios de nos origines, mais depuis la fin des années 1970, on s'aperçoit que les modes de locomotion apporte eux aussi des informations à cette quête, et ils sont aujourd'hui considérés comme des éléments à part entière. En fait, la reconstitution des modes locomoteurs passés est essentielle.
Les grands singes fossiles
Les grands singes fossiles sont connus dès l'Oligocène supérieur en Afrique orientale et sont représentés par quelques pièces dentaires attribuées à Kamoyapithecus. Mais c'est au Miocène inférieur que les grands singes vont s'épanouir en Afrique. Si pendant longtemps, on les a cru confinés à l'Afrique orientale, on les a retrouvés au début des années 90 en Egypte, puis en Afrique du Sud en 1996. Les restes extérieurs à l'Afrique orientale sont très peu nombreux : un humérus en Egypte au Wadi el Moghara et une demi-dent supérieure dans la mine de diamants de Ryskop en Afrique du Sud. En raison de leur faible nombre, ils n'ont pas pu être nommés formellement.
En Afrique orientale, par contre, on connaît de très nombreux grands singes de grande taille (dont certains équivalents à un gorille) et de petite taille (proche de celle des gibbons). Nous nous focaliserons sur ceux de grande taille parmi lesquels nous recherchons nos ancêtres.
Les plus connus des grands singes de la période de 22 à 17 Millions d'années environ sont les Proconsul. Très bien représentés au Kenya et en Ouganda par plusieurs formes qui ont la taille des chimpanzés et colobes actuels. Ce sont des grands singes généralisés par leur dentition et leur locomotion. Probablement adaptés à un régime plutôt frugivore, ils habitaient dans des environnements de forêt sèche où ils se déplaçaient à quatre pattes sur les branches, ou au sol. Ces reconstitutions sont basées sur les restes de plantes, de grands mammifères, de micromammifères et ceux d'escargots fossiles, notamment des très riches gisements de l'île de Rusinga au Kenya.
A la même époque les Ugandapithecus, de la taille du gorille, vivaient sur les pentes des volcans de Napak en Ouganda et à Songhor au Kenya. Assez lourds, ils vivaient probablement en partie au sol, mais ils pratiquaient également un grimper vertical. Leurs canines présentent un caractère tout particulier : le sommet de la dent est en forme de lame plutôt que conique. Leurs dents assez massives suggèrent qu'ils se nourrissaient de nourritures assez coriaces. Les Ugandapithèques sont connus jusqu'à la base du Miocène moyen (16-17 Millions d'années) en Afrique orientale, et spécialement sur le gisement de Moroto en Ouganda où ils côtoient les Afropithèques, de taille plus modeste, découverts également sur la rive occidentale du Lac Turkana au Kenya. Entre 17 et 12 millions d'années les grands singes connaissent un second buissonnement avec les Turkanapithèques du Lac Turkana, les Nacholapithèques des Collines Samburu. Dans les gisements de l'île de Maboko on trouve les Kenyapithèques, dont l'espèce présente à Fort Ternan ( Kenyapithecus wickeri) sera considérée, dès sa découverte, comme un hominidé ancien. Cependant, les caractères utilisés à l'époque (petite canine, face plate, émail épais) se sont avérés, pour les premiers, des caractères de dimorphisme sexuel et, pour le dernier, un caractère classique des grands singes du Miocène moyen dont les l'alimentation est basée sur des végétaux plutôt durs. Le Kenyapithèque de Fort Ternan avait aussi été considéré comme un hominidé sur la base de présence de galets utilisés trouvés avec les fossiles. Toutefois, ces cailloux « utilisés » se sont avérés être des pierres de lave brisés naturellement. Par ailleurs, on sait aujourd'hui que d'autres primates utilisent des outils ou manipulent et cela ne leur donne pas automatiquement le statut d'hominidé.
Après avoir longtemps été considérés comme des animaux typiquement est-africains, les grands singes voyaient leur aire de répartition considérablement augmentée par la découverte d' Otavipithecus namibiensis au nord-est de la Namibie. Ils avaient toutefois été signalés en 1975 en Arabie saoudite qui, à l'époque où ils vivaient, était rattachée à l'Afrique orientale. L'Otavipithèque ne ressemble à aucun des grands singes classiques est-africains de l'époque, par sa mâchoire étroite, ses dents aux cuspides gonflées, mais cela n'est pas surprenant car il vivait dans une région très excentrée, par rapport à celle où vivaient les autres grands singes de la même époque.
C'est probablement vers ce moment-là que les grands singes vont émigrer vers l'Eurasie; ainsi, on les retrouve en France, en Espagne, en Hongrie, en Grèce, en Inde, au Pakistan, en Turquie, en Chine... où ils prennent les noms de Dryopithèques, Ankarapithèques, Sivapithèques, Ouranopithèques, Lufengpithèques, etc... Certains d'entre eux, bien que considérés par plusieurs auteurs comme des ancêtres potentiels des Hominidés, semblent plus probablement se rapprocher des grands singes asiatiques modernes. Les caractères utilisés pour en faire des Hominidés se sont avérés être souvent des caractères hérités des grands singes africains antérieurs et non pas dérivés d'Hominidés, et dans certains cas dérivés d'Orangs-outans ou même encore liés au dimorphisme sexuel observé classiquement chez les grands singes actuels et fossiles.
Le trou noir- la divergence
Le trou noir correspond à cette période pendant laquelle nous ne connaissions pratiquement rien au début des années 1990 entre les grands singes du Miocène et les premiers Hominidés avérés, les Australopithèques, c'est à dire environ entre 10-12 millions d'années et 4,2 millions d'années. A l'époque, les quelques pièces fossiles, toutes kenyennes, pouvaient se compter sur les doigts des deux mains: un fragment de maxillaire trouvé au début des années 80 dans les Samburu Hills et vieux de 9,5 millions d'années, une dent isolée dans la Formation de Lukeino datée de 6 millions d'années, un fragment d'humérus vieux de 5,1 millions d'années, un fragment de mandibule à Tabarin vieille de 4,5 millions d'années, un fragment de mandibule à Lothagam (aujourd'hui redatée à 4,2 millions d'années environ). Les nombreuses expéditions menées en Afrique depuis la dernière décennie ont pratiquement triplé le matériel connu au début des années 1990; il n'est donc pas surprenant que les scénarios de nos origines soient largement discutés. A part le maxillaire des Samburu, tous ces fossiles étaient rapportés aux Hominidés. Dans tous les scénarios évolutifs ces restes ont été considérés comme appartenant obligatoirement à des ancêtres des Australopithèque et donc des Hominidés. En fait, les chercheurs dans leur grande majorité ont focalisé leurs travaux sur les Australopithèques et toute pièce hominidée trouvée dans des niveaux plus anciens était systématiquement considérée comme un ancêtre de ceux-ci et donc des hommes. L'évolution était linéaire, ce qui malheureusement ne semble pas très biologique. En effet, jusqu'à 12 millions d'années environ, les grands singes sont largement représentés en Afrique; il faudrait donc admettre que ces derniers disparaissent pour laisser la place à une seule lignée et que celle-ci soit obligatoirement ancestrale à l'homme. Cette interprétation nie le phénomène de radiation chez les grand singes et les hominidés anciens. Vers 6 millions d'années environ, on sait que les grands groupes de mammifères sont très diversifiés et il est probable que les primates (grands singes et hommes inclus) n'ont pas échappé à la règle.
Samburupithecus
Le premier acteur dans ce trou noir est Samburupithecus; découvert au début des années 1980 dans les Samburu Hills au Kenya (mais publié seulement en 1994), il est connu exclusivement par un fragment de maxillaire portant les 2 prémolaires et les 3 molaires. Par certains aspects, il rappelle les gorilles, notamment pas la morphologie de son museau, la position de l'arcade zygomatique relativement basse et antérieure sur la mâchoire. Les tubercules de ses dents sont, en revanche, gonflés; il s'agit sans doute d'une femelle comme le suggère l'alvéole préservée de la canine qui indique que la racine de cette dernière était petite. Par ses caractères, cette pièce pourrait être considérée comme un ancêtre des grands singes et de l'homme, ou un ancêtre de gorilles, mais il faut plus de matériel pour conclure.
Ardipithecus ramidus
En 1994/1995, Ardipithecus ramidus, vieux de 4,4 millions d'années venait combler une lacune dans l'histoire de la dichotomie des grands singes et de l'homme. Découverts en Ethiopie dans la Vallée moyenne de l'Aouache, les restes attribués à cette espèce se composent de dents isolées, de quelques os postcrâniens fragmentaires un petit fragment crânien et un squelette partiel qui n'est toujours pas publié. Ces éléments furent rapportés à un hominidé, mais si certains caractères de ses canines l'en rapprochent effectivement, toute une suite d'autres l'en isolent comme l'épaisseur de l'émail dentaire ou la taille de la canine par rapport aux dents jugales. Le squelette indiquerait une adaptation à la bipédie, mais les restes publiés à ce jour ne permettent pas cette affirmation. Ardipithecus ramidus est-il un hominidé ou un grand singe? Il est bien difficile de conclure à la lueur des éléments disponibles.
Orrorin tugenensis
A l'automne 2000, une douzaine de restes dentaires, mandibulaires et postcrâniens d'un hominidé étaient trouvés dans la Formation de Lukeino au Kenya qui avait déjà livré une dent isolée en 1974. Les gisements qui ont livré les fossiles s'échelonnent dans le temps entre 6,0 et 5,7 millions d'années; le gisement le plus riche étant celui de Kapsomin situé à la base de la formation. Les dents en général sont petites, proches en taille de celles de chimpanzés et des hommes actuels, mais leur forme plus carrée les rapproche des seconds. La morphologie de la canine supérieure portant une gouttière verticale ou la première prémolaire inférieure avec ses racines décalées rappelle la morphologie observée chez les grands singes actuels et fossiles. Toutefois, les tubercules dentaires ne présentent pas les ridulations d'émail classique chez les grands singes, la morphologie de la canine inférieure est intermédiaire entre celle des grands singes et celle de l'homme, l'émail est épais, la face interne des molaires est verticale. La partie antérieure de la mandibule est droite et on n'observe aucun espace (diastème) entre la canine et la première prémolaire inférieures. L'ensemble des caractères dentaires rapprochent Orrorin des hominidés.
La découverte d'Orrorin était importante également par le fait que des restes postcrâniens étaient signalés, dont des fémurs relativement bien conservés. C'est l'étude du fémur qui a montré que Orrorin était bipède. Ceci s'exprime par un col fémoral allongé et aplati antéro-postérieurement, la position de la tête fémorale, la position des insertions musculaires, la distribution de l'os cortical (épaissi à la partie inférieure et plus mince à la partie supérieure) sur la coupe du col fémoral, et la présence en vue postérieure d'une gouttière pour le muscle obturator externus. La plupart de ces caractères sont présents chez les Australopithèques et l'homme et sont classiquement associés à la bipédie. Cependant, certaines différences d'avec les Australopithèques (en particulier, orientation de la tête fémorale, position du petit trochanter) et une meilleure ressemblance avec les hommes indiquent que cette bipédie est plus humaine que celles de Australopithèques. Cet hominidé pratiquait donc probablement habituellement la bipédie; toutefois, il n'est pas encore affranchi du milieu arboré, comme le montrent son humérus et ses phalanges de main.
Orrorin n'est pas un être petit puisque les mesures de son humérus et de son fémur indiquent qu'il était une fois et demie plus grand que Lucy, la célèbre Australopithèque de l'Afar. Cette dernière est de taille modeste, mais possède des dents assez grosses (mégadonte); en revanche, chez Orrorin, l'inverse est vrai, le corps est plus grand mais les dents plus petites (microdonte). Si Orrorin devait être un ancêtre des Australopithèques, eux-mêmes ancêtres de l'homme, il faudrait admettre que des êtres microdontes auraient donné naissance à des mégadontes, qui eux-mêmes auraient donné naissance à des microdontes. Ces aller-retours anatomiques qui touchent à la fois le système masticateur et le système locomoteur semblent douteux et c'est pour cela que nous considérons les Australopithèques comme une branche à part de notre famille. Lors de sa découverte en 2000, Orrorin était le premier Hominidé connu antérieur à 5 millions d'années et sa présence si ancienne remettait en cause les données moléculaires en suggérant une dichotomie entre les grands singes et l'homme très ancienne (bien antérieure à 6 millions d'années).
Ardipithecus ramidus kadabba
Le débat sur nos origines était relancé en juillet 2001 avec la publication d'une sous-espèce d'Ardipithèque, Ardipithecus ramidus kadabba, découverte en Ethiopie dans des niveaux vieux de 5,7 à 5,2 millions d'années. Elle est représentée par des dents et os isolés (notamment fragment d'humérus et phalanges du pied et de la main). Elle se différencie des grands singes actuels par la tendance des canines à être incisiformes et la morphologie générale de ces dernières; mais, elle s'isole également d' Ardipithecus ramidus ramidus par la morphologie des P3 et M3 supérieures et de la canine inférieure. Les caractères des éléments post-crâniens rappellent ceux des grands singes et de certains spécimens de Hadar et suggéreraient des adaptations à la vie arboricole. Même si selon les auteurs, on peut considérer cette sous-espèce d'Hominoïde comme un Hominidé, il n'en reste pas moins qu'un certains nombre de caractères rappellent les grands singes et que les différences d'avec l'autre sous-espèce méritent clarification.
Sahelanthropus tchadensis
Puis, un an après la découverte éthiopienne étaient publiés les restes d'un hominoïde vieux de 6 à 7 millions d'années, trouvés au Tchad, très loin à l'Ouest de la fameuse faille est-africaine. La pièce la plus médiatique est un crâne légèrement écrasé rapporté par ses inventeurs à un Hominidé sur la base en particulier de la petite taille de la canine, le mode d'usure de cette dernière, l'aplatissement de la face, la position dite « plus antérieure » du foramen magnum. Selon les auteurs, le bourrelet sus-orbitaire très massif indiquerait que le crâne appartenait à un individu mâle. Les autres caractères incluent entre autres: des dents jugale (molaires et prémolaires basses), l'émail intermédiaire en épaisseur entre celui des chimpanzés et des Ardipithèques, une morphologie supra-orbitaire robuste (probablement mâle selon les auteurs), un plancher nuchal plat et des insertions musculaires puissantes dans la région nuchale.
La petite canine n'est pas un caractère d'Hominidé sensu stricto comme signalé plus haut; en effet, chez les grands singes miocènes et modernes, la taille de la canine est le plus souvent l'expression du dimorphisme sexuel. La canine du mâle étant beaucoup plus développée, il s'ensuit un gonflement de la région faciale qui reçoit la racine de la dent, alors que chez la femelle, le gonflement est réduit en liaison avec une racine de taille plus modeste; d'où l'aspect plus plat de la face.
La taille du bourrelet sus-orbitaire n'est pas classiquement utilisé pour sexer des crânes isolés. Chez les chimpanzés ou les gorilles actuels, le bourrelet sus-orbitaire apparaît fort chez les mâles, comme chez les femelles au sein d'une même population; il est en général un peu plus fort chez les mâles. Sur un crâne isolé, il est très difficile de déterminer le sexe de l'individu à partir de ce seul caractères. En dehors du fait que la position antérieure du foramen magnum n'est pas confirmée, il faut être prudent car celle-ci n'est pas liée exclusivement à la bipédie, elle aurait, pour certains, un lien avec le développement cérébral Parmi les caractères décrits, certains semblent rapprocher plus volontiers la pièce des grands singes : aplatissement du plancher nuchal, systèmes des crêtes postérieures et le spécimen, probablement femelle n'apparaît pas très différent de celui des grands singes actuels, en particulier des gorilles. Si cette hypothèse s'avérait confirmée, cela rendrait la découverte tchadienne encore plus intéressante scientifiquement, car elle commencerait à combler l'immense lacune de l'histoire des grands singes africains entre 12 millions d'années et aujourd'hui.
L'origine de l'homme : une histoire de climat ?
Si on veut comprendre l'histoire de nos origines, on ne peut pas se limiter à l'étude des modifications anatomiques de nos ancêtres potentiels. Ces derniers ont vécu dans un environnement qui s'est transformé au cours des temps géologiques en liaison avec les modifications climatiques, géographiques, tectoniques et autres. Un vieux mythe qui encombre encore certains de nos ouvrages est la naissance de l'homme et de sa bipédie dans un milieu ouvert de savane. Or, les dernières données suggèrent que le milieu dans lequel vivait Orrorin ou ses parents Ardipithecus était plutôt humide. En particulier, dans l'environnement d' Orrorin, les colobes et les impalas dominaient la faune; ces espèces ne vivent pas en milieu ouvert : les colobes sont des animaux très arboricoles et les impalas vivent plutôt dans des fourrés. D'où probablement les adaptations à la vie arboricole encore bien marqués chez eux comme chez les premiers australopithèques.
Une hypothèse séduisante a été proposée par Coppens au début des années 1980 : la fameuse « East Side Story ». Dans cette hypothèse éco-climatico-géographique, le rift jouait un rôle majeur: des grands singes auraient été largement distribués en Afrique au Miocène, puis vers 8 millions d'années, une réactivation de la faille aurait engendré la coupure en deux de cette population ancestrale, l'une à l'Ouest aurait donné les grand singes actuels africains restés inféodés au milieu forestier et l'autre aurait évolué vers l'homme dans un milieu plus sec (mais pas forcément de savane sèche, ni de désert). Toutefois, vers 8 millions d'années, il y a une modification du climat à l'échelle du monde. L'établissement de la calotte polaire arctique a entraîné le mouvement vers le Sud des ceintures climatiques mondiales, affectant ainsi la température de l'eau de océans, la répartition des faunes et leur composition. Les grands singes faisant partie de cette faune n'ont probablement pas échappé à ce grand remaniement. L'événement a été ressenti à l'échelle du globe de l'Amérique à l'Europe en passant par l'Afrique. C'est à cette époque que se met en place le Sahara. Le changement faunique a aussi coïncidé avec l'effondrement du rift et des changements à l'échelle locale ont pu avoir lieu. Si l'hypothèse de l'East Side Story a souvent été caricaturée, elle n'en demeure pas moins valide dans l'état actuel de nos connaissances d'un point de vue chronologique et climatique.
Quel(s) ancêtre(s)
Selon certains auteurs, les hominidés antérieurs à 3,5 millions d'années sont les ancêtres des Australopithèques, eux-mêmes ancêtres des hommes. Les découvertes réalisées récemment dans le Miocène supérieur et le Pliocène suggèrent que la diversité des formes a été plus importante et en fait, il semble bien qu'il y ait eu une lignée mégadonte Australopithèque qui s'est éteinte vers 1,4 Millions d'années avec peut-être certains ardipithèques à sa base et une lignée plus microdonte avec Orrorin, Praeanthropus et les Homo anciens. L'origine de ces lignées est à rechercher au-delà de 6 millions d'années et peut-être jusqu'à 12-13 Millions d'années. Qui sont les ancêtres des grands singes africains modernes ? Des fossiles découverts récemment au Kenya suggèrent que des formes proches des chimpanzés auraient pu être présents dès 12,5 millions d'années dans la Formation de Ngorora, Certains Ardipithèques en seraient-ils les descendants? Une dent fragmentaire de 6 millions d'années trouvée au Kenya semble proche des gorilles et à la même époque ces derniers auraient pu être au Tchad. Quoiqu'il en soit, il apparaît que la dichotomie entre les grands singes africains et l'homme est plus ancienne que ne le suggèrent les données moléculaires et que la découverte de tout jalon sur la lignée des premiers sera un apport essentiel à la compréhension des autres. Mais où se situe l'origine des hominidés ? est-elle donc à l'Est ? ou ailleurs ? Si on en croit l'Abbé Breuil, le berceau est à roulettes. Si on s'en tient aux données actuelles, l'Afrique orientale semble renfermer les plus anciennes traces d'hominidés. Si le matériel tchadien était confirmé dans son statut d'hominidé, l'Afrique centrale tiendrait peut-être le flambeau. Mais finalement, cela n'a pas grande importance lorsqu'on réalise que 3% peut-être du continent africain sont aujourd'hui prospectés. Nos scénarios sont forcément voués à changer. En revanche, on peut affirmer aujourd'hui que des êtres bipèdes très anciens sont connus vers 6 millions d'années en Afrique et qu'ils vivaient dans un milieu plus humide qu'on ne le pense généralement.
Bibliographie
M. Brunet, F. Guy, D. Pilbeam, H. Mackaye, A. Likius, D. Ahounta, A. Beauvilain, C. Blondel, H. Bocherens, J-R. Boisserie, L. De Bonis, Y. Coppens, J. Dejax, C. Denys, P. Duringer, V. Eisenmann, G. Fanone, P. Fronty, D. Geraads, T. Lehmann, F. Lihoreau, A. Louchar, A. Mahamat, G. Merceron, G. Mouchelin, O. Otero, P. Campomanes, M. Ponce De Leon, J-C. Rage, M. Sapanet, M. Schuster, J. Sudre, P. Tassy, X. Valentin, P. Vignaud, L. Viriot, A. Zazzo, C. Zollikofer, « A new hominid from the Upper Miocene of Chad, Central Africa », Nature, 418, 145-151, 2002
Y. Coppens, « Hominoïdés, Hominidés et Hommes », La Vie des Sciences, Comptes rendus, série générale, 1, 459-486, 1984
Y. Coppens & B. Senut (Eds.), Origine(s) de la bipédie chez les Hominidae, Cahiers de Paléoanthropologie, Paris, CNRS, 1991
H. Ishida, M. Pickford, « A new Late Miocene hominoid from Kenya : Samburupithecus kiptalami gen et sp. nov », C. R Acad. Sci. Paris, IIa , 325, 823-829, 1998
M. Pickford, H. Ishida, « Interpretation of Samburupithecus, an Upper Miocene hominoid from Kenya », C. R Acad. Sci, Paris, IIa 326, 299-306, 1998
M. Pickford, B. Senut, « The geological and faunal context of Late Miocene hominid remains from Lukeino, Kenya », C. R. Acad. Sci, Paris, sér IIa, 332, 145-152, 2001
M. Pickford, B. Senut, D. Gommery, J. Treil, Bipedalism in Orrorin tugenensis revealed by its femora. C. R. Palevol 1, 191-203, 2002
Y. Sawada, T. Miura, M. Pickford, B. Senut, T. Itaya, C. Kashine, M. Hyodo, T. Chujo, H. Fujii, « The age of Orrorin tugenensis, an early hominid from the Tugen Hills, Kenya », C. R. Palevol, 1, 293-303, 2002
B. Senut, « Les grands singes fossiles et l'origine des Hominidés : mythes et réalités », Primatologie, 1, 93-134, 1998
B. Senut, M. Pickford, D. Gommery, P. Mein, K. Cheboi, Y. Coppens, « First hominid from the Miocene (Kukeino Formation, Kenya) », C. R. Acad. Sci, Paris, série IIa, 332, 137-144, 2001
T.D. White, G. Suwa, B. Asfaw, « Australopithecus ramidus, a new species of early hominid from Aramis, Ethiopia », Nature, 371, 306-312, 1994
T.D. White, G. Suwa, B. Asfaw, « Corrigendum - Australopithecus ramidus, a new species of early hominid from Aramis, Ethiopia », Nature, 375, 88, 1995
G. WoldeGabriel, T.D. White, G. Suwa, P. Renne, J. de Heinzelin, W. K. Hart, G. Helken, « Ecological and temporal palcement of early Pliocene hominids at Aramis, Ethiopia », Nature, 371, 330-333, 1994
M. Wolpoff, B. Senut, M. Pickford, J. Hawks, « Sahelanthropus or Sahelpithecus ? », Nature, 419, 581-582.
VIDEO canal U LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Le génie génétique |
|
|
| |
|
| |
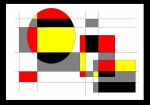
Le génie génétique
Denis Mater, Nicole Truffaut dans mensuel 342
daté mai 2001 -
Avec à peine trente ans d'existence, le génie génétique est à l'origine d'une multitude d'applications, dont certaines ont déjà fait irruption dans notre vie quotidienne. Les outils qu'il met en oeuvre ne cessent de gagner en performance, en rapidité et en disponibilité. Revue de détail...
Qu'est-ce que le génie génétique ?
N'en déplaise aux amateurs de contes des « Mille et Une Nuits » , il ne suffit pas de frotter vigoureusement un tube à essais pour voir en sortir un génie, fût-il génétique. Si la racine latine du mot ne permet pas de différencier étymologiquement un spectre sortant d'une lampe d'un jeune cadre issu d'une école d'ingénieur, c'est pourtant bien à l'ingénierie que fait référence l'expression « génie génétique ». Ainsi, au même titre que le génie civil se rapporte aux techniques mises en oeuvre par les ingénieurs pour construire des routes ou des ponts, le génie génétique regroupe l'ensemble des outils et des méthodes employés pour conférer de nouvelles propriétés aux cellules vivantes en modifiant leur matériel génétique. Ces modifications s'effectuent en l'occurrence par des combinaisons entre différentes molécules d'ADN, ce qui a valu au génie génétique l'appellation de « technologies de l'ADN recombinant ».
Le génie génétique découle initialement des avancées techniques de la biologie moléculaire, de la biochimie et de la génétique. Il tire également profit de nombreux autres domaines de la biologie, en particulier pour les méthodes de culture de cellules : la microbiologie dans le cas des bactéries et des cellules de levures, la biologie cellulaire pour les cellules végétales ou animales. Ainsi, le génie génétique peut être comparé à une boîte à outils dont chaque élément représenterait une compétence particulière issue d'un champ scientifique, parfois même extérieur à la biologie. Il constitue un élément à part entière du secteur des biotechnologies, aux côtés d'autres domaines des sciences appliquées : le génie de la fermentation, le génie enzymatique, ou encore le génie des procédés.
Dans quel contexte est-il apparu ?
Dans les années 1940, pour nombre de généticiens, l'acide désoxyribonucléique l'ADN est une molécule chimiquement trop « banale » pour constituer le support de l'information génétique. En effet, elle ne comprend que quatre types d'éléments distincts les bases adénine, cytosine, guanine et thymine : A, C, G et T tandis que les protéines, construites à partir de vingt élé-ments différents les acides aminés, semblent offrir davantage de possibilités. Mais, en 1944, reprenant des travaux de la fin des années 1920, le groupe d'Oswald Avery à l'institut Rockefeller de New York démontre qu'une forme non pathogène de pneumocoque peut acquérir un caractère virulent par simple incorporation d'ADN issu d'une forme pathogène. Les résultats de cette expérience sont suffisamment convaincants pour faire admettre à la quasi-totalité de la communauté scientifique que les caractères héréditaires sont transmis par la molécule d'ADN, et non par des protéines. L'intérêt pour la molécule s'accroît alors, et de nombreuses recherches sont initiées pour élucider sa composition et sa structure. Dans un numéro de Nature daté du 25 avril 1953, James Watson et Francis Crick présentent finalement la célèbre structure en double hélice telle qu'on la connaît aujourd'hui. Si cette découverte marque le début d'une ère nouvelle pour l'ensemble de la biologie, elle ne constitue encore que les fondations sur lesquelles reposera une quinzaine d'années plus tard le génie génétique.
La connaissance de la structure de l'ADN enclenche une série de travaux qui permettent de comprendre comment l'information génétique est stockée dans la molécule d'ADN. Le code génétique, c'est-à-dire la table de correspondance entre l'ordonnancement des bases A, C, G et T dans l'ADN et l'enchaînement des acides aminés d'une protéine, est ainsi établi. En l'espace d'une décennie, le gène acquiert une définition moléculaire et correspond désormais à un fragment d'ADN dont la séquence des bases peut être traduite en protéines par la machinerie cellulaire.
Mais, au milieu des années 1960, l'exceptionnelle longueur de la molécule d'ADN laisse penser qu'il est pratiquement impossible d'isoler spécifiquement un gène donné. Aucune technique ne permet en effet de casser de manière reproductible la molécule en courts fragments bien précis. Le concept de génie génétique reste encore inimaginable. A l'aube des années 1970, plusieurs découvertes concernant des enzymes capables d'agir directement sur l'ADN viennent bouleverser cette vision. Les outils indispensables à la « microchirurgie » de l'ADN sont vite réunis, et la porte du génie génétique s'ouvre presque instantanément.
Quels sont ses outils de base ?
Les enzymes qui agissent sur l'ADN sont les outils moléculaires indispensables du génie génétique. En particulier, certaines enzymes ont la propriété de reconnaître invariablement une même séquence d'ADN et de couper la molécule à cet endroit précis : elles sont appelées enzymes de restriction. En 1970, le groupe de Hamilton Smith aux Etats-Unis purifie pour la première fois une telle enzyme et identifie son site de restriction, c'est-à-dire la séquence qu'elle reconnaît : elle est longue de six bases. Depuis, des centaines d'enzymes de restriction ont été isolées. Leur site d'action comporte presque toujours quatre à huit bases et présente une symétrie. Pour comprendre cette dernière particularité, il faut se souvenir que la molécule d'ADN est composée de deux chaînes intimement associées par l'intermédiaire de leurs bases la double hélice. Une base A d'une chaîne s'associe toujours à une base T de l'autre chaîne, et de la même façon, une base C ne peut s'associer qu'à une base G. La séquence d'une chaîne est donc complémentaire de l'autre. Pour un site de restriction, la séquence lue dans un sens sur une chaîne est identique à la séquence lue dans le sens inverse sur l'autre chaîne. Certaines enzymes de restriction coupent le site en son milieu et produisent deux fragments dont les extrémités sont franches. Cependant, la plupart réalisent une coupure dissymétrique. Chaque fragment obtenu possède alors une chaîne qui dépasse l'autre de quelques bases. On parle dans ce cas d'extrémités cohésives voir schéma.
De nombreuses autres enzymes sont utiles au génie génétique. La ligase permet notamment de souder les extrémités franches ou cohésives de deux fragments d'ADN. Les polymérases permettent de reconstruire une chaîne d'ADN en utilisant comme modèle la séquence de la chaîne complémentaire. Elles sont notamment utilisées dans les méthodes de séquençage qui déterminent l'enchaînement des bases d'une molécule d'ADN. On les retrouve également dans la technique d'amplification en chaîne qui, connue sous le nom de « PCR » polymerase chain reaction , reproduit un fragment d'ADN à des millions d'exemplaires.
Enfin, une technique se révèle incontournable pour séparer un mélange de fragments d'ADN : l'électrophorèse. Comme toute molécule chargée, l'ADN peut se déplacer à travers un champ électrique. De plus, si on la force à traverser un support relativement dense, les fragments courts se déplacent plus rapidement que les fragments plus longs, qui se trouvent retardés. En pratique, le support est de l'agarose, un polymère qui forme un gel très consistant. Lorsqu'un mélange d'ADN est déposé dans un gel d'agarose et qu'on impose un courant électrique, les fragments migrent à travers le gel et se séparent en fonction de leur taille. L'électrophorèse terminée, il suffit d'utiliser un colorant de l'ADN pour visualiser chaque fragment individuellement. Cette technique permet, de plus, d'estimer le nombre approximatif de bases que renferme chaque fragment.
Comment manipule-t-on les gènes des micro-organismes ?
Soit un gène quelconque, porté par un fragment d'ADN, qu'on désire introduire dans une bactérie afin qu'elle se mette à fabriquer la protéine codée par ce gène. Selon les termes appropriés du génie génétique, il s'agit de cloner le gène et d'exprimer la protéine. En premier lieu, ce fragment doit être associé à un autre élément d'ADN qui permet de le « présenter » à la bactérie, comme s'il s'agissait de son propre matériel génétique. Ce type d'élément est un vecteur de clonage. Très souvent, on utilise comme vecteur un plasmide, une petite molécule d'ADN circulaire que l'on trouve naturellement chez de nombreuses bactéries. Ces plasmides sont suffisamment autonomes pour se maintenir dans la cellule bactérienne de génération en génération. Pour les expériences de génie génétique, certains plasmides ont été améliorés et optimisés par l'ajout d'éléments essentiels à leur manipulation : des sites de restriction, des séquences judicieusement positionnées pour permettre l'expression de protéines, ou des gènes particuliers appelés marqueurs de sélection. Ces marqueurs permettent par exemple aux bactéries qui abritent le plasmide de devenir résistantes à un antibiotique ou de produire un pigment bleu très caractéristique, ce qui facilite leur identification.
Choisissons un tel plasmide et coupons-le avec une enzyme de restriction. S'il ne contient qu'un exemplaire du site de restriction, le plasmide n'est alors coupé qu'une seule fois et devient linéaire, comme si l'on avait coupé un élastique d'un seul coup de ciseaux. En employant une ligase, chaque extrémité de notre fragment peut alors être soudée à chacune des extrémités du plasmide. Ce dernier reprend donc sa forme circulaire après avoir intégré le fragment étranger. Reste à expédier la construction à l'intérieur d'une bactérie : cette étape est la « transformation ». Une première solution est de traiter chimiquement l'enveloppe de la cellule pour la perméabiliser. Une autre consiste à soumettre les bactéries à un voltage de plusieurs milliers de volts durant quelques millisecondes, de manière à créer des trous dans l'enveloppe par lesquels l'ADN peut transiter : cette technique est l'électroporation. Les cellules ainsi transformées sont ensuite cultivées en boîtes de Petri sur un milieu de croissance, choisi de manière à révéler les marqueurs portés par le plasmide. Il suffit alors de sélectionner les colonies de bactéries qui correspondent aux caractéristiques recherchées.
Dans son principe, la démarche paraît relativement simple, mais la réalité expérimentale est souvent plus complexe. Le positionnement du fragment au sein du plasmide doit notamment respecter des règles très précises pour que les bactéries recombinantes produisent la protéine. Des vecteurs disponibles dans le commerce facilitent aujourd'hui la réalisation des constructions, la production et la purification de protéines.
Et chez les organismes supérieurs ?
Dans l'ensemble, les stratégies appliquées aux organismes supérieurs ne diffèrent pas fondamentalement de celles des micro-organismes. Les constructions génétiques impliquant de l'ADN végétal ou animal sont d'ailleurs réalisées dans un premier temps chez les bactéries, avant d'être finalement introduites dans les cellules de l'organisme supérieur. Alors qu'il est relativement facile de manipuler de l'ADN dans des cellules individuelles telles que les bactéries, l'approche est à l'évidence d'une tout autre envergure dans le cas d'un organisme pouvant comporter des millions de cellules. Lorsque l'on souhaite obtenir une plante ou un mammifère dont toutes les cellules sont transformées un organisme transgénique, il est donc nécessaire d'utiliser des cellules embryonnaires, seules capables de régénérer un organisme entier. Pour certaines applications, la thérapie cellulaire par exemple, on vise en revanche l'obtention de simples lignées cellulaires transgéniques et leur culture in vitro .
Contrairement aux micro-organismes, les plantes ne possèdent pas naturellement de plasmide. La transformation des végétaux constitue donc une étape critique. En s'intéressant à une bactérie du genre Agrobacterium responsable de tumeurs chez les plantes, des chercheurs belges ont découvert au milieu des années 1970 qu'elle était capable de transférer son plasmide aux plantes. Ce plasmide appelé Ti constitue aujourd'hui le vecteur incontournable pour introduire un gène dans une cellule végétale. Il est d'autant plus efficace que le gène en question s'intègre directement dans le matériel génétique de la plante, et se transmet donc de façon héréditaire.
Une autre technique, moins répandue car plus lourde à mettre en oeuvre, consiste à littéralement bombarder des cellules végétales avec des billes microscopiques recouvertes de fragments d'ADN. Il s'agit de la méthode « du canon à gène ». Pour incorporer un gène dans des cellules animales, on peut selon les cas utiliser l'électroporation ou injecter minutieusement l'ADN à l'intérieur du noyau de la cellule à l'aide d'une micropipette. Les mécanismes d'infection des virus peuvent également être mis à profit : selon cette approche, c'est le virus qui injecte son ADN dans la cellule accompagné du gène étranger. Dans tous les cas, des enzymes de recombinaison doivent intégrer le gène étranger dans le matériel génétique de la cellule pour que celui-ci soit maintenu durablement.
Pour quoi faire ?
Les technologies de l'ADN recombinant trouvent des applications aussi bien dans les secteurs médical et pharmaceutique que dans l'agrochimie, l'industrie alimentaire ou l'environnement. Par exemple, le génie génétique sert déjà à produire des antibiotiques, de l'insuline ou à fabriquer le vaccin contre l'hépatite B. Le nombre de protéines aujourd'hui fabriquées par génie génétique ne cesse d'augmenter et les fonctions qu'elles remplissent sont multiples. Certaines sont, par exemple, utilisées chez l'homme comme médicament, afin de soigner des patients atteints d'un dérèglement causé par une protéine déficiente. L'hormone de croissance humaine a été l'une des premières à bénéficier du génie génétique : auparavant, plusieurs centaines de glandes hypophysaires prélevées sur des cadavres étaient nécessaires pour obtenir quelques milligrammes d'hormone, induisant un risque important de contamination de l'extrait par des virus et autres prions.
Dans le monde végétal, le génie génétique se présente comme une alternative aux pratiques ancestrales de sélection des variétés. Alors que l'agronome tente d'améliorer un caractère « au hasard » des croisements, le génie génétique se propose de faire émerger directement ce caractère, voire un caractère qui n'existe pas naturellement chez les plantes. C'est le cas du désormais célèbre « maïs Bt » dans lequel a été introduit le gène d'une bactérie du sol, qui, en exprimant une toxine insecticide, permet de défendre la plante contre les ravageurs. Autre exemple, plus récent : des gènes de jonquille et de bactérie ont été introduits dans un riz qui produit ainsi du carotène, un précurseur de la vitamine A. Mais chacun sait que ces innovations ne cessent d'alimenter de vives controverses sur les bénéfices réels des organismes génétiquement modifiés !u Quelle évolution pour le génie génétique ?
Sur un plan technique, les outils du génie génétique se sont considérablement enrichis et améliorés depuis une décennie. La PCR, imaginée il y a quinze ans, comporte aujourd'hui des dizaines de variantes, et ses applications sont multiples : diagnostic de maladies génétiques, détection de virus tels que celui du sida ou recherche d'organismes génétiquement modifiés dans l'alimentation. Une méthode élaborée en 1975 par Edwin Southern, l'hybridation moléculaire, qui repose sur la complémentarité de deux chaînes d'ADN, est aujourd'hui réalisée grâce à « des puces à ADN ». Avec l'apport des techniques de fabrication de circuits électroniques, cette technologie permet d'analyser des milliers de fragments génétiques en un minimum d'opérations. On l'aura compris, l'automatisation des techniques et l'informatique constituent de puissants moteurs de l'évolution du génie génétique, comme en témoigne le nombre de génomes séquencés en l'espace de deux ou trois ans.
Dans les laboratoires publics et les sociétés de biotechnologies, de nombreux programmes de recherche se développent depuis plusieurs années, parfois d'une envergure titanesque comme le séquençage du génome de l'homme ou de la drosophile. La séquence de nos gènes permettra-t-elle pour autant de comprendre les dérèglements génétiques, les diagnostiquer et les réparer grâce à la thérapie génique ? Par ailleurs, de nombreuses molécules sont déjà produites chez les végétaux par le biais du génie génétique. Les plantes sont-elles en passe de devenir les usines pharmaceutiques de demain ? Certains les voient supplanter le pétrole comme matière première pour produire le carburant, des huiles, des lubrifiants ou des matières plastiques biodégradables.
Avec quels risques ?
La première construction génétique a été réalisée en 1972 en associant l'ADN d'un virus du singe et un fragment de plasmide bactérien. Paul Berg, l'auteur de ces travaux récompensés par le prix Nobel de chimie en 1980, s'est lui-même très vite interrogé sur les dangers de telles constructions : ces techniques de recombinaison ne sont-elles pas susceptibles de faire apparaître de nouvelles bactéries virulentes pour l'homme ? Une conférence présidée par Paul Berg fut ainsi organisée à Asilomar en 1975 afin de définir des règles de sécurité en matière de génie génétique. Alors que ces réflexions étaient à l'époque restreintes à la seule communauté scientifique, le débat s'est depuis généralisé et concerne aussi bien les acteurs économiques, politiques que les consommateurs. Notamment, l'arrivée programmée des organismes génétiquement modifiés dans les champs et les assiettes a fait transparaître de nouvelles interrogations : le risque environnemental, avec la dissémination de gènes dans la nature, l'apparition d'espèces résistantes ou la réduction de la biodiversité ; le risque alimentaire d'ordre toxicologique ou allergique. En France, deux commissions d'experts se répartissent le travail d'évaluation, de définition et de contrôle de tels risques : la Commission du génie biomoléculaire et la Commission du... génie génétique !
DOCUMENT larecherche LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
LE MÃCANISME DE REPLIEMENT DES MOLÃCULES |
|
|
| |
|
| |
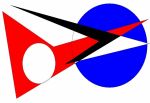
LE MÉCANISME DE REPLIEMENT DES MOLÉCULES
Ce terme désigne le mécanisme par lequel une macromolécule linéaire (par macromolécule on entend un enchaînement linéaire de motifs moléculaires) acquiert une structure tridimensionnelle. Un tel mécanisme est particulièrement important dans le domaine du vivant car une fois synthétisées c'est par ce processus que les protéines acquièrent la structure qui va leur permettre de remplir une fonction précise au sein de la cellule. Ce mécanisme a attiré l'attention de nombreux chercheurs du fait de son importance cruciale en biologie mais aussi du fait du formidable problème computationnelle que représente la prédiction de la structure tridimensionnelle de ces objets à partir de leur structure chimique linéaire. Nous rappellerons les notions essentielles nécessaires à la compréhension de ce mécanisme (atomes, liaisons chimiques, molécules, macromolécules) ainsi que les principaux mécanismes biologiques mis en jeu lors de la synthèse d'une protéine. Nous passerons ensuite en revue les principales forces mises en jeu lors du repliement (essentiellement les forces électrostatiques, l'effet hydrophobe, la liaison hydrogène) puis nous décrirons les principaux outils expérimentaux permettant d'aborder l'étude de ce phénomène. Quelques expériences seront présentées ainsi que la situation actuelle du problème.
LE MÉCANISME DE REPLIEMENT DES MOLÉCULES
Textede la 595ème conférencede l'Universitéde tous les savoirs prononcée le 17 juillet 2005
ParDidier Chatenay: « Le mécanisme de repliement des molécules »
Le thème de cette conférence vous fera voyager aux confins de plusieurs sciences : physique, chimie et biologie bien évidemment puisque les macromolécules dont nous parlerons sont des objets biologiques : des protéines.
Le plan de cet exposé sera le suivant :
- Quelques rappels sur la structure de la matière (atomes, liaisons chimiques, molécules, macromolécules).
- Qu'est-ce qu'une protéine (la nature chimique de ces macromolécules, leur mode de synthèse, leurs structures et leurs fonctions biologiques) ?
- Le problème du repliement (d'où vient le problème, paradoxe de Levinthal).
- Résolution du paradoxe et interactions inter intra moléculaires (échelles des énergies mises en jeu).
Rappels sur la structure de la matière.
La matière est constituée d'atomes eux-mêmes étant constitués d'un noyau (composé de particules lourdes : protons, chargés positivement, et neutrons non chargé) entouré d'un nuage de particules légères : les électrons chargés négativement. La taille caractéristique d'un atome est de 1 Angström (1 Angström est la dix milliardième partie d'un mètre ; pour comparaison si je prends un objet de 1 millimètre au centre d'une pièce, une distance dix milliards de fois plus grande représente 10 fois la distance Brest-Strasbourg).
Dans les objets (les molécules biologiques) que nous discuterons par la suite quelques atomes sont particulièrement importants.
Par ordre de taille croissante on trouve tout d'abord l'atome d'hydrogène (le plus petit des atomes) qui est le constituant le plus abondant de l'univers (on le trouve par exemple dans le combustible des fusées). L'atome suivant est le carbone ; cet atome est très abondant dans l'univers (on le trouve dans le soleil, les étoiles, l'atmosphère de la plupart des planètes. Il s'agit d'un élément essentiel comme source d'énergie des organismes vivants sous forme de carbohydrates). On trouve ensuite l'azote, constituant essentiel de l'air que nous respirons. L'atome suivant est l'oxygène, également constituant essentiel de l'air que nous respirons, élément le plus abondant du soleil et essentiel au phénomène de combustion. Le dernier atome que nous rencontrerons est le souffre que l'on trouve dans de nombreux minéraux, météorites et très abondants dans les volcans.
Les atomes peuvent interagir entre eux pour former des objets plus complexes. Ces interactions sont de nature diverse et donnent naissance à divers types de liaisons entre les atomes. Nous trouverons ainsi :
- La liaison ionique qui résulte d'interactions électrostatiques entre atomes de charges opposées (c'est par exemple ce type de liaison, qu'on rencontre dans le chlorure de sodium, le sel de table). Il s'agit d'une liaison essentielle pour la plupart des minéraux sur terre, comme par exemple dans le cas des silicates, famille à laquelle appartient le quartz.
- Un autre type de liaison est la liaison covalente. Cette liaison résulte de la mise en commun entre 2 atomes d'un électron ou d'une paire d'électrons. Cette liaison est extrêmement solide. Ce type de liaison est à l'origine de toute la chimie et permet de former des molécules (l'eau, le glucose, les acides aminés). Ces acides aminés sont constitués de carbone, d'azote, d'hydrogène et d'oxygène. Dans ces molécules on retrouve un squelette qu'on retrouve dans tous les acides aminés constitué d'un groupement NH2 d'un côté et COOH de l'autre ; la partie variable est un groupement latéral appelé résidu. Un exemple d'acide aminé est constitué par la méthionine qui d'ailleurs contient dans son résidu un atome de soufre. La taille caractéristique des distances mises en jeu dans ce type de liaison n'est pas très différente de la taille des atomes eux-mêmes et est de l'ordre de l'angström (1.5 Angström pour la liaison C-C, 1 Angström pour une liaison C-H).
Ces liaisons ne sont pas figées et présentent une dynamique ; cette dynamique est associée aux degrés de libertés de ces liaisons tels que par exemple un degré de liberté de rotation autour de l'axe d'une liaison C-C. Ces liaisons chimiques ont donc une certaine flexibilité et aux mouvements possibles de ces liaisons sont associés des temps caractéristiques de l'ordre de la picoseconde (mille milliardième partie de seconde) ; il s'agit de temps très rapides associés aux mouvements moléculaires.
A ce stade nous avons 2 échelles caractéristiques importantes :
- 1 échelle de taille : l'angström
- 1 échelle de temps : la picoseconde.
C'est à partir de cette liaison covalente et de petites molécules que nous fabriquerons des macromolécules. Un motif moléculaire, le monomère, peut être associé par liaison covalente à un autre motif moléculaire ; en répétant cette opération on obtiendra une chaîne constituée de multiples monomères, cette chaîne est une macromolécule. Ce type d'objets est courant dans la vie quotidienne, ce sont les polymères tels que par exemple :
- le polychlorure de vinyle (matériau des disques d'antan)
- le polytétrafluoroéthylène (le téflon des poêles)
- le polyméthacrylate de méthyl (le plexiglas)
- les polyamides (les nylons)
Quelle est la forme d'un objet de ce type ? Elle résulte des mouvements associés aux degrés de libertés discutés plus haut ; une chaîne peut adopter un grand nombre de conformations résultant de ces degrés de liberté et aucune conformation n'est privilégiée. On parle d'une marche aléatoire ou pelote statistique.
Les protéines
Quelles sont ces macromolécules qui nous intéressent particulièrement ici ? Ce sont les protéines qui ne sont rien d'autre qu'une macromolécule (ou polymère) particulière car fabriquée à partir d'acides aminés. Rappelons que ces acides aminés présentent 2 groupes présents dans toute cette famille : un groupe amine (NH2) et un groupe carboxyle (COOH) ; les acides aminés diffèrent les uns des autres par la présence d'un groupe latéral (le résidu). A partir de ces acides aminés on peut former un polymère grâce à une réaction chimique donnant naissance à la liaison peptidique : le groupement carboxyle d'un premier acide aminé réagit sur le groupement amine d'un deuxième acide aminé pour former cette liaison peptidique. En répétant cette réaction il est possible de former une longue chaîne linéaire.
Comme nous l'avons dit les acides amines diffèrent par leurs groupes latéraux (les résidus) qui sont au nombre de 20. On verra par la suite que ces 20 résidus peuvent être regroupés en familles. Pour l'instant il suffit de considérer ces 20 résidus comme un alphabet qui peut donner naissance à une extraordinaire variété de chaînes linéaires. On peut considérer un exemple particulier : le lysozyme constitué d'un enchaînement spécifique de 129 acides aminés. Une telle chaîne comporte toujours 2 extrémités précises : une extrémité amine et une extrémité carboxyle, qui résultent de la réaction chimique qui a donné naissance à cet enchaînement d'acides aminés. Il y a donc une directionnalité associée à une telle chaîne. La succession des acides aminés constituant cette chaîne est appelée la structure primaire. La structure primaire d'une protéine n'est rien d'autre que la liste des acides aminés la constituant. Pour revenir au lysozyme il s'agit d'une protéine présente dans de nombreux organismes vivants en particulier chez l'homme où on trouve cette protéine dans les larmes, les sécrétions. C'est une protéine qui agit contre les bactéries en dégradant les parois bactériennes. Pour la petite histoire, Fleming qui a découvert les antibiotiques, qui sont des antibactériens, avait dans un premier temps découvert l'action antibactérienne du lysozyme ; mais il y a une grosse différence entre un antibiotique et le lysozyme. Cette molécule est une protéine qu'il est difficile de transformer en médicament du fait de sa fragilité alors que les antibiotiques sont de petites molécules beaucoup plus aptes à être utilisées comme médicament.
Pour en revenir au lysozyme, présent donc dans les organismes vivants, on peut se poser la question de savoir comment un tel objet peut être fabriqué par ces organismes. En fait, l'information à la fabrication d'un tel objet est contenue dans le génome des organismes sous la forme d'une séquence d'acide désoxyribonucléique (ADN) constituant le gène codant pour cette protéine. Pour fabriquer une protéine on commence par lire l'information contenue dans la séquence d'ADN pour fabriquer une molécule intermédiaire : l'ARN messager, lui-même traduit par la suite en une protéine. Il s'agit donc d'un processus en 2 étapes :
- Une étape de transcription, qui fait passer de l'ADN à l'ARN messager,
- Une étape de traduction, qui fait passer de l'ARN messager à la protéine.
Ces objets, ADN et ARN, sont, d'un point de vue chimique, très différents des protéines. Ce sont eux-mêmes des macromolécules mais dont les briques de base sont des nucléotides au lieu d'acides aminés.
Ces 2 étapes font intervenir des protéines ; l'ARN polymérase pour la transcription et le ribosome pour la traduction. En ce qui concerne la transcription l'ARN polymérase se fixe sur l'ADN, se déplace le long de celui-ci tout en synthétisant l'ARN messager. Une fois cet ARN messager fabriqué un autre système protéique, le ribosome, se fixe sur cet ARN messager, se déplace le long de cet ARN tout en fabriquant une chaîne polypeptidique qui formera la protéine. Il s'agit d'un ensemble de mécanismes complexes se produisant en permanence dans les organismes vivants pour produire les protéines.
Ces protéines sont produites pour assurer un certain nombre de fonctions. Parmi ces fonctions, certaines sont essentielles pour la duplication de l'ADN et permettre la reproduction (assure la transmission à la descendance du patrimoine génétique). Par ailleurs ce sont des protéines (polymérases, ribosomes) qui assurent la production de l'ensemble des protéines. Mais les protéines assurent bien d'autres fonctions telles que :
- Des fonctions de structure (la kératine dans les poils, les cheveux ; le collagène pour former des tissus),
- Des fonctions de moteurs moléculaires (telles que celles assurées par la myosine dans les muscles) ; de telles protéines sont des usines de conversion d'énergie chimique en énergie mécanique.
- Des fonctions enzymatiques. Les protéines de ce type sont des enzymes et elles interviennent dans toutes les réactions chimiques se déroulant dans un organisme et qui participent au métabolisme ; c'est par exemple le cas du mécanisme de digestion permettant de transformer des éléments ingérés pour les transformer en molécules utilisables par l'organisme.
Pour faire bref toutes les fonctions essentielles des organismes vivants (la respiration, la digestion, le déplacement) sont assurés par des protéines.
A ce stade nous avons donc introduit les objets essentiels de cet exposé que sont les protéines. Pour être complet signalons que la taille de ces protéines est très variable ; nous avons vu le lysozyme constitué d'une centaine d'acides aminés mais certaines protéines sont plus petites et certaines peuvent être beaucoup plus grosses.
Nous allons maintenant pouvoir aborder le problème de la structure et du repliement de ces objets.
La structured'une protéine
Tout d'abord quels sont les outils disponibles pour étudier la structure de ces objets. Un des outils essentiels est la diffraction des rayons X. L'utilisation de cet outil repose sur 2 étapes. La première (pas toujours la plus facile) consiste à obtenir des cristaux de protéines. Ces protéines, souvent solubles dans l'eau, doivent être mises dans des conditions qui vont leur permettre de s'arranger sous la forme d'un arrangement régulier : un cristal. C'est ce cristal qui sera utilisé pour analyser la structure des protéines qui le composent par diffraction des rayons X. A partir du diagramme de diffraction (composé de multiples tâches) il sera possible de remonter à la position des atomes qui constituent les protéines. Un des outils essentiels à l'heure actuelle pour ce type d'expérience est le rayonnement synchrotron (SOLEIL, ESRF).
Il existe d'autres outils telle que la résonance magnétique nucléaire qui présente l'avantage de ne pas nécessiter l'obtention de cristaux mais qui reste limitée à l'heure actuelle à des protéines de petite taille.
Finalement à quoi ressemble une protéine ? Dans le cas du lysozyme on obtient une image de cette protéine où tous les atomes sont positionnés dans l'espace de taille typique environ 50 Angströms. Il s'agit d'un cas idéal car souvent on n'obtient qu'une image de basse résolution de la protéine dans laquelle on n'arrive pas à localiser précisément tous les atomes qui la constituent. Très souvent cette mauvaise résolution est liée à la mauvaise qualité des cristaux. C'est l'exemple donné ici d'une polymérase à ARN. Néanmoins on peut obtenir des structures très précises même dans de le cas de gros objets.
Repliement,dénaturation et paradoxede Levinthal
Très clairement on voit sur ces structures que les protéines sont beaucoup plus compactes que les chaînes désordonnées mentionnées au début. Cette structure résulte du repliement vers un état compact replié sur lui-même et c'est cet état qui est l'état fonctionnel. C'est ce qui fait que le repliement est un mécanisme extrêmement important puisque c'est ce mécanisme qui fait passer de l'état de chaîne linéaire déplié à un état replié fonctionnel. L'importance de ce repliement peut être illustrée dans le cas d'un enzyme qui permet d'accélérer une réaction chimique entre 2 objets A et B ; ces 2 objets peuvent se lier à l'enzyme, ce qui permet de les approcher l'un de l'autre dans une disposition où une liaison chimique entre A et B peut être formée grâce à l'environnement créé par l'enzyme. Tout ceci ne peut se produire que si les sites de fixation de A et B sont correctement formés par le repliement de la longue chaîne peptidique. C'est la conformation tridimensionnelle de la chaîne linéaire qui produit ces sites de fixation.
Il y a une notion associée au repliement qui est la dénaturation. Nous venons de voir que le repliement est le mécanisme qui fait passer de la forme dépliée inactive à la forme repliée active ; la dénaturation consiste à passer de cette forme active repliée à la forme inactive dépliée sous l'influence de facteurs aussi variés que la température, le pH, la présence d'agents dénaturants tels que l'urée.
La grande question du repliement c'est la cinétique de ce phénomène. Pour la plupart des protéines où des expériences de repliement-dénaturation ont été effectuées le temps caractéristique de ces phénomènes est de l'ordre de la seconde. Comment donc une protéine peut trouver sa conformation active en un temps de l'ordre de la seconde ?
Une approche simple consiste à développer une approche simplifiée sur réseau ce qui permet de limiter le nombre de degrés de liberté à traiter ; on peut par exemple considérer une protéine (hypothétique) placée sur un réseau cubique. On peut considérer le cas d'une protéine à 27 acides aminés. On peut alors compter le nombre de conformations possibles de telles protéines ; à chaque acide aminé on compte le nombre de directions pour positionner le suivant. Sur un réseau cubique à chaque étape nous avons 6 possibilités ce qui fera pour une chaîne de 27 acides aminés 627 possibilités. Cela n'est vrai qu'à condition d'accepter de pouvoir occuper 2 fois le même site du réseau ce qui, bien sur, n'est pas vrai dans la réalité ; si on tient compte de cela on arrive en fait à diminuer quelque peu ce nombre qui sera en fait 4,727. Plus généralement pour une chaîne de N acides aminés on obtiendra 4,7N possibilités. Si on part d'une chaîne dépliée on peut alors se dire que pour trouver le « bon état replié » il suffit d'essayer toutes les conformations possibles. Cela va s'arrêter lorsqu'on aura trouvé une conformation stable, c'est-à-dire une conformation énergétiquement favorable. Pour passer d'une conformation à une autre il faut au moins un mouvement moléculaire élémentaire dont nous avons vu que l'échelle de temps caractéristique est la picoseconde (10-12 seconde). I faut donc un temps total (afin d'explorer toutes les conformations) :
Trepliement= 4,7N * Tmoléculaire.
Si on prend N=100, Tmoléculaire= 1picoseconde=10-12seconde, alors :
Trepliement= 1055 secondes !!!
C'est beaucoup car on cherche 1 seconde et on trouve quelque chose de beaucoup plus grand que l'âge de l'univers (de l'ordre de 1027 secondes). Avec cette approche il faut plus de temps à une protéine pour se replier et met plus de temps que l'âge de l'univers.
C'est le paradoxe de Levinthal.
Comment s'en sortir ?
Il faut revenir aux acides aminés et en particulier aux résidus qui permettent de différencier les 20 acides aminés. Ces 20 acides aminés peuvent se regrouper en famille selon la nature de ce résidu.
Une première famille est constituée par les acides aminés hydrophobes. Qu'est ce qu'un acide aminé hydrophobe ou l'effet hydrophobe ? Il s'agit de l'effet qui fait que l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Si sur une chaîne on dispose des acides aminés hydrophobes alors ceux-ci vont faire « collapser » la chaîne afin de se regrouper et de se « protéger » de l'eau, tout comme l'eau et l'huile ont tendance à ne pas se mélanger. Ce mécanisme tend à créer ainsi une poche hydrophobe qui permet à ces acides aminés d'éviter l'eau. On commence ainsi à avoir une amorce de solution au paradoxe de Levinthal : la protéine ne va essayer que toutes les conformations, elle va commencer à utiliser dans un premier temps ce mécanisme qui à lui seul va éliminer un grand nombre de conformations possibles.
Mais il y a d'autres familles d'acides aminés et parmi celles-ci celle des acides aminés chargés (+ ou -) qui vont être soumis aux interactions électrostatiques classiques (les charges de même signe se repoussent, les charges de signe contraire s'attirent). Ainsi, si le long de la chaîne nous avons 2 acides aminés de signe opposé ils vont avoir tendance à s'attirer ; cet effet a là encore tendance à diminuer le nombre de conformations possibles pour la chaîne.
Dernière famille, un peu plus complexe mais au sein de laquelle les interactions sont de même nature que pour les acides aminés chargés, à savoir des interactions de type électrostatique. Cette famille est constituée par les acides aminés polaires qui ne portent pas de charge globale mais au sein desquels la distribution des électrons est telle qu'il apparaît une distribution non uniforme de charges ; cette asymétrie dans la répartition des charges va permettre par exemple de créer des liaisons hydrogènes entre molécules d'eau (interactions qui donnent à l'eau des propriétés particulières par rapport à la plupart des autres liquides).
Au total l'image initiale que nous avions des chaînes polypeptidiques doit être un peu repensée et l'on doit abandonner l'idée d'une marche au hasard permettant d'explorer toutes les conformations possibles puisque les briques de base de ces chaînes interagissent fortement les unes avec les autres. On peut ainsi récapituler l'ensemble des interactions au sein d'une chaîne (effet hydrophobe, liaison ionique, liaison hydrogène, sans oublier un mécanisme un peu particulier faisant intervenir des acides aminés soufrés qui peuvent former un pont disulfure ; il s'agit néanmoins d'une liaison un peu moins générale que les précédentes et qui par ailleurs est beaucoup plus solide).
La structure globale de nos protéines résulte de la présence de toutes ces interactions entre les acides aminés présents le long de la chaîne. Lorsque l'on regarde attentivement de telles structures on observe la présence d'éléments répétitifs assez réguliers : hélices, feuillets. Ces feuillets sont des structures locales au sein desquelles la chaîne est organisée dans un plan au sein duquel la chaîne s'organise. Ces éléments de régularité résultent des interactions entre acides aminés et pour la plupart il s'agit des fameuses liaisons hydrogènes entre atomes spécifiques. Bien évidemment certaines régions sont moins organisées et on retrouve localement des structures de type marche au hasard.
Si on récapitule ce que nous avons vu concernant la structure des protéines, nous avons introduit la notion de structure primaire qui n'est rien d'autre que l'enchaînement linéaire des acides aminés. Nous venons de voir qu'il existait des éléments de structure locale (hélices, feuillets) que nous appellerons structure secondaire. Et ces éléments associés aux uns aux autres forment la structure globale tridimensionnelle de la protéine que nous appellerons structure tertiaire.
Il faut noter que cette structure des protéines résulte d'interactions entre acides aminés et il est intéressant de connaître les ordres de grandeur des énergies d'interactions mises en jeu. Ces énergies sont en fait faibles et sont de l'ordre de grandeur de l'énergie thermique (kBT). C'est le même ordre de grandeur que les énergies d'interaction entre molécules au sein d'un liquide comme l'eau ; on peut s'attendre donc à ce que de tels objets ne soient pas rigides ou totalement fixes. Ces mouvements demeurent faibles car il y a une forme de coopérativité (au sens ou plusieurs acides aminés coopèrent pour assurer une stabilité des structures observées) qui permet néanmoins d'observer une vraie structure tridimensionnelle. Ainsi, au sein d'un feuillet ou d'une hélice, plusieurs liaisons sont mises en jeu et à partir de plusieurs éléments interagissant faiblement, on peut obtenir une structure relativement stable de type feuillet ou hélice ; il suffit néanmoins de peu de chose pour détruire ces structures, par exemple chauffer un peu.
Si on revient au mécanisme de repliement on doit abandonner notre idée initiale de recherche au hasard de la bonne conformation. Si on part d'un état initial déplié, un premier phénomène a lieu (essentiellement lié à l'effet hydrophobe, qui vise à regrouper les acides aminés hydrophobes) qui fait rapidement collapser la chaîne sur elle-même. D'autres phénomènes vont alors se mettre en route comme la nucléation locale de structures secondaires de type hélices ou feuillets qui vont s'étendre rapidement le long de la chaîne. Le processus de Levinthal est donc complètement faux et l'image correcte est beaucoup plus celle donnée ici de collapse essentiellement lié à l'effet hydrophobe et de nucléation locale de structures secondaires.
Les protéines n'essaient donc pas d'explorer l'ensemble des conformations possibles pour trouver la bonne solution mais plutôt utiliser les interactions entre acides aminés pour piloter le mécanisme de repliement.
En fait la composition chimique de la chaîne contient une forme de programme qui lui permet de se replier correctement et rapidement.
Au sein des organismes vivants il y a donc plusieurs programmes ; un programme au sein du génome qui permet la synthèse chimique des protéines et un programme de dynamique intramoléculaire interne à la chaîne protéique qui lui permet d'adopter rapidement la bonne conformation lui permettant d'assurer sa fonction.
Il faut noter qu'il existe d'autres façons de s'assurer que les protéines se replient correctement qui font intervenir d'autres protéines (les chaperons).
Notons enfin les tentatives effectuées à l'heure actuelle de modélisation réaliste sur ordinateurs.
VIDEO CANAL U LIEN
|
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
