|
| |
|
|
 |
|
LA PEINTURE |
|
|
| |
|
| |

peinture
(latin populaire pinctura, du latin classique pictura)
Consulter aussi dans le dictionnaire : peinture
Cet article fait partie du dossier consacré à l'art.
Art de l'artiste peintre ; ensemble des œuvres d'un peintre, d'un pays, d'une époque.
BEAUX-ARTS
La peinture est l'art d'utiliser des pigments pour tracer sur une surface des images constituant un ensemble cohérent porteur de sens. Du paléolithique à nos jours, elle a été et demeure un mode d'expression primordial de l'homme. Elle se définit techniquement par un support (en général revêtu d'un enduit, d'une préparation), des pigments de couleur, un liant et/ou un diluant. Sur le plan iconographique, son histoire offre un répertoire inépuisable de symboles et d'idées autant que de formes.
1. ÉVOLUTION HISTORIQUE
1.1. DE LA PRÉHISTOIRE AU MOYEN ÂGE
Le champ de la peinture connaît une extension géographique et chronologique qui suit pour ainsi dire celle de l'humanité. Dès la préhistoire apparaissent les premiers décors pariétaux, comme à Lascaux. La peinture, alors essentiellement murale, utilise des procédés à l'eau. De l'Antiquité, marquée notamment par les différents styles décoratifs développés à Pompéi, au Moyen Âge et jusqu'à la Renaissance, où s’épanouissent nombre de peintures murales et de fresques au cœur des églises et des palais, les recettes se multiplient, qu'il s'agisse de détrempe, de tempera ou de fresque ; les matériaux les plus divers (colle, œuf, cire, etc.) interviennent dans les préparations.
Une majorité des peintures murales romanes de France sont, comme à Saint-Savin, exécutées à l'aide d'une sorte de détrempe à la colle. Les procédés à l'eau sont également adaptés aux œuvres indépendantes du mur (détrempe ou tempera sur panneau de bois) et au décor des manuscrits (variantes de gouache ou d'aquarelle des enluminures médiévales).
1.2. DE LA RENAISSANCE AU XVIIIe S.
Dans l'art occidental, la Renaissance ouvre une ère nouvelle marquée par de profondes transformations des techniques et des conceptions. Les xve et xvie s. voient ainsi le développement du procédé de la peinture à l'huile et l'usage de la toile comme support. Celle-ci en effet vient peu à peu supplanter les panneaux de bois et son emploi va de paire avec l’épanouissement de la peinture dite de chevalet. L’époque connaît également l’élaboration de la perspective linéaire mais aussi la mutation du rapport de l'homme à l'univers au fil des conquêtes scientifiques.
À la pratique des « recettes » s'ajoutent à présent l'observation de la nature, l'étude (anatomie, géométrie…) ainsi que la spéculation intellectuelle. Le peintre tend à être considéré comme un artiste et non plus comme un simple artisan.
LES POSSIBILITÉS NOUVELLES DE LA PEINTURE À L'HUILE
La peinture à l'huile (de lin), dont l'invention fut attribuée à Van Eyck, est le résultat de nombreuses recherches pour obtenir une pâte colorée plus délicate et plus transparente ; elle permet des échanges lumineux plus riches. Le travail de la matière et la qualité sensuelle de la peinture se développent alors, d'abord dans la technique par fines couches successives, qui fait la manière précieuse des Flamands (panneaux de Van Eyck, Van der Weyden, Van der Goes), et qu'on retrouve chez Bellini ou Léonard de Vinci ; ensuite, la progression de l'usage de la toile comme support, dès le début du xvie s., favorise la technique des glacis et des empâtements, qui donne la facture souple et grasse des Vénitiens. On aboutit ainsi à la touche de Titien, puis à la modulation de Rubens et à la matière de Rembrandt. À travers ces évolutions, le travail de la couleur, comme celui de la préparation des fonds, est profondément renouvelé.
LES LOIS DE LA PERSPECTIVE
De son côté, la construction de l'espace, en pleine mutation depuis le début du xive s. (Giotto), se transforme au siècle suivant : la découverte et l'application de lois de la perspective (Brunelleschi) répondent au besoin d'une représentation « vraie », « rationnelle » de la réalité, c'est-à-dire fondée sur des rapports géométriques et mathématiques qui permettent une conception unitaire des objets et de la lumière.
Les expérimentations de la Renaissance (d'Uccello et Piero della Francesca à Léonard) se fixent en un ensemble cohérent à partir de la seconde moitié du xve s., puis se codifient en doctrine que transmettent, à partir du xvie s., académies et traités de peinture. La fonction de la peinture, création mais aussi instrument de prestige et d'apologie, appelle, dans les États forts qui apparaissent au xviie s., des lois strictes ; en France, l'Académie royale codifie et hiérarchise les genres : peinture d'histoire, portrait, paysage, peinture de genre, nature morte…
1.3. LES ÉVOLUTIONS MODERNES
Il faut attendre le xixe s. pour voir se développer, face à l'académisme, de nouvelles exigences (Delacroix), de nouvelles techniques et de nouveaux matériaux. La préparation des couleurs, notamment, se transforme (broyage industriel et non plus fait à l'atelier, conservation en tubes d'étain, création de couleurs de synthèse) : elle offre des teintes plus nombreuses et facilite le travail pictural, notamment en plein air. Ces nouvelles conditions sont déterminantes pour l'éclosion de l'impressionnisme, du fauvisme, de l'expressionnisme. Le rôle primordial accordé à la lumière et à la couleur dans la construction spatiale ouvre la voie aux spéculations cézanniennes, qui closent la tradition issue de la Renaissance et débouchent sur les conceptions nouvelles du cubisme ou de Matisse.
Dès lors, aussi diverses soient-elles, les recherches picturales mettent l'homme et ses rapports au monde (extérieur et intérieur) au centre d'une expression libre de toute soumission aux apparences. L'œuvre, avec l'abstraction, acquiert une autonomie totale et joue sur la spontanéité ou, au contraire, sur la construction pure, ou encore sur la diversité des matériaux (peintures nouvelles, comme les émulsions acryliques, incorporation de substances ou d'objets divers). Et, lorsqu'il est fait référence au monde visible (surréalisme ; nouvelle figuration), les lois de celui-ci ne sont plus que règles, parmi d'autres, d'un jeu avec l'image de la réalité.
2. LA MAIN DU PEINTRE
2.1. LE TRAVAIL PRÉLIMINAIRE
Selon une pratique qui prévaut durant de nombreux siècles, avant de tracer sur le fond préparé les grandes lignes de sa composition au charbon de saule ou au fusain et de raffermir le dessin à l'encre et au pinceau, le peintre a en général longuement travaillé son sujet. Les dessins préparatoires de détail, puis d'ensemble, sont considérés comme des étapes essentielles. La mise au carreau sur un carton à grandeur est le procédé le plus usité pour le transfert du dessin sur la toile. Mais les règles graduées, les compas, les fils à plomb, et des procédés plus complexes comme le cadre de bois tendu de fils croisés ou la chambre obscure, seront utilisés par tous les peintres, même les plus grands, tels Léonard de Vinci ou Dürer. Quelques artistes, comme Poussin ou Gainsborough, n'hésiteront pas à modeler des figurines pour mieux saisir les jeux d'ombre et de lumière. Enfin, dès son invention, la photographie sera perçue et utilisée par certains comme un précieux auxiliaire de travail.
Au xviie s., l'économie d'une étape – le passage direct du dessin préparatoire à la toile – entraîne la multiplication des « repentirs ». Le peintre, changeant d'idée, ne gratte pas ce qui ne lui plaît plus mais se contente de superposer les empâtements. Souvent, en vieillissant, la couche picturale s'usant ou la transparence s'accroissant, la première manière redevient visible. Elle peut également être mise en évidence en éclairant le tableau en lumière rasante, laquelle accuse les reliefs de la couche picturale.
2.2. LA COUCHE COLORÉE
C'est sur le bois ou la toile préparés qu'est posée la couche colorée, qui se compose des pigments – lesquels peuvent être soit minéraux, soit organiques – et des liants. Depuis les primitifs jusqu'à la fin du xviie s., la palette des pigments reste réduite. À côté du blanc (de plomb, de zinc) et du noir (de charbon, de fumée), on ne rencontre que le bleu, le vert, le jaune et le rouge. Ce n'est qu'aux xviiie et xixe s. que les découvertes chimiques lui permettront de s'enrichir. Broyés à l'atelier par les apprentis, les pigments sont mélangés à des liants. Ceux-ci sont de quatre sortes : la cire, le liant aqueux, l'œuf et l'huile.
2.3. LE VERNIS
La couche picturale est protégée par un vernis. Jusqu'au xve s., une simple couche de blanc d'œuf est passée à la surface. Puis c'est un mélange d'huile et de résine qui sera utilisé pour protéger le tableau et intensifier la réflexion de la lumière.
Mais, en 1883, Huysmans loue les artistes du Salon des indépendants d'avoir abandonné l'emploi du vernis pour adopter le « système anglais », qui consiste à laisser la peinture mate et à la recouvrir d'un verre.
2.4. LES INSTRUMENTS
Le pinceau, en poils d'écureuil, de mangouste ou de martre, ou en soie, est l'instrument le plus important. Certains peintres, comme Léonard de Vinci, les fabriquaient eux-mêmes.
La brosse se distingue du pinceau en ce que ses poils, plus raides et plus gros, sont d'égale longueur, au lieu d'être effilés en pointe; en outre, la brosse est de forme plate et élargie. Le couteau à palette, ou spatule, est utilisé pour mélanger les couleurs sur la palette avant de les étendre sur la toile à l'aide du pinceau ou de la brosse, mais il est parfois employé pour peindre en pleine pâte.
2.5. LES TECHNIQUES CONTEMPORAINES
Si la toile, préparée ou non, reste d'un usage très répandu, tout matériau est aujourd'hui utilisé au fil des recherches comme support de la peinture : le bois, le papier, le métal, la tôle, le voile de Nylon, le béton. La rupture de la couche picturale avec la représentation du réel, ou du moins sa relation complexe et d'un type nouveau avec le réel, donne de nos jours à la peinture un nouveau statut au sein des arts. Désormais désinvestie d'un discours – politique, religieux, social ou esthétique –, elle n'existe que dans son rapport au peintre; image d'elle-même, trace du geste créateur, elle ne parle plus d'autre chose que de sa matérialité. Les soins minutieux portés pendant des siècles aux subtils mélanges et dosages des pigments et des liants sont oubliés. Mais le lien fondamental qui unissait la maîtrise technique et le pouvoir créatif demeure. La peinture acrylique connaît une faveur particulière pour ses multiples qualités : outre son faible coût, elle sèche rapidement, et permet ainsi l'application de couches successives en un temps réduit; elle se conserve bien et peut être appliquée sur de nombreux supports – la toile, le papier, le carton, le bois, l'enduit, le contreplaqué. Aussi remplace-t-elle avantageusement la gouache, l'huile ou la détrempe. Depuis son apparition, elle a été utilisée par de nombreux artistes tels les représentants de l'op art, les minimalistes ou les tenants du hard-edge.
3. L'ESPACE PICTURAL
3.1. ÉVOLUTION DU CONCEPT
L'espace pictural est étroitement lié à la fonction dévolue à la peinture. Lorsque celle-ci est purement décorative, elle forme avec l'espace dans lequel elle s'inscrit un ensemble homogène qui ne renvoie qu'à lui-même. La peinture narrative et symbolique des églises et des synagogues des premiers siècles de notre ère prend place sur leurs sols, leurs murs et leurs voûtes dans une sorte de topographie signifiante, mais l'organisation interne de son espace se fonde sur une juxtaposition et une superposition des scènes et des motifs étrangères à une véritable construction de l'espace pictural. Si la peinture murale – notamment à Pompéi – connaît un espace pictural engendré par le sujet et la composition faisant de chaque « tableau » une œuvre en soi, c'est véritablement avec la peinture de chevalet que naît cet espace pictural contraignant qui, tout en donnant l'illusion d'une fenêtre ouverte sur le monde, circonscrit le sujet et le coupe de son environnement. Le cadre devient dès lors l'élément indispensable d'une lecture correcte du tableau: de Poussin à Van Gogh, l'espace pictural se définit par sa bordure. Et Baudelaire pourra dire dans « Le cadre », un poème de Spleen et Idéal :
« Comme un beau cadre ajoute à la peinture,
Bien qu'elle soit d'un pinceau très vanté,
Je ne sais quoi d'étrange et d'enchanté
En l'isolant de l'immense nature. »
3.2. REDÉFINITION DE L’ESPACE PICTURAL
L'effacement du cadre dit la complexité de l'espace pictural et annonce sa transgression. En effet, tant que la peinture est une mimêsis – une imitation – du monde, c'est le cadre qui garantit et fournit les repères séparant réalité et représentation. Le trompe-l'œil, qui fait sortir le motif et déborder le cadre pour donner l'illusion que le sujet appartient à l'espace du spectateur, ne transgresse la limite généralement imposée que pour mieux affirmer l'espace pictural. Cet espace strictement limité contient lui-même une mise en scène de l'espace qui est renforcée par l'unité locale et temporelle du sujet due à la composition tracée depuis un point de vue unique : la perspective linéaire.
LES AVANCÉES DU XIXe S.
C'est sans doute Degas qui, par des plans tronqués, des vues plongeantes, des personnages brutalement coupés par le cadre, redéfinit l'espace pictural. L'attention qu'il porte aux bordures, loin d'être une simple préoccupation d'esthète, révèle une conception nouvelle de la relation sujet-réalité.
Claude Monet va plus loin avec ses Nymphéas en représentant dans le format habituel des tableaux une étendue illimitée. La perception qu'en a Félix Fénéon fait du maître de Giverny un précurseur des recherches contemporaines : « Un paysage de M. Monet ne développe jamais intégralement un thème de nature et semble l'un quelconque des vingt rectangles que l'on taillerait dans une toile panoramique de cent mètres carrés. »
DIVERSITÉ DES EXPÉRIMENTATIONS
Si Bonnard se dégage de la perspective pour retourner au plan (Nu dans le bain, 1937), ce sont les expériences cubistes – dont l'unique souci est l'espace – qui mènent à la rupture entre le réel et le tableau. Lorsque, en 1912, Picasso introduit un morceau de toile cirée pour figurer le cannage d'une chaise dans une toile, il inaugure une conception de l'espace pictural en rupture totale avec la représentation figurative et naturaliste de la Renaissance, fondée sur la perspective. Le collage, dont l'avatar ultime sera l'assemblage, fait éclater la notion de tableau comme surface plane. Dès lors, l'espace pictural peut être redéfini. « La toile n'est plus prise comme écran de projection, mais comme matériau », écrit Simon Hantaï en 1969 à propos des drippings de Jackson Pollock. L'espace pictural a éclaté, il est ouvert, affirmant du même coup le fait pictural comme ayant une existence en soi et non plus en référence à la réalité. Avec les murs peints et le land art, l'espace, ouvert et mis en scène, renoue avec la réalité, mais il n'est plus représenté, il est.
4. LA PEINTURE ET L'ÉCRIT
4.1. UNE TRADITION ANCIENNE
Depuis l'Antiquité, la peinture a suscité deux types de littérature : des considérations esthétiques et philosophiques, dont le cœur est le problème de la mimêsis, c'est-à-dire la reproduction, l'imitation du réel ; et des recueils techniques, mêlant recettes et conseils. Jusqu'à la Renaissance italienne, la peinture est ainsi ravalée au rang des savoir-faire. On l'oppose volontiers à la poésie, pure création de l'esprit.
4.2. ÉCRITS DE LA RENAISSANCE
Si l'ouvrage de Cennino Cennini, Il libro dell'arte, paru en 1398, est essentiellement un guide de la technique picturale, le De pictura d'Alberti (1435) donne ses premières lettres de noblesse à la peinture. Toute cette période est fertile en ouvrages techniques : Valentin Boltz, Albrecht Dürer, Leonardo Fioravanti figurent parmi les auteurs les plus illustres. Mais, au xvie s., c'est certainement le Florentin Giorgio Vasari, peintre, architecte et collectionneur, qui, avec ses Vies des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes, écrit de 1542 à 1550, puis remanié en 1568, donne aux générations futures la plus importante source d'informations sur l'humanisme et l'art de son époque.
4.3. DÉVELOPPEMENT DE LA CRITIQUE
Jusqu'au xviie s., ce sont les peintres qui parlent publiquement de leur art, ou qui écrivent et publient dessus. Ainsi, Le Brun et Poussin alimentent par leurs jugements et leurs prises de position les querelles académiques. L'organisation des Salons et le développement d'un réseau culturel européen contribuent à l'apparition d'une critique artistique dans les milieux d'amateurs. Entre-temps, Diderot invente véritablement un nouveau genre littéraire, la critique de peinture, à travers ses Salons.
Créée en 1768, l'Académie anglaise devient le lieu d'un nouveau discours sur la peinture, jusque-là diffus. Analyse de la beauté, publié en 1753 par William Hogarth, est représentatif du climat intellectuel qui règne alors en Angleterre. Reynolds, dans les discours qu'il prononce devant les élèves de l'Académie dès 1769, y rend hommage à son rival, Gainsborough. Son influence, encore mal mesurée, sera très large : ses discours, traduits et publiés en italien, en français et en allemand, ont probablement contribué, avec l'œuvre des Allemands Anton Raphael Mengs et de Johann Joachim Winckelmann, à l'élaboration d'une certaine conception du « goût classique ».
La critique, initiée par Diderot, se développe largement au xixe s., au cours duquel le genre littéraire du « Salon » connaît chez Baudelaire son accomplissement. Parallèlement, la critique artistique journalistique n'est pas de reste : revues spécialisées puis rubriques artistiques accueillent des contributions plus ou moins éclairées d'écrivains ou d'hommes politiques, qui sentent que la peinture est devenue un enjeu moral et politique. Les peintres eux-mêmes se font plus discrets, s'exprimant à travers leur journal intime (Delacroix) ou leur correspondance (lettres de Van Gogh à son frère Théo). L'heure des manifestes n'a pas encore sonné.
4.4. LE TEMPS DES MANIFESTES
Vers la fin du xixe s., puis au xxe s., l'innovation picturale s'accompagne d'un programme théorique et esthétique : manifestes du symbolisme, du réalisme, du Blaue Reiter, du Bauhaus, du De Stijl, du mouvement Cobra ou du nouveau réalisme.
Dans un renversement radical, alors que le sujet disparaît de la peinture – la toile devenant elle-même le sujet – s'est développé parallèlement le discours sur la peinture – à tel point que certaines œuvres contemporaines semblent ne pouvoir exister ou prendre sens sans un accompagnement discursif : le discours sur la peinture est devenu constitutif de la peinture elle-même.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Ãgypte : histoire de l'Ãgypte ancienne et préislamique |
|
|
| |
|
| |
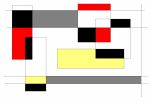
Égypte : histoire de l'Égypte ancienne et préislamique
Cet article fait partie du dossier consacré à l'Égypte ancienne.
DOCUMENT larousse.fr LIEN
1. L'ÉPOQUE ARCHAÏQUE
On divise généralement l'histoire égyptienne en périodes correspondant aux 30 dynasties royales recensées par Manéthon, chroniqueur égyptien du iiie siècle avant J.-C. Si les recherches les plus récentes (juin 2010) en vue d’établir une chronologie absolue grâce à la datation par le carbone 14 d’échantillons de divers objets ou plantes attribués à une période ou à un règne, sont de manière générale en accord avec la plupart des travaux déjà menés, la chronologie de l’Égypte pharaonique diffère toutefois toujours selon les historiens et archéologues avec parfois des écarts sensibles, pouvant atteindre plus d’un siècle. La datation présentée ici est ainsi, parmi d’autres, approximative. La période antérieure à 3200 avant J.-C., pour laquelle on ne dispose d'aucun témoignage écrit, est dite prédynastique ; elle est maintenant beaucoup mieux connue grâce à l'archéologie.
1.1. LA PÉRIODE PRÉDYNASTIQUE
À une époque nettement antérieure à 5000 avant J.-C., de nombreuses communautés de chasseurs-cueilleurs vivent sur les plateaux surplombant le Nil et dans les savanes qui s'étendent à l'est et à l'ouest. Quand la baisse des précipitations et celle, relative, des crues, en particulier après 4000, entraînent une désertification des terres occidentales, ces populations colonisent densément la vallée du Nil et ses abords immédiats. Néanmoins, la faune de ces plateaux, parmi laquelle des éléphants et des girafes, persiste jusqu'aux environs de 2300, avant de se replier définitivement vers le sud.
La vallée du Nil, qui présente des bassins d'irrigation naturels retenant les eaux de crue, est un emplacement idéal pour passer de l'économie mésolithique dotée d'un embryon d'agriculture à une économie fondée sur une agriculture sédentaire accompagnée d'élevage.
En Basse-Égypte, au sud du Delta, à Merimdeh et dans le Fayoum (5000-4000), les fouilles archéologiques montrent l'importance d'une société paysanne, dont les villages étaient construits en clayonnages de roseaux, et produisant une poterie monochrome parfois rehaussée de décors incisés ou appliqués.
1.2. L'AVANCE PRISE PAR LA HAUTE-ÉGYPTE
À la même période, en Haute-Égypte, le pouvoir paraît déjà beaucoup plus fort, centralisateur ; des phénomènes urbains apparaissent à Hiéraconpolis. Les trois époques successives de la culture de Nagada produisent une poterie très différente de celle du Nord – plus proche de celle de Khartoum, plus ancienne – et de superbes objets de pierre polie.
C'est à cette époque que des schémas historiques généraux se dessinent, avec l’émergence d'élites politiques asseyant leur pouvoir sur la prospérité de l'agriculture et sur le contrôle des matières précieuses, qui commencent à être exploitées par des techniques nouvelles.
Si les outils et les armes sont initialement en pierre ou en matériaux organiques, le cuivre et les métaux précieux acquièrent une importance croissante en Haute-Égypte et, plus tard, en Basse-Égypte. La culture de Nagada (milieu du IVe millénaire) voit la construction de bateaux de rivière plus grands et plus performants, et l'essor du commerce sur le Nil. Ces facteurs, parmi d'autres, favorisent l'apparition d'une élite dont les sépultures sont plus grandes et plus somptueuses que précédemment (on peut même reconnaître celles des chefs politiques provinciaux sur différents sites). Selon des traditions ultérieures, deux royaumes seraient apparus à la fin de l'époque prédynastique, la prééminence matérielle et politique de la Haute-Égypte étant plus nette.
1.3. LE COMMERCE
Tout au long de cette période, de 5000 à 3100, les influences étrangères directes ou indirectes sont décisives, mais il est difficile de déterminer leur part respective. La culture des céréales et l'élevage de certains animaux, introduits de Syrie et de Palestine, est un signe de l'influence de ces régions. La Haute et la Basse-Égypte commercent avec la Syrie, la Palestine et l'Afrique du Nord.
On n'a, jusqu'aujourd'hui, retrouvé en Haute-Égypte que des sceaux cylindriques, des poteries et des motifs décoratifs de style mésopotamien, particulièrement remarquables, probablement apportés par des intermédiaires plutôt que par contact direct.
Les témoins les plus parlants de l'architecture prédynastique se trouvent dans les nécropoles ; les fosses funéraires sont tapissées de bois ou de briques et couvertes d'un toit de sparterie ou de pavés ; certaines tombes sont surmontées de petites structures solides en brique ou en remblai. Des campements ont fait l'objet de fouilles partielles, et l'on a découvert récemment à Hiéraconpolis un temple probablement prédynastique.
2. L'ÉGYPTE PHARAONIQUE
2.1. LA PÉRIODE THINITE (VERS 3200-VERS 2778 AVANT J.-C.)
Vers 3200 avant J.-C., Narmer, originaire de Hiéraconpolis, unifie les deux royaumes existant alors : celui de Haute-Égypte (capitale Hiéraconpolis ; divinité tutélaire : la déesse-vautour Nekhbet ; insigne : la couronne blanche) et celui de Basse-Égypte (capitale Bouto ; divinité tutélaire : la déesse-serpent Ouadjet ; insigne : la couronne rouge). Ceignant les deux couronnes (nommées en égyptien « les deux puissantes », en transcription grecque : le pschent), il est le premier des rois qui, durant 30 dynasties (selon le schéma traditionnel de source égyptienne, transmis par Manéthon) au cours de trois millénaires, vont administrer l'Égypte jusqu'en 333 avant J.-C., date de l'arrivée d'Alexandre de Macédoine. Narmer établit sa capitale à This (près d'Abydos), où règnent les rois des deux premières dynasties ; celles-ci sont connues grâce aux découvertes faites dans les nécropoles d'Abydos, de Saqqarah et d'Hélouân (en Basse-Égypte). Il est possible que Narmer ait jeté les fondations de la ville nouvelle de Memphis, à la pointe du Delta du Nil.
L'œuvre de ces premiers souverains, qui maintiennent fermement l'unité du royaume, semble importante : création d'une économie nouvelle (mise en valeur des terres par l'organisation d'une politique nationale d'irrigation, développement de l'agriculture et de l'élevage) ; établissement des principes de la nouvelle monarchie, unificatrice et d'essence divine ; mise en place des éléments de gestion politique (les rouages de l'administration centrale et ceux de l'administration provinciale étant « dans la main du roi », monarque tout-puissant).
Les pharaons des Iere et IIe dynasties sont les successeurs de Narmer. D'après certains spécialistes, des rois de la Iere dynastie auraient été enterrés à Abydos, dans des fosses funéraires coiffées de structures analogues à des tumulus et assorties d'édifices cultuels ; cette architecture a sans doute annoncé les complexes pyramidaux postérieurs. Cette thèse confère au pharaon un statut à part dès l'origine. Or les sépultures royales de la Iere dynastie, dans les environs de Saqqarah, sont de taille et d'architecture analogues à celles des autres élites. Ainsi a été établie la certitude que le statut royal est seulement en germe. On dispose de bien moins d'éléments sur les sépultures royales de la IIe dynastie ; il y en a deux à Abydos, auxquelles sont adjoints des complexes cultuels ; les autres se trouvent à Saqqarah.
2.2. L'ANCIEN EMPIRE (2778-2420 AVANT J.-C., IIIe À VIe DYNASTIE)
Il est convenu d’organiser la succession des pharaons en dynasties. L'Ancien Empire, qui couvre un peu plus d'un demi-millénaire, en compte quatre : de la IIIe dynastie, à partir de laquelle le pouvoir royal va fortement s'accroître, à la VIe dynastie, où il s'affaiblit.
2.2.1. LES PYRAMIDES
Vers 2778 avant J.-C., la IIIe dynastie et son premier souverain Djoser établissent la capitale à Memphis. L'Ancien Empire est aussi l'âge des pyramides ; c'est l'architecte Imhotep, ministre de Djoser, qui donne à l'architecture de pierre un immense développement.
À Saqqarah, Gizeh, Meidoum, Abousir, les tombes royales dominent encore le désert de leurs hautes masses pointant vers le ciel, immortalisant notamment les noms de Kheops, Khephren, Mykerinus.
2.2.2. L'ORGANISATION DU POUVOIR
Sous les IVe et Ve dynasties, le pouvoir du pharaon s'affirme ; en raison de l'importance croissante prise par l'administration, le pharaon Snefrou crée la charge de vizir, homme de confiance du roi, qui gère en son nom justice, police, armée, notamment ; à la cour memphite, une classe de favoris, hauts fonctionnaires, se développe, recherchant les grâces royales, car le roi demeure l'instance suprême de tout élément directeur de l'Égypte ; il dispose aussi du pouvoir spirituel, donnant la faveur au dieu solaire Rê, dont il se dit « le fils », et qui devient alors un véritable dieu d'État.
2.2.3. LE RAYONNEMENT DE L'ÉGYPTE
L'Égypte n'est pas un pays isolé : les rapports et les échanges commerciaux sont importants avec Byblos et la Phénicie, avec Chypre, la Crète et les îles de la Méditerranée, avec le Sinaï (dont les mines ont été exploitées et mises en valeur par les Égyptiens dès les débuts de l'Ancien Empire), avec la Mésopotamie ; l'Afrique, considérée comme le prolongement naturel de l'Égypte, est reconnue jusqu'aux abords de la troisième cataracte du Nil : les territoires nubiens sous hégémonie égyptienne contribuent par leurs apports (blé, bétail, ivoire, ébène, plumes d'autruche, peaux de léopard et de panthère) à la richesse du royaume ; de grandes expéditions maritimes organisées vers le pays de Pount (l'actuelle Somalie) donnent aux Égyptiens
2.2.4. LE DÉCLIN À PARTIR DE LA VIe DYNASTIE
Sous la VIe dynastie (→ Teti, Pepi Ier, Pepi II), la toute-puissance du pharaon est menacée par la montée d'une oligarchie (courtisans et favoris, hauts fonctionnaires de province) et peut-être par l'opposition de couches populaires. L'obscurité règne sur la période qui sépare la fin de la VIe dynastie de l'avènement de la XIe, dont les historiens font traditionnellement le point de départ du Moyen Empire ; le pouvoir n'est cependant pas demeuré vacant et les noms de certains pharaons nous sont connus. Le désordre social est certain pendant une période relativement longue, mais on en connaît mal les causes.
2.3. LA PREMIÈRE PÉRIODE INTERMÉDIAIRE (2420-2160 AVANT J.-C.)
Durant plus de deux siècles alors, on émet l’hypothèse d’une révolution sociale qui livre le pays à l'anarchie, à la récession économique, à la famine, aux infiltrations étrangères, sous les VIIe et VIIIe dynasties memphites, notamment. On pense qu’au cours de la première période intermédiaire, les pharaons de Memphis sont impuissants à empêcher les gouverneurs militaires locaux de livrer bataille pour le contrôle de territoires. Deux royaumes distincts finissent par se constituer, l'un sous la domination des IXe et Xe dynasties de Héracléopolis ; l'autre, quasi contemporaine, sous celle de la XIe dynastie de Thèbes. Ils se disputent l'hégémonie mais se heurtent à l'autonomie des gouverneurs de province.
2.4. LE MOYEN EMPIRE (VERS 2160-VERS 1785 AVANT J.-C., XIe À XIVe DYNASTIE)
2.4.1. L'UNITÉ RETROUVÉE
L'unité est reconstituée par les princes de Thèbes, les Antef, qui fondent la XIe dynastie et inaugurent le Moyen Empire (2160-vers 1785 avant J.-C.). Cette dynastie, qui a pour capitale Thèbes et pour souverains les Antef et les Montouhotep, donne, pour la première fois, la primauté religieuse au dieu thébain Amon. Avec la XIIe dynastie, celle des Amenemhat et des Sésostris – dont la capitale est sise, de nouveau, plus au nord, à Licht (près de Fayoum) –, la monarchie, centralisée, retrouve sa puissance, patronnée par le dieu d'État, Amon-Rê (dont la personnalité divine résulte d'un compromis entre le clergé de Thèbes et celui d'Héliopolis).
2.4.2. L'ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ
Les bouleversements sociaux sont considérables. Autour du pharaon (ressenti désormais comme « le bon berger » du peuple, médiateur officiel entre les dieux et les hommes) se rassemble une société plus différenciée. Les sujets ont une conscience accrue de leurs droits individuels. La religion en est affectée : les croyances et les rites funéraires, jusqu'alors apanage des pharaons, se diffusent dans toutes les couches de la société. Sous la XIIe dynastie, la politique royale favorise même l'émergence d'une classe moyenne aisée (scribes, artisans, etc.) qui joue un rôle actif dans des centres cultuels tels que celui d'Abydos.
Dans le domaine idéologique, le Moyen Empire est marqué par une évolution fort importante : le développement du culte d'Osiris permet désormais à tout homme (et non au roi seul) l'accession à l'éternité, s'il reproduit les rites qui ont présidé à la passion et à la résurrection du dieu.
2.4.3. LA PROTECTION DU ROYAUME
La région du Fayoum est systématiquement mise en valeur, cependant qu'est instaurée une politique de défense des frontières. Au nord-est, il faut avant tout, d'une part, mettre le Delta à l'abri des incursions des Asiatiques – qui, après la VIe dynastie, constituent un réel fléau – et, d'autre part, assurer la liberté du commerce pour les villes de Basse-Égypte. Pour assurer la protection de la voie de terre Amenemhat Ier fait construire sur la frontière orientale du Delta une série de forteresses, les « Murs du Prince », qui, pourvues de garnisons permanentes, protègent le royaume. Au sud, la pénétration en Afrique se développe et s'organise : une administration « coloniale » est créée, en même temps qu'est construite la ville de Bouhen (deuxième cataracte), qui devient le siège du vice-roi d'Égypte ; des forteresses égyptiennes jalonnent désormais le cours du Nil, en Nubie et au Soudan.
À partir de 1900 avant J.-C., des invasions progressives de peuples indo-européens, venus des régions de la mer Caspienne et de la mer Noire, vont « remodeler » la carte du Proche-Orient, entraînant la création de puissants États asiatiques : le Hatti (terre des Hittites, sur les plateaux d'Anatolie), le Mitanni (dans les hautes vallées du Tigre et de l'Euphrate), cependant qu'une dynastie nouvelle s'installe à Babylone.
2.5. LA DEUXIÈME PÉRIODE INTERMÉDIAIRE (VERS 1785-VERS 1580 AVANT J.-C., XVe À XVIIe DYNASTIE)
Les populations autochtones, chassées par ces invasions, fuient vers le sud, refluant jusqu'en Égypte, où, sous le nom de Hyksos, elles vont d'abord s'installer dans le nord-est du Delta, autour de la ville d'Avaris. Favorisés par la faiblesse des XIIIe et XIVe dynasties indigènes, les Hyksos, devenus puissants grâce à l'arrivée de nouveaux contingents d'Asiatiques refoulés, conquièrent peu à peu le royaume, sans toutefois étendre réellement leur pouvoir sur la Haute-Égypte ; ils règnent durant les XVe et XVIe dynasties. Les princes thébains mettent fin à cette seconde deuxième intermédiaire en entreprenant une guerre de libération. Les pharaons Kames, puis Ahmosis chassent les Hyksos, prennent Avaris, poursuivant l'ennemi jusqu'à Sharouhen.
2.6. LE NOUVEL EMPIRE (1580-1085 AVANT J.-C., XVIIIe À XXe DYNASTIE)
L'ÂGE D'OR DE LA MONARCHIE PHARAONIQUE
Le Nouvel Empire qui commence alors, et dont la capitale est fixée à Thèbes (palais royal à Louqsor), est l'âge d'or de la monarchie pharaonique. Les Aménophis, les Thoutmosis, Seti, Mineptah, les Ramsès œuvrèrent pour la grandeur de leur terre.
C'est une période de luxe, caractérisée par une intense activité artistique : Karnak (sur la rive droite du Nil) devient une aire architecturale immense où se succèdent, jusqu'à l'époque romaine, les constructions grandioses entreprises pour la gloire du dieu Amon-Rê, notamment ; les hypogées royaux et privés sont creusés sur la rive gauche (Vallée des rois, Vallée des Reines).
La XVIIIe dynastie, celle des Thoutmosis et des Aménophis, connaît trois entorses à l'ordre des successions royales. La première est le règne d'une reine, Hatshepsout, qui exerce la régence pendant l'enfance de son neveu, le futur Thoutmosis III ; elle se proclame pharaon et gouverne une vingtaine d'années. Après sa mort, Thoutmosis s'acharne à effacer toutes les traces de son règne, faisant abattre des obélisques et défigurer ses monuments ; il va jusqu'à détruire l'un des plus beaux temples de toute l'histoire égyptienne, celui qu'Hatshepsout avait fait édifier à Deir el-Bahari.
La deuxième entorse est le bref règne du jeune Toutankhamon ; la troisième est, à la mort de ce dernier, l'usurpation du pouvoir pharaonique par Horemheb, un simple général. Son règne met un terme à la dynastie.
Les XIXe et XXe dynasties, celles des Seti et des Ramessides (Ramsès Ier à Ramsès XI), participent également à la gloire militaire et au rayonnement culturel de la monarchie pharaonique.
LA POLITIQUE EXTÉRIEURE
Sous ces trois dynasties, qui gouvernent l'Égypte pendant près de cinq siècles, la politique extérieure est remarquable. La reconquête de la haute Nubie, celle de la Palestine, les interventions dans les affaires du Proche-Orient constituent une constante.
Le pharaon, dont le royaume est menacé maintenant par les États puissants qui viennent de se constituer au Proche-Orient, devient, pour la défense de son pays, un grand conquérant : créant et organisant un vaste empire, pratiquant aussi une véritable politique internationale menée par une diplomatie nouvelle, importante, avisée. Thoutmosis III, en 17 campagnes militaires (relatées par le texte des Annales sculptées dans le grand temple d'Amon-Rê à Karnak), dénoue la dangereuse coalition liée par le Mitanni, et Aménophis II s'allie finalement avec ce pays.
Ramsès II abat la puissance hittite (bataille de Qadesh) et les deux États concluent aussi une alliance (dont le texte a été retrouvé dans les archives égyptiennes et hittites). Mineptah et Ramsès III luttent contre les invasions des peuples du Nord et de la mer (vaste ligue, constituée par les populations côtières de l'Asie Mineure et par les Achéens, chassés de leurs terres, les uns par de nouvelles invasions indo-européennes venues du nord, les autres par l'arrivée des Doriens en Grèce, et tous en quête d'un nouvel habitat) : vainqueur sur terre et sur mer (bataille navale dans les bouches du Nil), Ramsès III maintient l'intégrité de son royaume. Les rois du Nouvel Empire doivent aussi lutter contre d'autres dangers venus de l'Assyrie et de la Libye. Au sud, leur pouvoir s'étend jusqu'au-delà de la quatrième cataracte du Nil. Les territoires africains conquis sont maintenus sous régime « colonial », administrés par des fonctionnaires égyptiens, cependant que les territoires asiatiques sous hégémonie (celle-ci s'étendant jusqu'à l'Euphrate, officiellement, mais pratiquement jusqu'à l'Oronte) connaissent une organisation qui respecte les pouvoirs locaux, établissant seulement un certain nombre de « devoirs », notamment le paiement de redevances.
UN POUVOIR CENTRALISÉ
La transformation de l'ancien système de vassalité des Hyksos en une autocratie centralisée est d'une plus grande portée. Les grandes armées royales, qui avaient été levées en vue des guerres contre les pays étrangers, intimident les pouvoirs rivaux ; l'administration est rationalisée, et un Premier ministre nommé à la tête de chacune des parties de l'Empire. En l'absence de conseil et de parlement, toutes les nominations et les révocations émanent directement des pharaons, qui entreprennent souvent des voyages d'inspection.
LE KA DIVIN DU PHARAON
Le pharaon est encore doté d'une double nature, humaine et divine, ce dernier aspect étant alors très valorisé. Le dogme impérial enseigne que chaque pharaon est possédé par le ka divin, qui désigne les énergies vitales dans leurs fonctions créatrice et conservatrice ; Horus est, selon la mythologie, le dernier dieu à avoir gouverné la terre dans la nuit des temps, et que l'on identifie à Amon-Rê. Ce dieu, qui figure l'alliance de la divinité thébaine avec le dieu solaire, est la divinité tutélaire de l'Empire.
LE CLERGÉ
Le clergé d'Amon, enrichi par les dons royaux (recevant notamment une part du butin recueilli lors des campagnes militaires), devient une puissance dangereuse ; à partir de la XIXe dynastie, il dispose de grands domaines, de milices privées, de tribunaux spéciaux. La réaction d'Aménophis IV contre l'ingérence amonienne dans les affaires de l'État (instauration du culte unique du disque solaire Aton, suppression des clergés, notamment) fut de courte durée ; pour diminuer l'importance prise par Thèbes, les Ramsès établissent une seconde capitale, dans le Delta, près de Tanis.
LE DÉCLIN
À la fin de la XXe dynastie, le développement de la corruption, le danger que représente le clergé d'Amon, les prétentions au pouvoir des chefs militaires étrangers (Libyens, notamment) finissent par affaiblir le pouvoir central : on pille les tombes royales, on complote contre le pharaon. Le Nouvel Empire se termine par une guerre civile sous Ramsès XI.
2.7. LA BASSE ÉPOQUE (V. 1085-V. 333 AVANT J.-C. ; XXIe À XXXIe DYNASTIE)
INFLUENCES ET DOMINATIONS
Vers 1085 avant J.-C., Smendès (originaire de Tanis) fonde la XXIe dynastie, qui gère le Delta, cependant qu'une souveraineté parallèle s'installe à Thèbes, avec Herihor, grand prêtre d'Amon et premier des rois-pontifes. La scission semble consommée. C'est le début de la Basse Époque, durant laquelle règnent plusieurs dynasties étrangères, dans le pays livré aux invasions. La XXIIe dynastie, d'origine libyenne (les Sheshonq, Osorkon, Takélot), règne, à Bubastis, en même temps que la XXIIIe dynastie installée à Tanis (Pedoubast) ; le Delta aussi est divisé.
Il est possible que, lors de l'avènement de Sheshonq Ier, une partie du clergé amonien ait alors fui à Thèbes et se soit réfugié au Soudan à Napata, où il aurait implanté le culte d'Amon et construit un temple grandiose pour ce dieu ; en tout cas, le roi de Napata, Piankhi (descendant de Herihor ?), vers 750 avant J.-C., remonte le fleuve jusqu'à Thèbes et étend son pouvoir sur la Haute-Égypte. Le Delta est alors administré par la XXIVe dynastie, indigène de Saïs (Tefnakht et Bocchoris).
Vers 715 avant J.-C., Shabaka établit le pouvoir soudanais en Égypte avec la XXVe dynastie, et les rois du Sud, pour renforcer leur mainmise, placent leurs parentes comme « divines adoratrices d'Amon » (épouses du dieu) à Thèbes ; mais les rois locaux de Basse-Égypte ne se soumettent pas.
LA CIVILISATION SAÏTE
Vers 671 avant J.-C., Assarhaddon et les Assyriens font du Delta un protectorat de Ninive ; Assourbanipal descend le fleuve à deux reprises jusqu'à Thèbes. La seconde fois, il fait saccager la grande ville. Mais Psammétique Ier, roi de Saïs, chasse les Assyriens de Basse-Égypte et les Soudanais de Haute-Égypte, et instaure la XXVIe dynastie, égyptienne ; jusqu'en 525 avant J.-C., on assiste à un renouveau national.
LA DOMINATION PERSE
Vers 525 avant J.-C., le roi perse Cambyse s'empare de toute l'Égypte et, jusqu'à Darios II (vers 404 avant J.-C.), la XXVIIe dynastie sera formée par les souverains achéménides, le pays étant devenu une satrapie du vaste empire des Darios et des Xerxès. Appuyé par les Grecs, le roi de Saïs, Amyrtée, chasse les Perses et fonde la XXVIIIe dynastie (404-398 avant J.-C.) ; il mène de nouveau une politique nationale, comme ses successeurs les rois de la XXIXe dynastie (398-378 avant J.-C.) et de la XXXe (378-341 avant J.-C.), celle-ci étant la dernière des dynasties indigènes ; vers 341 avant J.-C., en effet, Nectanebo II ne peut résister à une nouvelle invasion et empêcher une seconde domination perse (341-333 avant J.-C.). La défaite de Darios III Codoman, à Issos puis à Gaugamèles (333 et 331), laisse le pouvoir à Alexandre de Macédoine, qui pénètre alors en Égypte.
3. LA RELIGION DE L'ÉGYPTE PHARAONIQUE
Dans l'Égypte primitive, la religion est essentiellement locale : chacun honore le dieu de sa bourgade, puis celui qui règne sur la métropole de sa province, ou nome. Les nomes possèdent des « enseignes », symboles de divinités représentant des animaux, des plantes ou des objets.
L'Égypte (comme tous les peuples de l'Antiquité) divinise les forces de la nature et les éléments (animés ou non) de l'univers créé, pour rendre hommage à leurs bienfaits ou se concilier leur éventuelle agressivité, établissant ainsi entre eux un courant d'« échanges », un lien, à vertu magique.
3.1. LES PRINCIPAUX DIEUX
Sont ainsi adorés Khnoum (le bélier, l'animal reproducteur du troupeau, dieu créateur par excellence), Hathor (la vache, féconde et nourricière – assimilée au ciel, lien fécond de l'univers, parce que donneur de lumière et de chaleur –, déesse donc aussi de la joie et de la danse), Sebek (le crocodile, qui guette sa proie tapi dans l'eau du fleuve), Anubis (le chacal, qui deviendra le divin embaumeur, très tôt mis en rapport avec le monde des défunts car l'animal hante toujours les abords des nécropoles en quête de possibles nourritures), Horus (le faucon, assimilé souvent au ciel ou au soleil, car, ailes largement étendues, l'oiseau qui plane semble se confondre avec l'étendue céleste), Min (dieu humain de la fertilité), Ptah (dieu de Memphis, première capitale de l'Égypte), etc. Chacune de ces divinités est adorée principalement dans une ville (parfois plusieurs) et est ressentie comme netjer, « le dieu », pour ses fidèles. Deux grandes forces bénéfiques de la nature sont particulièrement révérées : le soleil, Rê, qui donne et entretient la vie de chaque jour, et Osiris, dieu du Nil et de la végétation toujours renaissante, le dieu qui, par sa passion et sa résurrection, donne aux hommes l'exemple et les « moyens » de la vie éternellement renouvelée.
3.2. LES SYNCRÉTISMES
Les vicissitudes de la politique créent les premiers syncrétismes nationaux et déterminent l'existence de dieux d'État (sommets du panthéon, comme le roi est celui de la société) : Rê, sous l'Ancien Empire, acquiert, à partir de son centre culturel d'Héliopolis (près de Memphis), une valeur nationale ; le roi, dieu lui-même, est son fils. Au Moyen et au Nouvel Empire, Amon de Thèbes (nouvelle capitale) « coiffe » les autres divinités, qui sont officiellement ses hypostases, mais s'allie avec le puissant Héliopolitain : Amon-Rê qui est alors le maître divin de l'Égypte.
Des syncrétismes religieux internationaux se développent aussi au Nouvel Empire, période des grandes conquêtes en Asie. La confusion des divinités justifie alors et légitime la conquête : Amon-Rê et Shamash (dieu solaire babylonien) sont assimilés, Osiris, Baal et Adonaï sont mêlés en une même foi dans la vitalité des forces végétantes, Ptah prend pour parèdre Ashtart (déesse mère de l'Asie antérieure) ; Sontekh (l'Asiatique) et Seth (l'Égyptien, dieu des forces néfastes et hostiles) confondent leur puissance guerrière.
3.3. LE CLERGÉ
Pour le service des dieux et des morts, des clergés, d'importance diverse, se constituent. Dans les temples divins, le roi – théoriquement, officiant unique – délègue son pouvoir à des prêtres. Un service quotidien est assuré : sortie, toilette et purification, nourriture de la statue divine, sous forme de riches offrandes alimentaires. Militants, les prêtres composent des systèmes théologiques où leur dieu est le créateur du monde : Ennéade héliopolitaine, Ogdoade hermopolitaine (menée par le dieu-ibis Thot), système « intellectuel » de Memphis, autour de Ptah. Gérants des biens du dieu, les prêtres possèdent souvent une grande richesse temporelle, notamment le clergé thébain d'Amon-Rê, enrichi par les dons royaux (butin rapporté des campagnes militaires, octroi de terres). Ainsi, ils peuvent parfois concurrencer, voire menacer la puissance politique du pharaon lui-même : des querelles d'influence naissent, des discussions sont apparentes, la « guerre » larvée entraîne peu à peu la réforme d'Aménophis IV à Amarna, mais vaut aussi aux rois-prêtres de la XXIe dynastie l'accès aux fonctions royales.
3.4. LES RITES FUNÉRAIRES
Les prêtres funéraires s'activent à maintenir la vie du défunt dans les temples funéraires royaux et les tombes privées ; la survie du corps étant garantie par la momification, tout un appareil funéraire est encore indispensable. Les prêtres (qui remplissent, dans cet office, le rôle du fils aîné) apportent, chaque jour, les offrandes alimentaires nécessaires à l'entretien de la force vitale, ou ka (l’esprit), du mort. La vie étant ainsi maintenue sous les épaisses bandelettes qui enserrent le corps, il faut aussi recouvrer la liberté du mouvement et la possibilité de revivre le quotidien ; élément ailé de l'être, le ba (oiseau à tête humaine), s'échappant du corps étendu, s'en va chercher sur terre les souffles vivificateurs et, à tire-d'aile, revient ainsi revigorer le défunt.
→ momie.
Cette survie en deux temps est encore insuffisante : l'Égyptien fabrique alors des « corps de rechange » sculptés en ronde bosse ou en bas relief (à la ressemblance du personnage), et dans lesquels peut se glisser le ba (l’âme) qui les réanime, pour une reprise des habitudes du temps de vie (de là, la grande imagerie des tombes, qui reproduit les scènes de la vie quotidienne) ; l'art devient ainsi le médiateur de l'immortalité. Enfin, pour le voyage dans l'au-delà, la connaissance des formules est indispensable (notamment lors du jugement par-devant Osiris) ; c'est la fonction (au Nouvel Empire) des papyrus du « Livre des morts », destinés à guider efficacement le défunt dans l'autre monde.
Religion de la tolérance et de l'espérance, la religion égyptienne s'inscrit dans l'ensemble des grandes religions panthéistes de l'Antiquité, qu'elle a fortement influencées. À l'époque tardive, elle essaime dans le monde clanique ; le culte d'Isis (l'épouse d'Osiris, magicienne de la résurrection) fleurit en Grèce, à Rome et dans tout le monde méditerranéen. Cette religion est d'une haute valeur morale, où la soumission au dieu, le respect des principes de paix et de charité sont essentiels. La déesse Maât, déesse de la Vérité et de la Justice (seuls principes abstraits déifiés), est le garant de l'ordre de l'univers.
4. L'ÉGYPTE HELLÉNISTIQUE (332-30 AVANT J.-C.)
4.1. D'ALEXANDRE AUX LAGIDES
L'Égypte est libérée de la domination perse par la conquête d'Alexandre. Soumise à l'autorité des souverains hellénistiques, ses successeurs, elle appartient désormais au monde grec.
Dans son court séjour (automne 332-printemps 331 avant J.-C.), Alexandre le Grand se pose en libérateur et, laissant aux indigènes leurs lois, il s'assure la bienveillance des prêtres en faisant reconnaître sa filiation divine au temple d'Amon, en l'oasis de Siouah. Il fonde Alexandrie, qui doit être le débouché maritime d'un pays jusque-là replié sur lui-même. Après sa mort (323 avant J.-C.), ses généraux attribuent la satrapie d'Égypte à un noble macédonien Ptolémée, fils de Lagos, qui se proclame roi en 305 avant J.-C., fondant la dynastie des Lagides (ou Ptolémées ; 305-30 avant J.-C.). Ces souverains, qui ajoutent au nom dynastique Ptolémée un surnom personnel, ont une histoire des plus agitées. À l'imitation des pharaons, ils épousent leur sœur et les intrigues familiales sont nombreuses à partir du règne de Ptolémée IV, affaiblissant la dynastie, que ne peuvent sauver quelques reines particulièrement énergiques (ainsi Cléopâtre VII). La dynastie possède également Cyrène, Chypre, un grand nombre d'îles grecques et de villes littorales d'Asie Mineure ou de l'Hellespont ; elle dispute aux Séleucides la Syrie, débouché des routes du commerce oriental vers la Méditerranée et région productrice de ce bois qui manque à l'Égypte pour ses constructions navales.
4.2. LA VIE ET LA SOCIÉTÉ À L'ÉPOQUE PTOLÉMAÏQUE
La domination des Lagides sur l'Égypte est de type colonial : les indigènes sont écartés de toute charge importante ; l'administration ou plutôt l'exploitation du pays est le fait d'étrangers privilégiés qui appartiennent à la race des conquérants hellènes (Macédoniens ou Grecs) ou qui ont acquis par leurs vertus militaires droit à un statut spécial (Perses, Juifs). Cela est d'autant plus mal ressenti des Égyptiens que le recrutement des allogènes est insuffisant pour assurer la puissance des armées lagides : il a fallu en 217 avant J.-C. (malgré tous les avantages dont bénéficiaient les soldats royaux, en particulier la concession en quasi-propriété de terres) engager des troupes égyptiennes pour lutter contre les Séleucides et les vaincre (bataille de Raphia).
Cette date marque le début de nombreuses révoltes qui déchirent le royaume (la Haute-Égypte a maintenu son indépendance, sous l'autorité de dynastes locaux, durant de très longues années). La mégalopole d'Alexandrie est agitée par des querelles entre les groupes ethniques, Grecs, indigènes plus ou moins hellénisés ou Juifs, ceux-ci, nombreux, s'administrant eux-mêmes dans leur quartier réservé. Bien que constituant une caste privilégiée, les Grecs n'échappent pas au pouvoir absolu des rois. Conservant leurs coutumes, leur genre de vie (fréquentation du gymnase, éphébie) et l'usage de leur langue, jugés selon le droit grec, ils sont essentiellement regroupés dans trois cités (Alexandrie, Ptolémaïs et Naukratis) pourvues d'institutions grecques traditionnelles, mais qui ne leur donnent qu'une apparence de libertés. Fonctionnaires ou militaires, ils assurent l'encadrement de la population indigène, au sein d'une administration pléthorique, très minutieuse et tatillonne : les archives, écrites sur papyrus, montrent avec quel soin est traitée la moindre affaire ; grâce à elles, on peut connaître avec assez de précision l'organigramme du système étatique.
L'unique fonction de cette administration est de faire entrer dans les caisses royales la plus grande partie des produits de l'activité de tous les habitants du royaume entre dans les caisses royales ; les souverains veulent amasser le plus possible, ce qui implique la mise en œuvre de techniques diverses : les fonctionnaires sont rendus financièrement responsables des effets de leur administration, on multiplie les monopoles. Le mieux connu de ces derniers, celui de l'huile, implique une politique douanière dissuasive ; le monopole de la monnaie, qui est de règle dans les monarchies hellénistiques, s'accompagne de la mise en service d'un numéraire fiduciaire qui permet au roi de contrôler parfaitement la circulation du métal précieux. L'exploitation des monopoles est confiée à des fermiers.
Si les prêtres détenteurs de secrets prestigieux continuent d'assurer le culte royal et sont comblés par le nouveau pharaon de privilèges qui récompensent leur action pour lui assurer la fidélité des masses, les autochtones sont pressurés par le régime. Le plus souvent ce sont des paysans ; ils louent au roi (seul propriétaire de la totalité du sol égyptien) des tenures sur lesquelles ils sèment (le roi est seul habilité à prêter des semences, il se fait rembourser principal et intérêts) en fonction d'un plan de culture établi par l'État (parcelle par parcelle, l'administration fixant la nature des cultures à réaliser), avant de récolter (si le Nil atteint un niveau suffisant) et de vendre le produit. Au prix fixé par le roi, outre le loyer de la terre, l'intérêt de l'emprunt, il faut aussi ajouter les impôts. Quand la situation devient trop difficile pour les paysans, ils font grève en fuyant vers les confins désertiques (anachorète), et les champs royaux restent en friche. Privée des ressources procurées par tel ou tel terrain, l'administration doit en venir à des mesures de coercition plus efficaces ou accorder (ce qui affaiblit la monarchie) des privilèges nouveaux à qui voudra bien se charger de telle ou telle exploitation.
UNE MONARCHIE PRESTIGIEUSE
Grecs et indigènes vivent dans deux communautés complètement séparées (ou presque). À l'obstacle de la langue s'ajoute le fait que chacune a un régime juridique différent ; leur seul point commun est de vivre au service exclusif de la monarchie. De leurs immenses richesses les rois tirent un prestige qui leur permet de mener en Méditerranée une politique active (Ptolémée III ira jusqu'en Babylonie), d'attirer à Alexandrie, pour des fêtes célébrées à la gloire de la dynastie (les Ptolemaia, dont l'importance sera égale à celle des concours olympiques), des foules énormes de dépendants, d'apparaître un temps comme les maîtres du jeu dans le monde hellénistique. Ptolémée Ier aura le très grand mérite de vouloir aussi fonder sa gloire sur les services rendus au développement de la culture grecque : à Alexandrie (d'où les Égyptiens étaient exclus) il rassemble dans le Musée les savants les plus remarquables (Archimède, Ératosthène, Euclide, Héron), des hommes de lettres de qualité (Apollonios de Rhodes, Callimaque), des érudits au dévouement et à la science inlassables (Aristarque), et les dote d'une bibliothèque extraordinairement riche. C'est grâce à la dynastie que nous connaissons Homère, les tragédies d'Eschyle ou de Sophocle ; par elle sera transmise aux savants arabes la science d'Aristote, des mathématiciens et des médecins hellénistiques.
LE PROTECTORAT ROMAIN
En 168 avant J.-C., le roi séleucide Antiochos IV est sur le point de s'emparer d'Alexandrie et de détrôner les rois lagides quand Rome, pour maintenir l'équilibre du monde hellénistique, envoie Popilius Laenas remettre en selle Ptolémée VI. Le grand royaume devient alors une sorte de protectorat romain à la tête duquel se succèdent des fantoches (Ptolémée XII Aulète), tandis que les Romains annexent Cyrène (74 avant J.-C.) et Chypre (58 avant J.-C.). Par sa passion pour Cléopâtre VII, Antoine se met au service des intérêts de la dynastie, et rêve pour ses enfants (Cléopâtre Silène II et Ptolémée Philadelphe) d'un nouvel empire de l'Orient, mais, vainqueur (30 avant J.-C.), Octave annexe le pays du Nil.
5. L'ÉGYPTE ROMAINE (30 AVANT J.-C.-395 APRÈS J.-C.)
Les hommes politiques romains ont depuis longtemps décelé les faiblesses internes de la monarchie lagide, qui se cachent derrière une façade brillante. C'est pourquoi Octave, en prononçant l'annexion, en 30 avant J.-C., ne fait que concrétiser leurs aspirations. Il prend des mesures originales : l'entrée de l'Égypte est interdite aux sénateurs, même s'ils y possèdent des domaines ; c'est la seule province importante où l'empereur est représenté par un personnage de rang équestre, le préfet d'Alexandrie et d'Égypte, qui a par ailleurs les pouvoirs d'un légat propréteur ; autre anomalie, les légions sont commandées par des préfets également de l'ordre équestre. On a émis l’hypothèse qu'Auguste ne tenait pas à ce que les sénateurs voient le princeps honoré comme un pharaon, dans ce pays dont le régime ne ressemble pas à celui du reste du monde romain.
5.1. VIE ET SOCIÉTÉ SOUS DOMINATION ROMAINE
Gouvernement, administration, exploitation économique sont calqués sur les méthodes des Lagides. Auguste se contente de réprimer les abus apparus avec l'affaiblissement de la dynastie macédonienne : il aurait supprimé, ou peut-être réduit, la terre concédée aux temples, la participation de l'État aux frais du culte et les grands domaines usurpés sur la terre royale auraient été repris. Pour mieux régner, l'empereur divise : il maintient le système des castes ; les indigènes, considérés comme « déditices » (peuple soumis), ne peuvent accéder à la cité romaine. Il refuse à la province l'occasion de s'unir en célébrant le culte impérial, qui n'existe ici que sous la forme municipale. Il installe 3 légions et 12 corps auxiliaires (23 000 hommes au total) pour surveiller Alexandrie ou les campagnes turbulentes de la Thébaïde. Pour suivre la tradition locale, on recrute les soldats dans les ex-castris (hors du camp), ce qui ne se fait nulle part ailleurs. Il ne semble pas que les Romains, qui restaurent sans cesse le système d'irrigation, aient tiré de l'Égypte plus que les Lagides : l'annone nourrit assez régulièrement les Romains quatre mois par an avec le blé égyptien, mais, les mauvaises années, la disette se fait sentir sur les bords du Nil. Pour l'Égypte, le changement de domination n'a pas produit de grands effets : les dirigeants sont maintenant des Romains, mais le grec reste la langue officielle ; la monnaie de compte (différente de celle du reste de l'Empire) est toujours la drachme. Les papyrus grecs, démotiques, encore plus nombreux que sous les Lagides, les ostraca, les règlements (comme le « Gnomon de l'Idiologue », code fiscal de l’Égypte romaine) témoignent de cette continuité : recensements, contrôles, réclamations.
Quelques faits pourtant se détachent dans l'histoire de ces premiers siècles de notre ère. Le voyage en Inde devient plus facile lorsque le navigateur alexandrin Hippalos découvre la mousson : chaque année, cent vingt vaisseaux partent des ports de la mer Rouge pour aller chercher les soieries, les perles et les parfums de l'Inde, et l'importance commerciale d'Alexandrie, qui redistribue ces denrées précieuses est encore accrue.
La communauté juive d'Alexandrie est en fermentation depuis longtemps : ces Juifs, qui ne parlent plus que le grec, ont généralement gardé leurs traditions (par la Bible des Septante), et le cas du philosophe juif Philon, qui tente une interprétation platonicienne de la Bible, n'est pas courant. L'antisémitisme se développe : sous Claude, déjà, des heurts éclatent entre Grecs et Juifs d'Alexandrie. Le soulèvement général des Juifs en 66 aurait coûté la vie à 50 000 de ceux-ci à Alexandrie ; celui de 117 aurait fait 240 000 victimes. Les empereurs essaient d'augmenter le rendement de leurs propriétés ; ils confisquent les grands domaines, utilisent la concession emphytéotique, pour retenir les paysans. Ils semblent devenus plus généreux à l'égard du clergé, et les temples de Philæ, d'Esnèh sont terminés au iie s. Le Musée est toujours subventionné, et la science alexandrine jette un dernier éclat avec Ptolémée (sous Hadrien) et l’historien Appien (à l'époque d'Antonin).
Septime Sévère, pour assurer la rentrée des impôts, établit le régime des curies dans les villes, et Alexandrie reçoit une boulê (assemblée) ; Coeranus est le premier Égyptien à entrer au sénat (vers 210). Déjà le commerce avec l'Extrême-Orient décline : Rome a épuisé le stock métallique qui permettait ces échanges. Vers 250, les Blemmyes, des Éthiopiens, envahissent les districts frontières et coupent les routes du Nil à la mer Rouge, sans doute moins bien défendues : depuis le iie s., il n'y a plus qu'une légion en Égypte. La méfiance des empereurs amène des transformations administratives, et, au ive s., le pays fait partie du diocèse d'Orient et dépend du comte qui réside à Antioche, mais il garde un préfet qui surveille les gouverneurs des provinces.
5.2. L'ÉGYPTE CHRÉTIENNE
Le christianisme a dû pénétrer d'abord dans la communauté juive d'Alexandrie, et il est sans doute à l'origine des troubles qui s'y produisent sous Claude. Par la suite, sa diffusion semble avoir été facile chez un peuple aussi déshérité, et, dès le iiie s., il a conquis la majorité de la population. Les Égyptiens, que les Anciens voyaient comme les plus religieux des hommes, apportent un caractère original à la nouvelle religion avec l'érémitisme et le monachisme. Saint Antoine (250-356) est le premier anachorète chrétien ; installé dans le désert, il attire des disciples, qui vivent comme lui dans des cabanes isolées. Vers 320, saint Pacôme fonde un koinobion (centre de vie commune) à l'ouest de Thèbes, où il groupe 2 500 moines. Sa sœur Marie fonde le premier couvent de femmes. L'Égypte chrétienne, qui en adoptant l'écriture copte entend préserver sa culture nationale, n'a pas renié le centre intellectuel d'Alexandrie. Au iie s., Pantène, philosophe converti, oppose au Musée l'école des catéchètes. Saint Clément, son élève et son successeur (vers 190), présente le christianisme comme la forme supérieure de la gnose (gnosticisme). Il doit fuir la persécution (202) et l'évêque Démétrios le remplace par le jeune Origène, qui mêle hellénisme et culture biblique jusqu'au jour où il est déposé et forcé de s'éloigner (vers 230). La fin du iiie s. est marquée par des querelles sur la nature du Christ ; le prêtre Arius, d'Alexandrie, qui a nié la divinité du Christ, est excommunié par l'évêque Alexandre (323), puis par le concile de Nicée (325). Le successeur d'Alexandre [à Alexandrie], saint Athanase (328-373), passe sa vie à lutter contre l'arianisme et les empereurs, qui le chassent de son diocèse. Enfin Théodose se prononce contre la doctrine d'Arius (379) et l'Égypte s'apaise.
Les païens n'ont pas voulu s'avouer vaincus. À la fin du iie s., le philosophe Ammonios Sakkas, qui abandonne le christianisme, fonde à Alexandrie l'école néoplatonicienne, et a pour disciples Origène et Plotin. L'école maintient ses traditions intellectuelles jusqu'au jour où les violences de la foule chrétienne en imposent la fermeture (415). Le culte païen est interdit par Théodose en 392.
6. L'ÉGYPTE BYZANTINE (395-642)
L'Égypte fait partie de l'empire d'Orient jusqu'à la conquête arabe. Depuis Théodose, le préfet d'Égypte, appelé préfet augustal, a les attributions d'un vicaire dans la vallée du Nil ; les provinces sont confiées à des ducs, dont la charge essentielle est de percevoir l'impôt et de veiller à l'annone ; l'Égypte, toujours exploitée par les étrangers, ravitaille maintenant Constantinople. Malgré les efforts des empereurs, la grande propriété se développe au profit de hauts fonctionnaires.
L'Égypte présente un intérêt nouveau pour la politique extérieure. Partis de son territoire, des missionnaires ont évangélisé le royaume éthiopien d'Aksoum et le pays des Himyarites (Yémen). Byzance compte sur ces deux peuples pour se débarrasser du contrôle des Sassanides sur la route de l'Inde, mais l'Égypte est trop excentrique, les menaces d'invasion sont trop nombreuses ailleurs pour que l'on songe longtemps à une expédition navale au-delà de la mer Rouge. Malgré son nom, Cosmas Indikopleustês (« le navigateur vers l'Inde »), auteur de la Topographie chrétienne de l'univers (vers 550), n'a pas dépassé les ports d'Arabie. Le rôle d'Alexandrie décline donc au profit des ports syriens, où aboutissent les caravanes venues d'Extrême-Orient.
Si l'empereur continue à exploiter le pays, il est loin d'y exercer une autorité sans partage. L'Égypte byzantine est avant tout une Égypte chrétienne. Le nouveau pharaon, comme disent ses adversaires, c'est l'évêque d'Alexandrie ; depuis le concile de Constantinople (381), il est reconnu comme patriarche, supérieur aux autres évêques d'Orient, désignant et installant à plusieurs reprises les évêques de la capitale ; il est le seul en Orient à avoir conservé le titre de pape. Il nomme les évêques d'Égypte (une centaine) et peut compter sur un clergé nombreux et docile ; il s'appuie sur les bandes fanatiques des moines du désert, alors commandés par Chénouté, abbé du Couvent Blanc. Fort riche, il distribue l'argent à bon escient, et les fonctionnaires impériaux sont à sa dévotion.
Mais, surtout, il ressuscite à son profit l'esprit national des Égyptiens, très montés contre le pouvoir des Grecs, qui continuent à les exploiter. Maître de l'Égypte, il espère supplanter son rival de Constantinople et il peut compter sur le pape, inquiet de la puissance de l'évêque de la nouvelle capitale de l'Empire.
6.1. LA QUERELLE DU MONOPHYSISME
En 404, Le patriarche d'Alexandrie, Théophile (385-412), provoque la chute de saint Jean Chrysostome, évêque de Constantinople, tandis que son successeur, saint Cyrille (412-444), fait condamner en 431 Nestorius, patriarche de Constantinople, comme hérétique (nestorianisme) : on est alors en pleine querelle christologique sur la personne et les natures du Fils.
Le patriarche Dioscore (444-451) soutient les théories de l'archimandrite Eutychès (eutychianisme), qui sont à l'origine du monophysisme (affirmant l'union du divin et de l'humain dans le Christ en une seule nature, le premier ayant abosrbé le second), et au concile d'Éphèse (449) il fait déposer Flavien, patriarche de Constantinople, qui avait condamné Eutychès.
Mais les violences exercées par des moines égyptiens à l'encontre des év^ques (à l'occasion de de concile qualifié de « brigandage) d'Éphèse », attirent l'attention du pape Léon Ier, qui redoute les prétentions d'Alexandrie. Au concile de Chalcédoine (451), Dioscore est déposé. L'Égypte n'accepte pas cette décision et adhère alors avec ardeur au monophysisme, parce qu'il est condamné par Constantinople.
Pendant deux siècles environ, le monophysisme devient alors le symbole de la résistance nationale et religieuse de l'Égypte à l'autotité de Byzance. De nombreuses persécutions à l'encontre de l'Église égyptienne s'en suivent mais les Coptes continuent de nommer leurs propres patriarches et la rupture donne naissance à une Église nationale qui gardera des racines profondes.
Dès 457, Alexandrie se soulève et le patriarche chalcédonien est tué, l'usurpateur monophysite bénéficiant des luttes politiques qui se déroulent à Constantinople. À partir de 460, deux patriarches s'opposent : le patriarche melkite (royal, car le mot « impérial » est inconnu en Orient), toujours menacé par la colère populaire, et le patriarche monophysite, toujours appuyé par la majorité des indigènes. Au vie siècle, les monophysites se divisent en sectes ennemies, toutes d'accord cependant pour refuser toute compromission avec le pouvoir impérial. Cette période agitée est la grande époque de l'art et de la littérature coptes.
Au viie siècle, l'empereur Héraclius (610-641), qui a reconquis ses provinces orientales sur les Sassanides (les Perses ont occupé l'Égypte de 616 à 629), veut à tout prix rétablir l'unité de croyance. Ses édits, qui imposent aux juifs le baptême, aux sectes chrétiennes rivales la doctrine nouvelle du monothélisme, provoquent des réactions violentes, et la haine des Grecs et du pouvoir impérial est à son comble lorsque les Arabes envahissent l'Égypte. |
| |
|
| |
|
 |
|
MALI |
|
|
| |
|
| |

Mali
Nom officiel : République du Mali
État d'Afrique occidentale, le Mali est bordé au nord et au nord-est par l'Algérie, à l'est par le Niger, au sud-est par le Burkina, au sud par la Côte d'Ivoire, au sud-ouest par la Guinée et le Sénégal et à l'ouest par la Mauritanie.
* Superficie : 1 240 000 km2
* Nombre d'habitants : 15 302 000 (estimation pour 2013)
* Nom des habitants : Maliens
* Capitale : Bamako
* Langue : français
* Monnaie : franc C.F.A.
* Chef de l'État : Ibrahim Boubacar Keïta
* Chef du gouvernement : Abdoulaye Idrissa Maïga
* Nature de l'État : république à régime semi-présidentiel
* Constitution :
* Adoption : 12 janvier 1992
* Entrée en vigueur : 25 février 1992
Pour en savoir plus : institutions du Mali
GÉOGRAPHIE
Ce vaste pays (plus du double de la superficie de la France), enclavé, est situé pour la majeure partie dans la zone sahélienne et même saharienne.
Le Nord et le Centre appartiennent au Sahara et à sa bordure ; c'est le domaine de l'élevage nomade (bovins et surtout ovins et caprins), fondement de l'économie d'un pays très pauvre, qui souffre de l'absence de débouché maritime et de ressources minérales notables. Le Sud, plus humide et mis partiellement en valeur par les travaux réalisés dans les vallées du Sénégal et du Niger (Macina), fournit du mil et du sorgho, du riz, du coton, de l'arachide. Le tourisme (Tombouctou, Pays dogon) a été ruiné par le terrorisme islamique et aujourd'hui par l'état de guerre. La population, en quasi-totalité islamisée, est formée, au N., de Sahéliens, blancs, nomades (Maures, Touareg), et, au S., de Noirs (Bambara surtout).
1. Le milieu naturel
1.1. Le relief
Adossé au sud de la Dorsale guinéenne par l'intermédiaire de la retombée septentrionale du Fouta-Djalon, le Mali est centré autour de la cuvette du Niger moyen occidental et pénètre jusqu'au Sahara. C'est un pays plat relevé sur ses bords. Le territoire s'inscrit dans deux vastes triangles juxtaposés, traversés par le cours supérieur du Sénégal environ un tiers de ses 1 700 km) et par le cours moyen du Niger (1 700 km sur 4 200).
La plus grande partie du pays constitue la cuvette du Niger, un vaste ensemble de bassins et de plaines recouverts de dépôts sédimentaires continentaux, pour l'essentiel tertiaires et quaternaires. Au centre sud, le bassin du Macina est occupé par le « delta intérieur » du fleuve Niger.
Au sud, le long de la zone frontalière, des massifs anciens sont disséqués en blocs creusés de gorges profondes et parfois couronnés d'inselbergs. Plus au nord, de part et d'autre du Niger, les plateaux Mandingues à l'ouest et le plateau de Bandiagara à l'est, formés de roches sédimentaires gréseuses anciennes, s'élèvent de 200 à 500 m au-dessus de la plaine du socle par l'intermédiaire de « falaises » verticales. Ces falaises sont des cuestas tournées vers l'extérieur, au relief vigoureux, mais à l'altitude modeste :
– plateaux et falaises de Sikasso et de Bandiagara au sud-est (700 à 800 m en moyenne) ;
– Adrar des Iforas dans le nord saharien ;
– plateaux ou monts mandingues au sud-ouest, avec des falaises et plateaux de grès (700 à 800 m).
Le socle précambrien se dégage en contrebas (bassins de la haute Falémé et du Baoulé), près de la frontière sénégalo-guinéenne. Le plateau de Bandiagara se prolonge vers l'est par les monts du Gourma.
1.2. Le climat
Le climat, tropical, varie du sud vers le nord.
Au sud du 14e parallèle, il est soudanien et soudano-sahélien, avec alternance d'une saison sèche (six à huit mois de l'année, d'octobre-novembre à mai-juin) d'abord fraîche, puis chaude, et d'une saison humide, domaine de la savane. Les précipitations passent de 1 200 à 600 mm. A Bamako, le total annuel des précipitations est de 1 100 mm, qui tombent surtout de juin à septembre, pour une température moyenne annuelle de 28 °C.
Plus au nord, la durée de la saison sèche augmente et les précipitations diminuent encore. Cette zone sahélienne steppique est comprise entre les isohyètes de 100 et de 400 mm (250 000 km2).
Il peut même ne plus pleuvoir tous les ans : de sahélien le climat devient aride dans le Sahara (300 000 km2). L'harmattan, qui souffle vers l'océan durant la saison sèche, accentue l'aridité. A Tombouctou, le total annuel des précipitations est de 225 mm, qui tombent surtout de juin à septembre, pour une température moyenne annuelle de 29 °C. Le Niger introduit cependant un microclimat le long de sa vallée : les écarts thermiques entre le jour et la nuit faiblissent et l'humidité relative est plus forte.
1.3. Les cours d'eau
Le réseau hydrographique regroupe le haut cours du Sénégal et le cours moyen du Niger. Le Sénégal coule à l'ouest du pays, le Niger le traverse du sud-ouest vers le nord-est. Le tracé en boucle du Niger, entamant profondément vers le nord la zone sahélienne et touchant la zone désertique, y apporte localement l'eau et la vie. Le Niger présente de fortes pentes et est coupé de rapides jusqu'à Koulikoro. A partir de Ségou, sa pente devient très faible et, avec son affluent, le Bani, il constitue un vaste delta intérieur. Après le coude de Gao, le Niger quitte la cuvette du moyen Niger occidental pour entrer dans la cuvette du moyen Niger oriental, et sa pente s'accentue de nouveau (rapides d'Ansongo). Son régime reflète assez fidèlement le rythme des précipitations avec des débits faibles à nuls en saison sèche et de hautes eaux en hivernage. Cependant on note un déplacement de la crue dans le temps de l'amont vers l'aval, en raison de la longueur de la distance à parcourir et de la diminution de la pente du lit mineur, notamment dans le delta intérieur, ce qui freine la vitesse des eaux (hautes eaux en août-septembre en amont de Bamako, en janvier seulement à Kahara, port de Tombouctou). Deux biefs sont navigables aux hautes eaux : Bamako-Kouroussa (374 km, juillet-septembre) et Koulikoro-Ansongo (1 300 km, juillet-janvier).
1.4. Les sols
Les meilleurs sols sont dans la vallée du Niger. Ailleurs, ils sont acides et souvent cuirassés.
1.5. La végétation
Dans le Sud, le paysage végétal est celui de la forêt claire ou des forêts-galeries, exploitées pour le bois de construction et les plantes à vertu médicinale. Plus au nord se trouve la savane avec tapis de graminées sous un étage arboré de karités, de nérés et de balanzans. En milieu soudano-sahélien, la savane se peuple d'épineux et passe progressivement à une steppe buissonnante à mimosées ou herbeuse. L'ensemble est bien fourni en baobabs, palmiers-doum et en graminées piquantes, tel le cram-cram. En milieu désertique, toute végétation disparaît et cède la place aux dunes de sable. L'usage domestique du bois et la crise climatique aggravent le processus de désertification. Par contre, les cuvettes profondes du Niger sont envahies par les hautes herbes du « bourgou ».
2. La population et l'économie
2.1. Le peuplement
La population, en quasi-totalité islamisée, est formée, au Nord, de Sahéliens, blancs, nomades (Maures, Touareg) et, au Sud, de Noirs (Bambaras surtout).
Les Bambaras sont les plus nombreux (36 % de la population globale), devant les Peuls (13 %), les Sénoufos (9 %), les Soninkés (8 %), les Dogons (8 %), les Songhaïs (7 %), les Malinkés (6 %), les Dioulas (2 %), les Bwabas (2 %), les Touareg (1 %), les Maures ou Berbères (1 %). Ces découpages ethniques se retrouvent par ailleurs, dans une certaine mesure, dans la répartition socioprofessionnelle : les Bambaras, les Dogons et les Sénoufos sont pour la plupart paysans ; les Bozos, pêcheurs ; les Markas et les Malinkés, traditionnellement commerçants, constituent l'essentiel de la population urbaine ; les Touareg, les Peuls (Foulanis) et les Maures, nomades, sont en majorité éleveurs.
Le caractère désertique ou semi-désertique d'une partie du territoire explique la faiblesse du peuplement (la densité moyenne est inférieure à 15 habitants par km2) et la très inégale répartition de la population. Le rapport entre le Nord, domaine des Touareg nomades (régions de Tombouctou et de Gao), et le Centre-Sud (Ségou, Bamako, Sikasso), voué à l'agriculture sédentaire, est de l'ordre de 1 à 20, mais la densité n'atteint jamais des valeurs très élevées. Le Mali fait preuve, depuis de nombreuses années, d'un fort dynamisme démographique, avec l'un des taux de natalité les plus élevés d'Afrique et un nombre d'enfants par femme très élevé, supérieur à 6. Corrélativement, la population est très jeune (près de la moitié de la population a moins de 15 ans), le taux de mortalité infantile est élevé et l'espérance de vie est faible.
Parallèlement, l'urbanisation s'est accélérée depuis une trentaine d'années. Bamako a vu sa population multipliée par cinq entre 1960 et 1990, et le pays compte plusieurs centres secondaires, comme Mopti, Ségou, Gao, Sikasso, Kayes. Terre très accessible, le Mali a accueilli au cours des siècles des groupes humains venus de tout l'Ouest africain. Inversement, ses habitants font souvent preuve d'une grande mobilité, émigrant facilement au gré des opportunités de travail, mais généralement de façon temporaire. Le Mali est un foyer d'émigration vers la Côte-d'Ivoire, le Sénégal, l'Afrique centrale et la France.
La langue mandingue des commerçants dioulas est très largement parlée – ou au moins comprise – sur la quasi-totalité du territoire. Ces brassages de population ont également favorisé la pénétration de l'islam, aujourd'hui très fortement majoritaire (90 % des Maliens sont musulmans).
2.2. Les langues
La langue officielle est le français. Le bambara est, dans plusieurs régions, la langue véhiculaire.
Trois principales familles de langues africaines sont représentées au Mali :
1) la sous-famille des langues nigéro-congolaises, groupe mandé (bambara, soninké [ou sarakolé], dioula, malinké, xassonké, bobo-fing) ; groupe gur (bobo-oulé, sénoufo, dogon) ; groupe ouest-atlantique (peul) ;
2) la famille nilo-saharienne, sous-famille songhaï-zarma ;
3) la famille afro-asiatique, sous-famille berbère (tamacheq, la langue des Touareg) ; sous-famille sémitique (arabe hassaniya).
2.3. L'agriculture
Pays enclavé, dénué de ressources minérales facilement exploitables, le Mali fonde son économie sur l'agriculture. Il a longtemps été considéré comme le grenier de l'Afrique de l'Ouest, mais la croissance démographique et la sécheresse ont très fortement réduit ses capacités exportatrices.
Le Nord et le centre appartiennent au Sahara et à sa bordure. C'est le domaine de l'élevage nomade (bovins et surtout ovins et caprins), fondement de l'économie d'un pays très pauvre.
Le développement de cultures nouvelles (riz, arachide), à côté des traditionnels mils et sorghos, remonte à la période coloniale. L'Office du Niger, créé au début des années 1930, fut la première opération de développement d'envergure réalisée en Afrique francophone (riz irrigué, auquel s'est ajoutée la canne à sucre). Malgré bien des vicissitudes, il est toujours en activité. L'intervention publique a aussi porté sur l'arachide et, avec beaucoup plus de succès, sur le coton : le Mali est, en effet, devenu le second producteur africain après l'Égypte. Avec l'urbanisation et la mise en service d'avions-cargos sont apparues des cultures maraîchères et fruitières, mais l'exportation de ces productions doit faire face à une âpre concurrence. Les techniques agricoles ont profondément évolué, ce dont témoignent le rapide essor de la culture attelée et l'emploi croissant d'engrais et de pesticides (qui varie, cependant, avec le revenu des paysans). Malgré les aléas climatiques, le cheptel (bovins et surtout ovins et caprins), grande richesse des populations pastorales berbères du Nord (Touareg et Maures), est aujourd'hui reconstitué.
Les trois grands barrages qui ont été édifiés ont donné lieu à de vastes aménagements : Manantali sur le Sénégal, Sélingué et Markala sur le Niger. Le barrage de Markala, qui date de 1934 et draine le canal du Sahel, avait été conçu pour développer la culture du coton, produit dépendant à l'origine des achats du Royaume-Uni. La zone aménagée est peuplée de colons. Le barrage de Manantali, construit pendant les années 1980, intéresse directement les trois pays (Mali, Sénégal, Mauritanie) qui sont regroupés au sein de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS).
2.4. L'industrie
Durant la période socialiste, c'est-à-dire jusqu'à la fin des années 1960, le Mali s'est efforcé de développer son industrie avec l'aide des pays de l'Est et de la Chine. Les entreprises publiques ainsi créées n'étaient guère viables, du fait de nombreuses erreurs de conception et de leur mauvaise gestion administrative. Aujourd'hui, le secteur secondaire se consacre à la transformation des productions locales (rizeries, huileries, tanneries, égrenage du coton) et à la fabrication de biens de consommation courante (boissons, chaussures, cigarettes). Sa part dans le produit intérieur brut reste faible. Les activités « informelles » sont en revanche omniprésentes et fournissent de nombreux emplois, y compris en milieu rural.
Le pays connaît une croissance continue depuis le début des années 2000, tirée par l'expansion des services (télécommunications) et par la production d'or (troisième producteur africain).
2.5. Les transports
Le pays souffre de l'absence de découchés maritimes. Les communications avec l'extérieur constituent un enjeu vital pour le Mali. Elles se sont beaucoup améliorées et diversifiées. Le chemin de fer Dakar-Bamako a perdu son quasi-monopole avec la concurrence de la route et, en particulier, de l'axe Bamako-Abidjan. Le « bitume » relie aussi la capitale malienne au Nigeria, via le Burkina et le Niger. D'importants investissements chinois sont réalisés. Les échanges transfrontaliers, qui échappent en grande partie aux statistiques, sont considérables. Ils s'appuient sur des réseaux commerciaux complexes et efficaces, capables de réagir très rapidement aux événements (variations du change, par exemple).
2.6. Les ressources minérales
Le pays souffre de l'absence de ressources minérales notables. Des gisements d'or sont exploités dans l'ouest et dans le sud-ouest. Le Mali est le troisième producteur d'or d'Afrique, derrière l'Afrique du Sud et le Gabon. L'or représente 15 % du produit intérieur brut et constitue la principale exportation depuis 2011.
2.7. Le tourisme
Le tourisme (Tombouctou, Pays dogon) est mis à mal par la progression du terrorisme islamiste.
Les sites du Mali inscrits à l'Unesco
Le Mali compte quatre sites classés au patrimoine mondial de l'Unesco :
– Tombouctou ;
– villes anciennes de Djenné ;
– falaises de Bandiagara (Pays dogon) ;
– tombeau des Askia.
2.8. Un pays dépendant
Le secteur industriel – traditionnellement peu développé – devrait se doter à court terme d'unités de transformation et de valorisation du coton. Peu urbanisé et connaissant un accroissement démographique annuel élevé, une balance commerciale toujours déficitaire et un fort endettement extérieur, le pays dépend très largement de l'aide internationale et de l'argent envoyé par ses ressortissants à l'étranger.
DOCUMENT larousse.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
BOUDDHISME |
|
|
| |
|
| |

DOCUMENT larousse.fr LIEN
bouddhisme
Consulter aussi dans le dictionnaire : bouddhisme
Religion et philosophie se réclamant de l'enseignement du Bouddha qui, bien que fidèle pour l'essentiel à la pensée du fondateur, s'est diversifiée dans l'espace asiatique au cours des temps.
Le bouddha shakyamuni
La vie
L'historicité du bouddha Shakyamuni, le Bouddha par excellence, n'est plus contestée ; les sources essentielles de sa biographie se trouvent dans les textes émanant des premières écoles du hinayana.
Le Bouddha naît au vie s. avant J.-C. à Kapilavastu, à 240 km au nord de Bénarès ; il est le fils de Shuddhodana, un roi de la lignée des Gautama et du clan des Shakya – d'où le nom de Shakyamuni, le moine des Shakya, souvent donné au Bouddha –, et de la reine Maya, morte sept jours après sa naissance.
Très vite, il a la révélation de la souffrance, quitte son foyer et mène une vie d'ascète errant ; il devient dès lors un bouddha, c'est-à-dire un « illuminé », l'homme qui renonce au monde pour chercher la voie de la délivrance et pour se libérer de l'emprise de la douleur.
Il s'entraîne d'abord aux pratiques enseignées par les brahmanes : mais leurs austérités effrayantes ne provoquent pas la lumière à laquelle il aspire. C'est, semble-t-il, à Gaya (Bodh-Gaya) que, au cours d'une longue période de recueillement, il achève son itinéraire spirituel : c'est le « suprême et complet éveil », l'« illumination » (abhisambodhi).
Son premier sermon, le Bouddha le prononce probablement dans la banlieue nord de Bénarès : c'est là qu'avec cinq moines il fonde la première communauté bouddhiste. Puis, pendant une quarantaine d'années, il parcourt l'Inde du Nord-Est, en prêchant sa doctrine et en faisant d'innombrables disciples. Il s'éteint à quatre-vingts ans, à Kushinagara (à 175 km de Patna) ; il entre alors dans le mahaparinirvana (la « grande totale extinction »).
Les documents sont d'accord sur les qualités exceptionnelles du Bouddha : noblesse de caractère, maîtrise de soi, fermeté tempérée par une immense bonté.
La doctrine
Le Bouddha ne prêche pas une religion – lui-même rejette tous les systèmes et tous les dogmes –, mais une morale, une éthique, une « philosophie vécue », également éloignée des plaisirs et des mortifications.
Quatre « nobles vérités » constituent l'essentiel de cette « voie ».
La première est que tout est douleur : la douleur tient à l'état même des choses ; elle imprègne et détermine la vie de tous les êtres, dont les éléments, de durée limitée, sont vides de tout principe personnel et éternel. La notion universelle de vacuité, qui constitue le fond de la pensée bouddhique, est incompatible avec la notion d'une âme individuelle, essence de la personnalité, et avec la croyance en un principe absolu et éternel. La mort entraîne nécessairement une nouvelle naissance, donne le branle à un nouveau cycle.
La deuxième vérité a trait à l'origine de la douleur, qui est la « soif », désir de jouissance, d'existence ou d'anéantissement, désir qui est inséparable de l'ignorance, et plus précisément de l'ignorance de la réalité telle que le Bouddha la dévoile. Cette soif et cette ignorance engendrent les « trois racines du mal » : la convoitise, la haine et l'erreur, qui, elles-mêmes, donnent naissance aux vices, aux passions, aux opinions erronées.
La troisième vérité est la suppression du désir, la cessation de la douleur, proche du nirvana (« état d'absence ») et de la délivrance absolue. Chacun atteint ce but différemment selon ses propres aptitudes. Le moine bouddhique, qui a parfaitement dominé la convoitise, la violence et l'erreur, l'atteint dès ici-bas ; aussi ne reviendra-t-il qu'une fois en ce monde, à moins que sa perfection ne lui octroie d'apparaître dans un monde supérieur. Le saint entre de son vivant dans le « nirvana de sainteté avec conditionnement restant » ; en mourant, il atteint le « nirvana sans conditionnement ». Quant au laïque converti au bouddhisme, il s'assure un nombre limité de re-naissances ici-bas en vénérant les « trois joyaux » (triratna) : le Bouddha, sa loi, sa communauté.
La quatrième vérité est la voie (marga) qui mène à la cessation de la douleur. Cette voie de la délivrance s'appelle aussi la « sainte voie aux huit membres », qui sont les huit aspects de la perfection de l'opinion, de l'intention, de la parole, de l'activité corporelle, des moyens d'existence, de l'effort, de l'attention et de la concentration mentale.
Une discipline morale, alliée à des exercices psycho-physiologiques favorables à la concentration spirituelle, est l'aide indispensable sur la voie de la sainteté, l'ultime étape étant l'« éveil » (bodhi).
Évidemment, cette discipline ne peut être pratiquée que par des hommes ayant quitté leur foyer. Tout en rejetant les mortifications inutiles, le Bouddha exige des moines une existence austère dans son déroulement journalier, dans la tenue, les ressources (mendicité), le rythme (prédication, itinérance). Cette existence a été précisée dans ses moindres détails par le Bienheureux, qui a, en outre, codifié les châtiments selon la responsabilité de chacun.
Le bouddhisme indien
L'évolution
Aucune transmission écrite ne se fait du vivant du Bouddha ; la première communauté bouddhique (sangha) ne possède ni canon ni règle stricte. Après le parinirvana (478 ? avant J.-C.), la nécessité d'unifier l'exposé des doctrines du Bouddha se fait sentir.
C'est pourquoi s'organisent alors différents conciles ; le plus important, qui se tient à Rajagriha (477 ? avant J.-C.), sous la direction du moine Kashyapa, rassemble les données tirées des discours du Bienheureux pour former le premier noyau des Écritures canoniques en pali. Il s'agit d'un triple exposé doctrinal sur la discipline monastique (vinaya), les paroles du Bouddha (sutra) et la métaphysique (abhidharma).
Des sectes se créent par la suite, dont plusieurs conciles (Vaishali au ive s. avant J.-C., Pataliputra au iiie s. avant J.-C.) ne peuvent endiguer la multiplication.
Les sectes bouddhiques se diversifient progressivement jusqu'à ce qu'un schisme intervienne au début de l'ère chrétienne. Alors, au bouddhisme traditionaliste, appelé le hinayana, s'oppose un bouddhisme réformiste, appelé le mahayana, qui prétend rester fidèle à l'enseignement du Bouddha. Quant au tantrisme bouddhique, il émerge tardivement vers le vie s. de notre ère.
Le hinayana
Le hinayana est, aux dires de ses adversaires, le « moyen inférieur de progression » (le « Petit Véhicule »). Les écoles anciennes qui s'y réfèrent appartiennent à deux branches sorties, au ive s. avant J.-C., du tronc primitif du bouddhisme : la branche sthavira et la branche mahasanghika. À la branche sthavira appartiennent trois rameaux majeurs : les theravada (« opinion des Anciens »), fidèles à la tradition palie, qui formeront l'Église de Ceylan et s'implanteront durablement dans l'Asie du Sud-Est ; les sarvastivadin, qui donnent la prééminence à l'abhidharma et sont illustrés surtout par Vasubandhu, lequel vécut au Cachemire au ive s. ou au ve s. après J.-C. ; les vatsiputriya, qui essaient de concilier la conception de l'atman avec celle de l'impermanence de la personnalité.
Quant aux mahasanghika, apparus au ive s. avant J.-C., ils affirment que les bouddhas possèdent une substance réelle. En cela ils annoncent le mahayana.
Le mahayana
Ce mouvement se veut réformiste et évolué : c'est le « grand moyen de progression » (le « Grand Véhicule »). À la « méthode pratique » pour l'arrêt de la douleur, proposée par le bouddhisme ancien, il veut substituer une « religion » de salut qui fait une large place au sentiment, à la spéculation et aussi à la dévotion. Autour de la théorie des « trois corps » du Bouddha (corps corruptible, corps d'esprit et corps de la loi), la bouddhologie devient métaphysique et philosophique.
Le mahayana, considérant qu'un grand nombre d'êtres peut aspirer au salut, peuple l'univers d'une multitude de bouddhas simultanés et surtout de bodhisattvas (êtres qui ont franchi plusieurs degrés dans la perfection et qui sont destinés à devenir bouddhas). Il conçoit la sainteté non comme un idéal individuel de perfection, mais comme une carrière visant à entraîner les autres créatures vers le salut.
Le mahayana, qui s'est surtout développé dans le nord de l'Inde (d'où il gagnera le Tibet, la Chine et le Japon), a donné un immense essor à la philosophie et à la dialectique indiennes ainsi qu'à toute une mythologie proche de celle du panthéon brahmanique.
Cette mythologie, repoussant à l'arrière-plan le Bouddha historique, se concentre sur les bodhisattvas Maitreya, Manjushri, Avalokiteshvara, etc., voire des divinités féminines auxiliatrices, les Tara.
Les écoles mahayaniques sont mieux connues que les écoles anciennes en raison de leur effort de propagande : l'école des madhyamika, fondée par Nagarjuna (fin du ier s. ou début du iie s. après J.-C.) et celle des vijnanavadin ou des yogacarin (« qui pratiquent le yoga »), fondée par Asanga, sont parmi les plus célèbres.
Le tantrisme
Le tantrisme est moins une doctrine qu'un mode de doctrine, superposant des éléments bouddhiques et brahmaniques. Tout en enseignant la dévotion à cinq bouddhas « vainqueurs » et aux bodhisattvas, il donne une grande importance à la mystique de « l'énergie » féminine (Tara bouddhique, Shakti shivaïte).
Le tantrisme, qui prend forme au vie s. de notre ère avec un ensemble de texte, les tantra, se distingue du bouddhisme traditionnel par ses méthodes propres dans la réalisation des rapports entre l'homme et l'univers. Ces méthodes ressortissent au yoga (« le fait de lier, d'atteler »), qui amène au contrôle des organes et du psychisme. Le tantrisme est mêlé aussi de magie et de cosmogonie ; son rituel, souvent fantastique, est fondé sur des rites ésotériques, la méditation et l'iconolâtrie.
Le tantrisme, qui influence le développement du bouddhisme en Asie du Sud-Est, se développe surtout au Bengale, d'où les invasions musulmanes le chassent au xiiie s., puis au Népal et au Tibet.
L'expansion du bouddhisme
Le bouddhisme indien reçoit une impulsion nouvelle du fait de la conversion de l'empereur Ashoka (vers 250 avant J.-C.). Dès lors, son expansion est favorisée par des missions tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Empire. C'est du règne d'Ashoka que date l'introduction du bouddhisme à Ceylan. Kanishka, monté sur le trône vers 145 après J.-C., pratique la même politique qu'Ashoka : sous son règne, un concile bouddhique se serait tenu au Cachemire.
Au début de notre ère, le bouddhisme est introduit en Chine par la route du Turkestan oriental. Déjà il a atteint la frange orientale du monde hellénistique et s'est étendu en Asie centrale.
L'apogée du bouddhisme indien se situe durant le règne de la dynastie Gupta (ive-ve s. après J.-C.). Jusqu'à la fin du règne d'Harsha de Kanauj (?-647), les sectes du mahayana s'épanouissent en même temps que l'hindouisme classique. Des lieux saints comme Nalanda et Gaya sont des centres très fréquentés de pèlerinage et de pensée.
Le bouddhisme s'installe au Viêt Nam, dans la presqu'île indochinoise et la presqu'île malaise à partir du iiie s. avant J.-C., en Corée en 372, en Insulinde au ve s., au Japon au vie s., au Tibet au viie s.
Parallèlement à sa diffusion en Asie, il subit dans sa patrie d'origine, l'Inde, un déclin irrémédiable, qui est dû notamment au foisonnement des sectes face à un hindouisme vigoureux, aux bouleversements consécutifs à la disparition des Gupta et surtout à l'avance de l'islam.
Le bouddhisme japonais
Introduction
Le bouddhisme japonais appartient pour l'essentiel aux philosophies religieuses des sectes du mahayana, lequel est parfois appelé « bouddhisme du Nord ». Cependant, le bouddhisme japonais diffère assez fortement des formes de bouddhisme élaborées sur le continent asiatique, tant dans ses conceptions de la philosophie que dans la représentation qu'il donne des divinités et des « forces » vénérées par ses nombreuses sectes et « écoles ». Ces dernières, après l'effort de syncrétisation fourni à partir du début du ixe s., attribuent aux images traditionnelles venues de l'Inde, par le truchement de l'Asie centrale, de la Chine et de la Corée, des valeurs quelque peu différentes de celles qu'elles avaient à l'origine. Les religieux des diverses sectes importées de Chine ou qui se créent par la suite au Japon ainsi que leurs fidèles conçoivent la divinité et son cortège divin de manières fort diverses. Une fois de plus confronté à un autre peuple et à un autre folklore, le bouddhisme prend au Japon des formes tout à fait particulières.
La plupart des formes, souvent théoriques, des diverses divinités du bouddhisme japonais se trouvent représentées sur des mandala (en japonais mandara), ou « diagrammes cosmologiques », ainsi que les formes divines peu courantes et, pour la plupart, non représentées au Japon, qui sont décrites dans toutes sortes de textes bouddhiques (sutra en sanskrit et kyo en japonais) indiens, tibétains, chinois ou japonais. Les représentations du bouddhisme japonais relèvent en grande partie (surtout à partir du ixe s.) de la tradition du bouddhisme ésotérique. Nombre d'entre elles se trouvent rassemblées dans les deux grands mandala de la secte shingon (Ryoka mandara ou « mandala des Deux-Mondes ») : le Kongokai mandara (Vajradhatu mandala, du « Monde de l'esprit ») et le Daihitaizosho mandara (ou Taizo-kai mandara), correspondant au Mahakarunagarbha mandala (Garbhadhatu mandala, du « Monde des manifestations »). Les divinités n'appartenant pas à ces deux mandala majeurs participent soit de la tradition du bouddhisme ancien (nous entendons par là celui des écoles introduites au Japon antérieurement au ixe s.), dans lequel on trouve déjà certains éléments ésotériques – on parle à ce sujet de komikkyo, ou « ésotérisme ancien » –, soit à des formes du bouddhisme ésotérique (amidisme, zen, etc.), soit encore du bouddhisme populaire, très souvent syncrétique et mêlé de shinto.
L'introduction du bouddhisme au Japon
Vers 538 de notre ère (certains préféreraient la date de 552), le roi de Kudara (du royaume de Paikche en Corée) envoya au souverain du Yamato (alors établi à Asuka, dans la préfecture actuelle de Nara) une lettre dans laquelle il exposait l'excellence des principes du bouddhisme et demandait de l'aide contre son trop entreprenant voisin, le royaume de Silla. Avec cette lettre, que présentait une délégation de lettrés et de religieux bouddhistes, se trouvaient plusieurs rouleaux des Saintes Écritures (rédigées en chinois), une image en bronze du Bouddha, peut-être d'autres en bois, des bannières et divers objets de culte… Ainsi, le bouddhisme pénétra-t-il, officiellement du moins, dans les îles japonaises. En fait, il est probable que des bribes de cette doctrine philosophique y avaient fait leur apparition bien avant cette date, apportées par des réfugiés coréens et des Japonais revenus du protectorat sur l'État de Mimana en Corée. Mais, manquant de soutien officiel, cette nouvelle religion n'avait pu se propager et ne comptait probablement que fort peu de fidèles en 538.
Certains clans locaux se convertirent à la foi nouvelle, y voyant un facteur de progrès capable de les aider à supplanter leurs rivaux, et commencèrent à utiliser le savoir et le talent des religieux, des artistes et des artisans revenus nombreux de Corée après que le Mimana eut échappé définitivement (en 562) aux souverains du Yamato.
Mais d'autres s'opposèrent farouchement à l'adoption du bouddhisme en tant que religion d'État, et deux partis se formèrent bientôt, plongeant le pays, déjà déchiré par les luttes d'influence opposant les clans entre eux, dans une confusion encore plus grande. Les uns, dirigés par le clan des Nakatomi, auquel appartenaient les prêtres shinto qui officiaient à la Cour, étaient de farouches partisans de la religion indigène, le shinto, tandis que les autres, à la tête desquels se trouvait le clan des Soga dirigé par le Premier ministre Iname, se montraient partisans des réformes « à la chinoise » et de l'adoption du bouddhisme. D'âpres luttes s'ensuivirent, qui se terminèrent en 587 par la destruction des clans tenant du shinto. La Cour se convertit alors au bouddhisme, ainsi qu'un certain nombre de familles nobles.
Un fils de l'empereur Yomei, le prince Umayado, devenu régent, devait devenir célèbre sous le nom de Shotoku Taishi. Fervent bouddhiste, Shotoku établit fermement sa religion à la Cour. Les autres clans se rallièrent alors de plus en plus nombreux et commencèrent d'embrasser la nouvelle religion – tout au moins de façon formelle. Les relations avec la Chine et la Corée de Silla furent renouées, et de nombreux missionnaires coréens traversèrent les détroits. Le prince Shotoku recommanda alors le bouddhisme dans sa « Constitution en dix-sept articles » (Jushichijo-no-Kempo), la première du Japon (probablement rédigée après sa mort en 622), en ces termes : « Vénérez de tout cœur les trois trésors que sont le Bouddha, le dharma (la loi bouddhique) et le sangha (la communauté des moines), car dans ceux-ci se trouvent la vie idéale et la sagesse de la nation. »
Le peuple japonais, encore quelque peu méfiant à l'égard du bouddhisme, au fur et à mesure des réformes apportées par l'esprit de cette nouvelle religion, commença d'y porter de l'intérêt. À partir de 607, Shotoku envoya en Chine plusieurs missions qui devaient rapporter les connaissances astronomiques, architecturales et administratives de l'époque des Sui (Souei [581-618]), ainsi que des œuvres littéraires et religieuses.
C'est ainsi qu'arrivèrent au Japon un grand nombre de textes bouddhiques ainsi, d'ailleurs, que nombre de pratiques taoïstes et de maximes confucéennes. Le prince-régent lui-même se voua à la propagation du bouddhisme et écrivit des commentaires fort savants sur trois sutra importants (Saddharmapundarika sutra, Hokke-kyo, Sutra du lotus de la Bonne Loi ; Vimalakirti sutra, Yuimakyo, Discussions de Vimalakirti sur la Doctrine ; Shrimala sutra, Shomangyo), lesquels illustraient la doctrine du salut et pouvaient ainsi fournir à son peuple les fondements d'une éthique. Enfin, il fit ériger plusieurs temples par des architectes venus de Corée, temples dont certains demeurent encore, comme ceux du Horyu-ji, près de Nara, et du Shitenno-ji, à Osaka, qui sont les témoins les plus admirables du génie de son gouvernement. Il multiplia également les fondations pieuses. À sa mort, en 622, si l'on ajoute foi aux dires du Nihongi (chronique historique rédigée en 720), il y avait au Japon 46 temples, 816 religieux et 569 religieuses… La promulgation, en 645, du code de l'ère Taika, code administratif calqué sur le modèle chinois, faisait une large part au bouddhisme. Par sa ferveur, l'empereur Tenchi (661-671) contribua encore à sa propagation dans les provinces. À cette époque, on ne pouvait encore parler de sectes au Japon. Le bouddhisme consistait alors, pour une bonne part, en adoration ou vénération de reliques (shari) et n'était pas tenu, en ce qui concerne ses applications pratiques, pour très différent du shinto : « Il était surtout apprécié pour ses pouvoirs magiques et de protection, particulièrement dans la prévention et la guérison des maladies » (E. W. Saunders). À la Cour, des sutra étaient lus afin de faire tomber la pluie, et les pratiques bouddhiques étaient souvent mêlées à des pratiques appartenant à des croyances populaires et au shinto.
Cependant, on continuait d'élever des temples pour abriter les saintes images de Shaka (le bouddha Shakyamuni), de Miroku (Maitreya, le bouddha du futur), de Kannon Bosatsu (Avalokiteshvara, le bodhisattva de miséricorde), de Yakushi Nyorai (Bhaisajyaguru, le bouddha-médecin des âmes et du corps), d'Amida Nyorai (Amitabha, le bouddha de l'au-delà), etc., et les moines commençaient à approfondir les diverses doctrines bouddhiques en étudiant les manuscrits religieux rapportés de Chine et de Corée.
Le bouddhisme « national », comme on appelait alors la doctrine prônée par le clan des Soga et par Shotoku Taishi, allait bientôt devenir, à l'imitation du bouddhisme de Chine, celui des sectes. Le changement de capitale, transférée d'Asuka et de ses environs à Nara en 710, allait, par le développement des temples et des monastères de la nouvelle ville impériale, favoriser la floraison de ces sectes. Le prince Shotoku avait étudié les doctrines du sanron (madhyamika) et du jojitsuron (satyasiddhishastra) sous la direction des maîtres coréens Eji, Eso et Kanroku. En 653, le religieux Dosho, appartenant au temple du Gango-ji, se rendit en Chine, où il fut l'élève du célèbre pèlerin chinois Xuanzang (Hiuan-tsang), appelé Genjo en japonais, et, à son retour, transmit la doctrine du hosso (madhyayana) au moine Gyogi (670-749). En 658, les Japonais Chitsu et Chitatsu allèrent à leur tour en Chine, où ils furent aussi les disciples de Xuanzang, et rapportèrent une traduction chinoise de l'Abhidharmakoshashastra. Mais aucune secte ne s'établit véritablement au Japon avant que la capitale ne fût définitivement installée à Nara.
Le bouddhisme des sectes de Nara (710-794)
Introduction
Toujours plus de religieux japonais se rendaient en Corée et en Chine, malgré les périls du voyage, et ils en revenaient chargés de textes nouveaux et d'objets de piété. Avec les temples régionaux (kokubun-ji) édifiés par ordre impérial à partir de 741, le bouddhisme se répandit dans tout le pays. En 749, à la suite d'une épidémie de variole qui avait ravagé la contrée et contre laquelle les prières aux kami shinto avaient été inopérantes, une colossale statue en bronze du bouddha Vairocana (Daibutsu, Dainichi Nyorai) fut fondue et installée dans le temple du Todai-ji à Nara, afin qu'il puisse la faire cesser, le bouddha étant alors considéré comme le protecteur de l'État.
Les cultes shinto n'étaient pas pour autant relégués au second plan : à la Cour, les cérémonies impériales étaient toujours faites par les prêtres, et une sorte de syncrétisme shinto-bouddhique commençait de naître. Une tradition (qui paraît tardive) rapporte que Gyogi avait été lui-même demander au grand kami shinto du soleil, Amaterasu Omikami, en son sanctuaire d'Ise, la permission d'élever le grand bouddha du Todai-ji… Dès le début du viiie s., cependant, des tendances diverses étaient apparues au sein du bouddhisme « national », et bientôt naquirent à Nara six sectes dont chacune fondait sa doctrine sur un ou plusieurs textes religieux.
Kusha-shu
La doctrine de cette secte appartenait encore au bouddhisme des écoles anciennes connu sous le nom de « Petit Véhicule » (hinayana). Fondée sur le texte de l'Abhidharmakoshashastra (Kusharon), composé par le moine indien Vasubandhu (Seshin en japonais) au ive s. ou ve s., elle enseigne un matérialisme admettant à la fois la matière et l'esprit, lesquels constituent selon elle une personnalité illusoire formée de cinq agrégats (skanda) : la forme (rupa), composant la matière, la sensation (vedana), la perception (samjna), le concept (samskara) et la connaissance, composant l'esprit. Selon cette doctrine, l'être consistant en ces cinq agrégats, il ne peut exister de « moi » en dehors de ceux-ci : il s'ensuit que seuls ces agrégats existent et sont réels, ainsi que les dharma, ou « conditions de l'être » …
Jojitsu-shu
Cette secte suit une école plus radicale que la précédente dans sa critique, qui refuse d'admettre l'existence des agrégats et les dharma. Sa doctrine est fondée sur le Satyasiddhishastra (Jojitsuron, « Livre de la perfection de la Vérité »), écrit vers le début du iiie s. par le moine indien Harivarman (Karibatsuma en japonais).
Ces deux écoles ne furent pas considérées au Japon comme des sectes véritablement indépendantes, celle du kusha étant identifiée à une branche de la secte hosso et celle du jojitsu étant une branche de la secte sanron.
Hosso-shu
École intermédiaire entre celles du hinayana et du mahayana, la secte hosso (madhyayana ou du « Moyen Véhicule ») enseigne que rien n'existe en dehors de la pensée, qui, seule, est réelle. Elle est fondée sur la philosophie de l'école indienne des yogacarin, créée au ve s. par Asanga (Muchaku), et sur le texte, écrit par ce dernier, du Yogacaryabhumishastra (Yugashijiron, « Traité sur le yoga »), traduit en chinois par Xuanzang, dont l'élève Dosho (628-700) transmit les enseignements au moine Gyogi.
Sarron-shu
Adepte de l'école du madhyamika (de la Voie du Milieu), fondée par le moine indien Nagarjuna (Ryuju) au iie s., la secte sanron fonde son enseignement sur quatre textes principaux : le Madhyamikashastra (Churon) de Nagarjuna, traduit en chinois en 409 par Kumarajiva ; le Dvadashadvarashastra (Junimonron, « Traité des onze portes »), traduit aussi par Kumarajiva ; le Satashastra (Hyakuron, « Traité des cent vers »), écrit par Aryadeva, élève de Nagarjuna ; le Prajnaparamitashastra (Daichidoron, « Traité de la grande sapience ») de Nagarjuna. La doctrine de cette école, dite encore « des enseignements de toute la vie du Bouddha » (ichidaikyo-shu), fut, en 625, importée au Japon, au temple du Gango-ji, par le moine coréen Ekan. Selon cette doctrine, « la vérité absolue n'est ni l'être ni le néant ; elle est indépendante de ce couple, c'est-à-dire qu'elle est insaisissable » (R. Fujishima).
Ritsu-shu
Cette secte, qui relève à la fois du Petit et du Grand Véhicule, entre lesquels elle semble jeter un pont, met principalement l'accent sur la nécessité de la discipline (vinaya, ritsu), qui, seule, selon elle, peut permettre au fidèle d'atteindre l'état de bouddha. Elle se développa surtout en Chine, se réclamant de la Dharmaguptavinaya (Shibunritsu, « Règle en quatre parties »), composée par Daoxuan (Tao-hiuan [596-667]), appelé Dosen ou encore Nanzan Rishi en japonais. Le moine Ganjin, venu de Chine en 754, introduisit au Japon le rite de l'ordination monastique de cette secte au monastère du Todai-ji, à Nara, à celui du Kanzeon-ji, à Tsukushi, et à celui du Yakushi-ji, dans la préfecture de Tochigi.
Kegon-shu
La « doctrine de l'argumentation fleurie » (kegon-shu) traite surtout de l'état non conditionné des choses, toute chose provenant, selon elle, de la nature absolue de la bhutatathata, « Nature absolue » ou encore « Nature du Bouddha ». Elle fut fondée en Chine par Fazhun (Fa-tchouen [557-640]) sur le texte de l'Avatamsaka sutra (Kegon-kyo). La secte kegon japonaise, quant à elle, se fonde sur une traduction du Dashabhumivibhashashastra (Jujibibasharon, « Shastra de l'explication en dix parties »). Elle fut introduite au Japon en 736 par le moine Dosen (703-762), un maître chinois de l'école de Discipline (vinaya), bien qu'une tradition assure que ce fut par Bodhisena, un brahmane indien.
Les doctrines philosophiques de ces six sectes ou écoles, très ardues, ne furent vraisemblablement comprises, en dehors du milieu des moines, que par quelques personnes appartenant à l'aristocratie japonaise ; le peuple, il va de soi, se sentait étranger à leurs spéculations. Certaines notions, cependant, indépendantes des doctrines purement philosophiques, s'imposèrent à lui, comme celle de la rétribution des actes par la loi nécessaire de cause (in) à effet (ka), « la cause et l'effet n'étant pas séparables », ainsi que celle de la croyance en la puissance salvatrice des divinités, principalement de celle des grands bouddhas (Tathagata, Nyorai en japonais) et des grands saints qui ont renoncé à l'état de bouddha pour aider l'humanité, les bodhisattvas (bosatsu).
Le bouddhisme de l'époque de Heian (794-1185)
Introduction
Lors de l'établissement de la nouvelle capitale de Heian-kyo (Kyoto) en 794, l'empereur Kammu, désirant peut-être s'affranchir de la pression qu'exerçaient sur la politique les moines de Nara, prit des mesures énergiques afin de limiter la prolifération des temples et des religieux. Afin de rénover le bouddhisme japonais et de le divulguer plus largement parmi les laïcs (le bouddhisme de Nara était surtout un bouddhisme de moines), il envoya en Chine des religieux dissidents pour y rechercher de nouvelles doctrines. En 805, Saicho (de son nom posthume Dengyo Daishi [767-822]) revenait du mont Tiantai en Chine, et fondait au Japon, sur le mont Hiei (où il avait, avant son départ, érigé un ermitage dont le dessein était de protéger la nouvelle capitale des mauvaises influences du Nord-Est), avec le patronage de la Cour, un monastère où il enseigna les doctrines de la secte du tendai (du nom japonisé de la montagne chinoise où il avait étudié). Un autre moine, Kukai (de son nom posthume Kobo Daishi [774-835]), revenu un an après, rapportait, lui aussi, les éléments doctrinaux d'une autre secte chinoise, celle du shenyan (shingon en japonais).
Dix ans plus tard, il fondait sur le mont Koga, au sud de Nara, une secte du bouddhisme ésotérique (mikkyo) dite « du mantra », ou « de la Vraie Parole » (shingon). Le bouddhisme des écoles de Nara, sans être abandonné, fut, cependant, obligé de céder progressivement la place aux deux nouvelles sectes qui, en marge de leur enseignement, prônaient le syncrétisme partiel du bouddhisme avec le rituel et les croyances du shinto. La divinité solaire shinto, le kami Amaterasu Omikami, ancêtre de la famille impériale du Japon, fut alors identifiée avec le grand bouddha solaire de Lumière et de Vérité Mahavairocana (Dainichi Nyorai), et les autres divinités du shinto furent considérées comme étant des « incarnations temporaires » ou « descentes » (gongen) des divinités bouddhiques. Le peuple était ainsi mis plus à même de se familiariser avec le bouddhisme. Alors que le syncrétisme shinto-bouddhique du shingon prit le nom de « ryobushinto », ou « shinto des deux parties de l'univers », celui de la secte tendai fut nommé « ichijitsu-shinto » ou « shinto de l'Unique Vérité ».
Cependant, les doctrines des deux sectes étaient encore trop hermétiques pour la plupart des gens du commun. Il s'ensuivit une réaction tendant à faire du bouddhisme une religion plus simple encore et praticable par tous, fondée sur l'adoration seule et qui était susceptible d'offrir une possibilité de salut même aux plus déshérités des hommes : ce fut l'amidisme, du nom du bouddha Amida (Amitabha). Cette nouvelle religion, issue du bouddhisme traditionnel, fut tout d'abord préconisée par un moine de la secte du tendai, Genshin ou Eshin (942-1017), puis prêchée par d'autres, comme Kuya Shonin. Le bouddhisme de la période de Heian se partagea dès lors entre ces trois tendances, les deux premières mettant l'accent sur l'ascèse, la méditation et le mysticisme ésotérique, la dernière ouvrant à tous l'accès facile au paradis d'Amida. La croyance au mappo, ou « période finale de la Bonne Loi », qui, selon les interprétations des données de certains sutra, devait marquer la troisième période d'un cycle bouddhique débutant en 1052 et qui prédisait pour cette date désordres et calamités en grand nombre, fit que beaucoup de dévots se vouèrent à l'adoration d'Amida, seul réputé capable de les sauver dès cette vie-ci et de leur apporter en son Paradis de la Terre pure (jodo) la paix et la félicité éternelles.
Tendai-shu
Tirant son nom de la montagne Tian tai, en Chine, où elle avait pris naissance, la secte japonaise du tendai fut établie au monastère de l'Enryaku-ji, sur le mont Hiei (Hieizan), par le moine Saicho, élève de Dao Sui (Tao Souei), et par un de ses condisciples, le moine Gishin (de son nom posthume Shuzen Daishi). En 838, le moine Ennin (de son nom posthume Jikaku Daishi [794-864]) partit à son tour en Chine afin d'en rapporter des textes et de nouveaux enseignements ; il fut suivi en 851 par Enchin (Chisho Daishi [814-891]). Deux lignes de transmission de la doctrine du tendai furent alors suivies au Japon : celle de Saicho au mont Hiei et celle d'Enchin au Mi-i-dera. De nombreuses sous-sectes en émanèrent à leur tour. La doctrine du tendai est essentiellement fondée sur trois textes : le Saddharmapundarika-sutra (Hokke-kyo, « Sutra du lotus de la Bonne Loi »), le Nirvana sutra (Nehangyo, « Sutra du nirvana ») et le Mahaprajnaparamita shastra (Daichidoron, « Traité de la grande vertu de sapience »). La secte du tendai est aussi parfois appelée du nom de « hokke-shu » (secte du Lotus) en raison de la vénération qu'elle porte à son sutra principal et aux commentaires de celui-ci, sur lesquels elle fonde sa doctrine.
L'essentiel de cette dernière repose sur la conception des « cinq périodes », des « huit doctrines » et des « trois corps » du Bouddha. Les « cinq périodes » (qui sont admises par toutes les doctrines bouddhiques) correspondent, selon le tendai, aux cinq phases successives de l'enseignement du Bouddha, des doctrines du Petit Véhicule, de celles du Grand Véhicule, de la « perfection de la sapience » et des prêches de la vérité définitive. Les « huit doctrines » correspondent aux enseignements exotériques, à ceux du « Petit Véhicule », du « Grand Véhicule » et du hokke-kyo. Les « trois corps » sont les trois aspects que prend le Bouddha : en tant que « corps d'essence » (dharmakaya, hosshin), qui représente le Bouddha existant comme Idéal ou Principe, c'est-à-dire sans existence personnelle ou historique ; en tant que « corps de fruition » (sambhogakaya, hoshin, juyushin), qui représente le corps obtenu par le Bouddha comme effet des actions passées et comme il se manifeste aux bodhisattvas ; et en tant que « corps de métamorphose » ou de « correspondance » (nirmanakaya, oshin, ojin, keshin), qui représente l'aspect que le Bouddha peut assumer pour sauver tous les êtres. Tous les bouddhas, il va de soi, possèdent simultanément ces trois « corps ». Cependant, le grand bouddha solaire Vairocana (Dainichi Nyorai) est vénéré sous l'aspect d'un « corps d'essence », tandis que le bouddha historique Shakyamuni l'est sous celui d'un « corps de métamorphose » …
L'absolu, selon les doctrines du tendai, ne peut être atteint que par une longue instruction dans la loi et à la suite d'une pratique ardue de la méditation. Cependant, des tendances à l'ésotérisme commencèrent très tôt à se développer dans les doctrines de la secte du tendai, peut-être sous l'influence du shingon, surtout après le retour du moine Ennin, tendances qui, une fois acceptées, furent considérées comme des aspects différents d'un même enseignement : tout ce qui existe possède la « nature de bouddha », et l'Absolu comme le Relatif, la Matière comme l'Esprit procèdent de la même Essence.
Shingon-shu
Ainsi que nous l'avons déjà vu, la doctrine du shingon fut rapportée de Chine en 806 par le moine Kukai (774-835), après qu'il en eut reçu l'enseignement du maître chinois d'ésotérisme Huige, (Keika en japonais). En Chine, celui-ci aurait reçu d'Amoghavajra, un sage indien, la « clé » de l'enseignement du shingon. Cette doctrine est essentiellement fondée sur l'interprétation du « mandala des Deux-Mondes » (Ryo-kai mandara), que Kukai a exposée dans ses essais critiques. D'après les doctrines du shingon, le fidèle peut obtenir dès cette vie-ci l'état de bouddha, à la condition qu'il se livre aux pratiques dites « du triple mystère » (sanmitsu). Les écrits de Kukai, qui constituent l'un des fondements de ces doctrines au Japon, s'appuient sur de nombreux sutra, mais ils sont principalement axés sur l'étude et l'explication du « mandala des Deux-Mondes », qui consiste en deux mandala complémentaires : le Taizokai mandara, qui représente les aspects manifestés de Dainichi Nyorai et le monde phénoménal, impermanent, matériel ; et le Kongo-kai, qui représente l'Esprit, l'aspect principe idéal, indestructible (Kongo signifie « diamant »), stable, permanent, de la Divinité.
Par ces deux mandala, les doctrines du shingon proposent une sorte de panthéisme dans lequel tout l'univers est une manifestation, une émanation du grand bouddha solaire central Mahavairocana (Dainichi Nyorai). Elles donnèrent naissance au Japon à une éclosion de formes d'art nouvelles, dans lesquelles les représentations des divinités sont extrêmement diversifiées et où les gestes symboliques (mudra, in-zo) ainsi que les postures sont significatives de la nature et des fonctions de chaque divinité. Ce panthéisme tantrique devait, lui aussi, admettre en son sein les nombreuses divinités, ou kami, du shinto et favoriser le syncrétisme shinto-bouddhique sous une forme particulière au shingon, le ryobu-shinto, ou « shinto des deux parties de l'univers ».
Jodo-shu
La secte du jodo tire son nom de celui de la « Terre pure » de l'Ouest ou du « Monde » (Paradis) occidental, qui est censé être la demeure du bouddha Amida (Amitabha), le Gokuraku Jodo. Cette secte aurait été rapportée de Chine en 847 par le moine Eun (798-869) et se serait développée surtout au début de l'époque des régents Fujiwara, c'est-à-dire aux xe s. et xie s., avec les écrits de Genshin ou Eshin (942-1017) [l'Ojoyoshu, ou « Questions et réponses sur la mort », en 984], de Ryonin (1071-1132) et surtout de Honen (appelé aussi Genku [1133-1212]). Bien que cette secte n'ait pas été tout d'abord reconnue comme indépendante de celle du tendai, elle tendit à populariser le bouddhisme au Japon en simplifiant à l'extrême les doctrines de salut de celui-ci. La seule adoration du bouddha Amida et la répétition constante (japa, litanies) de son nom sous forme d'invocation (« Namu Amida Butsu », parfois abrégée en « Nammanda Butsu »), appelée « nembutsu », doivent suffire pour assurer à l'être humain, après sa mort, l'entrée dans le « Paradis de l'Ouest » (Sukhavati, Gokuraku Jodo), où il pourra se perfectionner pour atteindre finalement l'état de bouddha. C'est une doctrine purement piétiste, selon la définition de Nagarjuna : « Dans le grand océan de la loi du Bouddha, le seul moyen d'entrer est la foi. »
Le bouddhisme de l'époque de Kamakura (1192-1333)
Introduction
Avec la décadence du régime des Fujiwara et les troubles qui s'ensuivirent, la croyance à l'entrée dans la période du mappo, ou « ère finale de dégénérescence de la loi du Bouddha », prit un caractère de plus en plus dramatique. L'avènement du gouvernement militaire de Kamakura et les luttes de celui-ci avec le pouvoir impérial et les aristocrates de Heiankyo allaient profondément marquer l'évolution du bouddhisme au Japon. De nouvelles sectes apparurent plus ou moins en réaction contre les autres, considérées comme trop aristocratiques, comme celle du zen, qui eut la faveur des guerriers, ou celles du jodo-shinshu et de nichiren, qui s'adressèrent principalement au peuple ignorant des campagnes et aux bushi, ou guerriers des classes moyennes et inférieures.
Jodo-shinshu
Un des disciples de Honen, Shinran (appelé aussi Zenshin et Shakku [1173-1262]), provoqua à la mort de son maître (1212) un schisme au sein de la secte du jodo en publiant son enseignement du Kyo-gyoshinho (doctrine, pratique, foi et réalisation) en 1224. Trente ans après la mort de Shinran, un fidèle auditeur de ce dernier résuma cet enseignement dans un opuscule intitulé Tannisho (opuscule sur les hétérodoxies déplorables). Ce texte devait devenir l'un des plus importants de la nouvelle secte, qui prit alors le nom de « jodo-shinshu » ou « vraie secte de la Terre pure ». Dans ses enseignements, Shinran préconisait une vérité double (shintai, zokutai : foi et moralité) ; il affirmait que le seul fait d'avoir foi dans le vœu originel d'Amida (lequel était de sauver tous les êtres quels qu'ils soient) et de réciter le nembutsu avec sincérité suffisait à assurer la renaissance dans le paradis d'Amida. La Vérité est alors de se reposer de tout cœur sur le pouvoir supérieur du vœu originel d'Amida en laissant de côté toute idée personnelle.
Une originalité de la nouvelle secte était que ses religieux avaient le droit de se marier, afin d'effacer la division traditionnelle existant entre le clergé et le monde laïque. Ippen Shonin (appelé parfois Yugyo Shonin [1239-1289]), un ancien moine du tendai, déclara à son tour que, les kami shinto étant des manifestations des bouddhas et des bodhisattvas, on pouvait aussi bien leur adresser le nembutsu. Il prêchait un abandon total en Amida et, de ce fait, ajouta le mysticisme au piétisme du jodo. Au xve s., Rennyo (1415-1499), continuateur de Shinran, assurera de même que la récitation du nembutsu sans foi est inutile. Ceux qui s'opposaient à ses vues, notamment pendant la période de guerres civiles qui ensanglantèrent le Japon du milieu du xve jusqu'au milieu du xvie s. (Sengoku-jidai, « époque du pays en guerre »), donnèrent à ses partisans le nom d'« ikko » (ceux qui se tournent d'un seul côté). Ces ikko, organisés en ligues (ikko-ikki), s'armèrent afin de résister aux attaques des autres sectes et à celles des puissances séculières. La foi des prédicateurs du jodo-shinshu était intense, et leurs prédications étaient énergiques. À cette époque, cette secte connut une extension prodigieuse. Les adeptes de la secte shin (comme on appelait alors par abréviation le jodo-shinshu), bien que mêlant à leur foi des principes confucianistes et politiques, refusaient de vénérer les nombreuses divinités du panthéon bouddhique et, en principe, n'admettaient que l'image du bouddha Amida.
Zen-shu
La doctrine du Zen (chan en chinois), abréviation de zenna, transcription japonaise du sanskrit dhyana (méditation), peut être résumée en ces mots : « C'est une transmission d'une nature spéciale en dehors de tout enseignement et qui ne s'appuie sur aucun mot ; il faut donc bien reconnaître la nature de la pensée humaine en soi-même si l'on veut devenir un bouddha » (R. Fujishima). Cette doctrine fut importée de Chine en 1191 par le moine Eisai (Senko Kokushi [1141-1215]), qui établit au Japon la secte Rinzai (Huang-long, ou Linji en chinois), et par le moine Dogen (Buppo Zenji, mort en 1253, de son nom posthume Shoyo Daishi), qui, à son retour de Chine en 1227, établit la secte soto (ou sodo, caodong, en chinois). Vers 1650, un religieux chinois importa au Japon une autre secte, appelée « obaku », se réclamant, elle aussi, des doctrines du zen. L'enseignement du dhyana aurait été, selon la tradition, transmis par un des grands disciples du bouddha Shakyamuni, Kashyapa (Makakasho), à un autre disciple, Ananda, et, à travers vingt-huit patriarches successifs, jusqu'à Bodhidharma (Bodaidaruma), qui, toujours selon une tradition historique douteuse, l'aurait introduit d'Inde en Chine en 520. Le zen propose une méthode de libération originale fondée plus sur l'expérience que sur l'étude des textes. Il proclame que la nature du Bouddha est dans tous les êtres et en dehors des classifications morales ordinaires : le seul moyen d'atteindre au satori, à la « pensée dégagée de toute diversité », est de méditer sur la pensée individuelle. Cette secte, par son refus de la tradition et que l'on a classée dans les sectes bouddhiques, devrait constituer une catégorie philosophique à part, bien
Nichiren-shu
Fils d'un pauvre pêcheur, Nichiren (de son nom véritable Zennichi Maru, de son nom de religieux Rencho, de son nom posthume Rissho Daishi [1222-1282]) fut élevé dans les principes de la secte jodo. Ordonné moine, il se mit à concevoir des doutes quant à la réelle efficacité de la pratique du nembutsu et s'attacha, parfois très violemment, à vouloir redonner au bouddhisme du tendai sa pureté première. Il quitta le mont Hiei et, refusant les doctrines ésotériques du tendai, commença, en 1253, à prêcher sa propre doctrine, tout entière fondée sur le Sutra du lotus (Saddharmapundarika sutra, Hokke-kyo) et sur trois grands principes : l'objet du culte (c'est-à-dire le Sutra du lotus), les sens moraux, qu'il affirmait se trouver dans l'invocation au titre du sutra (Namu Myohorenge-kyo, « Au nom sacré du Sutra du lotus de la Bonne Loi »), et l'identification de sa doctrine avec le devenir du Japon. Il exposa ce dernier principe dans son Rissho Ankokuron (« Traité sur la stabilisation de l'État par l'établissement de l'orthodoxie »), écrit en 1260. Douze ans après, il écrivit son Kaimokusho (« Traité qui ouvre les yeux ») ainsi que d'autres ouvrages sur les relations qui, selon lui, devaient exister entre la religion et le gouvernement (Shuga Kokkaron, « Traité pour la protection de l'État »), sur les remèdes contre les calamités (Sainan Taiji), combattant violemment toutes les autres sectes. Afin de matérialiser ses idées, il adopta un mandala déjà utilisé par la secte tendai, où, autour de la formule « Namu Myohorengekyo » placée au centre des quatre orients, il plaça Shakyamuni et Prabhutaratna. Dans l'ensemble, sa doctrine n'était pas essentiellement différente de celle du tendai prêchée par Saicho. Ses successeurs, Nichiji (1250- ?), Nisshin (1407-1488), Nichio (1565-1630), déployèrent un grand zèle missionnaire. La formule mystique d'invocation au titre du sutra du lotus connut un grand succès, surtout dans le peuple. Cette secte, vénérant principalement la personne de Shaka (le bouddha Shakyamuni) et, accessoirement, quelques divinités populaires, n'eut que très peu d'influence sur les classes aristocratiques.
Le bouddhisme populaire après la période de Kamakura
Après le xive s., le bouddhisme cessa pratiquement de se renouveler au Japon. Les sectes existantes, jodo-shu, jodo-shinshu, nichiren-shu, zen-shu, shingon-shu et tendai-shu, pour ne pas parler des sectes mineures ou des innombrables sous-sectes, continuèrent d'évoluer, mais sans esprit novateur. Cependant, l'enseignement diffusé par les sectes bouddhiques avait pénétré profondément dans toutes les couches de la société japonaise, se mêlant (zen-shu et jodo-shinshu exceptés) aux croyances populaires et au shinto. Avec l'avènement de nouvelles couches de la société à l'époque des shogun Tokugawa (1603-1867), et avec le nouveau développement de l'influence chinoise, on voit certaines divinités bouddhiques se colorer d'une personnalité nouvelle et apparaître des cultes jusque-là inconnus, les uns empruntés à la tradition chinoise, les autres émergeant du folklore local (ainsi le culte de certaines divinités du Bonheur et de la Fortune). Le bouddhisme japonais tendit à se populariser et à absorber des croyances très diverses, ce qui lui permit, dans un certain sens, de survivre à la stagnation qu'il fut obligé de subir sur le plan intellectuel pendant l'époque d'Édo, les philosophies néo-confucianistes et l'éthique du zen étant alors presque exclusivement à l'honneur. Le bouddhisme se confine alors dans des rôles sociaux (registres de population, œuvres pieuses) et dans une hiérarchisation de ses temples. Cependant, quelques personnalités de premier plan apparaissent, surtout chez les religieux zen, tels que Hakuin (1685-1768), Takuan (1573-1645), Suzuki Shosan (1579-1655), Ingen (1592-1673 ; importateur de la secte obaku). Certains moines zen jouent le rôle de conseillers auprès des shogun…
La restauration de l'ère Meiji en 1868 et la séparation officielle du shinto d'État et du bouddhisme contraignirent ce dernier, jusqu'à un certain point, à se réformer et à prendre ses distances à l'égard des cultes populaires, phénomène qui contribua sans doute, dans une certaine mesure, à favoriser le développement de sectes nouvelles indépendantes plus ou moins syncrétiques que l'on englobe sous le nom de « shinko-shukyo » ou « nouvelles religions établies ». Parmi celles-ci, nous citerons le tenri-kyo, ou « religion de la sagesse divine », le konko-kyo, ou « religion de la lumière d'or » et, comme exemple de groupement religieux moderne s'inspirant du bouddhisme, la soka gakkai, ou « société pour l'étude des valeurs créatives », dont la doctrine religieuse d'entraide, prétendant être la seule dépositaire de l'orthodoxie nichirénite, se fonde sur les doctrines de Nichiren et sur le texte du sutra du lotus. Cependant, les sectes orthodoxes connurent (et connaissent encore) un certain regain de popularité. Ces nouvelles religions ont, pour la plupart, emprunté au shinto primitif sa tradition aniconique et n'ont donné naissance à aucune forme originale d'art religieux. Mais l'esprit populaire a gardé vivaces jusqu'à nos jours les cultes de la plupart des divinités du panthéon bouddhique.
Le bouddhisme chinois
L'histoire
Introduction
Introduit en Chine dès le ier s. de notre ère, le bouddhisme joua un rôle capital aussi bien dans la vie que dans la culture chinoises. Et c'est aussi grâce à la Chine que le bouddhisme connut un essor extraordinaire et se répandit dans toute l'Asie.
Du ie de notre ère jusqu'au milieu du iiie s.
Cette période correspond à la dynastie des Han postérieurs et à l'époque dite « des Trois Royaumes ». L'expansion de la Chine vers l'Asie centrale sous les Han permit le contact non pas immédiatement avec l'Inde, mais avec les régions situées entre les deux pays, notamment le Turkestan oriental.
Selon la tradition, ce serait sous l'empereur Mingdi des Han (58-75 de notre ère) que débuta la pénétration du bouddhisme en Chine. À la suite d'un rêve dans lequel il vit le Bouddha, cet empereur envoya chez les Yuezhi (Yue-tche), vers l'an 65, une mission composée de dix-huit personnes qui devait ramener, trois ans plus tard, deux missionnaires ainsi que le texte du « sutra en quarante-deux chapitres ». Toujours selon la tradition, l'empereur fit construire à Luoyang (Lo-yang) le premier monastère : le temple du Cheval Blanc.
On sait maintenant que les Chinois avaient eu connaissance de cette religion bien avant ce temps. Tout au début, il s'agissait pour eux d'une religion étrangère qui n'était qu'un objet de curiosité. Si, vers le iie s., grâce à un nombre plus important de textes traduits, principalement ceux du hinayana (Petit Véhicule), l'intérêt grandit, on considéra encore cette doctrine comme appartenant aux arts occultes au même titre que les pratiques d'inspiration taoïste.
De la fin du iiie à la fin du vie s.
C'est la période d'assimilation, durant laquelle les Chinois traduisirent et commentèrent, souvent en collaboration avec les maîtres indiens, les grands textes bouddhiques, non plus seulement ceux du hinayana, mais surtout, à partir de 265 environ, ceux du mahayana (Grand Véhicule).
Au début de cette période eurent lieu deux événements importants : l'incendie de la capitale Changan par les Tartares en 311 et l'exode de la Cour (dynastie des Jin vers le sud, événements qui bouleversèrent les structures sociales de la Chine et favorisèrent la propagation du bouddhisme. La Chine fut divisée en deux parties : celle du Nord et celle du Sud. Les princes barbares semi-sinisés qui régnaient au nord ne tardèrent pas à encourager une religion qui leur permettait de trouver un terrain d'entente avec le peuple soumis.
D'autre part, dans le Sud comme dans le Nord, les misères du temps présent et les incertitudes de l'avenir poussèrent les gens à chercher refuge dans la vie spirituelle. De nombreux lettrés se tournèrent vers le taoïsme ; par leurs discussions et leurs commentaires sur la doctrine de Laozi (Lao-tseu), ils inaugurèrent la tradition de xuanxue, qui marqua toute leur époque. On assista à des conversions massives au bouddhisme.
Pour des raisons d'ordre géographique et culturel s'instaura une différence de style et même de conception entre le bouddhisme du Nord, plus conservateur et dont l'effort porta avant tout sur la traduction des textes, et celui du Sud, plus libéral et plus orienté vers la recherche théorique.
|
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
