|
| |
|
|
 |
|
Les dessous de âlâeffet cocktailâ des perturbateurs endocriniens révélés |
|
|
| |
|
| |

Les dessous de “l’effet cocktail” des perturbateurs endocriniens révélés
COMMUNIQUÉ | 03 SEPT. 2015 - 11H19 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
BASES MOLÉCULAIRES ET STRUCTURALES DU VIVANT
Des substances chimiques, qui prises isolément, sont sans danger pour l’Homme, peuvent devenir nocives lorsqu’elles sont mélangées. Trois équipes de recherche associant des chercheurs de l’Inserm et du CNRS [1] à Montpellier ont élucidé in vitro un mécanisme moléculaire qui pourrait contribuer à ce phénomène connu sous le nom « d’effet cocktail ». Cette étude est publiée dans la revue Nature Communications.
Nous sommes quotidiennement exposés à de multiples composés exogènes tels que des polluants environnementaux, des médicaments ou des substances provenant de notre alimentation. Certaines de ces molécules, appelées perturbateurs endocriniens, sont fortement suspectées d’interagir inopportunément avec des protéines régulatrices de nos cellules et d’induire de nombreux troubles physiologiques ou métaboliques (cancers, obésité, diabète, …). Par ailleurs, la combinaison de ces molécules dans les mélanges complexes avec lesquels nous sommes généralement en contact pourrait exacerber leur toxicité.
Dans un article à paraitre dans Nature Communications, les chercheurs dévoilent un mécanisme qui pourrait contribuer à cet effet de mélange pour lequel aucune explication rationnelle n’avait pour l’instant été apportée. Ils montrent que certains estrogènes comme l’éthinylestradiol (un des composants actifs des pilules contraceptives) et des pesticides organochlorés tels que le trans-nonachlor, bien que très faiblement actifs par eux-mêmes, ont la capacité de se fixer simultanément à un récepteur situé dans le noyau des cellules et de l’activer de façon synergique.
Les analyses à l’échelle moléculaire indiquent que les deux composés se lient coopérativement au récepteur, c’est-à-dire que la fixation du premier favorise la liaison du second.
Cette coopérativité est due à de fortes interactions au niveau du site de liaison du récepteur, de sorte que le mélange binaire induit un effet toxique à des concentrations largement plus faibles que les molécules individuelles.
Ces résultats obtenus in vitro constituent une preuve de concept qui ouvre la voie à un large champ d’études. Il existe effectivement dans notre environnement environ 150 000 composés dont l’action combinée pourrait avoir des effets inattendus sur la santé humaine au regard de leur innocuité reconnue ou supposée en tant que substances isolées. Si ces travaux sont confirmés in vivo, des retombées importantes sont attendues dans les domaines de la perturbation endocrinienne, la toxicologie et l’évaluation des risques liés à l’utilisation des produits chimiques.
Séparément, l’éthinylestradiol (EE2) et le trans-nonachlor (TNC) se lient seulement à forte concentration au récepteur des xénobiotiques (PXR) et sont des activateurs faibles de ce récepteur. Lorsqu’ils sont utilisés ensemble, les deux composés se stabilisent mutuellement dans la poche de liaison du récepteur. Le « ligand supramoléculaire » ainsi créé possède une affinité augmentée pour PXR, de sorte qu’il est capable d’induire un effet toxique à des doses auxquelles chaque composé est inactif individuellement. © Vanessa Delfosse, William Bourguet
[1] Centre de Biochimie Structurale (CNRS UMR5048 – Inserm U1054), de l’Institut de Recherche en Cancérologie (Inserm U1194) et de l’Institut de Génomique Fonctionnelle (CNRS UMR5203 – Inserm U661)
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
ChroMS, le cerveau comme il nâavait jamais été vu |
|
|
| |
|
| |

ChroMS, le cerveau comme il n’avait jamais été vu
COMMUNIQUÉ | 10 AVRIL 2019 - 11H35 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE
Mise au point par des chercheurs de l’École polytechnique, de Sorbonne Université, de l’Inserm et du CNRS regroupés au sein du Laboratoire d’optique et biosciences1 et de l’Institut de la Vision2, ChroMS est une nouvelle technique de microscopie associant couleur, 3D et haute résolution, introduisant une véritable révolution dans l’imagerie du cerveau des vertébrés. L’approche ChroMS est décrite en détail dans un article qui vient de paraitre dans Nature Communications.
En matière d’imagerie du cerveau des vertébrés, l’écueil que rencontraient jusqu’à présent les chercheurs était de devoir choisir entre résolution et volume. Soit on obtenait de la très haute résolution avec la microscopie électronique tridimensionnelle, mais sur un volume beaucoup trop faible pour retracer un circuit neuronal complet, soit on obtenait une image entière du cerveau, mais cette fois à une résolution bien trop large pour saisir les détails.
Le principal bénéfice de l’approche d’imagerie ChroMS (pour Chromatic Multiphoton Serial imaging), c’est d’offrir une véritable visite virtuelle à haute résolution (à l’échelle de la cellule) de certaines parties du cerveau essentielles pour comprendre le développement des circuits neuronaux. Si la visite est virtuelle, les données sont bien réelles, issues de cerveaux de souris transgéniques dans les neurones desquelles ont été introduits des marqueurs fluorescents issus de méduses ou de coraux, qui, une fois stimulés par un laser infrarouge, permettent d’obtenir la couleur.
« L’instrument est idéal pour reconstruire en 3D avec une très grande précision des régions du cerveau, de quelques millimètres-cubes de volume, ce qui est une première avec cette qualité d’images, et qui constitue l’échelle pertinente par rapport à ce que nous voulons observer » explique Emmanuel Beaurepaire, du Laboratoire d’optique et biosciences (LOB – École polytechnique, CNRS, Inserm). « Nous pouvons aussi reconstituer un cerveau entier de souris, avec une moindre précision dans la version actuelle de notre instrument ».
« Nous nous intéressons plus particulièrement au lignage cellulaire » précise Jean Livet, de l’Institut de la vision (Sorbonne Université, Inserm, CNRS), « c’est-à-dire la façon dont se développe le cerveau à partir de cellules souches neurales : quelles sont les cellules filles issues d’une cellule souche donnée, comment une mutation de la cellule souche a pu influer sur leur développement, comment les groupes de cellules générées par différentes cellules souches s’agencent les uns par rapport aux autres, c’est toute cette histoire d’une région du cerveau, codée dans la couleur, que nous révèlent les images grand volume de ChroMS ».
En ligne de mire, la capacité de répondre à des questions qui se posent depuis longtemps en neurosciences, comme celle de savoir si les neurones issus d’une même cellule souche se connectent de façon préférentielle entre eux pour remplir une fonctionnalité donnée, ou si des pathologies comme l’épilepsie peuvent être reliées à des problèmes localisés affectant certaines cellules souches neurales.
Si la technique ChroMS est particulièrement adaptée à l’étude d’un organe aussi complexe que le cerveau, elle peut être mise à profit sur tous les organes et devrait s’avérer être un outil très efficace pour les études portant sur l’embryogénèse.
(A) Principe de la microscopie ChroMS, associant excitation biphotonique couleur par mélange de fréquences et découpe sériée automatisée du tissu cérébral. (B) Image acquise avec le mode « tomographie sur cerveau entier » montrant le cortex et l’hippocampe d’une souris Brainbow. (C) Reconstruction 3D et vue à différentes échelles d’un volume de 4.8 mm3 de cortex de souris dans lequel les astrocytes sont marqués avec des protéines fluorescentes de couleurs différentes. (D) Vue 3D de neurones marqués en couleur dans le cortex de souris. Adapté de : Abdeladim et al, Nat Commun 2019.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Tumeurs cérébrales : le réseau lymphatique méningé ouvrirait une nouvelle piste thérapeutique |
|
|
| |
|
| |

Tumeurs cérébrales : le réseau lymphatique méningé ouvrirait une nouvelle piste thérapeutique
COMMUNIQUÉ | 15 JANV. 2020 - 19H00 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
CANCER
Les glioblastomes sont les tumeurs les plus fréquentes du système nerveux central Image capturée en utilisant un microscope à épifluorescence champ plein Zeiss Axioimager Z1. Inserm/Guichet, Pierre-Olivier
Les glioblastomes sont les tumeurs cérébrales les plus fréquentes, dont le pronostic est souvent très défavorable. Une étude collaborative menée entre Jean-Léon Thomas, chercheur Inserm au sein de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (Inserm/CNRS/Sorbonne Université) et à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP, et Akiko Iwasaki (département d’immunologie, école de médecine de Yale aux Etats-Unis), a montré un rôle bénéfique du réseau vasculaire lymphatique méningé dans le traitement de ces tumeurs, à court et à plus long terme. Les résultats sont publiés dans la revue scientifique Nature.
Les glioblastomes sont les tumeurs cérébrales les plus fréquentes, mais aussi les plus graves. Leur prévalence est estimée à 1/100 000, touchant principalement des patients âgés de 45 à 70 ans. Les traitements qui sont aujourd’hui proposés sont principalement chirurgicaux, associés à de la radiothérapie et de la chimiothérapie. Le bénéfice thérapeutique, en terme de survie, reste modeste (environ 18 mois actuellement), incitant les chercheurs à continuer d’explorer de nouvelles pistes de traitements potentiels.
Eric Song (Université de Yale), premier auteur de ces travaux, Jean-Léon Thomas (Inserm/CNRS/Sorbonne Université), Akiko Iwasaki et leurs collègues se sont penchés sur le réseau lymphatique méningé pour savoir si celui-ci régulait le système immunitaire en réponse à la présence d’une tumeur cérébrale. Véritable tuyauterie de vaisseaux lymphatiques parcourant les méninges autour du cerveau, le réseau lymphatique méningé suscite un intérêt particulier depuis des études publiées au cours des cinq dernières années montrant sa connexion aux ganglions lymphatiques du cou (qui sont le lieu de prolifération et de différenciation des cellules immunitaires), ainsi que sa fonction de drainage des cellules immunitaires vers ces derniers.
Dans la nouvelle étude publiée dans Nature, les chercheurs ont travaillé avec des modèles animaux de glioblastome. Ils ont montré que la tumeur disparaissait lorsque les lymphatiques méningés étaient préalablement élargis par injection dans les méninges d’un facteur de croissance lymphatique appelé VEGF-C. La croissance du réseau lymphatique méningé induite par VEGF-C (observable sur la photo) a été corrélée à une entrée massive de cellules immunitaires lymphocytaires T (CD4 et CD8), absentes dans des conditions normales, dans l’environnement de la tumeur.
Cette réponse à court terme détruit la tumeur et s’accompagne d’une persistance de cellules immunitaires ‘mémoires’ spécifiquement dirigées contre les cellules tumorales, permettant le rejet de la même tumeur à plus long terme.
Néanmoins, les expériences des chercheurs montrent que c’est en combinaison avec une immunothérapie déjà utilisée en neuro-oncologie que le traitement transitoire avec VEGF-C est le plus efficace, permettant d’éradiquer complètement le glioblastome existant. « Notre étude souligne que le fait de renforcer le réseau des vaisseaux lymphatiques méningés permet d’augmenter le trafic des antigènes tumoraux depuis les méninges vers les ganglions lymphatiques », explique Jean-Léon Thomas.
Avec ses collègues, il conclut que le rôle majeur du réseau lymphatique méningé serait de transporter depuis les méninges le message d’alerte immunitaire déclenchant l’activation des lymphocytes dirigés contre la tumeur.
Les résultats de l’étude ouvrent de nouvelles perspectives dans le traitement des tumeurs cérébrales en ciblant les vaisseaux lymphatiques méningés et leurs ganglions associés.
Les chercheurs souhaitent poursuivre ces travaux en étudiant le rôle du réseau lymphatique méningé dans le cadre d’autres pathologies. « Nous sommes en train d’explorer les mécanismes de fonctionnement et le potentiel thérapeutique de ce réseau vasculaire avec de nouveaux modèles expérimentaux, et pour d’autres maladies du système nerveux, neurodégénératives, neuro-vasculaires, et infectieuses », conclut Jean-Léon Thomas.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Les émulsifiants alimentaires augmentent le pouvoir pathogène de certaines bactéries et le risque dâinflammation intestinale |
|
|
| |
|
| |
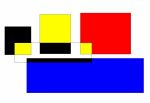
Les émulsifiants alimentaires augmentent le pouvoir pathogène de certaines bactéries et le risque d’inflammation intestinale
COMMUNIQUÉ | 26 OCT. 2020 - 14H00 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
BIOLOGIE CELLULAIRE, DÉVELOPPEMENT ET ÉVOLUTION | GÉNÉTIQUE, GÉNOMIQUE ET BIO-INFORMATIQUE | IMMUNOLOGIE, INFLAMMATION, INFECTIOLOGIE ET MICROBIOLOGIE
Certaines bactéries du microbiote intestinal, marquées en rouge, sont capables de pénétrer la couche de mucus normalement stérile et marquée en vert. © Benoit Chassaing
L’alimentation jouerait un rôle dans le déclenchement d’inflammations intestinales pouvant aboutir au développement de certaines pathologies, comme la maladie de Crohn. Des chercheurs de l’Inserm, du CNRS et de Université de Paris ont montré que les émulsifiants alimentaires présents dans de nombreux plats transformés pouvaient avoir un impact délétère sur certaines bactéries spécifiques du microbiote intestinal, conduisant à une inflammation chronique. Leurs résultats sont publiés dans Cell Reports.
La prévalence des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin ne cesse d’augmenter dans tous les pays du monde. Près de 20 millions de personnes seraient concernées. Caractérisées par l’inflammation de la paroi d’une partie du tube digestif, ces pathologies regroupent notamment la maladie de Crohn et les rectocolites hémorragiques.
Plusieurs facteurs, à la fois génétiques et environnementaux, ont été mis en cause pour expliquer l’inflammation de l’intestin associée à ces maladies. Depuis plusieurs années, le chercheur Inserm Benoît Chassaing et son équipe à l’Institut Cochin (Inserm/CNRS/Université de Paris) s’intéressent au rôle de l’alimentation et notamment à l’impact de certains additifs alimentaires comme les émulsifiants.
Largement utilisés par l’industrie agroalimentaire dans de nombreux produits transformés, les émulsifiants[1] ont pour fonction d’en améliorer la texture et d’en prolonger la durée de conservation. Par exemple, des émulsifiants comme la lécithine et les polysorbates permettent de garantir la texture onctueuse des crèmes glacées industrielles et d’éviter qu’elles ne fondent trop rapidement une fois servies.
Dans différents travaux s’appuyant sur des modèles animaux, les scientifiques ont déjà montré que la consommation d’émulsifiants alimentaires altérait négativement le microbiote de manière à favoriser l’inflammation.
Par ailleurs, dans des modèles de souris dont le microbiote était composé d’une faible diversité de bactéries, les chercheurs ont observé que les animaux étaient protégés contre les effets négatifs de certains émulsifiants.
Ils ont donc émis l’hypothèse que les émulsifiants impacteraient seulement certaines bactéries spécifiques, inoffensives dans des conditions “normales”, mais ayant un potentiel pathogène. C’est seulement en présence d’agents émulsifiants que ces dernières seraient capables de favoriser le développement d’une inflammation intestinale chronique et de maladies associées.
E. coli comme un modèle
Dans le cadre de leur étude publiée dans Cell Reports, les chercheurs ont cette fois ci travaillé à partir de deux modèles de souris : l’un sans microbiote et l’autre avec un microbiote simple comportant seulement 8 espèces de bactérie. Ils les ont colonisés avec une souche de la bactérie Escherichia coli (les « bactéries AIEC ») associée à la maladie de Crohn.
Les chercheurs se sont intéressés aux effets de deux émulsifiants administrés suite à la colonisation des souris par les bactéries AIEC. Alors que la seule consommation d’agents émulsifiants était inoffensive chez ces animaux en l’absence de ces bactéries, ils ont constaté le développement d’une inflammation intestinale chronique et de dérégulations métaboliques lorsque ces dernières étaient présentes. Ainsi, le « couple » bactéries AIEC / agent émulsifiant était nécessaire et suffisant pour induire une inflammation intestinale chronique.
Des analyses supplémentaires ont révélé que lorsque ces bactéries étaient en contact avec les émulsifiants, elles sur-exprimaient des groupes de gènes qui augmentaient leur virulence et leur propension à induire l’inflammation. « Nous avons ainsi pu identifier un mécanisme par lequel les émulsifiants alimentaires peuvent favoriser l’inflammation intestinale chronique chez les personnes abritant certaines bactéries, telles que les bactéries AIEC, dans leur tractus digestif », souligne Benoît Chassaing qui a coordonné l’étude.
La prochaine étape consiste à lister l’ensemble des bactéries ayant les mêmes effets au contact de ces additifs alimentaires.
A plus long terme, des études pour identifier et stratifier les patients en fonction de la composition de leur microbiote et de leur risque d’inflammation pourraient être mises en place dans le but de faire de la prévention et de mettre en place des recommandations nutritionnelles personnalisées. Les personnes porteuses de microbiotes spécifiques, sensibles aux émulsifiants, pourraient en effet bénéficier de recommandations alimentaires ciblées.
« Et s’il est illusoire de penser que l’on pourra bannir les émulsifiants de notre alimentation, les modèles et les méthodologies que nous avons développés ici vont aussi nous permettre de tester l’action de plusieurs types d’agents émulsifiants sur le microbiote afin identifier ceux qui n’auraient pas d’effets délétères, et ainsi encourager leur usage », conclut Benoît Chassaing.
[1] Un émulsifiant est un composé qui a une affinité à la fois avec l’eau et avec l’huile et qui permet aux différentes phases d’un composé de rester mélangées
DOCUMENT inserm LIEN
|
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
