|
| |
|
|
 |
|
Quand la narcolepsie rend plus créatif |
|
|
| |
|
| |

Quand la narcolepsie rend plus créatif
COMMUNIQUÉ | 04 JUIN 2019 - 9H00 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE | SANTÉ PUBLIQUE
Dormir nous rendrait-il plus créatif ? L’étude des personnes narcoleptiques, qui bénéficient d’un accès privilégié au sommeil paradoxal, pourrait apporter des informations clés pour comprendre ce phénomène. Une équipe associant des médecins de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP et des chercheurs de l’Inserm, du CNRS et de Sorbonne Université au sein de l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière, en collaboration avec une équipe de l’université de Bologne en Italie, a mis en évidence l’existence d’une plus grande créativité chez les patients atteints de narcolepsie. Les résultats de l’étude suggèrent un lien entre une phase du sommeil particulière, le sommeil paradoxal, et les capacités créatives. Cette avancée importante, publiée dans la revue Brain le 29 mai 2019, ouvre de nouvelles pistes quant à la compréhension des fonctions cognitives du sommeil et des mécanismes de la pensée créative.
La narcolepsie est un trouble rare du sommeil qui touche environ 0.02% de la population générale. Il est caractérisé par des phases de sommeil incontrôlables. Ces endormissements ont la particularité de débuter souvent immédiatement par une phase de sommeil particulière, le sommeil paradoxal, une situation impossible à rencontrer en temps normal.
En effet, notre sommeil est composé de plusieurs phases et le sommeil paradoxal est systématiquement précédé d’une phase de sommeil lent. Il faut donc en général dormir au moins une heure avant d’accéder à ce sommeil particulier. Les personnes narcoleptiques bénéficient donc d’un accès privilégié au sommeil paradoxal. Ils présentent d’ailleurs beaucoup de symptômes parallèles associés au sommeil paradoxal, comme s’ils existaient chez eux une barrière poreuse entre l’éveil et cette phase du sommeil. Par exemple, la majorité d’entre eux sont des rêveurs lucides, c’est-à-dire conscients de rêver au moment où ils rêvent et pouvant même parfois influencer le scénario du rêve. Si plus de la moitié de la population adulte rapporte avoir fait un rêve lucide au moins une fois dans sa vie, les rêveurs lucides réguliers (plusieurs fois par semaine) sont très rares.
Les données de la littérature actuelle suggèrent par ailleurs qu’une sieste incluant une phase de sommeil paradoxal est suivie d’une période accrue de plus grande flexibilité mentale pour la résolution de problèmes. Les individus narcoleptiques ayant un accès privilégié à cette phase du sommeil, y aurait-il un effet à long-terme sur leur créativité ?
« En rencontrant régulièrement des patients narcoleptiques au sein de mon service, j’ai remarqué qu’ils semblaient plus évoluer dans des activités créatives que la moyenne ; pas uniquement dans leur vie professionnelle mais aussi dans leurs loisirs ou leur façon de penser.» explique le Pr Isabelle Arnulf, cheffe du service des pathologies du Sommeil à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière-AP-HP.
De ce constat est née l’idée d’explorer les capacités créatives de ces patients au regard de leur accès particulier au sommeil paradoxal.
Une étude conduite par Célia Lacaux, chercheuse à Sorbonne Université, et Delphine Oudiette chercheuse à l’Inserm, au sein du service des pathologies du sommeil de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP dirigé par le Pr Isabelle Arnulf à l’ICM, a testé, en collaboration avec une équipe de l’université de Bologne en Italie, les capacités créatives de 185 personnes narcoleptiques et de 126 individus contrôles.
Définir et mesurer la créativité n’est pas une tâche aisée. En neuroscience, elle peut être définie comme la capacité à produire quelque chose d’à la fois original et adapté à des contraintes. Pour l’évaluer et obtenir la mesure la plus complète possible, les chercheurs ont employé deux méthodes :
* Une mesure « subjective » à base de questionnaires de créativité chez 185 sujets narcoleptiques et 126 sujets contrôles : un test « de profils créatifs » axé sur la personnalité et le profil créatif, et un test « d’accomplissement créatif » portant sur les réalisations personnelles des participants dans différents domaines des arts et des sciences, de l’écriture au cinéma, en passant par l’humour, la cuisine ou encore l’architecture.
* Une mesure « objective » de la performance créative grâce à un test « papier crayon » durant deux heures, appelé EPoC (Evaluation du Potentiel Créatif) chez 30 patients et 30 contrôles. Celui-ci évalue les deux grandes dimensions de la créativité: la pensée divergente qui demande, à partir d’un stimulus, de générer le plus de réponses possibles ; et la pensée convergente, qui requiert d’intégrer plusieurs objets dans une seule et même production, cohérente et originale.
Les individus narcoleptiques ont globalement obtenu des scores plus élevés que les sujets contrôles, aussi bien aux mesures objectives que subjectives. « Si les sujets narcoleptiques obtenaient des scores plus élevés que les sujets contrôles, seule une partie d’entre eux sortait vraiment du lot en matière d’accomplissement créatif. Ceci nous suggère de vraiment encourager les personnes narcoleptiques à exploiter leur potentiel. », précise Delphine Oudiette, chercheuse Inserm à l’ICM, qui a dirigé l’étude. « De plus, parmi les personnes narcoleptiques, le sous-groupe des rêveurs lucides obtenait les scores les plus élevés au test de profils créatifs, suggérant un rôle du rêve dans les capacités créatives. »
Cette créativité accrue pourrait s’expliquer par l’accès privilégié au sommeil paradoxal et aux rêves dont bénéficient les personnes narcoleptiques et qui leur donne l’occasion « d’incuber » leurs idées lors de siestes brèves pendant la journée.
« Il s’agit d’un argument fort pour dire que l’accès régulier au sommeil paradoxal et aux rêves favorise la créativité. Dors dessus, tu trouveras une solution! C’est aussi la première fois que nous montrons que les sujets narcoleptiques sont meilleurs que la moyenne dans un domaine aussi important que la créativité, apportant par là même une note positive à cette maladie difficile à vivre.» conclut Célia Lacaux, premier auteur de l’étude. Des travaux supplémentaires seront nécessaires pour confirmer cette hypothèse mais ces premiers résultats ouvrent des pistes importantes vers la compréhension des fonctions du sommeil paradoxal et des rêves.Quand la narcolepsie rend plus créatif
COMMUNIQUÉ | 04 JUIN 2019 - 9H00 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE | SANTÉ PUBLIQUE
Dormir nous rendrait-il plus créatif ? L’étude des personnes narcoleptiques, qui bénéficient d’un accès privilégié au sommeil paradoxal, pourrait apporter des informations clés pour comprendre ce phénomène. Une équipe associant des médecins de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP et des chercheurs de l’Inserm, du CNRS et de Sorbonne Université au sein de l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière, en collaboration avec une équipe de l’université de Bologne en Italie, a mis en évidence l’existence d’une plus grande créativité chez les patients atteints de narcolepsie. Les résultats de l’étude suggèrent un lien entre une phase du sommeil particulière, le sommeil paradoxal, et les capacités créatives. Cette avancée importante, publiée dans la revue Brain le 29 mai 2019, ouvre de nouvelles pistes quant à la compréhension des fonctions cognitives du sommeil et des mécanismes de la pensée créative.
La narcolepsie est un trouble rare du sommeil qui touche environ 0.02% de la population générale. Il est caractérisé par des phases de sommeil incontrôlables. Ces endormissements ont la particularité de débuter souvent immédiatement par une phase de sommeil particulière, le sommeil paradoxal, une situation impossible à rencontrer en temps normal.
En effet, notre sommeil est composé de plusieurs phases et le sommeil paradoxal est systématiquement précédé d’une phase de sommeil lent. Il faut donc en général dormir au moins une heure avant d’accéder à ce sommeil particulier. Les personnes narcoleptiques bénéficient donc d’un accès privilégié au sommeil paradoxal. Ils présentent d’ailleurs beaucoup de symptômes parallèles associés au sommeil paradoxal, comme s’ils existaient chez eux une barrière poreuse entre l’éveil et cette phase du sommeil. Par exemple, la majorité d’entre eux sont des rêveurs lucides, c’est-à-dire conscients de rêver au moment où ils rêvent et pouvant même parfois influencer le scénario du rêve. Si plus de la moitié de la population adulte rapporte avoir fait un rêve lucide au moins une fois dans sa vie, les rêveurs lucides réguliers (plusieurs fois par semaine) sont très rares.
Les données de la littérature actuelle suggèrent par ailleurs qu’une sieste incluant une phase de sommeil paradoxal est suivie d’une période accrue de plus grande flexibilité mentale pour la résolution de problèmes. Les individus narcoleptiques ayant un accès privilégié à cette phase du sommeil, y aurait-il un effet à long-terme sur leur créativité ?
« En rencontrant régulièrement des patients narcoleptiques au sein de mon service, j’ai remarqué qu’ils semblaient plus évoluer dans des activités créatives que la moyenne ; pas uniquement dans leur vie professionnelle mais aussi dans leurs loisirs ou leur façon de penser.» explique le Pr Isabelle Arnulf, cheffe du service des pathologies du Sommeil à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière-AP-HP.
De ce constat est née l’idée d’explorer les capacités créatives de ces patients au regard de leur accès particulier au sommeil paradoxal.
Une étude conduite par Célia Lacaux, chercheuse à Sorbonne Université, et Delphine Oudiette chercheuse à l’Inserm, au sein du service des pathologies du sommeil de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP dirigé par le Pr Isabelle Arnulf à l’ICM, a testé, en collaboration avec une équipe de l’université de Bologne en Italie, les capacités créatives de 185 personnes narcoleptiques et de 126 individus contrôles.
Définir et mesurer la créativité n’est pas une tâche aisée. En neuroscience, elle peut être définie comme la capacité à produire quelque chose d’à la fois original et adapté à des contraintes. Pour l’évaluer et obtenir la mesure la plus complète possible, les chercheurs ont employé deux méthodes :
* Une mesure « subjective » à base de questionnaires de créativité chez 185 sujets narcoleptiques et 126 sujets contrôles : un test « de profils créatifs » axé sur la personnalité et le profil créatif, et un test « d’accomplissement créatif » portant sur les réalisations personnelles des participants dans différents domaines des arts et des sciences, de l’écriture au cinéma, en passant par l’humour, la cuisine ou encore l’architecture.
* Une mesure « objective » de la performance créative grâce à un test « papier crayon » durant deux heures, appelé EPoC (Evaluation du Potentiel Créatif) chez 30 patients et 30 contrôles. Celui-ci évalue les deux grandes dimensions de la créativité: la pensée divergente qui demande, à partir d’un stimulus, de générer le plus de réponses possibles ; et la pensée convergente, qui requiert d’intégrer plusieurs objets dans une seule et même production, cohérente et originale.
*
Les individus narcoleptiques ont globalement obtenu des scores plus élevés que les sujets contrôles, aussi bien aux mesures objectives que subjectives. « Si les sujets narcoleptiques obtenaient des scores plus élevés que les sujets contrôles, seule une partie d’entre eux sortait vraiment du lot en matière d’accomplissement créatif. Ceci nous suggère de vraiment encourager les personnes narcoleptiques à exploiter leur potentiel. », précise Delphine Oudiette, chercheuse Inserm à l’ICM, qui a dirigé l’étude. « De plus, parmi les personnes narcoleptiques, le sous-groupe des rêveurs lucides obtenait les scores les plus élevés au test de profils créatifs, suggérant un rôle du rêve dans les capacités créatives. »
Cette créativité accrue pourrait s’expliquer par l’accès privilégié au sommeil paradoxal et aux rêves dont bénéficient les personnes narcoleptiques et qui leur donne l’occasion « d’incuber » leurs idées lors de siestes brèves pendant la journée.
« Il s’agit d’un argument fort pour dire que l’accès régulier au sommeil paradoxal et aux rêves favorise la créativité. Dors dessus, tu trouveras une solution! C’est aussi la première fois que nous montrons que les sujets narcoleptiques sont meilleurs que la moyenne dans un domaine aussi important que la créativité, apportant par là même une note positive à cette maladie difficile à vivre.» conclut Célia Lacaux, premier auteur de l’étude. Des travaux supplémentaires seront nécessaires pour confirmer cette hypothèse mais ces premiers résultats ouvrent des pistes importantes vers la compréhension des fonctions du sommeil paradoxal et des rêves.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Des techniques synchrotrons révèlent lâaction dâune molécule métallo-organique dans des cellules dâune forme agressive du cancer du sein |
|
|
| |
|
| |

Des techniques synchrotrons révèlent l’action d’une molécule métallo-organique dans des cellules d’une forme agressive du cancer du sein
| 04 FÉVR. 2019 - 15H18 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
CANCER
Certains types de cancer, comme le cancer du sein type triple négatif, restent réfractaires aux traitements par chimiothérapie. Des scientifiques de l’Inserm, du CNRS, de Sorbonne université, de l’université PSL, de l’Université Grenoble Alpes et de l’ESRF, le synchrotron européen de Grenoble, ont étudié une molécule organométallique, intéressante pour son activité antitumorale. Leurs recherches ont apporté une meilleure compréhension de son mécanisme d’action. Ces résultats sont publiés dans Angewandte Chemie.
Le cancer du sein type triple négatif (TNBC en anglais, « triple negative breast cancer »), représente 10 à 20% des cas de cancers du sein. Il se caractérise par l’absence de récepteur des œstrogènes, de récepteur de la progestérone et de récepteurs du facteur de croissance épidermique humaine (HER2). Ceci signifie qu’il ne répond ni à l’hormonothérapie ni à l’immunothérapie. Le manque de cibles moléculaires pour le traitement adapté de ce type de cancer très agressif reste un défi pour la communauté scientifique et médicale.
Une équipe pluridisciplinaire de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), du CNRS, de Sorbonne université, de l’université PSL, de l’Université Grenoble Alpes et de l’ESRF, a étudié une molécule organométallique de la famille des métallocènes, un dérivé du métabolite actif du tamoxifène, – un médicament oral d’hormonothérapie très utilisé pour la prévention et le traitement du cancer du sein non invasif et invasif – , et précisé son mécanisme d’action au sein de cellules de cancer du sein type triple négatif.
Ces composés organométalliques ont été développés par le professeur G.Jaouen et son groupe à Sorbonne université et à l’université PSL à Paris. Il sont démontré leur large spectre d’efficacité envers différents types de cellules cancéreuses et leur potentiel à surmonter la résistance aux médicaments anticancéreux.
« Nous connaissions l’efficacité de cette molécule à base d’osmium grâce aux travaux approfondis déjà effectués. Mais, nous ne connaissions pas exactement son mécanisme d’action dans des cellules de cancer du sein type triple-négatif. C’est pourquoi nous avons localisé et mesuré les concentrations de cette molécule à l’intérieur même de la cellule cancéreuse, afin de mieux évaluer son efficacité », explique Sylvain Bohic, chercheur Inserm et auteur principal de l’étude.
Les chercheurs ont utilisé la ligne de lumière ID16A pour leur expérience. La technique de pointe de nano-imagerie synchrotron permet un éclairage unique sur la distribution intracellulaire de ce métallocène, avec une résolution de 35 nanomètres. « Depuis plusieurs années, les recherches sont menées dans ce domaine. Aujourd’hui, elles bénéficient des dernières techniques en matière de cryo-fluorescence des rayons X en 2D et 3D » explique Peter Cloetens, scientifique ESRF, en charge de ID16A.
Pour la première fois, l’équipe scientifique a montré comment la molécule pénètre aisément les membranes de la cellule cancéreuse en raison de sa nature lipophile et comment elle cible un organite cellulaire essentiel, le réticulum endoplasmique, un réseau de tubules membranaires (souvent interconnectées) dispersées dans tout le cytoplasme des cellules eucaryotes. La molécule, un dérivé osmocénique de l’hydroxytamoxifène, qui est oxydée à cet endroit engendre des métabolites qui vont attaquer différentes parties de la cellule en même temps, menant à l’activité anticancéreuse observée. « la cellule cancéreuse doit faire face à de nombreux feux démarrant à différents endroits dans la cellule. La cellule tumorale, débordée par autant d’attaques, ne peut faire face et meurt, ou s’inactive»,explique S. Bohic.
Les résultats sont prometteurs. En effet, cette nouvelle famille de composés organométalliques, qui présentent un mécanisme d’action multi-cibles, pourrait devenir une alternative intéressante dans l’arsenal de chimiothérapie classique et, permettre de surmonter la résistance aux médicaments actuels tout en ayant un coût faible. Le médicament Cisplatine, une autre molécule contenant un métal de transition qui est largement utilisé pour le traitement du cancer, a comme cible primaire l’ADN qu’il endommage à l’intérieur de la cellule. Souvent efficace, il a cependant des effets secondaires et les cellules cancéreuses développent aussi des mécanismes de résistance à ce type de chimiothérapie. Le cancer du sein triple négatif, comme d’autres cancers, est souvent résistant au Cisplatine. « Cette étude contribue au développement de mécanismes alternatifs à ceux des molécules de chimiothérapie classique utilisées dans le traitement des cancers. Nous sommes au début de cette recherche. A ce stade, des tests cliniques ne peuvent être envisagés, mais cette étude est prometteuse »,indique leprof.G.Jaouen co-auteur de cette étude.
La prochaine étape est de découvrir comment cette molécule agit sur des cellules saines et d’étudier sa toxicologie.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Le traitement par hormone de croissance chez les enfants guéris dâun cancer nâaugmente pas le risque de survenue dâune seconde tumeur |
|
|
| |
|
| |
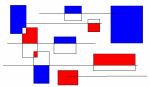
Le traitement par hormone de croissance chez les enfants guéris d’un cancer n’augmente pas le risque de survenue d’une seconde tumeur
| 16 SEPT. 2020 - 17H39 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
CANCER | NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE
Le déficit en hormone de croissance est une complication habituelle de la radiothérapie. ©Adobe Stock
Des équipes de l’hôpital Bicêtre AP-HP, de l’Inserm, de Gustave Roussy et de l’Université Paris- Saclay ont étudié l’influence d’un traitement par hormone de croissance sur le risque de survenue d’une seconde tumeur chez 2 852 adultes guéris d’un cancer dans l’enfance. Les données confirment que le traitement par hormone de croissance chez les enfants qui présentent un déficit de cette hormone n’augmente pas le risque de survenue d’un second cancer. Cette étude apporte donc des données rassurantes sur le devenir à long terme de ces enfants. Les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue European Journal of Endocrinology en septembre 2020.
Le déficit en hormone de croissance est une complication habituelle de la radiothérapie. Les enfants traités par radiothérapie ont besoin d’un traitement par hormone de croissance pour atteindre une taille adulte normale, mais des craintes avaient été rapportées sur une éventuelle augmentation du risque d’apparition d’une autre tumeur à l’âge adulte causée par ce traitement.
Des chercheurs au Centre de recherche en Epidémiologie et Santé des Populations (CESP)(Inserm/Université Paris-Saclay/Gustave Roussy) et de l’hôpital Bicêtre APHP, ont analysé les données d’une cohorte française, Euro2k, qui réunit 2 852 survivants d’un cancer pédiatrique diagnostiqué avant l’âge de 18 ans, avant 1986. Parmi eux, 196 avaient été traités dans l’enfance par hormone de croissance.
L’équipe de recherche a étudié l’influence du traitement par hormone de croissance sur la survenue des secondes tumeurs avec un recul de 26 ans en tenant compte des doses de radiation reçues par l’ensemble des organes du corps. Celles-ci ont été obtenues grâce à une reconstitution de la radiothérapie reçue pour chaque enfant.
Dans cette cohorte, 374 survivants ont développé une seconde tumeur, dont 40 ayant reçu un traitement par hormone de croissance dans l’enfance. L’analyse de ces données suggère que le traitement par hormone de croissance n’est pas associé à un risque accru de secondes tumeurs.
Néanmoins, les chercheurs ont trouvé chez les survivants ayant reçu un traitement par hormone de croissance pendant plus de 4 ans une légère augmentation du risque de méningiome, une tumeur bénigne des méninges favorisée par des fortes doses de radiothérapie. Ce léger excès de risque de méningiome chez les survivants ayant reçu plus de 4 ans de traitement par hormone de croissance n’est cependant pas significatif. De plus, il n’est pas non plus certain que ce soit le traitement par hormone de croissance qui en soit responsable.
“Cette étude apporte des informations sur le devenir à long terme des enfants que nous traitons
par hormone de croissance pour un déficit en hormone de croissance secondaire au traitement de leur cancer. Ces nouvelles données nous permettent d’aborder sereinement le traitement par hormone de croissance lorsqu’il est nécessaire et de rassurer les familles concernant l’absence d’augmentation du risque de secondes tumeurs”, conclut Cécile Thomas-Teinturier, pédiatre endocrinologue à l’hôpital Bicêtre AP-HP et premier auteur de l’étude.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Des défauts de lâexpression des gènes dans la maladie des enfants de la lune |
|
|
| |
|
| |

Des défauts de l’expression des gènes dans la maladie des enfants de la lune
vendredi 6 juillet 2018
Les enfants de la lune ne peuvent s’exposer au soleil en raison de leur déficience dans des protéines de la réparation de l’ADN dont XPC, le facteur qui reconnaît les lésions dues aux rayons ultraviolets. Un défaut de réparation de l’ADN ne suffit pourtant pas à expliquer l’ensemble des symptômes observés. Dans cette étude, les chercheurs ont montré que le facteur XPC était également impliqué dans un mécanisme fondamental de l’expression des gènes, l’initiation de la transcription. Ces résultats sont publiés le 4 juillet 2018 dans la revue Nature Communications.
Le Xeroderma pigmentosum est une maladie génétique rare qui peut être liée à une mutation du gène codant pour la protéine XPC, un facteur de réparation de l’ADN qui reconnaît les lésions produites par les rayons ultraviolets. Les patients atteints de Xeroderma pigmentosum sont très sensibles au soleil et présentent un risque accru de cancer de la peau mais développent également d’autres troubles, neurologiques, oculaires ou de développement. Ces symptômes originellement associés à des défauts de la réparation pourraient aussi relever de perturbations de la transcription, mécanisme fondamental de l’expression des gènes. Les chercheurs de l’équipe dirigée par Frédéric Coin et Nicolas Le May ont donc cherché à établir le lien entre le facteur XPC et la transcription.
Ils ont tout d’abord utilisé des approches de génomique fonctionnelle qui leur ont permis d’observer la présence de la protéine XPC sur près de 500 promoteurs de gènes codant pour des protéines. Les sites d’occupation de la protéine XPC à l’ADN coïncident précisément avec ceux de l’ARN polymérase II, l’enzyme qui catalyse la transcription de ces gènes. En revanche, dans des cellules dérivées de patients dans lesquelles XPC est défectueux, ils ont montré que l’expression de ces gènes était dérégulée et que l’ARN polymérase II n’était plus recrutée correctement sur les promoteurs, mettant ainsi en évidence le lien entre le facteur XPC et la transcription.
Les chercheurs ont ensuite analysé les modifications des histones qui sont essentielles à la mise en place d’un environnement chromatinien optimal à l’expression des gènes. Ils se sont en particulier intéressés à l’acétylation de l’histone H3, effectuée par deux complexes majeurs de la transcription, SAGA et ATAC. Ils ont observé que l’acétylation de l’histone H3 au niveau des 500 promoteurs de gènes nécessitait la présence de XPC. En effet, XPC interagit avec le complexe ATAC et permet le recrutement de ce dernier sur le promoteur des gènes.
Ils ont ensuite cherché à comprendre comment la protéine XPC, qui reconnaît normalement des lésions sur l’ADN, pouvait être recrutée sur des promoteurs. Ils ont montré que la protéine XPC interagissait avec la protéine E2F1, un facteur de transcription reconnaissant certaines séquences d’ADN présentes en amont des promoteurs de ces 500 gènes. Ainsi une succession d’événements, initiée par le recrutement du facteur de transcription E2F1 suivi de l’arrivée d’XPC et du recrutement d’ATAC conduit au remodelage de la chromatine et à l’expression de ces gènes.
Ces résultats montrent qu’en plus de son rôle dans la réparation de l’ADN, XPC régule la transcription ; ils permettent également de mieux comprendre les bases moléculaires des défauts des patients atteints de Xeroderma pigmentosum.
Figure : Dans les cellules sauvages, l’interaction du facteur de réparation à l‘ADN XPC avec le facteur de transcription E2F1 permet le recrutement du complexe ATAC. Cette succession d’évènements entraîne l’acétylation de l’histone H3 et la transcription des gènes. Dans les cellules de patients, en l’absence du facteur XPC, le complexe ATAC n’est plus fonctionnel et les gènes ne sont pas exprimés
© IGBMC
Références :
* XPC is an RNA polymerase II cofactor recruiting ATAC to promoters by interacting with E2F1. Bidon, B., Iltis, I., Semer, M., Nagy, Z., Larnicol, A., Cribier, A., Benkirane, M., Coin, F., Egly, JM., and Le May, N..
Nature Communications 9, 2018 July 4 doi: 10.1038/s41467-018-05010-0
*
Contacts :
* Frédéric Coin
* Nicolas Le May
* Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire
UMR7104 (CNRS/INSERM/Université de Strasbourg)
1 Rue Laurent Fries
BP 10142
67404 ILLKIRCH CEDEX
DOCUMENT CNRS LIEN
|
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
