|
| |
|
|
 |
|
LE CERCLE CARRÃ |
|
|
| |
|
| |

LE CERCLE CARRÉ - ETUDE DE LA PERCEPTION D'UNE FORME MOUVANTE
Présentation de quelques illusions typiques et inédites de la perspective monoculaire. Etude expérimentale des conflits possibles entre ces illusions et la constance perceptive des grandeurs et des formes. Démonstration du rôle du mouvement dans la résolution de ces conflits.
VIDEO canal u LIEN
( si la vidéo n'est pas visible,inscrivez le titre dans le moteur de recherche de CANAL U )
|
| |
|
| |
|
 |
|
LA NOTION D'ÃVOLUTION |
|
|
| |
|
| |
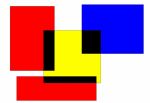
Hervé Le Guyader, "La notion d'évolution"
Pour présenter la notion d'évolution, j'ai choisi d'adopter une démarche historique, en singularisant différents points autour de périodes clés.
Premièrement, je présenterai quelques éléments importants des XVIIe et XVIIIe siècles qui permettent d'arriver à la conception d'un individu clé, Lamarck, date clé : 1829, publication de sa Philosophie zoologique. Le deuxième individu important est Darwin, date clé : 1859, publication de l' Origine des espèces. La troisième date clé se situe aux alentours de 1940, quand la Théorie synthétique de l'évolution est développée. Enfin, j'exposerai quelques éléments de l'après guerre, qui, à mon sens, montrent comment tout ce qui gravite autour des théories de l'évolution se met en place.
En introduction, j'attire votre attention sur cette citation d'Ernst Mayr qui compare les biologistes et les physiciens : « Au lieu de créer et de donner des lois comme le font les physiciens, les biologistes interprètent leurs données dans un cadre conceptuel »
Ce cadre conceptuel, c'est la notion d'évolution, qui se construit pas à pas, à force de discussions, controverses, voire même d'altercations, de progrès conceptuels ou expérimentaux.
Actuellement, ce cadre conceptuel devient extrêmement compliqué. Néanmoins, il s'en dégage quelques idées directrices.
I. L'apparition du transformisme
Je vous présente tout d'abord comment l'idée, non pas d'évolution, mais de transformisme, est apparue.
En premier lieu, je tiens à insister sur un point. En histoire, on montre souvent l'apparition de concepts « nouveaux » - sous entendu : avant, il n'existait rien. De plus, on attache souvent l'apparition d'un concept à un individu clé, considéré comme un génie. En réalité, ce génie, cet individu clé, ne représente la plupart du temps que le courant de l'époque, et ne fait « que » cristalliser une idée, qui existe néanmoins chez ses contemporains.
Pour que l'idée du transformisme apparaisse, deux mouvements se sont produits en même temps. La première avancée concerne la réfutation d'idées erronées. Ces idées, tant qu'elles n'étaient pas réfutées, empêchaient l'émergence de la notion de transformisme. Concomitamment, de nouveaux concepts apparaissent.
A. Les obstacles au transformisme
1. La métamorphose
Parmi les concepts erronés, celui de métamorphose est l'un des plus importants. Une planche extraite d'un livre d'Ulisse Aldrovandi (1522 - 1605) (fig.1), édité en 1606, illustre cette idée. Elle représente des crustacés, qui appartiennent à la classe des cirripèdes : des anatifes, crustacés fixés par un pédoncule, et dont le corps est contenu dans une sorte de coquille formée de plaques calcaires.
Cette planche montre comment on concevait le devenir de ces coquillages : selon Aldrovandi, les anatifes peuvent se transformer en canards ! Les cirres devenaient les plumes, le pédoncule, le cou, et la tête du canard correspond à l'endroit de fixation. J'aurais pu vous citer bien d'autres exemples de la sorte... D'ailleurs, ceux qui ont fait du latin reconnaîtront peut-être dans le terme actuel pour désigner une de ces espèces, Lepas anatifera, le terme anatifera qui signifie « qui porte des canards ».
Ainsi, dans les esprits d'alors, les animaux pouvaient se transformer les uns en les autres, un crustacé en canard, parmi une foultitude d'exemples. On concevait également des passages du monde végétal au monde animal... Tout était imaginable !
Dans ces conditions, il était impossible que l'idée d'un processus historique puisse apparaître. Ces exemples de métamorphose sont rencontrés jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Puis chacun des exemples de métamorphose est tour à tour réfuté. La notion-même devient progressivement la notion biologique actuelle - la métamorphose par mues des insectes et le passage têtard-adulte des batraciens.
2. La génération spontanée
La deuxième idée, la notion de génération spontanée, n'est pas caractéristique des XVIIe et XVIIIe siècles. Il faudra attendre Louis Pasteur (1822 - 1895) pour qu'elle soit complètement anéantie. En termes actuels, la notion de génération spontanée consiste en ce que de la « matière inanimée » puisse s'animer et produire des êtres vivants. L'abbé Lazzaro Spallanzani (1729-1799) est un homme clé parmi ceux qui ont démontré que la génération spontanée n'existe pas, du moins au niveau des organismes de grandes tailles : souris, insectes... etc. Cependant, il faudra attendre la controverse de 1862 entre Pasteur et Pouchet pour que cette notion disparaisse également au niveau des microorganismes. Retenons qu'au XVIIIe siècle cette notion ne persistera qu'à l'égard des « animalcules », les petits organismes.
3. L'Echelle des Êtres
La notion d'Echelle des Êtres existe déjà chez Aristote. Cette notion traverse tout le Moyen- Age, puis est remise en valeur par Gottfried Leibniz (1646-1716) et reprise par le biologiste Charles Bonnet (1720-1793).
La planche (fig 2) figure cette conception du monde : au bas de l'échelle, se situent les quatre éléments : feu, air, terre, eau. Des terres, on monte vers les cristaux et les métaux. Ensuite, on progresse vers le corail, les polypes, les champignons, jusqu'aux végétaux, insectes et coquillages. Certaines hiérarchies peuvent paraître étranges : les serpents d'abord, les poissons ensuite. Plus haut encore, les poissons, dominés par les poissons volants, qui conduisent aux oiseaux (!) ; puis des oiseaux, on parvient aux quadrupèdes et, qui se situe au sommet de l'échelle ? Bien naturellement : l'homme.
Ce concept était très ancré avant la Révolution. Un extrait d'un poème d'Ecouchard le Brun (1760) illustre comment les lettrés concevaient les relations entre êtres vivants :
« Tous les corps sont liés dans la chaîne de l'Être.
La nature partout se précède et se suit.
[...]
Dans un ordre constant ses pas développés
Ne s'emportant jamais à des bonds escarpés.
De l'homme aux animaux rapprochant la distance,
Voyez l'homme du Bois lier leur existence.
Du corail incertain, ni plante, ni minéral,
Revenez au Polype, insecte végétal. »
Tout était mêlé, avec une notion de progrès. Cette échelle des Êtres vivants est un concept qu'il a fallu discuter longuement, avant qu'il ne soit réfuté.
Cette notion d'Echelle des Êtres, il faut le souligner, est une notion quasi intuitive que tout individu développe. Il ne faut pas se focaliser sur son aspect historique ou archaïque. Chacun, de façon « naturelle », s'imagine être au sommet d'une Echelle des Êtres et conçoit une hiérarchie qui le lie à des subordonnés.
4. L'échelle de temps
Dernière conception à réfuter, la notion de temps. Avant la Révolution, l'échelle des temps reste une échelle biblique. Différents théologiens anglicans ont longuement calculé le temps qui les séparait de la création du monde, à partir des généalogies bibliques. Ils n'étaient pas tous d'accord, à une centaine d'années près, mais s'accordaient autour de 6 000 ans. Comment une idée d'évolution aurait-elle pu germer dans les esprits avec une marge de temps aussi courte ?
L'un de ceux qui réfutent cette idée, c'est Georges Buffon (1707-1788). Il propose une dizaine de milliers d'années, puis une centaine de milliers d'années. Enfin, dans sa correspondance, il émet l'idée que, peut être, la vie serait apparue il y a plusieurs millions d'années. C'est donc à cette époque que naît l'idée d'un temps long, en lien avec le développement de la géologie de l'époque.
B. Les nouvelles idées
A présent, quelles sont les nouvelles propositions ? Trois notions sont essentielles pour que les concepts de transformisme et d'évolution puissent apparaître.
1. L'unicité de la classification naturelle
Depuis Aristote au moins, les hommes ont voulu classer les organismes. Initialement, cette classification a principalement occupé les botanistes.
Aux XVe et XVIe siècles, on se retrouve avec une multitude de systèmes et de méthodes de classification. La bibliothèque du Muséum d'Histoire Naturelle en conserve une centaine dans ses vieux livres. S'il en reste tant actuellement, il en existait au minimum 500 à 600 en Europe, à cette époque.
Carl von Linné (1707-1778), comme les savants de cette époque, est un grand lecteur : il connaît toutes les tentatives réalisées par ses contemporains. Brusquement, il lui apparaît quelque chose d'assez extraordinaire. En effet, lorsque le travail de classification est mené correctement, en bonne logique, d'après de bons caractères, à chaque fois les grandes familles de la botanique ressortent : liliacées, orchidacées, rosacées... etc. Linné remarque que ces multiples tentatives conduisent à une même classification, un même ordonnancement. Tout se passe comme s'il existait une unité qui représente un ordre de la Nature. L'objectif est désormais de décrire cet ordre par une classification naturelle. Cette classification est nécessairement unique, car il n'y a qu'un ordre dans la Nature. Dans le contexte judéo-chrétien de l'époque, Linné imaginait que cette classification naturelle représentait l'ordre de la création.
Cette unicité de la classification est une idée extrêmement forte, comme on le verra avec Darwin. Elle change le sens de la classification - non plus seulement ranger les organismes, mais trouver une unité au monde du vivant.
2. Le concept d'homologie
Le concept d'homologie est mis au point par Etienne Geoffroy St Hilaire (1772-1844). Il utilise des travaux de botanique et bâtit un concept repris par Cuvier quasi en même temps : le concept de plan d'organisation. Cette idée de plan d'organisation, bien antérieure à Geoffroy St Hilaire, est fondamentale. Elle met en évidence que certains êtres vivants sont organisés de la même façon. Cuvier présente quatre plans d'organisation différents pour l'ensemble du règne animal - par exemple, le plan d'organisation des vertébrés.
A partir de ces plans d'organisation, Geoffroy St Hilaire construit un outil très performant pour l'anatomie comparée. Il crée, bien que ce ne soit pas le terme qu'il emploie, le concept d'homologie. Il affirme la nécessité, si on souhaite comparer les organismes, de savoir quels sont les "bons" organes que l'on compare : comment savoir si on compare les « mêmes » organes chez deux organismes différents ? Geoffroy Saint-Hilaire essaie, tout simplement, de trouver des organes qui occupent la même situation dans un plan d'organisation. Par exemple, en observant les membres antérieurs de vertébrés quadrupèdes (fig 3), on remarque qu'à chaque fois, le cubitus, entre autres, se trouve au même endroit dans le membre, même si la forme, la fonction de ce membre changent entre ces animaux.
Ce concept d'homologie permet de comparer de façon pertinente les organismes, ce qui est la condition pour proposer une bonne systématique.
3. La mort des espèces
En plus du concept d'homologie, George Cuvier (1769-1832) apporte une autre notion, qui a un impact considérable. Il démontre, par la paléontologie, que les espèces meurent. Grâce à des fossiles de vertébrés, en particulier ceux du gypse de Montmartre, il prouve qu'il existait des animaux qui n'existent plus actuellement dans le monde, c'est-à-dire que les espèces disparaissent.
Ce concept de mort des espèces a été une révolution extrêmement importante à l'époque, au tout début du XVIIIesiècle. Cet extrait de La peau de chagrin, de Balzac, illustre la portée de ce concept dans le monde des lettres :
« Cuvier n'est-il pas le plus grand poète de notre siècle. Notre immortel naturaliste a reconstruit des mondes avec des os blanchis. Il fouille une parcelle de gypse, y perçoit une empreinte et vous crie : « Voyez ! ». Soudain, les marbres s'animalisent, la mort se vivifie, le monde se déroule »
Brusquement, l'idée apparaît que des mondes, qui n'existent plus, existaient; le monde « se déroule » ; on verra qu'il « évolue ».
C. Lamarck et le transformisme
1. Logique et transformisme
Pour résumer, si vous réfutez les métamorphoses, si vous abandonnez le concept de génération spontanée, si vous allongez l'échelle de temps, si vous relativisez l'Echelle des Êtres, si vous imaginez une unité de classification, si vous concevez les concepts d'homologie et de plan d'organisation et si vous acceptez l'idée de mort des espèces, vous ne pouvez que suivre Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829), puis proposer de conserver avec lui la notion de transformisme.
Pourquoi ? Très brièvement, si on suit un raisonnement logique, il ne reste que deux possibilités pour réunir ces idées. Soit on reste créationniste : il faut alors nécessairement imaginer des créations multiples. Or, cela ne figure pas dans la Bible, qui ne mentionne qu'une seule création. Soit, on opte pour une seconde possibilité : les espèces se transforment les unes en les autres. Une troisième possibilité a été retenue par quelques théologiens : le stock des espèces allait en s'amenuisant - ce qui, d'après eux, n'était pas important, puisque seul l'homme a une valeur. Cette dernière théorie a eu très peu d'impact.
2. La théorie de Lamarck
Lamarck présente une classification. Il a l'idée remarquable, même si elle a été réfutée plus tard, de séparer vertébrés et invertébrés. Au niveau des animaux, il construit ce qui reste une échelle des Êtres. Il classe les animaux en trois catégories : les animaux apathiques, les animaux sensibles, les animaux intelligents. Cette vision demeure hiérarchisée.
Il imagine une transformation des organismes les uns en les autres (fig 4). Un premier point est fondamental, novateur : Lamarck présente des bifurcations, c'est-à-dire qu'il construit un arbre, une arborescence. A ma connaissance, c'est la première représentation qui rompt ainsi la linéarité de l'échelle des Êtres. Deuxième innovation, les espèces sont reliées par des points (actuellement ce serait symbolisé par des flèches), qui désignent les transformations possibles : les vers en insectes, les poissons en reptiles ou en amphibiens. La limite de la vision de Lamarck se situe à la base de ce réseau de transformations : la génération spontanée alimente le stock des organismes les plus simples - les vers -. Pour expliquer ce schéma, on a utilisé l'image de l'escalier roulant, qui, avec ses arrêts, ses paliers, paraît particulièrement pertinente : elle montre que Lamarck n'a pas une vision historique. Par exemple, au niveau des oiseaux, certains viennent de prendre l'escalier roulant - ils viennent de se transformer -, tandis que d'autres sont là depuis longtemps. Cela signifie que les animaux semblables ne résultent pas d'une même transformation, qui serait survenue à une même date dans le cours de l'histoire.
Il faut retenir, dans la pensée de Lamarck, cette notion de transformation, d'arbre, nourri continuellement par la génération spontanée.
II. Darwin
Sans entrer dans les détails de la vie de Charles Darwin (1809-1882), un élément important pour le développement de sa vision scientifique et pour l'élaboration de l' Origine des espèces (1859) réside dans un tour du monde de presque cinq ans, effectué entre 1831 et 1836. Non seulement Darwin est un très bon naturaliste et un très bon géologue, mais il possède également des notions d'anatomie et d'embryologie comparées.
A. La théorie de L'Origine des Espèces
Pour illustrer la difficulté de recevabilité que rencontra le livre de Darwin à sa publication, voilà le sous- titre donné dans la traduction française. Le titre original anglais est "Origin of species - by means of natural selection" , qui se traduit par : « L'origine des espèces - par les moyens de la sélection naturelle ». Or, dans l'édition française de 1862, ce titre est « traduit » de manière erronée en : « De l'origine des espèces ou des lois du progrès chez les êtres organisés ». Ce sous-titre montre combien la notion de progrès - et d"échelle des espèces" implicite - était profondément ancrée.
La meilleure solution pour exprimer l'idée clé de L'Origine des espèces, c'est d'examiner un extrait qui traduit de manière essentielle le sens que donne Darwin à la notion de classification :
«Le système naturel, c'est-à-dire la classification naturelle, est fondé sur le concept de descendance avec modification... »
Ce concept de «descendance avec modification » est essentiel pour comprendre la pensée de Darwin. Pourtant, si on interroge quelqu'un sur ce qu'a apporté Darwin, il répondra sans doute « la sélection naturelle "». En réalité, il a proposé ces deux idées, liées : sélection naturelle et descendance avec modification. A mon sens, c'est cette dernière idée qui est la plus importante.
« ... sur le concept de descendance avec modification, c'est-à-dire que les caractères que les naturalistes décrivent comme montrant de réelles affinités entre deux ou plusieurs espèces sont ceux qui ont été hérités d'un parent commun. »
Ces caractères auxquels Darwin fait référence, ce sont les caractères homologues de Geoffroy St Hilaire. Ce que propose Darwin, c'est une réponse à la question : pourquoi ces caractères sont-ils homologues ? Parce qu'ils ont été hérités d'un parent commun. Darwin interprète la notion de ressemblance, très prégnante depuis Geoffroy St Hilaire, comme une notion d'héritage de caractères. Il ne remet pas en cause le travail de ces prédécesseurs : il lui donne « seulement » un autre sens.
« Et par conséquent, toute vraie classification est généalogique... »
Enfin, Darwin plonge ce travail dans un continuum temporel. Cette notion de généalogie bouleverse le sens des classifications : désormais, on recherche des relations de parenté :
« ... c'est-à-dire que la communauté de descendance est le lien caché que les naturalistes ont cherché inconsciemment et non quelque plan inconnu de création. »
A l'époque, cette dernière phrase a représenté une provocation extraordinaire !
Pour éclairer le propos de Darwin, voilà la seule illustration présente dans L'Origine des Espèces (fig 5). Premièrement, cette planche dévoile une vision historique : les lignes horizontales représentent des horizons temporels. Cette figure comprend trois concepts importants :
1) des espèces disparaissent - l'idée de Cuvier ;
2) au cours du temps, les espèces peuvent se transformer - l'idée de Lamarck ;
3) des espèces peuvent donner naissance à plusieurs autres espèces.
Si on considère deux espèces après un embranchement, Darwin considère qu'il faut les rapprocher parce qu'elles partagent un ancêtre commun. Or les espèces partagent toujours un ancêtre commun. La différence réside dans la plus ou moins grande proximité de ces ancêtres. Pour Darwin, les organismes se ressemblent beaucoup car ils partagent un ancêtre commun récent. Les organismes très différents partagent un ancêtre commun lointain, à partir duquel il y a eu énormément de temps pour diverger.
B. La première « généalogie » des organismes
Ces concepts proposés par Darwin sont immédiatement repris par un biologiste allemand, Ernst Haeckel (1834 - 1919). Haeckel poursuit ces idées, en les exagérant même un peu.
Il utilise un arbre pour représenter sa classification. Il propose trois règnes : aux deux règnes animal et végétal classiques, il ajoute les protistes (organismes unicellulaires). Son apport fondamental se situe à la base de l'arbre. Pour chacun des règnes, il situe un ancêtre commun hypothétique, et surtout, il met en place un tronc avec une seule racine commune à l'ensemble des êtres vivants-un ancêtre commun à l'ensemble des organismes.
Cette proposition, en 1866, est le premier arbre dit « phylogénétique »- terme créé par Haeckel. Bien que discutée à ses débuts, l'idée essentielle d'origine commune est conservée - elle contient également l'idée d'origine de la vie sur terre -. Le mouvement est lancé : depuis Haeckel, les chercheurs vont « se contenter » de corriger cet arbre. Seules les logiques pour inférer les relations de parenté sont modifiées et améliorées.
C. Les difficultés de Darwin
Il manque des éléments à Darwin pour expliquer les mécanismes soutenant ce double concept de descendance avec modification. Elle contient premièrement l'idée de descendance entre espèces. Darwin n'utilise pas d'échelle des temps. Entre les lignes horizontales de son schéma, il ne s'agit pas d'années, ni de millions d'années : il s'agit de nombres de générations. Selon Darwin, ce qui rythme la vie des organismes, c'est la reproduction sexuée, à l'origine du concept de descendance. Deuxièmement, Darwin suppose que les caractères héréditaires, transmis via la reproduction sexuée, se « transforment »- mais il ignore comment.
Les deux disciplines qui lui manquent sont d'une part la génétique, et d'autre part, l'embryologie.
III. La Théorie synthétique de l'évolution
A. Les bases de la théorie
Un événement scientifique se produit au début du XXe siècle : la redécouverte des lois de Gregor Mendel (1822 - 1884), indépendamment par trois chercheurs : le hollandais Hugo De Vries (1848 - 1935), l'allemand Carl Correns (1864 - 1933), et l'autrichien Erich von Tschermak (1871 - 1962). Redécouverte, certes, mais enrichie d'un nouveau concept essentiel, celui de mutation. Cette idée de mutation permet de concevoir comment les caractères sont à la fois héréditaires et changeants.
A partir de 1905 jusqu'à 1930, se produit un difficile rapprochement entre deux disciplines : la génétique dite « des populations » (l'étude du devenir des fréquences de gènes dans les populations au cours du temps), se rapproche du darwinisme, par l'intermédiaire de la sélection naturelle. Ce rapprochement conduit à la Théorie synthétique de l'évolution. Signalons que cette traduction mot à mot de l'anglais introduit une connotation étrange en français - c'est plutôt une théorie qui fait une synthèse -.
Cinq biologistes de renom participent à cette nouvelle vision de l'évolution. Le premier individu clé est Theodosius Dobzhansky (1900 - 1975), d'origine russe, immigré aux États-Unis. Comme quasi tous les autres protagonistes de cette théorie, il appartient à l'Université de Columbia, à New York. Dobzhansky publie en 1937 un ouvrage intitulé : Genetics and Origin of Species. Cette référence explicite à Darwin traduit bien sa volonté de démontrer, par la génétique, que Darwin avait raison.
Les autres chercheurs impliqués dans cette vision nouvelle sont :
- Julian S. Huxley (1887-1975), généticien ;
- Ernst Mayr, zoologiste, ornithologue, théoricien de la spéciation ;
- George G. Simpson (1902-1984), géologue et paléontologue ;
- Ledyard G. Stebbins, qui travaille sur la spéciation en biologie végétale.
J'ai repris à partir d'un article récent d'Ernst Mayr les principes de base de cette théorie :
Premier principe : l'hérédité est particulaire et d'origine exclusivement génétique. Cela signifie que l'hérédité est portée par des particules-les gènes-qui ne se mélangent pas. En insistant sur l'origine exclusivement génétique, ce principe nie l'idée d'hérédité des caractères acquis, une forme de lamarckisme en vogue à l'époque.
Second principe : il existe une énorme variabilité dans les populations naturelles. Les organismes présentent une grande variabilité des différents gènes, des différents caractères. Cette variabilité intraspécifique permet l'apparition de nouvelles espèces à partir d'une espèce donnée.
Troisième principe : l'évolution se déroule dans des populations distribuées géographiquement. Un des moteurs les plus importants de la spéciation est l'isolement reproducteur. Les populations peuvent se retrouver séparées par des barrières géographiques, de comportement... etc. A partir du moment où une barrière de reproduction apparaît, des populations isolées peuvent donner naissance à des espèces distinctes.
Quatrième principe : l'évolution procède par modification graduelle des populations. L'évolution se fait pas à pas suivant un gradualisme quasi linéaire en fonction du temps. Autrement dit, le taux d'évolution est toujours considéré comme à peu près constant par unité de temps.
Cinquième principe : les changements dans les populations sont le résultat de la sélection naturelle. Les changements de fréquence des gènes et de caractères dans les populations sont provoqués par la sélection naturelle. Cette idée sera remise en question plus tard : la sélection naturelle existe, certes, mais d'autres moteurs de changement seront avancés.
Dernier principe : la macro-évolution n'est que le prolongement dans le temps de ces processus. La macro-évolution désigne les changements importants, les grands bouleversements, en particulier au niveau des animaux - changements de plans d'organisation, etc. Cette macro-évolution n'est considérée ici que comme le prolongement de la micro-évolution - les changements graduels. La macro-évolution n'est que le résultat de petits changements accumulés pendant des dizaines ou des centaines de millions d'années.
La théorie synthétique de l'évolution contredit la notion fondamentale de finalité : elle affirme que l'évolution ne poursuit aucun but. Tout se passe pas à pas, dans un affrontement continuel, au présent, des organismes avec leur environnement, et les uns par rapport aux autres, et non en fonction d'un but précis.
B. La rupture de la cladistique
Cette théorie synthétique de l'évolution a été un nouveau point de départ. Dans les années 1950, plusieurs aspects sont discutés pour parvenir à la vision actuelle.
Premier point clé : cette nouvelle vision modifie la manière de traiter les fossiles en particulier, et l'histoire de la vie sur Terre, en général. Deux éléments illustrent cette notion. Le premier est révélé par un schéma de Simpson, qui, représente par une arborescence les différentes classes de vertébrés, les mammifères, les oiseaux, les reptiles et les poissons. Malgré Darwin, cet arbre traduit, non pas une recherche de parenté, mais de descendance, de généalogie. Par exemple, l' Ichthyostega est placé de telle sorte qu'on puisse penser qu'il est l'ancêtre de l'ensemble des organismes qui le suivent.
Cette représentation illustre un problème clé : comment retracer les relations de parenté ? Comment se servir des fossiles ? A ces questions, le zoologiste allemand Willy Hennig (1913-1976) propose une nouvelle méthode : la cladistique.
Hennig pense qu'il faut rechercher, non pas des relations de descendance, mais de parenté-les relations de cousinage, en quelque sorte-, et positionner des ancêtres hypothétiques. Pour mettre à jour ces relations de parenté, il faut, parmi les caractères homologues (hérités d'un ancêtre commun), considérer ceux qui correspondent à des innovations. Ces caractères novateurs permettent de rassembler les organismes.
En considérant ces organismes (fig 6), des oiseaux et des reptiles (tortues, lézards et crocodiles), une des innovations héritées d'un ancêtre commun hypothétique est la plume, partagée par l'ensemble des oiseaux. La plume résulte de la transformation de l'écaille épidermique existant chez les organismes reptiliens, à la suite d'un processus évolutif particulier.
Cette démarche, fondée non pas sur un mais plusieurs caractères, permet de construire des arbres phylogénétiques. La méthode consiste à définir des groupes monophylétiques, pas à pas, à partir d'ancêtres hypothétiques communs. Un groupe monophylétique est un groupe qui rassemble un ancêtre et l'ensemble de ses descendants. A l'opposé, un groupe paraphylétique correspond à un ancêtre et une partie de ses descendants.
Pour éclairer ces concepts, considérons cet arbre, relativement juste - relativement car encore sujet de controverse. Cet arbre met évidence un groupe monophylétique, les sauropsides, groupant les oiseaux, les crocodiles, les lézards, les serpents et les tortues. Or, dans la classification "traditionnelle", les reptiles (serpents, lézards, tortues) figurent d'un côté, les oiseaux de l'autre. Cela revient à présenter un groupe monophylétique (les oiseaux) et un groupe paraphylétique (les serpents, les oiseaux et les tortues). Cette dichotomie se fonde sur un ensemble de particularités des oiseaux qui les mettaient, intuitivement, "à part" : la capacité de voler, le plumage... Dans ce cas-là, on occulte la relation de parenté extrêmement importante entre les crocodiles et les oiseaux. Dans le cas contraire, on explicite un groupe monophylétique clé : les archosauriens (crocodiles et oiseaux), ce qui modifie la conception évolutive intuitive.
On aurait "naturellement" tendance à penser que les crocodiles ressemblent plus aux varans ou aux lézards qu'aux oiseaux. Cette méthode met en pièce le concept de ressemblance - en trouvant des caractères (moléculaires ou morpho-anatomiques) qui permettent de positionner des ancêtres hypothétiques communs qui ont apporté des innovations. Dans ce cas particulier, l'innovation est la présence d'un gésier. Ce gésier, connu chez les oiseaux, moins chez les crocodiles, n'est pas présent chez les autres reptiles.
Examinons à présent cet arbre (fig 7), qui représente les archosaures. Deux groupes d'animaux vivent actuellement : les oiseaux et les crocodiliens (ici l'alligator), aux deux extrémités du graphe. D'autres branches sont importantes :
- la branche des ptérosauriens - les « dinosaures » volants ;
- le groupe des dinosaures, divisés en deux branches : ornitischiens et saurischiens ;
- les théropodes.
Contrairement à la figure précédente (fig 6), les fossiles ne figurent pas en tant qu'ancêtres. Ils sont représentés comme apparentés aux autres organismes. Des ancêtres hypothétiques communs sont positionnés. A leur niveau, on fait apparaître les innovations. De cette manière, l'histoire de ces innovations est retracée : à partir d'organismes de "type" dinosaure, on voit l'évolution des différents caractères (tels que la plume, l'évolution des membres, mâchoires...etc.), jusqu'aux oiseaux actuels.
Parmi ces archosaures, seuls existent encore les crocodiles et les oiseaux. Entre ces deux groupes se trouvent tous les dinosaures. Les oiseaux partagent des ancêtres hypothétiques avec quantité de ces dinosaures. On croit que les dinosaures ont disparu. Et bien non ! Quand vous croiserez une volée de pigeons dans les rues de Paris, vous pourrez dire : "nous sommes envahis par les dinosaures !" Tous les oiseaux sont des dinosaures : cette méthode change considérablement la vision intuitive des choses, n'est ce pas ?
Je conclus cet exposé en présentant ce à quoi vous avez échappé :
- Tout d'abord, à la phylogénie moléculaire. Actuellement, tous les organismes de la diversité du vivant peuvent apparaître sur un même arbre : bactérie, animaux, plantes... Cet arbre commence à représenter une bonne vision synthétique du monde vivant.
- Ensuite, à l'évolution du génome. On commence à comprendre comment les innovations, les mutations surviennent au niveau du génome. Elles se produisent principalement par duplication des gènes : des motifs de l'ADN se dupliquent et ces gènes dupliqués peuvent acquérir de nouvelles fonctions. La mise en évidence de ces phénomènes permet de mieux comprendre comment la descendance avec modification se produit. Ce ne sont pas de petites modifications ponctuelles comme on le pensait auparavant.
- Troisième point : la sélection n'agit pas exclusivement au niveau des organismes. Elle opère à tous les niveaux d'organisation. Un exemple très simple est la présence, dans les génomes, de petites unités appelées transposons. Ces transposons se répliquent, indépendamment, envahissent le génome, peuvent passer d'un chromosome à l'autre. Ces transposons participent certainement à la fluidité du génome. Le pourcentage de ces transposons dans le génome est considérable : 40 % du génome humain est composé de ces séquences - des unités « parasites "» puisqu'elles ne participent ni à la construction, ni au fonctionnement de notre organisme. Au niveau végétal, ce chiffre est encore plus important : jusqu'à 75 % du génome de certaines plantes serait envahi de transposons.
- Avant dernier point : l'évolution n'est pas si graduelle, elle se fait souvent par crises. La vitesse d'évolution change. Des crises se sont produites, extrêmement importantes dans l'histoire géologique de la Terre. L'une des plus belles crises est celle du Permien, au cours de laquelle 80 % des espèces auraient disparu. Ces crises d'extinctions ont été suivies de radiations, où des innovations très importantes se produisent.
- Enfin, dernier point qui m'est cher. La notion de progrès devient complètement relative. Les innovations se font sur toutes les branches : il n'existe pas d'organisme plus évolué qu'un autre. Tous les organismes ont parcouru le même temps d'évolution. Seulement, ils n'ont pas évolué dans les mêmes directions, en raison de contraintes différentes, de milieu et de choix de stratégies différentes.
Si on prétend dans un style « d'Echelle des Êtres », qu'il existe de « meilleurs » organismes, c'est qu'on met en exergue un ou plusieurs caractères. Ce n'est pas de la biologie. La biologie considère tous les caractères au même niveau et que la biodiversité est structurée par cette évolution. Dans ces conditions, chaque organisme vaut par lui-même.
VIDEO canal u LIEN
( si la vidéo n'est pas visible,inscrivez le titre dans le moteur de recherche de CANAL U ) |
| |
|
| |
|
 |
|
COMMENT SE FORMENT NOS HABITUDES |
|
|
| |
|
| |

Comment se forment nos habitudes
Hélène Beaunieux dans mensuel 432
Jongler fait appel à la mémoire procédurale. C’est la mémoire des savoir-faire, qui nous permet d’accomplir automatiquement certaines activités physiques, verbales ou cognitives routinières.
Selon quels processus acquérons-nous tous nos savoir-faire ? Leur identification permet le développement de nouvelles techniques d’apprentissage pour certaines personnes amnésiques.
EN DEUX MOTS : La mémoire procédurale permet d’accomplir automatiquement des activités physiques, verbales et cognitives routinières. Identifiée il y a déjà plusieurs siècles par les philosophes, elle fait actuellement l’objet de nombreux travaux de recherche. Ils ont permis de déterminer la façon dont elle interagit avec d’autres types de mémoire, telle la mémoire des évènements.
La journée a été longue, et le travail harassant. Le soir venu, fort heureusement, votre voiture emprunte le chemin du retour, et vous conduit jusque chez vous comme si elle était branchée sur pilote automatique. Vous ne vous souvenez plus des circonstances dans lesquelles vous avez appris à conduire. Ni de la première fois où vous avez parcouru cette route. Mais vous la sillonnez sans produire le moindre effort.
De tels automatismes sont actionnés par une mémoire qualifiée de « procédurale » par les neuropsychologues. Elle fait actuellement l’objet de nombreux travaux de recherche. Ces travaux ont conduit à une compréhension plus fine des mécanismes liés au fonctionnement de cette mémoire procédurale, mais aussi des autres types de mémoire avec lesquels celle-ci interagit, telle la mémoire des événements et de leur contexte.
Bergson précurseur
La mémoire procédurale a d’abord été un objet d’intérêt pour des philosophes, à l’instar d’Henri Bergson, en particulier dans son ouvrage Matière et Mémoire, publié en 1896. Bergson n’était pas le premier à s’intéresser à la mémoire sous une forme évoquant les théories cognitives modernes. René Descartes, Pierre Maine de Biran et Théodule Ribot l’avaient fait avant lui. Mais, pour tout neuropsychologue s’intéressant à cette fonction mentale, la lecture de Matière et Mémoire est toujours saisissante.
« Le passé se survit sous deux formes distinctes : dans les mécanismes moteurs et dans les souvenirs indépendants. » Le postulat bergsonien de deux mémoires de natures différentes est en accord avec les modèles actuels de l’architecture de la mémoire humaine. Cette distinction renvoie à celle formulée en 1980 par Neal Cohen et Larry Squire, de l’université de Californie. En montrant que des patients amnésiques pouvaient, malgré tout, apprendre une nouvelle habileté de lecture sans conserver de souvenirs des séances d’apprentissage, ils ont opéré une distinction entre la mémoire déclarative - mémoire du « savoir quoi » - et la mémoire procédurale - mémoire du « savoir comment ».
La mémoire déclarative permet la récupération consciente des événements - mémoire épisodique - et des faits - mémoire sémantique. La mémoire épisodique contient nos souvenirs de vie, comme un accident de trottinette, nos premiers rendez-vous amoureux, etc. Et la mémoire sémantique stocke tout ce que nous avons appris au cours de notre vie : une recette de cuisine ; 1515 : la bataille de Marignan, etc.
La mémoire procédurale correspond, quant à elle, à la mémoire de nos savoir-faire, expressions des procédures cognitives et motrices encodées en mémoire, non accessibles à la conscience et difficilement verbalisables. Elle nous permet d’accomplir, de manière automatique, des activités physiques, verbales ou cognitives routinières. C’est une mémoire qui s’exprime dans l’action.
Les capacités d’apprentissage de nouveaux automatismes par une variété de patients amnésiques ont ainsi été testées au moyen de tâches essentiellement motrices. Outre l’apprentissage de nouveaux automatismes, ces patients amnésiques conservent aussi tous leurs anciens automatismes : conduite automobile, gestes sportifs ou techniques, automatismes de calcul ou stratégie de jeu.
Il semble néanmoins que l’apprentissage de nouveaux automatismes cognitifs soit plus difficile à acquérir pour les patients présentant des troubles de la mémoire épisodique, ce qui est le cas des amnésiques. Ce constat a été réalisé en 1994 par Alan Baddeley et Barbara Wilson, de l’université de Cambridge [1] .
Ils avaient proposé à deux patients amnésiques d’apprendre à utiliser un agenda électronique afin de pallier leurs difficultés à s’orienter dans le temps et de mieux gérer leurs rendez-vous. Pour cela, ils avaient tenté de leur apprendre la procédure de programmation d’un rendez-vous dans un agenda électronique. Contre toute attente, ces deux patients avaient été incapables d’apprendre ce nouvel automatisme : ils commettaient des erreurs lors des premières étapes de cette procédure, et ils étaient incapables, lors de l’essai suivant, de ne pas les commettre à nouveau. Le fait est que les deux patients avaient déjà oublié leurs erreurs, ainsi que les solutions qui leur avaient été proposées sur le moment. Cette observation a conduit à reconsidérer le rôle de la mémoire épisodique dans l’apprentissage de nouvelles habiletés cognitives.
Phase transitoire
Des travaux menés en 2006 par notre laboratoire auprès de sujets jeunes non amnésiques ont, par ailleurs, montré que l’apprentissage d’une nouvelle habileté cognitive était de nature séquentielle, et qu’elle impliquait la mémoire épisodique [2] .
Notre objectif était d’étudier le rôle de certaines fonctions cognitives dans l’encodage d’une action en mémoire procédurale, grâce à une série d’expériences sur des sujets sains à qui nous avons demandé d’automatiser la résolution du problème de la « tour de Toronto ».
Trois tiges sont disposées sur une base rectangulaire. Sur la tige la plus à gauche, quatre disques de couleurs différentes sont enfilés : un noir, un rouge, un jaune et un blanc. Le disque le plus foncé se situe en bas, et le plus clair, sur le dessus. L’exercice consiste à reproduire la même configuration sur la tige la plus à droite, en obéissant à deux règles : ne bouger qu’un seul disque à la fois ; et ne jamais placer un disque foncé au-dessus d’un disque plus clair. L’objectif, pour le sujet, est de découvrir et d’automatiser la procédure de résolution du jeu à force de pratique. Nous avons ainsi démontré que l’apprentissage d’une procédure se déroule en trois étapes distinctes : une étape cognitive, une étape associative et une étape qualifiée d’autonome.
Lors de la première étape, le sujet découvre ce qu’il doit apprendre : il tâtonne et commet de nombreuses erreurs. Puis il passe à l’étape associative, phase transitoire au cours de laquelle il commence à contrôler la tâche à effectuer, sans pour autant l’avoir automatisée. Enfin, pendant la troisième étape, les gestes sont automatisés et atteignent un niveau d’efficacité maximale.
En plus de cet apprentissage, nous avons évalué l’intelligence non verbale des sujets, ainsi que leurs capacités de raisonnement, leurs capacités psychomotrices, leur mémoire de travail et leur mémoire épisodique, à l’aide de différents tests cognitifs.
Erreurs passées
L’examen des corrélations entre le niveau de performance des sujets lors des différentes étapes de la résolution de la tour de Toronto et leurs résultats à ces divers tests a permis de déterminer la contribution de chacune de ces fonctions à l’apprentissage procédural. Ces analyses indiquent que les sujets qui automatisent le plus vite la solution sont également ceux qui possèdent également la meilleure mémoire épisodique.
Nous avons ainsi établi que la mémoire procédurale ne fonctionne de manière autonome que lorsqu’une procédure est totalement automatisée. Les deux premières phases de l’apprentissage nécessitent, en revanche, l’intervention d’autres formes de mémoire : la mémoire épisodique et la mémoire de travail. Le recours à la première permet de se souvenir de ses erreurs passées, et ce faisant, de ne pas les reproduire. Quant à la mémoire de travail, il s’agit d’un registre à court terme, qui permet de visualiser dans son intégralité la séquence à effectuer.
Devant un distributeur automatique de billets, par exemple, l’étape cognitive correspond aux premiers retraits d’argent avec un nouveau code. Nous sommes alors très concentrés. Nous faisons appel à notre mémoire épisodique pour nous souvenir consciemment du code, et éviter les erreurs qui auraient pour conséquence de voir notre carte avalée par le distributeur ! À force d’utilisation, nous avons de plus en plus de facilités à taper ce nouveau code - même s’il nous arrive encore d’avoir une hésitation, ce qui correspond à la phase associative. Puis peut-être au terme de la période des soldes, nous entrons dans la phase autonome, au cours de laquelle la composition du code est devenue un automatisme. Nous n’avons plus à nous concentrer pour nous rappeler du code. Nos doigts le composent tout seuls.
Lobes frontaux
Cette dynamique est liée à une réalité cérébrale. En 2007, notre équipe a en effet démontré qu’à chacune de ces trois étapes correspondait l’implication d’aires cérébrales spécifiques [3] . La première étape est caractérisée par une activation du lobe frontal, qui est impliqué dans le fonctionnement de la mémoire épisodique et de nos capacités de résolution de problèmes. On observe ensuite un basculement progressif de cette activation vers les régions postérieures : le cervelet, les ganglions de la base * et le thalamus.
Ce basculement expliquerait pourquoi nos automatismes sont si difficiles à verbaliser. Reprenons l’exemple du distributeur de billets. Au départ, nous enregistrons notre code en mémoire épisodique afin de pouvoir le composer correctement. Mais, à force de pratique, ces informations sont transformées en un programme moteur, stocké cette fois en mémoire procédurale. Autrement dit, les régions antérieures de notre cerveau travaillent de moins en moins, tandis que les régions postérieures prennent le relais.
Il devient difficile, dès lors, de chercher à nous souvenir de notre code : une fois l’information transformée et stockée dans ces structures cérébrales, la trace conservée par les régions antérieures du cerveau est moins accessible, car moins utile. Nous connaissons notre code, mais il devient très difficile de le verbaliser... Tout simplement parce que l’information la plus accessible ne se trouve plus là où nous la cherchons : elle est stockée dans une zone du cerveau qui ne permet pas cette verbalisation. Heureusement, avec un effort de concentration faisant appel à nos lobes frontaux, nous pourrons tout de même mettre des mots sur les gestes que nous maîtrisons parfaitement et avoir accès à notre code caché dans un recoin de notre mémoire épisodique.
Apprentissage sans erreur
Le rôle joué par la mémoire épisodique et les régions antérieures du cerveau lors de la première étape explique pourquoi certains patients amnésiques, ainsi que tous les sujets présentant des troubles de la mémoire épisodique éprouvent des difficultés lors de ce type d’apprentissage. Ces difficultés peuvent aller d’un ralentissement de l’apprentissage procédural, comme cela a été récemment démontré chez des sujets âgés [4] et des alcooliques chroniques [5] , à l’impossibilité de mise en place d’un nouvel automatisme cognitif chez certains patients amnésiques [6] .
Face aux difficultés d’apprentissage des patients, et parce que la mémoire procédurale serait préservée chez ces derniers, plusieurs techniques d’acquisition adaptées à leurs difficultés ont été imaginées et testées. Parmi celles-ci, la technique de l’apprentissage sans erreur semble particulièrement efficace [7] . Son principe est simple : si les patients, du fait de leur déficit de mémoire épisodique, ne sont pas capables de corriger leurs erreurs d’apprentissage, mettons-les dans des situations où ils ne sont pas susceptibles d’en commettre.
Par exemple, il est possible d’aider un patient amnésique à automatiser le code PIN de son téléphone portable, à condition de rester à ses côtés avec lui lors des 50 premières utilisations afin de lui donner le code. À force de pratique, le patient va automatiser la série motrice sur le clavier de son téléphone. Il restera néanmoins incapable de s’en rappeler explicitement sans l’usage de son téléphone. Cette technique devra encore être développée et élargie, mais elle a déjà fait ses preuves, tant pour l’apprentissage des procédures cognitives de programmation d’agenda électronique chez des patients traumatisés crâniens [8] que la réactivation d’anciennes habiletés liées au jardinage chez une patiente atteinte de la maladie d’Alzheimer [9] .
Hélène Beaunieux 2009
chercheur dans l’unité de recherche de neuropsychologie cognitive et neuroanatomie fonctionnelle de la mémoire humaine de l’Inserm, à Caen.
[1] A. Baddeley et B. Wilson, Neuropsychologia, 32, 53, 1994.
[2] H. Beaunieux et al., Memory, 14, 521, 2006.
[3] V. Hubert et al., Human Brain Mapping, 28, 1415, 2007.
[4] V. Hubert et al., Human Brain Mapping, 30, 1374, 2009.
[5] A. Pitel et al., Alcoholism : Clinical and Experimental Research, 31, 238, 2007.
[6] B. Wilson et al., Neuropsychological Rehabilitation, 4, 307, 1994 ; A. Pitel et al., Brain Injury, 20, 1099, 2006.
[7] B. Wilson et al., Neuropsychological Rehabilitation, 4, 307, 1994.
[8] A. Pitel et al., Brain Injury, 20, 1099, 2006.
[9] S. Adam et al. dir., La Rééducation neuropsychologique en 2008, Solal, 2009.
NOTES
* Les ganglions de la base sont formés d'un ensemble de structures nerveuses enfouies profondément sous le cortex cérébral.
ACQUISITION : LE VÉLO, C'EST POUR LA VIE
- Enfants, nous avons appris à faire du vélo progressivement : d’abord avec des roulettes, puis avec l’aide d’un adulte, pour enfin pouvoir rouler seul. Après une longue période d’acquisition, nous sommes devenus des « experts ». Cette expertise est inscrite, à jamais, dans notre mémoire procédurale. C’est pourquoi les automatismes liés à la pratique du vélo sont rapidement activés, même après plusieurs années d’interruption. Et que nous avons le sentiment de n’avoir jamais cessé de rouler !
L’apprentissage des procédures motrices se déroule toutefois en trois étapes cognitives, associatives et autonomes. Seule la dernière correspond à l’encodage des informations en mémoire procédurale, et par conséquent, à l’émergence de l’automatisme. Ainsi, nous n’aurions jamais eu autant de facilité à remonter sur un vélo si nous avions arrêté sa pratique avant une maîtrise complète - avant l’encodage des procédures motrices en mémoire procédurale, autrement dit.
REMUE-MÉNINGES : LES TESTS DOPENT LA MÉMOIRE
Mieux vaut passer un test qu’étudier sans relâche. Selon une étude américaine réalisée en 2006 [1], évaluer ses connaissances après un cours en répondant à un questionnaire se révèle doublement bénéfique. Lors d’un deuxième examen, non seulement l’on retrouve mieux les informations sur lesquelles portaient les questions du premier test, mais aussi - dans une moindre mesure - celles qui n’étaient pas directement concernées par le questionnaire.
Pour parvenir à ce constat, les chercheurs ont donné à apprendre à des étudiants en psychologie un texte sur un domaine qu’ils ne connaissaient pas a priori - sur les toucans ou le Big Bang, par exemple. Ils les répartissaient ensuite en trois groupes : une partie passait un test ; une autre recevait des textes supplémentaires recouvrant les mêmes informations ; les derniers étaient congédiés. Le lendemain, tous passaient un examen sur le sujet étudié : les étudiants du premier groupe, qui avaient déjà subi un test, obtenaient un résultat supérieur en moyenne à celui de leurs camarades.
[1] J.C.K. Chan et al., Journal of Experimental Psychology : General, 135, 553, 2006.
SAVOIR
- Une présentation complète de la technique de l'apprentissage sans erreur.
http://tiny.cc/Zv87Q
DOCUMENT larecherche.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
MÃMOIRE SPATIALE |
|
|
| |
|
| |

Le chef d'orchestre de la mémoire spatiale
Bruno Poucet et Etienne Save dans mensuel 344
Trouver son chemin ou se perdre : l'équation, binaire de prime abord, se révèle à inconnues multiples. Dans le cerveau, deux populations de neurones, découvertes presque par hasard, permettraient de mémoriser les lieux et de s'orienter dans l'espace. Chez le rat, on frôle les certitudes. Et chez l'homme ?
Se déplacer dans une ville familière se fait tout naturellement, presque sans y penser. En revanche, en arrivant dans une ville inconnue, nous éprouvons souvent de grandes difficultés d'orientation. Ces difficultés diminuent tandis que nous apprenons à nous repérer, à situer par exemple les monuments les uns par rapport aux autres, les avenues par rapport aux espaces verts, etc. Nous parvenons alors à mémoriser les relations spatiales entre les lieux importants et nous formons dans notre cerveau une représentation de la ville. C'est cette mémoire spatiale que l'on va utiliser pour choisir le trajet le plus court entre deux lieux, ou encore pour se souvenir de l'emplacement où nous avons garé la voiture ! Ainsi, notre mémoire permet d'organiser et de stocker des informations spatiales configuration de repères, trajets entre les différents lieux, etc. sélectionnées au cours de la découverte de l'environnement. Finalement, la mémoire spatiale confère à l'individu la capacité d'adapter son comportement en fonction des contraintes de l'environnement.
La mémoire spatiale n'est pas, bien sûr, l'apanage de l'homme. Les compétences spatiales de nombreuses espèces animales sont remarquables, ce qui n'est pas étonnant si l'on considère que leur survie dépend en grande partie de leur capacité à mémoriser les caractéristiques spatiales du milieu dans lequel elles évoluent. Les études sur l'animal favori des laboratoires, le rat, ont permis de dévoiler en partie la nature des mécanismes comportementaux et cérébraux à l'origine de la mémoire spatiale chez les mammifères. Dès le début du siècle, les recherches sur l'apprentissage, qui reposaient alors essentiellement sur l'utilisation de labyrinthes souvent complexes, avaient démontré l'aptitude du rat à s'orienter dans l'espace et à mémoriser de nombreux emplacements. Les travaux contemporains n'ont fait que confirmer cette capacité, notamment grâce à la mise au point de procédures qui excluent la possibilité pour l'animal d'utiliser des repères directs tels que des traces olfactives ou des chaînes d'actions stéréotypées. Lorsque ces précautions sont prises, on peut ainsi montrer que la mémoire spatiale repose sur une mémoire des lieux et de leurs relations1.
Heureux hasard. En 1978, paraissait un ouvrage qui devait avoir un impact remarquable sur les recherches ultérieures concernant le substrat neuronal de la mémoire spatiale2. Ce livre défendait avec vigueur l'hypothèse selon laquelle cette mémoire serait logée dans l'hippocampe des mammifères. Cette théorie s'appuyait sur une découverte accidentelle faite quelques années auparavant par John O'Keefe au University College de Londres. Alors que O'Keefe et son collaborateur John Dostrovsky enregistraient l'activité neuronale unitaire de l'hippocampe chez le rat, ils eurent la surprise d'observer qu'un certain nombre de cellules, parfaitement silencieuses la plupart du temps, présentaient des bouffées de décharge électrique soudaines lorsque l'animal se trouvait à certains emplacements de l'environnement.
En étudiant de plus près les caractéristiques de cette décharge neuronale, ils établirent qu'elle ne dépendait pas de l'orientation, de la trajectoire ou de l'activité de l'animal, mais du lieu où il se trouvait. Ils acquirent ainsi la conviction que chacun de ces neurones représentait un endroit particulier de l'espace et les appelèrent « cellules de lieu » pour indiquer que leur décharge était essentiellement liée à la position de l'animal à tel ou tel endroit de son environnement. O'Keefe et Lynn Nadel entreprirent alors de réanalyser la littérature concernant les effets comportementaux entraînés par les lésions de l'hippocampe. Ils observèrent que les déficits postlésionnels pouvaient, dans la majorité des cas, résulter de la perte de la capacité de l'animal à se repérer dans l'espace. En rapprochant cette observation de la découverte des cellules de lieu, ils émirent l'hypothèse que celles-ci fourniraient le support neuronal de la mémoire spatiale et que cette mémoire reposerait sur le codage exocentrique - autrement dit indépendant de la position du sujet - des relations spatiales entre les lieux.
Cette hypothèse audacieuse fut d'abord accueillie avec scepticisme par la communauté scientifique. Néanmoins, en raison même de son côté provocateur, elle finit par susciter l'intérêt de nombreux chercheurs qui se lancèrent dans l'investigation approfondie des propriétés de ces neurones.
Décharges caractéristiques. L'enregistrement de l'activité des cellules de lieu chez le rat nécessite l'implantation chronique préalable de micro-électrodes dans l'hippocampe. Ainsi équipé, l'animal se déplace tout à fait normalement dans l'environnement expérimental. Les signaux électriques provenant des neurones de l'hippocampe sont amplifiés, puis traités par des programmes informatiques qui permettent de calculer leur fréquence en fonction de la position de l'animal dans l'environnement. Les cellules de lieu représentent environ 50 % du million de neurones pyramidaux qui constituent la principale classe de cellules dans l'hippocampe. Le champ d'activité de chacune - soit la zone de l'environnement dans laquelle leur décharge est intense - peut être de forme et de taille variées, couvrant de 10 % à 50 % de l'environnement exploré. Ces champs d'activité sont établis en quelques minutes dans un environnement nouveau et, une fois établis, peuvent persister pendant des semaines. Leur position est sous la dépendance des indices visuels de l'environnement : ainsi, la rotation de ces indices entraîne une rotation correspondante de la position des champs d'activité. Cependant, le retrait des indices visuels n'entraîne pas pour autant la disparition immédiate des champs d'activité, qui peuvent rester stables pendant plusieurs dizaines de minutes. Cette conservation temporaire des caractéristiques de la décharge neuronale reposerait sur l'utilisation additionnelle d'informations d'origine vestibulaire et proprioceptive liées aux mouvements de l'animal. Elle ferait aussi intervenir des informations tactiles et olfactives permettant la correction des erreurs computationnelles inhérentes aux calculs de position issus des seules informations de mouvement3. A l'échelle de la population neuronale, l'activité de ces petits intégrateurs d'informations multi-sensorielles serait la traduction électrophysiologique de la mémoire spa- tiale de l'environnement, chaque cellule représentant une position spécifique de l'animal au sein de cet environnement. Un nouveau pas de géant eut lieu dans un laboratoire de la State University à New York. En 1985, Jim Ranck découvrit, là encore un peu par hasard, une autre population de neurones aux propriétés rigoureusement complémentaires de celles des cellules de lieu : les cellules d'orientation. Initialement décrites dans le postsubiculum, une aire qui reçoit les projections de l'hippocampe, les cellules d'orientation furent ensuite trouvées dans de nombreuses autres structures ayant toutes des connexions importantes avec l'hippocampe. Comme leur nom le suggère, les cellules d'orientation ne sont actives que lorsque la tête de l'animal est orientée dans une direction spécifique, indépendamment de la position du rat dans son environnement. En outre, chacune de ces cellules présente une activité maximale pour une direction de la tête donnée, appelée direction de décharge préférentielle. De façon analogue à ce que l'on observe avec les cellules de lieu, la direction de décharge préférentielle des cellules d'orientation est contrôlée par les indices visuels, mais reste stable un certain temps lorsque ces indices sont retirés : les informations liées aux mouvements de l'animal ne sont donc pas transitoires, mais intégrées4. Et, de même que les cellules de lieu ne sont pas de simples cellules sensorielles, les cellules d'orientation effectuent, elles aussi, une intégration complexe d'informations en provenance de plusieurs canaux sensoriels.
La similarité des propriétés des cellules de lieu et des cellules d'orientation, ainsi que leur complémentarité en termes de signal de sortie laissent penser que ces deux populations de neurones pourraient faire partie d'un même réseau fonctionnel. Ce réseau, réactivé chaque fois que l'animal est confronté à un environnement donné, serait le support d'une certaine forme de mémoire spatiale. Cette idée est appuyée par l'existence de connexions anatomiques étroites entre les différentes composantes de ce réseau et par le fait que les cellules de lieu et les cellules d'orientation semblent fonctionnellement couplées les unes avec les autres. Ainsi, l'enregistrement simultané de cellules de lieu et de cellules d'orientation montre qu'il est possible de prédire l'activité spatiale d'une des deux populations à partir de l'observation de l'activité au sein de l'autre population.
Quel pourrait être le rôle de ce réseau ?
Convergences. L'hypothèse privilégiée à l'heure actuelle est que ce système permettrait à l'animal de connaître, à chaque instant, à la fois sa position et son orientation dans l'espace. On conçoit aisément l'importance de ces deux types d'informations pour la réalisation de trajets efficaces et optimaux. Bien que nécessaires, ces informations ne sont pourtant pas suffisantes puisqu'elles ne spécifient pas le but poursuivi par l'animal. Néanmoins, certaines études soulignent leur importance en montrant que l'activité des cellules de lieu et des cellules d'orientation est prédictive du comportement spatial de l'animal. Pour prouver qu'il existe un lien réel entre l'activité de ces cellules et le comportement spatial, plusieurs équipes se sont récemment attachées à dégager des convergences entre les deux phénomènes. Le principe de ces expériences est relativement simple : il consiste à considérer que si les informations codées par les cellules de lieu et les cellules d'orientation sont importantes pour la mémoire spatiale, alors des perturbations de ces informations devraient avoir des répercussions sur le comportement lui-même. Or, il se trouve que l'on peut perturber les signaux produits par les cellules de lieu en manipulant les informations environnementales. Par exemple, lorsque l'on effectue une rotation des repères visuels en présence de l'animal, il arrive fréquemment que l'emplacement du champ d'activité des cellules de lieu reste inchangé.
Dans ce cas, les relations spatiales entre les champs d'activité et les repères sont modifiées : la représentation interne de l'environnement codée par la population des neurones hippocampiques est, en quelque sorte, orientée de façon incorrecte. Le résultat des études reposant sur ce principe montre que les performances de rats réalisant une tâche de localisation spatiale de cible par rapport aux repères visuels sont, alors, considérablement dégradées. Autrement dit, lorsque leur représentation interne ne converge pas avec l'environnement réel, les rats ne semblent plus capables de réaliser correctement la tâche en question. Plus convaincant encore, l'animal s'oriente sur la base de sa représentation interne erronée, et l'on peut souvent prédire ses choix en observant l'activité de ses cellules de lieu5 ou de ses cellules d'orientation6. Ses comportements semblent, en l'occurrence, assujettis aux informations de localisation et de direction mémorisées et restituées par ces cellules.
Comparaison. Que peut-on dire de l'hippocampe chez les primates et en particulier chez l'homme ? De toute évidence, la situation n'est pas complètement comparable. Chez le singe, par exemple, on trouve des cellules de lieu similaires en de nombreux points à celles observées chez le rat, mais qui seraient plus sensibles à l'emplacement vers lequel l'animal porte son attention qu'à celui où il se trouve réellement7,8. Chez l'homme, les progrès accomplis dans le domaine de l'imagerie fonctionnelle ont permis de dégager quelques résultats montrant le rôle de l'hippocampe dans l'orientation et dans la mémoire spatiale. Ainsi, des chercheurs anglais ont observé une activation spécifique de l'hippocampe droit chez des chauffeurs de taxi londoniens à qui l'on demandait d'imaginer leur déplacement au sein de la ville de Londres et dont l'activité cérébrale était examinée par tomographie par émission de positons9 voir l'encadré : « L'hippocampe des chauffeurs de taxi londoniens ». Ce résultat remarquable est en accord avec l'idée que l'hippocampe jouerait un rôle fondamental dans la mémoire spatiale chez de nombreuses espèces dont l'homme. Chez ce dernier, il pourrait également contribuer à la construction de la mémoire autobiographique de l'individu, en fournissant à chaque souvenir un cadre spatial permettant de le restituer avec précision. Certains chercheurs n'hésitent d'ailleurs pas à avancer une fonction comparable chez l'animal10,11. Que ce soit chez l'animal ou chez l'homme, les merveilleux petits intégrateurs d'informations de l'hippocampe n'ont pas fini d'exciter la curiosité des chercheurs !
1 B. Poucet, Psychol. Rev. 100 , 163, 1993.
2 J. O'Keefe et L. Nadel, Hippocampus as a Cognitive Map, Clarendon, Oxford, 1978.
3 B. Poucet et al. , Rev. Neurosci. 11 , 95, 2000.
4 J.S. Taube, Prog. Neurobiol. 55 , 225, 1998.
5 P.P. Lenck-Santini et al. , Hippocampus , 2001, sous presse.
6 P. Dudchenko et J.S. Taube, Behav. Neurosci. 111 , 3, 1997.
7 T. Ono et al. , J. Neurophysiol. 70 , 1516, 1993.
8 E.T. Rolls et S.M. O'Mara, Hippocampus 5 , 409, 1995.
9 E.A. Maguire et al. , J. Neurosci. 17 , 7103, 1997.
10 H. Eichenbaum et al. , Neuron 23 , 209, 1999.
11 N.S. Clayton et D.W. Lee, « Memory and the hippocampus in food-storing birds », in Animal Cognition in Nature. Academic Press, p 99, 1998.
12 E. A. Maguire et al., Proc. Natl. Acad. Sci. 97 , 4398, 2000.
L'HIPPOCAMPE DES CHAUFFEURS DE TAXI LONDONIENS
Les chauffeurs de taxi londoniens sont considérés comme des experts de la navigation spatiale. Ils subissent en effet un entraînement intensif de deux ans en moyenne sanctionné par un examen très strict qui leur permet d'acquérir une excellente connaissance du réseau complexe des rues de la ville. Faisant l'hypothèse que les structures nerveuses responsables de la navigation spatiale seraient particulièrement développées chez ces chauffeurs de taxi, une équipe de chercheurs du University College de Londres a récemment étudié les caractéristiques de leur cerveau en utilisant la technique d'Imagerie structurale par résonance magnétique IRM structurale12. Cette technique permet d'obtenir des images anatomiques du cerveau où l'on peut déterminer avec une grande précision les caractéristiques morphologiques des structures nerveuses. Une comparaison des images obtenues chez des chauffeurs de taxi avec celles de sujets n'ayant jamais eu un entraînement similaire a permis de montrer que les chauffeurs de taxi ont un hippocampe postérieur plus développé que celui des sujets témoins. Il semble donc que l'hippocampe postérieur joue un rôle important dans l'acquisition d'une représentation spatiale et que l'entraînement intensif des chauffeurs de taxi ait pour effet de renforcer cette structure. De plus, sa taille est corrélée à la durée de l'expérience professionnelle du conducteur, ce qui signifie que les modifications de volume observées sont la conséquence d'un apprentissage spécifique et non une caractéristique structurale préétablie. Les résultats de Eleanor Maguire et ses collègues sont tout à fait cohérents avec leurs données antérieures obtenues par IRM fonctionnelle, qui montraient que l'hippocampe droit des chauffeurs de taxi est activé lors de la réalisation d'une tâche de mémoire spatiale9. Il semble donc que l'activation répétée de l'hippocampe lors d'un apprentissage puisse induire des processus de plasticité à l'origine de ses changements morphologiques et fonctionnels.
DOCUMENT larecherche.fr LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
