|
| |
|
|
 |
|
SÉMANTIQUE |
|
|
| |
|
| |

SÉMANTIQUE, subst. fém. et adj. I. − Subst. fém.
A. − LINGUISTIQUE
1. Étude d'une langue ou des langues considérées du point de vue de la signification; théorie tentant de rendre compte des structures et des phénomènes de la signification dans une langue ou dans le langage. Sémantique analytique, générative, logique, structurale; sémantique descriptive, interprétative; sémantique comparée, diachronique, historique, synchronique; sémantique lexicale, narrative; sémantique paradigmatique, syntagmatique; sémantique de l'énoncé, de la phrase; rapports entre syntaxe et sémantique. Opposée tantôt au couple phonétique-phonologie, tantôt à la syntaxe (plus particulièrement en logique), la sémantique est une des composantes de la théorie du langage (ou de la grammaire) (Greimas-Courtés1979).V. sémasiologie ex. de Rey:
1. Nous définirons (...) le mot comme l'unité sémantique minima de la parole. (...) La science du mot s'appelle lexicologie. Elle comportera deux subdivisions, selon qu'on s'intéresse au nom ou au sens. L'aspect formel des mots est examiné par la morphologie (...). Les significations lexicales constituent le domaine de la sémantique [it. ds le texte]. S. Ullmann, Précis de sém. fr., Berne, éd. A. Francke, 1952, p. 33.
− P. ext., rare. Étude (et théorie) d'un système de signification quel qu'il soit. Synon. sémiotique.Sémantique linguistique, musicale, cinématographique. Le sous-sol de l'âme, − ce que le meilleur philologue Beethovenien (je pourrais dire: le maître de sémantique Beethovenienne) Heinrich Schenker, a nommé l'« Urlinie », le « Lichtbild des Seelenkernes » (Rolland,Beethoven, t. 1, 1937, p. 23).
2. En partic. [Dans le cadre de la sémiotique classique de Ch.-W. Morris, et p. oppos. aux deux autres composantes de celle-ci, la syntaxe et la pragmatique] Étude générale de la signification des signes conçue comme une relation entre les signes et leurs référents. (Ds Rey Sémiot. 1979).
B. − LOG. [Dans un lang. formalisé, p. oppos. à la syntaxe qui expose l'alphabet utilisé, les règles de construction des expressions bien formées, ainsi que les règles de déduction opérant à partir des axiomes] Ensemble des aspects du système logique relatifs aux notions de satisfaction et de vérité. Les logiciens du cercle de Vienne, et principalement Carnap, en sont venus à considérer la logique d'abord comme une syntaxe générale et ensuite comme complétée par une sémantique (la tendance récente (...) qui atténue singulièrement la rigueur du système, consistant à la compléter encore par une pragmatique) (Traité sociol.,1968, p. 233).Il est bien difficile de fixer le sens d'un mot qui désigne, non pas un objet immuable comme une racine cubique, mais une discipline en plein développement. La frontière même de la sémantique et de la syntaxe est incertaine (VaxLog.1982, p. 139, s.v. syntaxe).
Rem. La sémantique peut traiter aussi des structures qui satisfont aux formules et prend alors le nom de théorie des modèles.
II. − Adjectif
A. − [Corresp. à supra I A 1] LING.
1. Qui est relatif à la sémantique, qui a rapport à la signification d'un mot ou d'une structure linguistique. Changement, évolution sémantique; contenu, trait sémantique; analyse, description sémantique; théorie sémantique. Le sens du signe dans le discours est une représentation dans laquelle se combinent la valeur sémantique en langue, telle qu'elle est définie par la convention, et la valeur de situation qui dérive de l'énoncé (Langage,1968, p. 454):
2. ... il est deux lois sémantiques (...). L'une a trait à l'usure des sens. Elle porte que le mot s'épuise avant l'idée et laisse aisément altérer, s'il ne la perd, − plus l'idée est de soi vive et frappante − sa vertu expressive. (...) La seconde (...) porte que le sens commun, en matière de langage, dispose d'un instinct qui ne le trompe guère; qu'il perçoit exactement (...) les plus menues variations d'un sens; qu'il peut enseigner l'écrivain lui-même, et qu'aux Halles on n'apprend pas seulement à parler, mais à entendre. Paulhan,Fleurs Tarbes,1941, p. 77.
♦ Champ sémantique. Ensemble des mots, des notions se rapportant à un même domaine conceptuel ou psychologique. La méthode d'analyse des champs sémantiques élaborée par l'Allemand J. Trier permet de montrer que l'articulation d'une même région notionnelle peut varier selon les langues ou les états successifs d'une même langue (Ducrot-Tod.1972, p. 176).
− [Dans une gramm. générative]
♦ Composant ou composante sémantique. Composant interprétatif traduisant les suites de morphèmes engendrés par la syntaxe en un métalangage permettant de donner une représentation de la signification des phrases. La composante sémantique d'une grammaire (...) a pour fonction d'interpréter les structures syntaxiques en termes de sens − autrement dit, d'attribuer une signification (ou plusieurs, dans le cas des phrases ambiguës) aux structures engendrées par la syntaxe (et le lexique) (N. Ruwet, Introd. à la gramm. générative,1967, p. 332).
♦ [P. oppos. à asémantique] Phrase sémantique. Phrase qui a un sens, qui est acceptable du point de vue du sens. Une phrase qui n'est pas sémantique est dite asémantique (ReySémiot.1979).
− Empl. subst. masc. [Chez Benveniste, p. oppos. au sémiotique] Mode de signifiance d'un signe engendré par le discours. V. sémiotique II B 2 ex. de Benveniste.
2. [Corresp. à supra I A 2] Qui est relatif, appartient à la signification, à la relation entre les signes et leurs référents. [Morris] distingue (...) entre les dimensions sémantique, syntaxique et pragmatique d'un signe: est sémantique la relation entre les signes et les designata ou les denotata; syntaxique, la relation des signes entre eux; pragmatique, la relation entre les signes et leurs utilisateurs (Ducrot-Tod.1972, p. 117).
B. − LOG. Système sémantique. Synon. de sémantique (supra I B). (Dict. xxes.).
REM. 1.
Séma(nt)-,(Séma-, Sémant-) élém. formanttiré du gr. σ η μ α ν τ- base de certaines formes du verbe σ η μ α ι ́ ν ε ι ν « signifier », entrant dans la constr. de qq. mots, dans le domaine de la ling., et indiquant l'idée de sens, de signification.V. sémantème, sémantique, sémanticien, sémasiologie, sémasiologique (dér. s.v. sémasiologie).
2.
Sémantiquement, adv.Du point de vue de la sémantique, de la signification. De toutes les analyses que j'ai reçues d'« et les fruits passeront la promesse des fleurs », la sienne est de beaucoup la mieux poussée, grammaticalement et sémantiquement (Bremond,Poés. pure,1926, p. 100).
Prononc. et Orth.: [semɑ ̃tik]. Att. ds Ac. 1935. Étymol. et Hist. 1. 1561 (Collange, Polygraphie, 14 r ods Delb. Notes mss: Lesquelles [vingt quatre lettres de l'alphabet] j'ay par bon ordre proposees a autant de dictions et paraphrasmes symentiques qui pourront servir pour toute simple description de tous et de tant de secrets que l'operateur voudra), attest. isolée; 2. 1875 art. milit. « art de mouvoir les troupes à l'aide de signaux » (Lar. 19e) − 1895, Guérin Suppl.; 2. a) 1879 (M. Bréal, Lettre à Angelo de Gubernatis, cité ds Hist. épistémol. lang., t. 3, fasc. 2, p. 128, note 8: Je prépare aussi un livre sur les lois intellectuelles du langage, auquel je travaille depuis des années: ç'est ce qu'on peut appeler la sémantique); b) 1897 adj. rapport sémantique (Thomas (A.) Essais, p. 172). Formé sur le gr. σ η μ α ι ́ ν ω « signifier » (cf. gr. σ η μ α ν τ ι κ ο ́ ς « qui signifie »; cf. chez Aristote φ ω ν η ́ « son, voix » σ η μ α ν τ ι κ η ́); à rapprocher de 2 le sens part. de σ η μ α ι ́ ν ω « faire un signal » d'où « donner un ordre, diriger une armée » et σ η μ α ́ ν τ ω ρ « qui donne le signal ou les ordres, qui commande ». En angl. l'adj. semantic est att. en ling. dès 1894 (v. NED Suppl.2), au sens gén. en 1665 semantick Philosophy (v. NED), et le subst. semantics dès 1893 (v. NED Suppl.2). Fréq. abs. littér.: 27.
DÉR.
Sémantisme, subst. masc.Contenu sémantique; ensemble des valeurs sémantiques dont un mot ou une expression sont investis. (Dict. xxes.). − [semɑ ̃tism̭]. − 1reattest. 1913 (Esnault ds R. Philol. fr. t. 27, p. 187); de sémantique par substitution du suff. -isme à la finale; le mot a été en concurrence avec sématisme (v. Esnault, L'Imagination pop., Métaph. occid., p. 6; cf. angl. sematism 1866 ds NED Suppl.2, s.v. seme) qu'il a supplanté.
BBG. − Baldinger (K.). Vers une sémantique mod. Paris, 1984, 261 p. − Baylon (Ch.), Fabre (P.). La Sémantique. Paris, 1974, 110 p. − Carnoy (A.). La Sc. du mot: traité de sémantique. Louvain, 1927, 428 p. − Charron (G.). La Distinction entre sémantique et axiologie. Mél. Martinet (A.) Paris, 1979, pp. 261-270. − Chomsky (N.). Questions de sémantique. Paris, 1975, 230 p. − Dubois-Charlier (F.), Galmiche (M.). La Sémantique générative. Paris, 1972, 130 p. − Ducháček (O.). Précis de sémantique fr. Brno, 1967, 263 p. − Greimas (A.J.). Sémantique struct. Paris, 1966, 263 p. − Guiraud (P.). La Sémantique. Paris, 1969, 128 p. − Hervey (S.). Axiologie et sémantique en ling. fonctionnelle. Lang. Ling. 1982, t. 8, n o2, pp. 57-70. − Ledent (R.). Comprendre la sémantique. Verviers-Paris, 1974, 224 p. − Le Ny (J.-F.). La Sémantique psychol. Paris, 1979, 257 p. -Lerat (P.). Sémantique descr. Paris, 1983, 128 p. − Lyons (J.). Élém. de sém. Paris, 1978, 296 p. − Martin (R.). Inférence, antonymie et paraphrase. Paris, 1976, 174 p.; Pour une log. du sens. Paris, 1983, 268 p. − Martinet (A.). Sémantique et axiologie. R. roum. ling. 1975, t. 20, pp. 539-542. − Mounin (G.). Clefs pour la sémantique. Paris, 1972, 269 p. − Pottier (B.). Ling. gén. Paris, 1974, 339 p. Vers une sém. mod. Trav. Ling. Litt. Strasbourg. 1964, t. 2, n o1, pp. 107-137. − Probl. de sémantique. Par A. Dugas et collab. Paris, 1973, 254 p. − Quem. DDL t. 24. − Rey (A.). La Sémantique. Lang. fr. 1969, n o4, pp. 3-28; Théor. du signe et du sens... Paris, 1976, 408 p. − Schogt (H. G.). Sémantique synchr. Toronto, 1976, 136 p. − Tutescu (M.). Précis de sémantique fr. Paris, 1975, 214 p. − Ullmann (S.). Esquisse d'une terminol. de la sémantique. In: Congrès Internat. des Linguistes. 6. 1948. Paris, 1949, pp. 368-375; Le mot sémantique. Fr. mod. 1951, t. 19, pp. 201-202; Précis de sémantique fr. Bern, 1965, 3eéd., 352 p. − Wunderli (P.). Sémantique und Sémiologie. Vox rom. 1971, t. 30, n o1, pp. 14-31.
DOCUMENT cnrtl LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
Stanislas Dehaene : la psychologie cognitive, les maths et le langage |
|
|
| |
|
| |
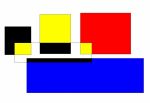
Stanislas Dehaene : la psychologie cognitive, les maths et le langage
Par Marine Van Der Kluft le 30.05.2017 à 15h09
Lecture 2 min.
Stanislas Dehaene est un éminent spécialiste des sciences cognitives. Il parraine la 18e édition du salon Culture et jeux mathématiques qui s'achève ce mardi 29 mai 2017. Entretien en vidéo.
Amoureux des chiffres depuis toujours, Stanislas Dehaene est aujourd’hui professeur au Collège de France, où il est titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale. Directeur de l'unité INSERM-CEA de neuro-imagerie cognitive, il est le parrain de cette 18e édition du salon Culture et Jeux Mathématiques qui s'achève aujourd'hui, mardi 29 mai 2017.
Une rencontre en vidéo avec Stanislas Dehaene
A cette occasion Sciences et Avenir a rencontré Stanislas Dehaene pour un entretien vidéo que nous proposons que visionner ci-dessous. Le chercheur y explique ce qu'est cette fameuse "psychologie cognitive". Il revient aussi sur ce qui lie cette discipline méconnue du grand public et les maths. Stanislas Dehaene confie que "ses recherches exploitent à la fois les méthodes de la psychologie cognitive et de l’imagerie cérébrale" et "notamment sur les circuits de l’arithmétique, de la lecture, du langage parlé, et de l’accès à la conscience dans le cerveau humain".
Stanislas Dehaene : la psychologie cognitive
Le thème de cette édition du salon Culture et Jeux Mathématiques était "Mathématiques et Langage". Un sujet vraiment dans les cordes du psychologue cognitif qui, en plus des maths, s'intéresse aussi au langage. "La compétence mathématique dépend-elle de l’émergence du langage ou fait-on plutôt appel à des intuitions pré-verbales ?" Une très vieille question, selon Stanislas Dehaene. En psychologie cognitive, la préoccupation est avant tout d'y apporter une réponse expérimentale. "Nous avons des données qui suggèrent que les circuits mathématiques ne font pas du tout appel aux aires du langage dans le cerveau", commente-t-il, sans trop en dévoiler.
Stanislas Dehaene : Mathématiques VS langage ?
En 2015, Stanislas Dehaene confiait à Sciences et Avenir : "Dès la première semaine (de son entrée à l'Ecole Normale Supérieure, NDLR), j'ai compris que je voulais résoudre des problèmes expérimentaux et étudier le cerveau ! Je rêvais de créer une intelligence artificielle". Un amour des maths venu très jeune, qu'il souhaite aujourd'hui partager : "A l'origine des mathématiques, il y a la découverte et le jeu (...). C'est ça que le salon a restauré."
DOCUMENT sciences et avenir.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Le libre-arbitre, vaste illusion ? Nos actions volontaires ne dépendraient peut-être pas de notre conscience |
|
|
| |
|
| |
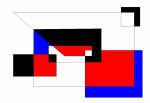
CERVEAU ET PSY
Le libre-arbitre, vaste illusion ? Nos actions volontaires ne dépendraient peut-être pas de notre conscience
Par Héloïse Chapuis le 06.02.2020 à 16h13
Lecture 6 min.
Le libre arbitre n'est-il qu'une vaste illusion ? Les angles philosophiques et psychologiques sur cette question n'ont cessé depuis des siècles de se succéder, de s'opposer et de se compléter. Le débat est désormais nourri par une nouvelle découverte, cette fois-ci neuroscientifique.
La conscience, le libre-arbitre, ils intriguent depuis des siècles les philosophes, qui plus récemment ont été rejoints par les psychologues et les neuroscientifiques, en quête d’en percer les secrets. Les mouvements volontaires que chacun choisi de faire et les mouvements physiologiques sur lesquels nous n’avons aucun contrôle ont inspiré un effort scientifique de mise en lumière des mécanismes cérébraux impliqués dans la prise de décision individuelle.
Ce phénomène passe par des signaux électriques parcourant l’encéphale en traversant l’immense réseau de neurones qui le constitue. Les connexions électriques régissant les mouvements volontaires sont-elles différentes de celles qui sont à l’origine des battements du cœur, des paupières, de la respiration ou des réflexes moteurs qui répondent à des stimulations extérieures ? Sommes-nous véritablement conscients et libres d’agir, ou simples sujets à des processus physiologiques et cérébraux qui, eux, prennent toutes les décisions musculaires que l’on pensait « volontaires » ? La réponse à cette question a fait l’objet d’une étude suisse publiée dans la revue Nature Communications le 6 février 2020.
Le potentiel de préparation motrice précède toujours une action volontaire
C’est en 1965 que Hans Helmut Kornhuber et Lüder Deecke découvrent le potentiel de préparation motrice (RP pour readiness potential) à l’issue d’expériences visant à mettre à l’épreuve les actions volontaires. A l’époque, les chercheurs demandent à des participants coiffés d’électrodes d’appuyer à volonté sur un bouton. L’électroencéphalogramme qui surveille l’activité électrique du cerveau repère systématiquement une augmentation des signaux environ une seconde avant la performance volontaire. Le RP devient alors le marqueur de l’action volontaire qu’il précède à chaque fois, sans exception.
C'est la question du "libre-arbitre" qui est mise à l'épreuve dans cette étude. Mais l'enjeu n'est-il pas terriblement ambitieux ? L'un des scientifiques qui a participé au projet, Bruno Herbelin, concède à Sciences et Avenir qu'il est en effet quelque peu excessif d'affirmer parvenir à définir la totalité de cette notion complexe par le simple appui sur un bouton. Certes, les participants s'en remettaient durant l'expérience à leur volonté pour déterminer a quel moment ils appuyaient, mais cette action n'englobait pas complètement l'essence du "libre-arbitre" : les participants ne pouvaient qu'appuyer sur un bouton, et rien d'autre, même s'ils en choisissaient le moment. Cette performance avait comme immense avantage de répondre à de nombreuses contraintes expérimentales : « Comme pour tout protocole experimental, il s'agit d'isoler des conditions pendant lesquelles la fonction en question (ici le libre arbitre) peut être observée de manière systématique, controlée et réplicable. Ceci est très limitant et en effet demanderait a être étendu a des conditions plus écologiques (de véritables actions du quotidien, ndlr) », explique Bruno Herbelin. Autre bénéfice de l'expérience : « Notre travail est en ligne avec les grands classiques de la recherche sur le potentiel de preparation et le libre arbitre (Kornhuber en 1965 et Libet en 1983) et nous repliquons exactement le meme protocole afin de pouvoir y apporter un element nouveau », selon Herbelin qui précise donc la volonté de compléter de précédentes découvertes en en suivant le même chemin. Et en effet, « le signal EEG observé est lié a un paramètre que les chercheurs n'avaient pas considéré a l'époque: la respiration du sujet ».
Le temps W, preuve de l’illusion du libre arbitre ?
30 ans plus tard, Benjamin Libet découvre le temps W, un moment décrit comme une « envie pressante » d’effectuer un mouvement volontaire, qui survient 200 millisecondes avant l’action elle-même. Ce temps W, manifestation de l’intention consciente de bouger, arrive juste après le RP, le courant électrique qui active les zones du cerveau impliquées dans la motricité volontaire. Ainsi, avant même la prise de décision consciente pour initier une action volontaire, le cerveau est déjà inconsciemment activé. La chronologie d’apparition du RP et du temps W témoigne de l’engagement du cerveau à engendrer une action avant même que l’individu soit conscient d’une envie d’effectuer ce mouvement.
Le potentiel de préparation est dépendant de la respiration
Olaf Blanke, auteur principal de l’étude a fait appel à 52 volontaires auxquels il a demandé de reproduire l’expérience de Kornhuber : appuyer sur un bouton lorsqu’ils le souhaitaient, en espaçant les répétitions d’au moins 8 à 12 secondes. "Nous avons explicitement demandé aux participants de ne pas utiliser de stratégies telles que le comptage de nombres (par exemple les secondes) et d'essayer d'utiliser des intervalles irréguliers pour maximiser la spontanéité de la tâche", peut-on lire dans l’étude. Sans surprise, l’électroencéphalogramme qui relevait l’activité cérébrale révéla l’apparition du RP et du temps W avant chaque initiation de mouvement.
Cependant, une ceinture autour de la poitrine qui mesurait la respiration et l’activité cardiaque apporta une nouvelle corrélation : les participants appuyaient sur le bouton pendant la phase d'expiration de leur respiration. Bien que les participants aient été entièrement libres de choisir le début du mouvement, dans les limites des contraintes expérimentales, leur modèle respiratoire, plus particulièrement la phase d’expiration, était systématiquement couplé au début de leurs mouvements volontaires, sans qu’ils s’en rendent compte.
Ce phénomène est propre aux actions volontaires, n’ayant pas été observé pendant une autre des expériences effectuées qui testait les mouvements involontaires (réponse à des stimuli extérieurs). "Une action volontaire, interne ou générée d’elle-même, est couplée avec un signal intéroceptif, en l'occurrence la respiration. Cela pourrait n’être qu’un exemple parmi d’autres de ce genre, où les actions de libre arbitre sont otages d’états corporels et du traitement des signaux internes par le cerveau. De manière intéressante, on a démontré que de tels signaux sont également important pour la conscience de soi ", résume Olaf Blanke.
Les signaux introspectifs, révélateurs de la volonté d’initier une action
L’expiration suit directement l’émission des signaux RP dans le cerveau, et cette phase de la respiration intervient systématiquement dans la performance d’une action volontaire. Pourrait-on à terme prédire quand quelqu’un va agir volontairement en surveillant ses cycles de respiration ? C’est ce que semblent espérer les scientifiques qui évoquent également dans un communiqué la possibilité d’"exploiter le mouvement du souffle pour prédire les comportements des consommateurs, comme lorsqu’on actionne un bouton". Cette découverte offre également des perspectives thérapeutiques, comme le développement d’outils pour diagnostiquer certaines pathologies du contrôle de l’action volontaire comme le syndrome de Gilles de la Tourette, les troubles obsessionnels compulsifs et la maladie de Parkinson.
DOCUMENT sciences et avenir.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Manier des outils améliore nos compétences langagières |
|
|
| |
|
| |

Manier des outils améliore nos compétences langagières
COMMUNIQUÉ | 11 NOV. 2021 - 20H00 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE | TECHNOLOGIE POUR LA SANTE
Les aires cérébrales liées au langage se seraient étendues chez nos ancêtres dans des périodes d’explosion technologique, au moment où l’usage d’outils devenait plus répandu. © Adobe Stock
Notre capacité à comprendre la syntaxe de certaines phrases complexes fait partie des compétences langagières les plus difficiles à acquérir. En 2019, des travaux avaient révélé une corrélation entre le fait d’être particulièrement habile dans le maniement d’outils et d’avoir de bonnes compétences syntaxiques. Une nouvelle étude, menée par des chercheurs et chercheuses de l’Inserm, du CNRS et de l’Université Claude Bernard Lyon 1 et l’Université Lumière Lyon 2, en collaboration avec le Karolinska Institutet en Suède, montre désormais que ces deux habiletés font appel à de mêmes ressources cérébrales, localisées dans la même région du cerveau. Par ailleurs, un entraînement moteur avec un outil améliore nos capacités à comprendre la syntaxe de phrases complexes et à l’inverse, un entrainement syntaxique améliore les performances d’utilisation d’outils. Dans le domaine clinique, ces résultats pourraient être exploités pour soutenir la rééducation de patients ayant perdu une partie de leurs compétences langagières. L’étude est publiée dans la revue Science.
Le langage a longtemps été considéré dans le domaine des neurosciences comme une habileté très complexe, mobilisant des réseaux cérébraux spécifiquement dédiés à cette faculté. Cependant, depuis plusieurs années, des travaux scientifiques ont réexaminé cette idée.
Des études ont ainsi suggéré que des zones du cerveau qui contrôlent certaines fonctions langagières, comme le traitement du sens des mots par exemple, sont également impliquées dans le contrôle de la motricité fine. Toutefois, aucune preuve fondée sur l’imagerie cérébrale n’a permis de révéler de tels liens entre langage et utilisation d’outil. La paléo-neurobiologie[1] a indiqué que les aires cérébrales liées au langage se seraient étendues chez nos ancêtres dans des périodes d’explosion technologique, au moment où l’usage d’outils devenait plus répandu.
En considérant ces données, des équipes de recherche se sont donc interrogées : et si l’usage de certains outils, qui suppose de réaliser des mouvements complexes, impliquait des ressources cérébrales similaires à celles mobilisées dans des fonctions langagières complexes comme la syntaxe?
Exercices de syntaxe et maniement d’une pince
En 2019, le chercheur Inserm Claudio Brozzoli en collaboration avec la chercheuse CNRS Alice C. Roy et leur équipe a montré que des individus particulièrement habiles dans l’utilisation d’outils étaient aussi généralement plus performants dans le maniement des subtilités de la syntaxe suédoise.
Pour aller plus loin, la même équipe en collaboration avec la chercheuse CNRS Véronique Boulenger[2], a mis au point toute une série d’expériences en s’appuyant sur des techniques d’imagerie cérébrale (imagerie par résonance magnétique fonctionnelle ou IRM) et des mesures du comportement. Les participants ont été invités à réaliser plusieurs tests consistant en un entraînement moteur avec une pince mécanique et des exercices de syntaxe en français. Cela a permis aux scientifiques d’identifier les réseaux cérébraux spécifiques à chaque tâche, mais aussi communs aux deux tâches.
Le maniement de la pince et les exercices de syntaxe proposés aux participants produisaient des activations dans une région appelée « ganglions de la base ». © Claudio Brozzoli
« Le choix de la pince et non d’un autre objet n’est pas un hasard. En effet, il s’agit d’un outil qui permet un mouvement sophistiqué, dans lequel interviennent des paramètres comme la distance parcourue pour rejoindre l’objet que l’on veut attraper, l’ouverture « des doigts » de la pince et l’orientation, et que l’on peut donc comparer en termes de complexité au maniement de la syntaxe dans le langage », explique Claudio Brozzoli.
À travers les différentes expériences, les scientifiques ont observé pour la première fois que le maniement de la pince et les exercices de syntaxe proposés aux participants produisaient des activations cérébrales dans des zones communes, avec une même distribution spatiale, dans une région appelée « ganglions de la base ».
Entraînement cognitif
Si ces deux types d’habiletés utilisent les mêmes ressources cérébrales, est-il possible d’en entraîner une pour améliorer l’autre ? Un entraînement moteur avec la pince mécanique permet-il d’améliorer la compréhension de phrases complexes ? Dans la seconde partie de leur étude, les scientifiques se sont intéressés à ces questions et ont montré que c’est bien le cas.
Les participants ont cette fois été invités à réaliser une tâche de compréhension syntaxique avant et après un entraînement moteur de 30 minutes avec la pince (voir encadré pour le détail de l’expérience). Les chercheurs et chercheuses ont ainsi démontré que l’entraînement moteur avec la pince s’accompagne d’une amélioration des performances dans les exercices de compréhension syntaxique.
Par ailleurs, les résultats obtenus soulignent que l’inverse est également vrai : un entraînement des facultés langagières, avec des exercices de compréhension de phrases à la structure complexe, améliore les performances motrices avec une pince mécanique.
Entraînement moteur et exercices de syntaxe
L’entraînement moteur consistait à insérer avec la pince de petits pions dans des trous adaptés à leur forme mais avec des orientations variables.
L’exercice de syntaxe réalisé avant et après cet entraînement consistait à lire des phrases à la syntaxe simple comme « Le scientifique qui admire le poète rédige un article » ou à la syntaxe plus complexe comme « Le scientifique que le poète admire rédige un article ». Ensuite, les participants devaient juger comme vraies ou fausses des affirmations du type : « Le poète admire le scientifique ». Les phrases comportant le pronom relatif objet « QUE » sont plus difficiles à traiter et les performances étaient donc généralement moins bonnes pour ce type de phrases.
Ces expériences ont révélé qu’après l’entraînement moteur, les participants présentaient de meilleures performances avec les phrases considérées plus difficiles. Les groupes contrôles, qui ont réalisé la même tâche langagière mais après un entraînement moteur à main nue ou sans entraînement, n’ont pas montré une telle amélioration.
Les scientifiques réfléchissent désormais à la meilleure manière d’appliquer ces résultats dans le domaine clinique. « Nous sommes en train d’imaginer des protocoles qui pourraient être mis en place pour soutenir la rééducation et la récupération des compétences langagières de certains patients ayant des facultés motrices relativement préservées, comme par exemple des jeunes présentant un trouble développemental du langage. Au-delà de ces applications, qui pourraient se révéler innovantes, ces résultats nous donnent aussi un aperçu de la manière dont le langage a évolué dans l’Histoire. Lorsque nos ancêtres ont commencé à développer et utiliser des outils, cette habileté a profondément changé le cerveau et a imposé des demandes cognitives qui pourraient avoir amené à l’émergence de certaines fonctions comme la syntaxe », conclut Claudio Brozzoli.
[1] Champ d’étude dans lequel les scientifiques s’intéressent à l’évolution de l’anatomie du cerveau de nos ancêtres.
[2] Sont impliqués dans ces résultats le Centre de recherche en neurosciences de Lyon (Inserm/CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1) et le laboratoire Dynamique du langage (CNRS/Université Lumière Lyon 2).
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 ] - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
