|
| |
|
|
 |
|
Rétine artificielle |
|
|
| |
|
| |

Rétine artificielle
Rendre la vue en grâce à un implant se substituant aux photorécepteurs
PUBLIÉ LE : 02/05/2016
TEMPS DE LECTURE : 9 MIN
Certaines personnes qui ont perdu la vue suite à la dégénérescence de leurs cellules photoréceptrices peuvent désormais bénéficier d’une rétine artificielle. Fixé sur ou sous la rétine, cet implant leur permet de percevoir à nouveau des signaux lumineux. Plusieurs systèmes sont en cours d’évaluation, et la recherche se poursuit pour améliorer leurs performances et la perception visuelle des patients.
Dossier réalisé en collaboration avec Serge Picaud et José-Alain Sahel, Institut de la vision (unité Inserm 968, Paris) et co-fondateurs de Pixium Vision
Comprendre le principe de la rétine artificielle
Située au fond de l’œil, la rétine est composée de cellules sensibles à la lumière – les photorécepteurs – et d’un réseau de neurones. Les photorécepteurs transforment les signaux lumineux en signaux électriques qui sont acheminés jusqu’au cerveau via le nerf optique. Une défaillance des photorécepteurs altère donc la vue et peut conduire à la cécité.
La rétine artificielle se substitue aux photorécepteurs. Concrètement, il s’agit d’implants (de 3 x 3 mm) fixés sur ou sous la rétine, composés d’électrodes qui stimulent électriquement les neurones rétiniens. Les premiers dispositifs testés dans les années 1990 incluaient 16 à 20 électrodes. Ils en comportent actuellement jusqu’à 1 500. Cependant, la perception visuelle des patients n’est pas liée directement au nombre d’électrodes.
Plusieurs dispositifs sont en cours d’évaluation. Trois ont déjà obtenu le marquage des autorités européennes (marquage CE) – Argus II (Second sight, Etats-Unis), Retina Implant (AG, Allemagne) et IRIS II (Pixium Vision, France). Argus II a également obtenu le feu vert de l’agence américaine (FDA) et il est commercialisé en France dans le cadre du forfait innovation. Les trois dispositifs existant offrent des résultats à peu près similaires. La recherche se poursuit pour améliorer les performances de ces différents systèmes.
Pour lire la suite, consulter le LIEN
DOCUMENT inserm LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
ESDDE - ÃTUDE SOCIOLINGUISTIQUE DES PROFILS DE DYSLEXIE DÃVELOPPEMENTALE |
|
|
| |
|
| |
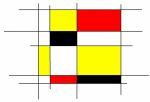
ESDDE - ÉTUDE SOCIOLINGUISTIQUE DES PROFILS DE DYSLEXIE DÉVELOPPEMENTALE
Réalisation : 10 janvier 2023 - Mise en ligne : 7 décembre 2023
document 1 document 2 document 3
niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Damien Chabanal (LRL) et Norbert Maionchi Pino (LAPSCO) présentent leur démarche et les premiers résultats du projet ESDDE qui consiste en une étude sociolinguistique des profils de dyslexie développementale.????Une grande majorité d’études sur le développement du langage portant sur le lien entre milieu social parental et développement du langage chez l’enfant établissent des corrélations qui ne dépassent pas le simple constat. Les liens présentés entre les deux variables donnent rarement lieu à des causalités de natures linguistique et cognitive qui rendraient compte de manière opératoire des processus chez l’enfant. Ainsi, les études mêlant approche sociolinguistique et compréhension des difficultés en lecture chez les enfants dyslexiques sont, à ce jour, inexistantes. L’approche socio-cognitive proposée ici (e.g., Tomasello, 2003 ; Kemmer et Barlow, 2000) a pour but d’explorer ce lien en évaluant dans quelle mesure certains dispositifs, comme la mémoire lexicale, ou certains comportements, comme le stress présent lors de situations à enjeux (situation d’évaluation), entravent les performances des enfants dyslexiques dans des tâches de lecture ou des tâches métalinguistiques.
Plus particulièrement, ce programme cherche à estimer dans quelle mesure les milieux socio-culturel et sociolinguistique influencent ces performances. Reposant sur l’hypothèse que le bain linguistique des enfants de milieux défavorisés serait plus pauvre d’un point de vue de la quantité et de la qualité du lexique (sous- spécification des représentations stockées en mémoire pour ces enfants-là), l'équipe souhaite observer si cela pourrait contribuer à amplifier l’expression des difficultés en lecture. S'appuyant sur ses précédentes recherches (projet MSH 2018-2020 EP2ED2) démontrant pour la première fois l’influence délétère des situations de pression socio-évaluative induite par des consignes stressantes sur le déficit phonologique des enfants dyslexiques, elle envisage d’approfondir l’étude de l’environnement social au travers de la sociolinguistique comme facteur régulateur des difficultés langagières (Chabanal, 2014).
Pour lire la suite , consulter le LIEN.
DOCUMENT cnrs LIEN
|
| |
|
| |
|
 |
|
DOUCUMENT. INSERM |
|
|
| |
|
| |
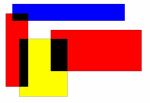
Une molécule pour régénérer les cellules produisant de l’insuline chez les diabétiques
01 Déc 2016 | Par Inserm (Salle de presse) | Physiopathologie, métabolisme, nutrition
Des chercheurs de l’Inserm sous la direction de Patrick Collombat au sein de l’Unité 1091 “Institut de biologie Valrose” (Inserm/CNRS/Université de Nice Sophia Antipolis) démontrent que le GABA, un neurotransmetteur utilisé parfois en complément alimentaire, pourrait induire la régénération des cellules produisant l’insuline. Cette découverte, réalisée chez la souris et partiellement validée chez l’homme, apporte un nouvel espoir aux patients atteints de diabète de type 1.
Ces travaux sont publiés dans la revue Cell.
Le diabète de type 1 est une maladie se caractérisant par la destruction sélective des cellules produisant l’insuline, une hormone permettant de diminuer le taux de sucre sanguin en cas d’apport sucré. On appelle ces cellules les cellules β pancréatiques. Trouver comment les restaurer est un enjeu majeur de la recherche notamment parce que les traitements actuels ne suffisent pas toujours à éviter de graves complications.
Les scientifiques avaient montré dans de précédents travaux qu’il était possible de recréer ces cellules β en modifiant génétiquement des cellules qui leur ressemblent : les cellules α productrices de glucagon. L’approche utilisée consistait en l’activation forcée d’un gène nommé Pax4 dans toutes les cellules alpha. Les résultats prouvaient aussi que ces cellules alpha étaient continuellement régénérées et converties en cellules bêta conduisant, à une augmentation massive du nombre de cellules bêta. Cependant, pour espérer un jour pouvoir transposer cette découverte à l’Homme, il fallait trouver un composé qui permette de recréer cette modification induite génétiquement. “Notre première avancée était importante, mais il n’était pas possible d’agir de cette manière sur le patrimoine génétique d’un être humain“. explique Patrick Collombat, directeur de recherche Inserm.
Dans ce nouveau travail, l’équipe de chercheurs vient de démontrer que cet effet pourrait être induit sans aucune modification génétique, grâce au GABA, un neurotransmetteur présent naturellement dans l’organisme mais aussi disponible sous forme de complément alimentaire.
Chez la souris d’abord : le GABA induit la régénération continue, mais contrôlée, des cellules alpha du pancréas et leur transformation en cellules produisant de l’insuline. Les cellules ainsi générées sont fonctionnelles et peuvent soigner plusieurs fois un diabète induit chimiquement chez la souris.
Chez l’Homme ensuite : sur des ilots de Langerhans (qui contiennent à la fois des cellules alpha et beta), les chercheurs ont observé qu’après 14 jours de culture en présence de GABA, le nombre de cellules alpha productrices de glucagon diminuait de 37% au profit d’une augmentation de 24% des cellules productrices d’insuline.
Enfin, en transplantant l’équivalent de 500 ilots de Langerhans humains chez la souris, les mêmes résultats ont été obtenus en supplémentant quotidiennement l’alimentation des souris en GABA pendant un mois. Ces résultats sont prometteurs quant à l’efficacité probable de cette solution pour l’Homme. Des essais thérapeutiques vont ainsi être prochainement initiés afin de déterminer si le GABA pourrait effectivement aider des patients atteints de diabète de type 1.
Ces travaux ont bénéficié du soutien financier de l’ERC et de la Juvenile Diabetes Research Foundation.
INSERM-LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
https://presse.inserm.fr/troubles-du-developpement-intellectuel-deux-nouveaux-genes-mis-en-cause/70579/ |
|
|
| |
|
| |

Troubles du développement intellectuel : deux nouveaux gènes mis en cause
11 Juin 2025 | Par Inserm (Salle de presse) | Génétique, génomique et bio-informatique
© Pexels
Une équipe de recherche internationale pilotée en France par l’Inserm, le CNRS, le CHU Grenoble-Alpes, l’université Grenoble-Alpes, l’Assistance publique des hôpitaux de Paris – APHP et par l’université d’Essen en Allemagne, a réussi à identifier deux nouveaux gènes qui jouent un rôle dans l’apparition de troubles du développement intellectuel (TDI), en collaboration avec Sorbonne Université, le CHU de Nantes, l’université de Nantes et celle de Rouen-Normandie. Les scientifiques ont aussi réussi à développer deux nouveaux types de tests pour diagnostiquer le syndrome de Renu, une maladie rare associée aux mutations du gène RNU4-2 qui se manifeste, entre autres, par des retards de développement intellectuel. Ces résultats, publiés dans la revue Nature Genetics, reposent sur l’analyse de près de 24 000 génomes de patients français atteints de maladies rares. Ils permettent d’apporter un diagnostic à de nombreux patients qui étaient jusqu’alors dans l’errance diagnostique, en plus d’améliorer les connaissances sur les causes de ces maladies. Cette étude s’inscrit dans le cadre du plan France Médecine génomique piloté par l’Inserm.
Les troubles du développement intellectuel (TDI) correspondent à la « capacité sensiblement réduite de comprendre une information nouvelle ou complexe et d’apprendre et d’appliquer de nouvelles compétences (trouble de l’intelligence) », selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS)[1]. Cette limitation du fonctionnement adaptatif est visible dans divers secteurs d’aptitudes tels que la communication, les apprentissages scolaires, l’autonomie, la responsabilité individuelle, la vie sociale, le travail, les loisirs, la santé, ou encore la sécurité.
Ces troubles concernent environ 1 % de la population générale, d’après le ministère de la Santé[2]. Ils peuvent être liés à l’environnement ou à la génétique (plus de 1 680 gènes impliqués ont déjà été identifiés)[3], mais dans de nombreux cas, leur cause reste encore inconnue. Pour progresser dans la compréhension de ces maladies complexes, et identifier de nouveaux gènes associés à ces troubles, il était nécessaire de disposer de génomes entiers à étudier.
Grâce au déploiement du Plan France Médecine génomique 2025 piloté par l’Inserm, le séquençage de génomes entiers est maintenant proposé aux patients atteints de maladies rares ou de cancers pour orienter le diagnostic, le conseil génétique ou encore la prise en charge. Depuis son lancement en 2016, près de 100 000 séquençages ont déjà été effectués chez plus de 40 000 patients et leurs proches, fournissant aux scientifiques un vivier de données génétiques.
« Cette pratique a permis de poser un diagnostic pour environ 30 % des personnes concernées, parfois après des années d’impasse diagnostique, explique Frédérique Nowak, coordinatrice du plan France Médecine génomique 2025 à l’Inserm. Mais un autre objectif de ce plan était d’adosser la recherche aux données résultant de ces séquençages. »
Près de 24 000 génomes français
Ce second objectif est déjà atteint, à en croire les résultats d’une nouvelle étude supervisée par une équipe de recherche internationale franco-allemande[4]. À partir des analyses de 23 649 génomes de patients français atteints de maladies rares, auxquels en ont été ajoutés d’autres issus de collaborations internationales, le groupement de scientifiques a pu collecter une très large série de cas, confirmant l’implication majeure de deux gènes dans des troubles sévères du neurodéveloppement. Ces gènes codent pour des petits ARN, des molécules à la structure proche de l’ADN, qui appartiennent au « complexe majeur d’épissage ». Cette machinerie permet de « préparer » les ARN dits messagers, sortes de copies des gènes, avant qu’ils ne soient traduits en protéines.
« Ce travail a permis d’identifier 145 patients porteurs de mutations de novo, c’est-à-dire non transmises par les parents, dans le gène RNU4-2 et dix-huit patients en ce qui concerne le gène RNU5B-1, soit un nombre sans précédent de patients qui présentent une symptomatologie proche, notamment des retards de développement, des troubles du développement intellectuel, des microcéphalies ou encore des épilepsies résistantes aux traitements, indique Julien Thevenon, chercheur Inserm au sein de l’Unité 1029 , l’Institut pour l’avancée des biosciences (Inserm/CNRS/UGA), au CHU de Grenoble et co-dernier auteur de l’étude.
En procédant à des analyses sanguines, les équipes de recherche ont aussi réussi à développer deux nouveaux types de tests pour diagnostiquer le syndrome de Renu, la maladie rare associée aux mutations du gène RNU4-2 qui se manifeste, entre autres, par des retards de développement intellectuel et moteur, ou des troubles du langage.
Ces tests seront utiles en cas de difficulté à poser un diagnostic avec une analyse de l’ADN classique. Le premier, dit « transcriptomique », identifie la quantité et les caractéristiques des acides ribonucléiques (ou ARN) messagers produits lors de copie -ou transcription- d’une séquence génétique. Le second, dit épigénétique, étudie les modifications moléculaires qui surviennent sur l’ADN sans en modifier la séquence. Dans les deux cas, l’objectif est d’observer si ces caractéristiques se rapprochent de celles considérées comme la signature du syndrome de Renu.
La recherche a impliqué un grand nombre de chercheurs français affiliés aux deux laboratoires SeqOIA et AURAGEN, les deux seuls en France autorisés à effectuer les séquençages de génome entier (l’ensemble des chromosomes et des gènes de chaque patient) dans un cadre diagnostique.
« C’est un travail collectif et une bonne organisation de recherche qui doit encourager à renforcer la dynamique du plan France Médecine génomique », estime Caroline Nava, chercheuse au sein de l’Unité 1127, Institut du cerveau « Inserm/Sorbonne Université /CNRS) première autrice de l’étude. « C’est grâce à la puissance du nombre de données ainsi qu’aux collaborations avec des chercheurs du monde entier que nous pouvons effectuer de telles découvertes », abonde Christel Depienne, chercheuse à l’université d’Essen et co-dernière autrice de l’étude.
À la clé : apporter un diagnostic au plus grand nombre et sortir de l’errance diagnostique qui est une véritable épreuve pour les familles ; améliorer le conseil génétique en informant les parents sur le risque d’avoir d’autres enfants avec la même maladie, et enfin promouvoir le développement de thérapeutiques ciblant les mécanismes dysfonctionnels.
[1] https://www.who.int/southeastasia/health-topics/mental-health/key-terms-and-definitions-in-mental-health#intellectual
[2] handicap.gouv.fr/la-strategie-nationale-autisme-et-troubles-du-neurodeveloppement-2018-2022
[3] https://panelapp-aus.org/panels/250/
[4] Cette étude a été supervisée par Christel Depienne, chercheuse au CHU d’Essen en Allemagne, Julien Thevenon, chercheur Inserm à l’Institut pour l’avancée des biosciences et au CHU Grenoble-Alpes et Caroline Nava, chercheuse au sein de l’APHP et de l’Unité 1127, Institut du cerveau « Inserm/Sorbonne Université /CNRS)
DOCUMENT inserm LIEN
|
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
