|
| |
|
|
 |
|
Consommer une alimentation riche en caroténoïdes diminue les risques de développer une DMLA |
|
|
| |
|
| |

Consommer une alimentation riche en caroténoïdes diminue les risques de développer une DMLA
COMMUNIQUÉ | 24 JUIN 2021 - 9H24 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
SANTÉ PUBLIQUE
Un régime alimentaire de type méditerranéen – riche en fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes, huile d’olive et poissons gras – permettrait de prévenir le développement de la DMLA, maladie dégénérative qui est la première cause de handicap visuel chez les plus de 50 ans. Une nouvelle étude publiée par des chercheurs de l’Inserm et de l’université de Bordeaux au Centre de recherche Bordeaux Population Health met en évidence de façon inédite une association entre les caroténoïdes circulants – des pigments végétaux protecteurs pour la rétine – et une réduction du risque de développer une forme avancée de DMLA. Ces travaux, fondés sur le suivi de 609 personnes sur huit ans, constituent la première étude longitudinale à identifier cette association et font l’objet d’une publication dans la revue Nutrients.
La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est la première cause de perte de la vision dans les pays industrialisés. Il s’agit d’une maladie dégénérative qui affecte la partie centrale de la rétine, cruciale pour les tâches quotidiennes (lire, conduire, reconnaître les visages…). À un stade avancé, la maladie prend deux formes : la forme néovasculaire, ou humide, que l’on soigne par injection d’anti-VEGF[1] directement dans l’œil, et la forme atrophique, ou sèche, pour laquelle il n’existe pas encore de traitements.
Néanmoins, à défaut de soigner complètement la maladie, il est possible de la prévenir ou de ralentir sa progression. On connaît déjà bien les facteurs de risque de la DMLA, qui sont liés à l’âge et au terrain génétique. Cependant, il s’agit de facteurs non modifiables, sur lesquels nous n’avons pas les moyens d’agir.
Depuis vingt ans, les chercheurs s’intéressent au lien entre nutrition et DMLA. Nous savons aujourd’hui que de nombreux aliments permettent de ralentir la dégénérescence : acide gras (oméga 3), antioxydants (vitamines C, zinc…). Ils protègent en effet la macula, la zone de l’œil affectée par la DMLA qui se situe au centre de la rétine.
À travers une étude prospective réalisée à partir du suivi sur 8 ans de la cohorte ALIENOR, l’objectif des chercheurs était d’étudier le lien entre la présence de lutéine et de zéaxanthine dans le plasma et l’apparition de la DMLA.
La lutéine et la zéaxanthine font partie de la grande famille des caroténoïdes. On les retrouve notamment dans les fruits jaune orangé comme les agrumes ou les tomates, ainsi que dans les légumes à feuilles vertes, tels que les épinards, les choux et les blettes. Ce sont des pigments qui jouent un rôle très spécifique pour l’œil puisqu’ils sont présents en grande concentration dans la macula. Ils ne sont pas synthétisés par notre corps, c’est pourquoi nous devons les absorber à travers notre alimentation.
Là où les précédentes études se fondaient uniquement sur les informations renseignées par les participants concernant leur régime alimentaire, l’équipe de la chercheuse Inserm Bénédicte Merle a analysé des prélèvements sanguins et a ainsi pu démontrer une association objective entre des niveaux circulants de lutéine et de zéaxanthine et une diminution du risque de la DMLA.
Ces travaux révèlent qu’une concentration plus importante de caroténoïdes dans le plasma, en particulier de lutéine et de zéaxanthine, réduit de 37 % le risque de développer une forme avancée de DMLA.
Ce résultat est similaire pour les formes atrophique et néovasculaire de la maladie. Toutefois, au-delà de la lutéine et la zéaxanthine, aucun autre caroténoïde n’a été associé à une telle diminution des risques.
La lutéine et la zéaxanthine apportent en effet une vraie protection à la rétine : d’une part elles absorbent la lumière bleue, qui est connue pour endommager la rétine sur le long terme. D’autre part, elles jouent le rôle d’antioxydant afin de protéger la rétine du stress oxydatif[1], qui est justement un facteur de la DMLA.
L’étude ALIENOR est une étude en population qui vise à évaluer le lien entre les maladies de l’œil et les facteurs nutritionnels. Dans le cadre de ces travaux, 609 participants âgés de 73 ans en moyenne ont été recrutés entre 2006 et 2008. Les participants ont réalisé dès leur intégration un dosage sanguin pour mesurer leur concentration plasmatique en lutéine et en zéaxanthine. Ils ont ensuite effectué une consultation ophtalmologique afin de diagnostiquer la DMLA. Parmi eux, 54 ont développé une DMLA sur la période de suivi, qui a duré 8 ans.
Que faut-il manger pour prévenir l’apparition ou ralentir la progression de la DMLA ?
Pour avoir des concentrations plasmatiques suffisantes en lutéine et en zéaxanthine dans l’organisme, il convient de privilégier les fruits et les légumes jaune orangé (tomates, carottes, agrumes), ainsi que les légumes à feuilles vertes (chou, épinards). « Si on veut aller un peu plus loin, l’alimentation la plus bénéfique pour prévenir la DMLA serait un régime de type méditerranéen, riche en fruits et légumes et qui apporte assez d’oméga 3 grâce aux poissons gras », souligne Bénédicte Merle, auteure de l’étude.
Au-delà des recommandations nutritionnelles, la découverte du rôle de ces caroténoïdes ouvre des pistes pour repérer des groupes de population plus à risque de développer la DMLA en fonction de leur régime alimentaire. Cette étude offre donc des stratégies de prévention mais aussi d’identification des facteurs de risque qui seront utiles pour l’avenir de la recherche.
[1] Le stress oxydatif est l’ensemble des agressions causées par des molécules dérivant de l’oxygène sur les cellules de notre corps. Les plus connues de ces substances néfastes sont les radicaux libres.
[1] Les anti-VEGF sont des nouvelles thérapeutiques qui agissent sur la membrane même des cellules et sont souvent utilisés pour empêcher la survie des tumeurs.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Dépression |
|
|
| |
|
| |

Dépression
Sous titre
Mieux la comprendre pour la guérir durablement
Le trouble dépressif caractérisé touche tous les âges de la vie. Il concerne environ 15 à 20% de la population générale, sur la vie entière. Il se présente comme une succession d’épisodes dépressifs caractérisés, se traduisant par de nombreux symptômes − parmi lesquels la tristesse pathologique, la perte de plaisir et les symptômes cognitifs −, avec un retentissement majeur sur la vie du patient et de son entourage. S’ils se pérennisent, les symptômes liés à la dépression vont avoir des répercussions importantes sur le plan socioprofessionnel. Le risque de suicide est particulièrement élevé et concerne 10 à 20 % de ces patients.
L’association de traitements biologiques (les médicaments antidépresseurs en première intention) et de traitements psychothérapiques bien conduits permet de soigner efficacement le trouble dépressif caractérisé et d’éviter la survenue de nouveaux épisodes dépressifs.
Les chercheurs tentent de comprendre pourquoi certaines personnes sont plus vulnérables que d’autres à la dépression. Au fur et à mesure de leurs découvertes sur les mécanismes de la maladie et des avancées neurobiologiques et épidémiologiques, de nouvelles pistes thérapeutiques se profilent.
Dossier réalisé en collaboration avec Alain Gardier et Emmanuelle Corruble, CESP (équipe Moods, unité 1178 Inserm), Université Paris-Saclay, Faculté de pharmacie de Chatenay-Malabry, Faculté de médecine Paris Sud, Mood Center Paris Saclay, Service hospitalo-universitaire de psychiatrie de l’Hôpital Bicêtre, AP-HP.
Comprendre la dépression
"Dépression" (au sens trouble dépressif caractérisé) et "déprime" sont deux concepts qui sont trop souvent confondus, alors qu’ils distinguent deux réalités différentes. En effet, la déprime correspond à un moment de blues, de tristesse, de découragement, de manque d’entrain… La dépression est par définition associée à un dysfonctionnement social et à une souffrance personnelle majeurs, qui peut avoir des conséquences parfois lourdes en termes de fonctionnement social, de santé et même de décès, le risque de passage de suicide étant particulièrement élevé. Il est donc indispensable de diagnostiquer et de prendre en charge efficacement les épisodes dépressifs caractérisés.
Une diversité de symptômes mais des critères diagnostiques précis
La dépression peut être caractérisée par :
* Une humeur dépressive, le plus souvent caractérisée par une tristesse pathologique quasi-permanente et intense, une anxiété marquée et parfois une indifférence affective. Cette humeur dépressive est associée à une douleur morale profonde, une perte de l’estime de soi et un pessimisme majeur, parfois associé à des idées de culpabilité inappropriées.
* Une perte de l’élan vital, c’est-à-dire une perte d’intérêt et du plaisir à l'égard des activités quotidiennes, même celles qui étaient habituellement plaisantes (anhédonie).
* Le sentiment que la vie ne vaut pas la peine d’être vécue, des idées de mort ou de suicide récurrentes, parfois des projets suicidaires, signant un risque suicidaire majeur.
* Un sentiment d’angoisse quasi-permanent, notamment au réveil, qui peut favoriser le passage à l’acte.
* Un ralentissement psychomoteur, observable par une modification de la marche, de la voix, des gestes, de l’initiative et de la fluidité idéiques.
* Une fatigue (asthénie), souvent plus marquée le matin.
* Une perte d’appétit, souvent associée à une perte de poids.
* Des troubles du sommeil, avec souvent une insomnie en deuxième partie de nuit et un réveil matinal précoce.
* Des troubles de l’attention, de la concentration et de la mémoire chez la plupart des malades.
Le diagnostic est posé lorsqu'une personne présente une humeur dépressive ou une perte de l’élan vital, associée à au moins quatre autres des symptômes décrits ci-dessus, tous les jours depuis au moins deux semaines, et ce en présence d’un retentissement des symptômes et d’une souffrance associée. L’intensité de l’épisode est le plus souvent associée au nombre de symptômes présents. Des échelles d’autoévaluation (évaluation par le patient lui-même) ou d’hétéro-évaluation (par le médecin) permettent d’évaluer plus précisément la sévérité de ces symptômes : échelle de dépression de Hamilton (HDRS), échelle de dépression de Montgomery et Asberg (MADRS)...
Une des difficultés dans le diagnostic de la dépression tient à la diversité de ses formes cliniques : la nature des symptômes prédominants varie d'un patient à l'autre. Par exemple, les dépressions mélancoliques sont caractérisées par une intensité sévère, de nombreux symptômes somatiques, mais également un sentiment de culpabilité, d’indignité et d’auto-accusation ainsi que par un risque suicidaire élevé, nécessitant une prise en charge immédiate. Dans d’autres cas, la dépression est masquée par des symptômes physiques - on parle alors de dépression masquée - ou encore par une irritabilité ou une hostilité - on parle alors de dépression hostile.
Le trouble dépressif caractérisé ne doit pas confondu avec le trouble bipolaire, dans lequel les épisodes dépressifs alternent avec des épisodes maniaques (excitation psychique et motrice, exaltation de l’humeur, euphorie, désinhibition, mégalomanie).
Enfin, la dépression est souvent associée à d’autres troubles psychiatriques, comme les troubles anxieux ou les troubles addictifs, ainsi qu’à des maladies physiques.
Une maladie aux multiples retentissements
… sur l‘entourage
Il est parfois difficile de faire la différence entre une déprime et un authentique épisode dépressif caractérisé. Il n’y a pas d’épisode dépressif caractérisé sans retentissement sur l’entourage : la dépression constitue une charge psychologique importante pour les proches aidants du malade et engendre souvent des conséquences au niveau du fonctionnement familial. Les aidants peuvent avoir le sentiment d’un manque d’action et de réaction de la part de la personne déprimée, d’une volonté insuffisante de sa part à vouloir changer les choses… Ils tendent à vouloir la raisonner alors que sa pathologie ne lui permet justement pas de réagir.
... sur la santé somatique
Sur le plan somatique, la dépression conduit fréquemment à négliger sa santé et à adopter une mauvaise hygiène de vie, avec notamment une consommation plus fréquente d’alcool ou de substances psychoactives (dont les médicaments).
Par ailleurs, il n’est pas rare que les personnes déprimées présentent des maladies somatiques. La première cause de décès des personnes déprimées est cardiovasculaire. La dépression pourrait de plus concerner jusqu’à 40% des personnes souffrant de maladie chronique: diabète, cancer, fibromyalgie ou encore alcoolisme, état de stress post-traumatique, troubles du comportement alimentaire… La dépression altère le pronostic de ces patients.
….sur le risque suicidaire
Mais le risque le plus redouté dans la maladie dépressive est celui lié aux idées et au passage à l’acte suicidaire : en réponse à ses idées suicidaires, le sujet malade peut envisager la mort comme la seule issue possible à ses difficultés. On estime que le risque de suicide est multiplié par 30 au cours de l’épisode dépressif et que 10 à 20% des personnes souffrant de cette maladie meurent par suicide.
… en termes de coût pour la société
La dépression est globalement associée à une qualité de vie médiocre dont les répercussions globales sont également coûteuses : L’OMS estime que le trouble dépressif caractérisé sera en 2020 au premier rang de l’ensemble des maladies en termes de dépenses globales, directes et indirectes pour la société.
Une maladie transgénérationnelle
On estime que près d’une personne sur cinq a souffert ou souffrira d’une dépression au cours de sa vie. Et selon le Baromètre Santé 2017, une personne sur dix âgée de 18-75 ans déclarait avoir vécu un épisode dépressif au cours des 12 derniers mois.
La dépression peut toucher n’importe quelle catégorie de la population : adultes, personnes âgées et enfants. Selon cette enquête, la prévalence
prévalence
Nombre de cas enregistrés à un temps T.
de la dépression au cours des douze derniers mois était comprise entre 11,2 et 11,4% pour les 15-44 ans, puis diminuait progressivement avec l’âge pour atteindre 8,4 % des personnes parmi les 55-64 ans et 5,5 % parmi celles âgées de 65-75 ans. Ces chiffres sont en augmentation depuis 2010, notamment dans les catégories de la population où les chiffres étaient déjà parmi les plus élevés, comme les femmes, les personnes de 35-44 ans et les chômeurs.
Quel que soit l’âge auquel elle se manifeste, le diagnostic du trouble dépressif caractérisé repose sur les critères rappelés précédemment. Mais la dépression peut aussi être suspectée devant des signes d’appel spécifiques à la personne ou à son âge : ainsi, elle peut être associée à une anxiété inhabituelle, au développement de comportements violents ou d’une phobie scolaire chez l’enfant ou l’adolescent. L’adolescent peut aussi adopter des comportements et des consommations à risque. Chez le sujet âgé, en revanche, la dépression favorise le repli sur soi, l’expression de plaintes physiques et le refus de l’aide d’un tiers.
Baby blues et dépression périnatale
La grossesse et les mois suivant la naissance d’un enfant constituent une période au cours de laquelle les bouleversements émotionnels et hormonaux peuvent favoriser l’apparition d’une dépression. Ses manifestations sont souvent, à tort, attribuée à la fatigue.
L’anxiété, les pleurs, le sentiment d’incapacité, de culpabilité ou d’indignité, associés à une importante variation de l’ascenseur émotionnel, la souffrance et le retentissement des symptômes sont caractéristiques de la dépression périnatale, notamment après la naissance.
Ce qu’on appelle le baby blues est fréquent dès le 3e jour suivant l’accouchement, mais il est bref, fluctuant et se résout par lui-même dans les 10 à 15 jours suivant la naissance. Il ne saurait être confondu avec une véritable dépression du post-partum qui peut altérer la relation précoce entre la mère et son enfant, voire menacer la bonne santé, la sécurité, voire la vie du nourrisson (en cas de difficultés à s’intéresser à l’enfant ou à s’en occuper) ou de la mère (risque suicidaire). Une prise en charge rapide et efficace s’impose.
Stopblues, un site et une appli de prévention
StopBlues est un dispositif numérique développé par une équipe Inserm afin d’agir sur le mal-être psychologique qui, s’il n’est pas reconnu, peut conduire à des troubles plus sévères comme la dépression ou le suicide. Une appli et un site internet offrent des outils d’information et d’évaluation afin de comprendre et de prendre conscience de ses troubles. Ils offrent aussi l’information nécessaire pour s’orienter ou aider un proche en difficulté.
Origine de la pathologie : des facteurs de risque ...
Des situations et des événements de la vie (un décès, une perte d’emploi, une séparation…) sont associés à un risque accru de dépression. C’est aussi le cas de traumatismes précoces, notamment affectifs ou sexuels, survenus au cours l’enfance. Néanmoins, toutes les personnes exposées à ce type d’événements ne développent pas la maladie. De plus, certaines personnes font une dépression sans facteur déclenchant apparent : on parle alors de dépression endogène. Cette disparité suggère une susceptibilité individuelle à la dépression.
La vulnérabilité génétique est soutenue par certaines données épidémiologiques : on sait par exemple qu’un individu a deux à quatre fois plus de risque de présenter un trouble dépressif caractérisé au cours de sa vie lorsque l’un de ses parents a des antécédents de trouble dépressif. L'implication de formes particulières de gènes codant pour le transporteur de la sérotonine
sérotonine
Un des principaux transmetteurs du système nerveux central.
(un neurotransmetteur
neurotransmetteur
Petite molécule qui assure la transmission des messages d'un neurone à l'autre, au niveau des synapses.
) ou pour un facteur essentiel à la prolifération, la différenciation et la survie des neurones (le BDNF pour Brain-Derived Neurotrophic Factor) a ainsi été identifiée. Néanmoins, l'impact de ces gènes reste limité, la maladie dépressive étant d’origine plurifactorielle. Plus que la présence de particularités génétiques en tant que telles, c’est l’influence de l’environnement sur leur expression qui est incriminée. On parle d’interactions entre gènes et environnement. Des travaux ont par exemple montré que certaines personnes qui développent davantage de dépressions et d’idées suicidaires après des stress précoces (menaces, abandon, violences, abus pendant l’enfance) ont des "versions courtes" du gène codant pour le transporteur à la sérotonine.
...aux facteurs neurobiologiques
Les neurones communiquent entre eux grâce à des molécules nommées neurotransmetteurs. Un défaut de la neurotransmission médiée par la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine
dopamine
Hormone sécrétée par certains neurones dopaminergiques, impliquée dans le contrôle de la motricité, dans la maladie de Parkinson ou encore les addictions.
(neurotransmission monoaminergique) a longtemps été avancé comme constituant le mécanisme fondamental à l’origine de la maladie dépressive. En réalité, il ne suffit pas à lui seul pour expliquer la maladie.
Depuis, le rôle d’autres neurotransmetteurs a été identifié : la balance entre glutamate
glutamate
Neurotransmetteur excitateur le plus répandu dans le système nerveux central.
et GABA
GABA
Principal neurotransmetteur inhibiteur.
a notamment été décrite comme déterminante. En effet, celle-ci influence la sécrétion du BDNF qui est un facteur essentiel à la prolifération, la différenciation et la survie des neurones. Le déséquilibre de la balance glutamate/GABA serait à l’origine d’une altération de la neuroplasticité chez le patient déprimé, avec une incapacité par rapport aux personnes non malades à former de nouveaux neurones, notamment au niveau de l’hippocampe.
Un déficit dans la régulation du système de réponse au stress chronique, dépendant de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, serait un mécanisme complémentaire mais étroitement associé au précédent : en effet, l’altération de la réponse au stress conduit à une sécrétion anormalement élevée de cortisol (l’hormone du stress) chez certains patients. Ce phénomène neurotoxique peut favoriser une désorganisation, voire une dégénérescence neuronale dans l’hippocampe. Or, il a été décrit que l’augmentation de la sécrétion de cortisol avait aussi un effet inhibiteur sur la production du BDNF.
Les rechutes, principal facteur de risque à moyen et long terme
En l’absence de prise en charge, un épisode dépressif caractérisé peut se résoudre spontanément en 6 à 12 mois dans certains cas. Mais les épisodes dépressifs caractérisés isolés sont rares : ils sont récidivants chez 80% des patients. Ainsi, la dépression est une maladie pour laquelle les risques de rechute (au cours du traitement), de récidive (après une rémission) et de chronicité sont élevés. La qualité de la prise en charge – nature des traitements mis en œuvre et observance
observance
Respect du traitement prescrit par le patient.
– est déterminante pour le pronostic de trouble dépressif caractérisé.
Des traitements efficaces dans près de 70 % des cas
Si l’origine neurobiologique de la maladie n'est toujours pas bien comprise, des traitements médicamenteux efficaces existent et permettent d’améliorer, voire de guérir, une majorité des épisodes dépressifs caractérisés. Il est donc important que la prise en charge du premier épisode dépressif et des suivants soit correctement menée. L’objectif du traitement de la dépression est :
* la réduction des symptômes et de leurs conséquences fonctionnelles
* la prévention de rechutes et récidives ultérieures
Si un épisode récidive lors d'un premier traitement (médicament et/ou psychothérapie), les alternatives possibles sont l’adaptation pharmacologique (modification de la posologie, modification de l’antidépresseur, association d’un autre antidépresseur), la mise en place d’une approche de psychothérapie longue (type TCC) ou, dans certains cas, le recours à d’autres traitements biologiques comme la stimulation magnétique transcrânienne (r-TMS) ou l’électroconvulsivothérapie (ECT).
Les antidépresseurs
Plusieurs classes thérapeutiques d’antidépresseurs existent : les imipraminiques, premiers à avoir été commercialisés, les IMAO, puis les antidépresseurs ciblant les neurones à sérotonine et/ou noradrénaline et/ou dopamine (ISRS, IRSN et autres antidépresseurs). Le choix entre ces différentes familles de molécules dépend du profil du patient, de ses symptômes, de ses pathologies associées, de la tolérance et de la maniabilité du médicament, ainsi que des antidépresseurs préalablement reçus.
La phase d’attaque du traitement consiste à prendre ces médicaments régulièrement pendant 6 à 12 semaines pour traiter la phase aiguë de la dépression. Leur efficacité n’est pas immédiate : l’amélioration des symptômes s’observe le plus souvent après un minimum de 2 à 4 semaines de traitement. Le traitement doit être prolongé par une phase de consolidation de 4 à 9 mois visant à maintenir le bénéfice et réduire le risque de rechute. Au total, le traitement d’un premier épisode doit durer au minimum 1 an. Les épisodes dépressifs sont d’autant plus difficiles à soigner que les épisodes précédents ont été nombreux. Lorsqu’un patient a présenté au moins deux épisodes dépressifs antérieurs, surtout s’ils ont été sévères, le traitement du nouvel épisode doit se prolonger par une phase d’entretien de plusieurs années visant à éviter la survenue d’un nouvel épisode.
De manière générale, après 8 semaines d’un traitement médicamenteux bien conduit, un tiers des patients présentent une rémission complète des symptômes, un tiers des patients présentent une rémission partielle et un tiers ne répondent pas du tout au traitement.
La psychothérapie
La psychothérapie est recommandée pour le traitement de tous les épisodes dépressifs caractérisés, en association avec les médicaments antidépresseurs.
L’électroconvulsivothérapie ou sismothérapie
La méthode, communément appelée "électrochocs" souffre d'une image négative liée aux anciennes pratiques. Elle est pourtant utile, sans risque lorsqu’elle est pratiquée dans les règles de l’art et efficace dans 90 à 95% des cas des épisodes dépressifs particulièrement sévères et/ou résistants.
Un courant électrique est appliqué via deux électrodes placées au niveau des tempes du patient, sous anesthésie générale. L'objectif est de provoquer une crise similaire à une crise d’épilepsie généralisée d’une durée de 30 secondes environ. De 9 à 12 séances, réparties sur 4 à 6 semaines, sont menées. Parfois un traitement d’entretien est nécessaire, avec environ une séance par mois.
La stimulation magnétique transcrânienne
Comme l’électroconvulsivothérapie, la stimulation magnétique transcrânienne (rTMS) est une alternative thérapeutique possible pour les personnes souffrant de dépression. Comme la sismothérapie, la rTMS favoriserait l’activation du cortex préfrontal, la neurotransmission dopaminergique
dopaminergique
Relatif à la dopamine ou au cellules sécrétant cette hormone.
et inhiberait certaines régions impliquées dans la régulation de l’humeur. Elle pourrait aussi avoir des propriétés neurotrophiques et neuroplastiques. Elle ne nécessite pas d’anesthésie générale. Mais son efficacité est inconstante.
La kétamine
La kétamine, est une molécule utilisée en anesthésie depuis plusieurs décennies. A faible dose, elle possède une activité antidépressive rapide et persistante pendant quelques jours. Cet effet serait dû à une augmentation de la plasticité synaptique (synaptogenèse
synaptogenèse
Formation des synapses.
) agissant sur le cortex médian préfrontal. La kétamine est utilisée dans le traitement des patients résistants aux traitements antidépresseurs classiques et/ou avec un risque suicidaire particulièrement élevé. Étant associée à des effets indésirables dans les toutes premières heures suivant l’administration (hallucinations, effets dissociatifs, troubles cardiovasculaires…), son utilisation doit être réalisée en milieu hospitalier sous surveillance médicale.
Les enjeux de la recherche
Sur le plan thérapeutique, des recherches cliniques sont menées autour de mécanismes d’action déjà identifiés : c’est notamment le cas de médicaments expérimentaux ciblant la voie du GABA, ainsi que d’autres molécules voisines de la kétamine. Les premières données issues des essais cliniques conduits jusqu’à présent sont encourageantes. Elles pourraient aboutir à une nouvelle offre de médicaments antidépresseurs dans les prochaines années.
Parallèlement, les chercheurs tentent toujours de mieux comprendre la dépression, notamment au regard des les données cliniques montrant des typologies de patients et des réponses aux traitements actuels très disparates. Plusieurs nouvelles voies émergent, dont certaines sont particulièrement prometteuses. Elles pourraient mettre en évidence de nouveaux mécanismes et aboutir à l'identification de nouvelles cibles thérapeutiques. A terme, il est possible d’imaginer de mieux cibler les traitements en fonction des profils individuels et des profils cliniques.
Dépression et olfaction
L’olfaction et ses déterminants constituent une piste intéressante : sur le plan physiologique, le système olfactif est un lieu de neurogenèse qui interagit directement avec l’hippocampe, une région du cerveau jouant un rôle essentiel dans la neurogenèse. De plus, l’imagerie cérébrale montre un lien très fort entre l’activation des structures cérébrales impliquées dans la perception des émotions comme l’amygdale et celles liées à l’olfaction.
Cette relation étroite existe en clinique : on observe une réciprocité entre dépression et olfaction, les patients déprimés ayant fréquemment une olfaction altérée tandis que les personnes développant des troubles olfactifs souffrent fréquemment de symptômes dépressifs. L’heure est à la compréhension fine des interactions entre les deux systèmes, afin d’envisager des pistes d’action thérapeutiques.
Dépression et inflammation
Le rôle de l’inflammation dans la dépression est renforcé par plusieurs données récentes : l'imagerie cérébrale (IRM) a permis de décrire une corrélation entre la diminution du volume de matière grise corticale et une augmentation de la concentration plasmatique de certains médiateurs de l'inflammation (interleukines
interleukines
Protéine du système immunitaire, servant de messagers entre les cellules qui le composent.
) chez des patients déprimés. La protéine-C réactive (CRP), pro-inflammatoire, a également été décrite comme étant un marqueur précoce du risque d’épisode dépressif caractérisé.
Ces éléments soutiennent l’importance de l’inflammation chronique et de l’activation du système immunitaire dans le développement et la progression de la pathologie. Elles perturberaient le métabolisme d'un acide aminé
acide aminé
Élément de base constituant les protéines.
essentiel à partir duquel la sérotonine est synthétisée : le L-tryptophane (Trp). L’inflammation périphérique favoriserait la libération d'une enzyme dégradant le Trp par différentes cellules du système immunitaire (macrophages
macrophages
Cellule du système immunitaire chargée d’absorber et de digérer les corps étrangers
, lymphocytes, cellules dendritiques
cellules dendritiques
Cellules présentatrices d’antigènes responsables du déclenchement d’une réponse immune adaptative.
), ce qui conduirait à une réduction de la synthèse de la sérotonine. D’ailleurs, des essais cliniques ont pu montrer l’amélioration des symptômes dépressifs après traitement anti-inflammatoires.
Dépression et microbiote intestinal
La dépression ne serait pas une maladie uniquement liée au système nerveux central
système nerveux central
Composé du cerveau et de la moelle épinière.
: elle pourrait également avoir une origine périphérique. Voilà plusieurs années en effet que l’impact du microbiote intestinal est évoqué dans plusieurs maladies systémiques et, plus récemment, dans certains troubles mentaux. Il est possible que les voies de communication entre le microbiote intestinal et le système nerveux central (SNC) impliquent le système nerveux autonome (SNA), les systèmes entérique, neuroendocrinien et immunitaire. De nombreuses données expérimentales et cliniques confirment ainsi que la composition du microbiote est différente entre les personnes atteintes par certaines pathologies psychiatriques (autisme, schizophrénie…) et celles qui n’en souffrent pas.
Les données précliniques actuelles suggèrent qu’une perturbation du microbiote intestinal (dysbiose intestinale) pourrait favoriser la survenue de troubles anxieux ou dépressifs. Une équipe Inserm (Moods, Université Paris-Saclay) a décrit que le microbiote des patients déprimés présente un profil différent de celui de sujets contrôles et que les antidépresseurs modifient la composition du microbiote. Le microbiote pourrait aussi constituer un facteur prédictif de réponse aux antidépresseurs. Des essais cliniques préliminaires de transplantation de microbiote fécal sont en cours.
D'autres voies à explorer
L’implication des neurostéroïdes ou des endocannabinoïdes
endocannabinoïdes
Lipides sécrétés de manière endogène par l’organisme.
est aussi à l’étude. Des modifications des concentrations périphériques de certains neurostéroïdes (DHEA, alloprégnanolone…) ou d’endocannabinoïdes (anandamine, 2-AG) ont en effet été observées chez les patients déprimés.
Vers la personnalisation des traitements
Les chercheurs tentent par ailleurs d’identifier des marqueurs de réponse aux traitements qui permettraient de choisir d’emblée la bonne stratégie thérapeutique pour chaque patient. Des travaux ont par exemple montré qu’une hypoactivité du cortex insulaire (impliqué dans la réponse émotionnelle) est associée à de bonnes chances de rémission par thérapie cognitive mais à une faible réponse aux antidépresseurs. A l’inverse, si cette région corticale est hyperactive, les antidépresseurs donneront de meilleurs résultats que la thérapie cognitivo-comportementale. L’activité des récepteurs à la sérotonine pourrait, elle aussi, constituer un marqueur de réponse aux traitements : les chances de rémission sont en effet plus élevées si ce récepteur fixe fortement la sérotonine au niveau cérébral, ce qui est variable selon les patients. De tels travaux peuvent améliorer l’évolution vers personnalisation de la prise en charge de la dépression.
Devant la variabilité interindividuelle de la réponse aux antidépresseurs, des explorations ont été menées afin d’identifier les gènes dont le polymorphisme
polymorphisme
Le fait qu’une espèce présente des individus aux caractéristiques différentes au sein d’une même population/ Propriétés des gènes qui se présentent sous plusieurs formes, appelées allèles.
peut influencer la pharmacocinétique des médicaments et, ainsi, l’efficacité de ces médicaments. Les gènes codant pour des protéines responsables du métabolisme, du transport ou des cibles moléculaires des antidépresseurs sont pour l’heure les plus étudiés et les mieux décrits. Cette approche, dite de pharmacogénétique, commence à être utilisée en pratique clinique, même si elle reste pour l’heure réservée à certains centres experts comme le service de psychiatrie de l’hôpital Bicêtre et le Mood Center Paris Saclay : elle permet de personnaliser le traitement en adaptant le choix de la molécule et sa posologie au profil pharmacogénétique du patient.
L’identification de marqueurs de vulnérabilité permettant de prédire une rechute après un premier épisode dépressif constitue enfin un autre champ de recherche. Pour les découvrir, les chercheurs mesurent les concentrations de différents marqueurs associés à la dépression au moment du diagnostic, lors du suivi, puis après rémission. De tels travaux ont ainsi pu montrer que l’augmentation du taux cérébral de monoamine oxydase (impliquée dans la dégradation de la sérotonine, noradrénaline et de la dopamine) est associé à celle du risque de rechute. Des taux élevés de cortisol après traitement par antidépresseur seraient aussi associés à un risque plus élevé de récidive dans les deux à trois années suivantes. Des travaux similaires sont actuellement menés sur certains récepteurs de la sérotonine.
Développement des Mood Centers en France
Grâce à une approche intégrée, transversale et pluridisciplinaire de la maladie, les Mood Centers anglo-saxons constituent un dispositif efficace de prise en charge de la dépression. Le service hospitalo-universitaire de psychiatrie et d’addictologie de Bicêtre est le premier centre à avoir engagé cette mutation en France, avec la volonté de créer un réseau national offrant la même approche.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Trop de gras déséquilibre rapidement la flore intestinale |
|
|
| |
|
| |
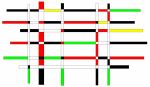
Trop de gras déséquilibre rapidement la flore intestinale
COMMUNIQUÉ | 20 SEPT. 2016 - 10H01 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
IMMUNOLOGIE, INFLAMMATION, INFECTIOLOGIE ET MICROBIOLOGIE
Un élément perturbateur comme un changement d’alimentation, et c’est toute la flore intestinale qui se dérègle avec des répercussions possibles sur la santé. Une étude internationale de recherche, menée par l’unité de Pathogénie microbienne moléculaire (Institut Pasteur/Inserm) dirigée par Philippe Sansonetti, vient notamment de mettre en évidence, chez la souris, l’influence directe d’une alimentation trop riche en graisse sur la flore intestinale et son environnement. Face à ce nouveau régime, les communautés de bactéries se réorganisent et le petit intestin lui-même se métamorphose. Et ce, dès le premier mois. Ces résultats ont été publiés dans la revue PNAS, le 16 septembre.
Les milliards de bactéries qui peuplent notre intestin – et qu’on appelle le microbiote – jouent un rôle central dans la digestion mais aussi dans certaines maladies comme le diabète de type 2 ou l’obésité. Ces pathologies ont souvent été associées à un déséquilibre de la flore intestinale, certaines bactéries devenant clairement prédominantes, et à un intestin perméable, susceptible de libérer dans le sang des substances inflammatoires. Mais si de nombreuses études se sont intéressées à l’état du microbiote intestinal une fois la pathologie installée, très peu se sont focalisées sur l’installation de ce déséquilibre intestinal lors de l’introduction d’une alimentation riche en graisse par exemple. C’est pourquoi une équipe internationale de recherche s’est penchée sur la question. « Nous voulions voir, de façon précoce, comment se comportaient les bactéries intestinales face à un régime riche en gras, souligne Thierry Pédron, ingénieur de recherche dans l’unité de Pathogénie microbienne moléculaire (Institut Pasteur/Inserm). Et rapidement, nous avons concentré nos recherches sur l’intestin grêle car c’est là que nous avons observé les variations les plus flagrantes ! »
Certaines souris de l’étude ont donc reçu une alimentation ordinaire tandis que d’autres recevaient une alimentation composée à 70 % de lipides. Grâce à des techniques de génomique, les chercheurs ont pu identifier les différentes espèces bactériennes contenues dans des échantillons de fèces et suivre l’évolution de la composition du microbiote au cours du temps. Ils ont également localisé et identifié avec précision les bactéries au sein de l’intestin grêle.
« Un mois seulement après le début de ce nouveau régime riche en graisse, nous avons constaté des changements dans la composition du microbiote, présente Thierry Pédron. Certaines espèces bactériennes proliféraient tandis que d’autres diminuaient, l’espèce Candidatus arthromitus ayant même complément disparu. Par ailleurs, et de façon totalement inédite, nous avons observé une concentration massive des bactéries entre les villosités de l’épithélium intestinal ».
D’ordinaire, les bactéries ne peuvent pas se rapprocher ni même traverser la paroi intestinale car l’épithélium libère des peptides antimicrobiens et il est tapissé d’un mucus protecteur. Les chercheurs se sont alors intéressés à ces défenseurs de la paroi intestinale : ils ont constaté que la production de peptides antimicrobiens chutait suite à une ingestion massive de lipides et que la couche de mucus s’affinait. Autrement dit, non seulement le microbiote se réorganise sous l’influence des lipides mais l’intestin, lui-même, subit des métamorphoses. Et les modifications ne s’arrêtent pas là. Des mesures complémentaires ont permis de mettre en évidence une augmentation de la perméabilité de l’intestin grêle et une diminution de l’activité de PPAR-γ. « PPAR-γ est une molécule qui a de nombreuses fonctions, elle joue un rôle important dans le métabolisme des acide gras, mais aussi dans l’inflammation et le développement embryonnaire, explique Thierry Pédron. Cette chute semble intimement liée à celle des peptides antimicrobiens. » Et si les liens entre tous ces résultats, et leurs implications potentielles dans certains déséquilibres alimentaires, ne sont pas encore établis, il est rassurant de noter que lorsque les souris retrouve un régime alimentaire équilibré, tout rentre dans l’ordre au bout d’un mois !
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Stress post-traumatique : Nouvelles pistes pour comprendre la résilience au trauma |
|
|
| |
|
| |

Stress post-traumatique : Nouvelles pistes pour comprendre la résilience au trauma
COMMUNIQUÉ | 13 FÉVR. 2020 - 20H00 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE
Une étude Science apporte de nouvelles pistes pour comprendre le trouble de stress post-traumatique © Inserm
Les attentats de Paris et Saint-Denis, le 13 novembre 2015, ont laissé des marques durables, non seulement sur les survivants et leurs proches, mais aussi sur la société française dans son ensemble. Vaste programme de recherche transdisciplinaire, le projet 13-Novembre est codirigé par le neuropsychologue Francis Eustache, directeur du laboratoire Inserm Neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine (Inserm/Université de Caen Normandie/École pratique des hautes études/CHU Caen/GIP Cyceron), et l’historien Denis Peschanski, directeur de recherche au CNRS[1]. L’objectif : étudier la construction et l’évolution de la mémoire, individuelle et collective, de ces événements traumatiques, mais également mieux comprendre les facteurs protégeant les individus du stress post-traumatique.
Dans ce cadre, une étude d’imagerie cérébrale intitulée Remember, dont l’Inserm est promoteur, s’intéresse aux réseaux cérébraux impliqués dans le trouble de stress post-traumatique (TSPT). Des travaux qui donnent lieu à une publication dans la revue Science, le 14 février 2020. Dirigée par le chercheur Inserm Pierre Gagnepain, cette étude montre que la résurgence intempestive des images et pensées intrusives chez les patients atteints de stress post-traumatique, longtemps attribuée à une défaillance de la mémoire, serait également liée à un dysfonctionnement des réseaux cérébraux qui la contrôlent. Ces résultats permettent d’identifier de nouvelles pistes de traitement.
1. Contexte : le programme 13-Novembre
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/Gi9QvS1ZBVY" allowfullscreen="allowfullscreen" width="560" height="315" frameborder="0"></iframe>
Les attaques du 13 novembre 2015, d’une ampleur et d’une violence inédites, ont provoqué une onde de choc dans la société française. La communauté scientifique décide de s’engager pour mieux appréhender les conséquences d’un tel traumatisme et améliorer la prise en charge des victimes et de leur entourage. Le 18 novembre 2015, Alain Fuchs, alors président du CNRS, s’adresse au monde académique et lance un appel à projets pour répondre à ces défis. Il demande à toutes les équipes de recherche intéressées d’émettre des « propositions sur tous les sujets pouvant relever des questions posées à nos sociétés par les attentats et leurs conséquences, et ouvrant la voie à des solutions nouvelles – sociales, techniques, numériques ».
Le programme transdisciplinaire 13-Novembre est alors lancé par l’Inserm, le CNRS et Hesam université[2]. Il comprend plusieurs volets, notamment « l’étude 1000 » : en pratique, l’idée est de suivre 1000 personnes volontaires sur 12 ans. Parmi elles, des personnes directement exposées aux attentats, survivants et proches des victimes, ainsi que celles intervenues sur les lieux le soir des attaques, mais aussi des habitants des quartiers ciblés et des quartiers périphériques de Paris et enfin des personnes issues de plusieurs autres villes françaises, afin de comprendre comment se construit et évolue la mémoire des attentats (voir encadré).
Remember : comprendre le trouble de stress post-traumatique
Dans le cadre du programme 13-Novembre, le projet Remember, dont l’Inserm est promoteur, permet d’aller encore plus loin dans la compréhension de la mémoire humaine. Avec cette étude d’imagerie cérébrale menée à Caen et portant sur un sous-groupe de 175 participants, les chercheurs explorent les effets d’un événement traumatique sur les structures et le fonctionnement du cerveau, identifiant des marqueurs neurobiologiques du stress post-traumatique mais également de la résilience au trauma. Ils espèrent qu’un jour ces travaux pourront déboucher sur de nouvelles pistes thérapeutiques, complémentaires à celles existant déjà.
Remember s’attèle ainsi à une question majeure qui intrigue les neuroscientifiques depuis des années : pourquoi certaines personnes ayant vécu un traumatisme souffrent-elles de stress post-traumatique, alors que d’autres ne développent jamais ce trouble ? L’un des objectifs de l’étude publiée dans la revue Science, est de déterminer s’il existe un lien entre les mécanismes de contrôle de notre mémoire et la capacité de résilience des individus.
« Nous avons focalisé ce programme de recherche sur les facteurs de protection et les marqueurs cérébraux associés à la résilience au traumatisme. C’est ce qui fait l’originalité de nos travaux par rapport aux études précédentes qui se focalisent plutôt généralement sur l’impact des chocs traumatiques sur la mémoire et son dysfonctionnement », souligne Pierre Gagnepain, chercheur Inserm et responsable scientifique de l’étude Remember.
L’« étude 1000 » du programme 13-Novembre
Au cours de quatre campagnes d’entretiens filmés lancées avec le soutien de l’Institut national de l’audiovisuel (INA) et de l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD), réparties sur 10 ans (2016, 2018, 2021 et 2026), les participants sont amenés à partager leurs témoignages et à évoquer leurs souvenirs personnels des attentats à partir d’un guide d’entretien identique.
Ces récits individuels seront ensuite analysés en détail et mis en perspective avec les traces de la mémoire collective telle qu’elle se construit au cours du temps, notamment au sein des espaces médiatiques (journaux télévisés et radiodiffusés, articles de presse, réseaux sociaux, images commémoratives…).
Cette démarche s’inspire de celle mise en place par William Hirst, professeur de psychologie de la New School (New York, États-Unis), à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Avec ses équipes, il avait recueilli près de 3 000 questionnaires écrits, quatre fois en dix ans, sans viser un suivi de cohorte.
Le programme 13-Novembre va plus loin, en privilégiant des enregistrements vidéo, en cherchant à suivre les mêmes personnes sur ces dix années, et en privilégiant l’approche transdisciplinaire. Il s’agit en ce sens d’une première mondiale. « En mettant en place 13-Novembre, l’idée était d’aller encore plus loin, grâce à une collaboration très riche entre de multiples disciplines et à la mise en place de l’étude biomédicale Remember. Nous avons là une opportunité scientifique unique de voir le processus de construction de la mémoire individuelle, et comment elle dialogue avec la mémoire collective », soulignent Francis Eustache et Denis Peschanski, codirecteurs du programme 13-Novembre.
2. Trouble de stress post-traumatique
Le trouble de stress post-traumatique (TSPT) peut se développer chez certains individus ayant été confrontés à des événements choquants, dangereux ou effrayants. D’abord repéré et étudié par les scientifiques au sein de populations de militaires revenus du front, le trouble de stress post-traumatique peut néanmoins toucher toutes les populations, enfants et adultes. Il peut survenir après tout type de traumatisme, d’une catastrophe naturelle au décès soudain d’un proche, en passant par un attentat terroriste comme ceux du 13 novembre 2015. Des études réalisées aux États-Unis et au Canada estiment que la prévalence du trouble de stress post-traumatique dans la population générale est de l’ordre de 6 à 9 %.
Les souvenirs intrusifs au cœur du trouble de stress post-traumatique
Le trouble de stress post-traumatique est un état complexe qui se caractérise par plusieurs symptômes, pouvant varier d’un individu à l’autre. Le trouble évolue de manière progressive, pouvant rester silencieux pendant des périodes relativement longues. Il peut apparaître juste après un traumatisme ou des années plus tard. Parmi les symptômes les plus caractéristiques, l’intrusion fréquente du souvenir des images, des odeurs et des sensations associées au traumatisme vécu.
Ces intrusions, qui bouleversent la vie quotidienne, induisent une grande détresse, ainsi que d’autres émotions intenses comme la peur, la culpabilité, la colère… Cet état peut s’accompagner de symptômes physiques provoqués par le rappel de l’événement, par exemple des tensions musculaires ou une accélération du rythme cardiaque.
Afin de limiter le sentiment de détresse engendré par les souvenirs intrusifs, les personnes atteintes de trouble de stress post-traumatique ont également tendance à développer des comportements d’évitement pour fuir toutes les circonstances qui pourraient éveiller le souvenir du traumatisme. Ils peuvent refuser de penser à l’événement ou d’en parler, s’isolant parfois petit à petit du reste de la société, et même de leurs proches.
3. L’étude Science: mieux comprendre l’origine des souvenirs intrusifs
D’après les modèles traditionnels du TSPT, la persistance des souvenirs intrusifs douloureux s’expliquerait par un dysfonctionnement de la mémoire, un peu à la manière d’un vinyle rayé rejouant en boucle les mêmes fragments de nos souvenirs. Au niveau anatomique, ces dysfonctionnements seraient visibles particulièrement au niveau de l’hippocampe, région clé pour la formation de la mémoire.
Par ailleurs, les tentatives de suppression par les patients de leurs souvenirs traumatiques ont longtemps été considérées comme un mécanisme inefficace. Au lieu de confronter ces images douloureuses pour les laisser dans le passé, le fait d’essayer de les chasser ou de les réprimer était plutôt perçu comme une stratégie négative, renforçant les intrusions et aggravant la situation des personnes souffrant de TSPT.
L’étude d’imagerie cérébrale Inserm publiée dans Science remet en cause certaines de ces idées, et émet l’hypothèse que la résurgence intempestive des images et pensées intrusives serait liée à un dysfonctionnement des réseaux cérébraux impliqués dans le contrôle de la mémoire (pour reprendre l’image précédente, le bras de la platine vinyle contrôlant la lecture des souvenirs). « Ces mécanismes de contrôle agissent comme un régulateur de notre mémoire, et sont engagés pour stopper ou supprimer l’activité des régions associées aux souvenirs, comme l’hippocampe », souligne Pierre Gagnepain.
Méthodes et résultats de l’étude
Avec ses collègues du laboratoire dirigé par Francis Eustache, Pierre Gagnepain a travaillé avec 102 survivants des attaques de Paris, dont 55 souffrant de TSPT. 73 personnes n’ayant pas été exposées aux attentats ont également pris part à l’étude.
Afin de modéliser la résurgence des souvenirs intrusifs constatée dans le TSPT chez ces volontaires, sans les exposer à nouveau aux images choquantes des attentats, les scientifiques ont opté pour un protocole de recherche en imagerie cérébrale s’appuyant sur la méthode Think/No-Think (cf. encadré).
Cette méthode vise à créer des associations entre un mot indice et un objet du quotidien n’ayant rien à voir l’un avec l’autre (par exemple le mot « chaise » avec l’image d’un ballon), afin de reproduire la présence d’une intrusion lors de la confrontation avec le mot indice. « Dans un second temps, nous pouvons étudier la capacité des participants à chasser et supprimer l’image intrusive de leur esprit surgissant contre leur gré lorsqu’ils sont confrontés au mot indice », précise la chercheuse Alison Mary, première auteure de l’article et chercheuse à l’Inserm au moment de ces travaux.
La méthode du Think/No-Think
Hors de question pour les chercheurs de soumettre les survivants des attentats à de nouvelles images traumatisantes qui pourraient les replonger dans une situation de détresse. Le paradigme « think/no-think » modélise la situation dans laquelle se trouvent les patients en état de stress post-traumatique, confrontés à des images et à des souvenirs qui s’imposent fréquemment à eux de manière intrusive, mais sans avoir recours à des stimuli qui pourraient être traumatisants.
Lors de la phase d’apprentissage, les participants apprennent des paires de stimuli par cœur (par exemple le mot chaise associé à l’image d’un ballon). L’objectif : quand le mot chaise est ensuite présenté aux participants, l’image du ballon est automatiquement réactivée. Le mot chaise se comporte comme indice d’une intrusion mentale, déclenchant le souvenir associé du ballon. Celui-ci survient de façon spontanée et automatique, simulant certaines caractéristiques des véritables souvenirs intrusifs du trouble de stress post-traumatique.
Dans la phase suivante, l’activité du cerveau est mesurée chez les participants à l’aide de la technique d’IRM fonctionnelle, selon deux conditions :
· Condition « Think » : l’un des mots est présenté écrit en vert, et le sujet doit visualiser précisément l’image associée.
· Condition « No-Think » : l’un des mots est présenté en rouge, et le sujet doit vider son esprit et empêcher l’image d’émerger, tout en maintenant son attention sur le mot. Les chercheurs distinguent alors les situations dans lesquelles l’image ne survient pas et les situations menant à une intrusion, même si elle est brève. Ils peuvent ainsi observer les différences d’activité cérébrale dans les deux cas, afin d’étudier de près les mécanismes de contrôle de la mémoire employés pour réprimer une image intrusive.
Contrôle des souvenirs intrusifs et résilience
Les chercheurs se sont intéressés aux connexions cérébrales entre régions de contrôle, situées dans le cortex frontal (à l’avant du cerveau) et les régions des souvenirs, telles que l’hippocampe. L’objectif : mettre en évidence d’éventuelles différences entre les trois groupes de participants (le premier non exposé aux attentats, le deuxième exposé aux attentats sans TSPT et le troisième exposé mais avec TSPT).
Les résultats montrent que les participants souffrant de TSPT présentent une défaillance des mécanismes qui permettent de supprimer et de réguler l’activité des régions de la mémoire lors d’une intrusion (notamment l’activité de l’hippocampe).
À l’inverse, le fonctionnement de ces mécanismes est très largement préservé chez les individus sans TSPT, qui parviennent à lutter contre les souvenirs intrusifs. « Dans notre étude, nous suggérons que le mécanisme de suppression des souvenirs n’est pas intrinsèquement mauvais et à l’origine des intrusions comme on le croyait. En revanche, son dysfonctionnement l’est. Si on prend pour analogie les freins d’une voiture, ce n’est pas le fait de freiner, ou dans le cas qui nous occupe, de supprimer les souvenirs qui pose problème, mais le fait que le système de freinage soit défaillant, ce qui conduit à sa surutilisation », explique Pierre Gagnepain.
4. Quelles sont les implications de ces travaux ?
Ces résultats permettent de questionner les idées reçues sur le trouble de stress post-traumatique et d’imaginer de nouvelles pistes de traitement.
Implications scientifiques
D’une part, l’étude souligne que la persistance du souvenir traumatique n’est vraisemblablement pas uniquement liée à un dysfonctionnement de la mémoire, mais également à un dysfonctionnement des mécanismes de contrôle de la mémoire.
D’autre part, si l’on a longtemps considéré les processus de suppression des souvenirs à l’œuvre chez les individus victimes de stress post-traumatique comme problématiques et inefficaces (puisqu’ils permettaient aux souvenirs traumatiques de revenir à la charge de manière encore plus violente), l’étude montre que le problème n’est pas ce mécanisme en tant que tel, mais sa mauvaise réalisation par les réseaux cérébraux.
Les patients atteints de TSPT seraient en fait constamment en état de « suppression » de la mémoire, même en l’absence d’intrusion des souvenirs, afin de compenser ce système défaillant du contrôle de la mémoire. Reste à déterminer si ces difficultés de contrôle se sont instaurées après le traumatisme, ou étaient présentes avant, rendant l’individu plus vulnérable.
Implications thérapeutiques
À l’heure actuelle, la plupart des thérapies existantes proposées aux patients visent à recontextualiser les souvenirs problématiques, à faire prendre conscience qu’ils appartiennent au passé, et à réduire le sentiment de peur qu’ils suscitent.
Proposer des interventions déconnectées des événements traumatiques, stimulant les mécanismes de contrôle identifiés dans cette étude, pourrait être un complément utile pour entraîner les patients à mettre en place des mécanismes de suppression plus efficaces. « Tous les traitements impliquent aujourd’hui de se confronter au traumatisme, ce qui n’est pas toujours évident pour les patients. On pourrait imaginer que réaliser une tâche similaire à la méthode Think-No Think permette de stimuler les mécanismes de suppression, facilitant ainsi le traitement du souvenir traumatique dans les thérapies classiques », expliquent les chercheurs.
Des résultats en dialogue avec les autres volets du programme 13-Novembre
L’étude permet aussi de mieux étudier le fonctionnement cérébral des survivants « résilients », n’ayant pas développé le trouble. « Cette étude va plus loin que toutes les autres, qui se concentrent traditionnellement sur les militaires ayant été exposés à des situations traumatiques. Cependant, les militaires ont rarement été exposés au même degré, à la même fréquence, ni aux mêmes situations. Il est donc souvent difficile d’étudier en parallèle des individus atteints de stress post-traumatique et des individus résilients ayant été exposés à la même situation choquante. Ici, nous avons cette possibilité. C’est un progrès qui aura, nous l’espérons, des répercussions importantes pour toutes les personnes victimes de trauma dans le monde », souligne Pierre Gagnepain.
Plusieurs études se profilent désormais pour venir compléter ces résultats. Les chercheurs vont notamment utiliser les données collectées lors des sessions d’imagerie cérébrale pour s’intéresser de plus près aux altérations spécifiques de l’hippocampe, structure clé dans l’expression des souvenirs intrusifs. Les études avec ces participants ayant déjà été menées à deux reprises, à deux ans d’intervalle, les chercheurs pourront également étudier leur évolution individuelle et tenter de repérer des biomarqueurs permettant de prédire cette évolution. « Enfin, il sera intéressant de confronter les données collectées dans le cadre du programme 13-Novembre, qui étudie l’évolution du souvenir traumatique aux niveaux collectif et individuel, et ceux de Remember, qui étudie les mécanismes cérébraux permettant de lutter contre ce traumatisme. Des travaux originaux et inédits au niveau mondial », conclut Pierre Gagnepain.
C’est cette capacité à faire dialoguer de nombreuses disciplines et à explorer toute la complexité de la mémoire humaine qui fait toute la richesse du programme 13-Novembre.
Témoignages de participants*
L’histoire d’Anna
Pour Anna et le père de ses enfants, le 13 novembre 2015 était une date importante. Pour la première fois depuis la naissance de leur deuxième fils, ils sortaient dîner en amoureux dans leur quartier. Habitant le XIe arrondissement, ils avaient choisi un restaurant à proximité. Après leur repas, alors qu’Anna rentrait retrouver leurs enfants, une détonation retentit sur le trottoir d’en face, au niveau du Comptoir Voltaire. Pensant à une fuite de gaz dans l’un des immeubles de la rue, elle était alors bien loin d’imaginer ce qui se passait réellement.
C’est en remontant chez elle, alors que la nouvelle des attentats est en train de faire le tour du monde, qu’Anna a commencé à réaliser ce qu’elle a vécu. Le reste de cette nuit-là est pour elle associé à une sensation de flottement et d’angoisse alors que son mari, parti retrouver des collègues pour une fête de fin de tournage, s’est retrouvé confiné dans le lieu qui accueillait la fête. À ce flottement succèdera l’incompréhension face à l’horreur tout au long du weekend qui a suivi.
La semaine après les attentats est difficile. Anna a du mal à réaliser ce qui s’est passé, elle pleure beaucoup. Chaque jour, elle craint pour la vie de ses enfants, scolarisés dans le quartier. Le diagnostic de stress post-traumatique est rapidement posé.
Participation aux études
Après les attentats, Anna apprend qu’une campagne de recrutement est menée à l’INA, qui recherche des volontaires pour participer au Programme 13-Novembre de l’Inserm et du CNRS. Sa psychologue l’incite à y participer, l’envie de mieux appréhender les événements du 13 novembre 2015 et d’apporter son témoignage à la communauté scientifique pousse Anna à s’y rendre. Tout s’enchaîne ensuite : elle acceptera aussi de participer à l’étude d’imagerie cérébrale du programme promue par l’Inserm, Remember.
Pour Anna, prendre part à une étude biomédicale a constitué une expérience très intense, mais enrichissante sur le plan humain. « À Caen, j’ai été accueillie avec beaucoup de bienveillance par l’équipe. Une équipe de médecins et psychologues étaient là pour poser des questions sur mon état de santé et pour m’expliquer le protocole et ses objectifs. On ressort lessivé : l’apprentissage de la liste de mots n’est pas une chose aisée, et la tâche Think-NoThink dans le scanneur est difficile à réaliser, car il y a beaucoup de bruit, mais j’ai été bien entourée, et je suis contente de savoir que ma participation permettait d’en apprendre plus sur le fonctionnement du cerveau dans le trouble de stress post-traumatique », explique-t-elle.
Anna n’a jamais cessé d’avancer tout en étant accompagnée par une psychologue rencontrée dans le cadre de la cellule de crise de la mairie du XIe. Elle est heureuse d’avoir pu participer à l’étude Remember et espère que les résultats permettront d’améliorer la prise en charge des personnes vivant avec du stress post-traumatique, et de dédramatiser ce trouble.
L’histoire de Dominique
C’est lors d’une réunion d’une association de victimes des attentats que Dominique a pour la première fois entendu parler du programme 13-Novembre codirigé par Francis Eustache et Denis Peschanski. Rescapé des attaques terroristes perpétuées dans les cafés parisiens, Dominique a toujours été très intéressé par la science et notamment par le grand défi scientifique que constitue l’exploration du cerveau humain pour en percer les mystères. L’aspect transdisciplinaire du programme, à la croisée des sciences sociales et des neurosciences, ainsi que la volonté des chercheurs de travailler sur la construction de la mémoire ont attisé sa curiosité.
« En tant que survivant des attentats, on peut ressentir une forme de culpabilité. J’avais envie d’agir, je voulais apporter une contribution pour que les choses avancent après ces événements. Le fait de participer à une étude scientifique autour de thématiques aussi importantes que celles de la mémoire collective d’un pays, de la prise en charge de victimes atteintes de stress post-traumatique et du vivre-ensemble en société après les attentats me paraissait intéressant. Et surtout, je m’en sentais capable », explique Dominique.
Après avoir participé aux sessions filmées à l’INA dans le cadre du programme 13-Novembre, Dominique a ensuite accepté de se rendre à Caen à deux reprises pour participer à l’étude Remember. Une expérience à la fois difficile et très enrichissante. « Les échanges avec tous les chercheurs qui étaient là, étaient passionnants, j’avais plein de questions à leur poser sur leur travail, sur ce qu’ils cherchaient à voir dans le cerveau. En revanche, la partie de l’étude sous IRM était un vrai défi. Je ne suis pas claustrophobe mais vous êtes tout de même confiné dans un espace étroit, dans la pénombre, et la machine est très bruyante, produisant des sons pouvant rappeler des coups de feu. Quand vous tentez de lutter contre vos souvenirs intrusifs, c’est très dur. Heureusement que j’étais bien accompagné par l’équipe », précise-t-il.
Afin de surmonter l’étape de l’IRM lors la deuxième session à Caen, Dominique s’est d’ailleurs entraîné à rester dans des espaces étroits en se glissant sous le lit à plusieurs reprises. À sa grande surprise, tout s’est déroulé sans encombre cette deuxième fois, et il est prêt à retourner à Caen l’année prochaine pour une troisième et dernière série d’expériences visant à collecter des données supplémentaires pour étudier l’évolution des participants à l’étude sur le plus long terme, et aller encore plus loin que l’étude publiée dans Science.
* Les prénoms ont été changés à la demande des participants
En savoir plus sur le programme 13-Novembre : « Quelle sera la mémoire du 13 novembre ? » (entretien croisé de Francis Eustache et Denis Peschanski du 13 juin 2016).
[1] Actuellement au Centre européen de sociologie et de science politique de la Sorbonne (CNRS/Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/EHESS)
[2] Porté par le CNRS et l’Inserm pour le volet scientifique et par HESAM Université pour le volet administratif, le programme 13-Novembre est financé par le Secrétariat général pour l’investissement via l’Agence nationale de la recherche (ANR) dans le cadre du Programme investissements d’avenir (PIA). Il rassemble 31 partenaires et 26 soutiens. Il est une composante de l’équipex MATRICE. Pour en savoir plus : http://www.memoire13novembre.fr/partenaires-et-soutiens2020-02-13_DP_13 Novembre
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
