|
| |
|
|
 |
|
Comment reconnaître les symptômes des troubles bipolaires ? |
|
|
| |
|
| |
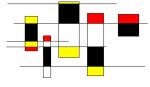
Comment reconnaître les symptômes des troubles bipolaires ?
Alain Sousa
Journaliste scientifique
Mis à jour le 25/10/2018 à 00h00
Validation médicale :
07 May 2018
Jesus Cardenas
médecin, ancien directeur médical
On parle de plus en plus de "troubles bipolaires" ou "maniaco-dépressifs". Bien que cette maladie soit parfois difficile à diagnostiquer, il existe des symptômes et des signes spécifiques à identifier. Doctissimo vous éclaire sur le sujet.
Sommaire
* Symptômes des troubles bipolaires : épisodes maniaques et dépressifs
Les autres symptômes particuliers des troubles bipolaires
Troubles bipolaires : un délai de diagnostic inacceptable
L'un des principaux problèmes des désordres bipolaires, c'est de le reconnaître ! Bien souvent, le délai entre le moment où les premiers symptômes apparaissent et la mise en place du traitement est de 5 à 10 ans ! Le malade aura vu entre temps 3 à 4 médecins en moyenne avant que l'un d'eux ne reconnaisse le problème. Car il est souvent difficile de différencier la dépression simple du véritable désordre bipolaire. Selon le Pr. Marie-Christine Hardy-Bayle, de l'hôpital André Mignot au Chesnay, de nombreux "déprimés" souffrent en fait de troubles bipolaires. Et 26 % ne seront pas diagnostiqués lorsqu'ils seront vus en médecine générale. Ce pourcentage passe à 36 % chez les psychiatres, dont on pourrait pourtant croire qu'ils sont plus a même de reconnaître le mal ! Enfin, 45 % ne seront pas diagnostiqués lors d'un passage à l'hôpital !
Symptômes des troubles bipolaires : épisodes maniaques et dépressifs
Les épisodes maniaques
Un épisode maniaque classique dure plus d’une semaine, et en général quatre à huit semaines. Il conduit souvent à proposer une hospitalisation, pour traiter (voire protéger) le patient.
Les épisodes maniaques sont souvent précédés de signes annonciateurs :
* Une énergie décuplée ;
* Une facilité dans les échanges sociaux ;
* Un sentiment d'euphorie.
Toutefois, dans ces moments, une certaine irritabilité est aussi possible.
Durant l’épisode maniaque, le patient bipolaire présente au moins trois des signes suivants :
* Accroissement des activités sociales (professionnelles ou sexuelles), besoin constant de parler, hyperactivité ;
* Des achats inconsidérés ;
* Sentiment exagéré de puissance (haute estime de soi) ;
* Tendance à passer "du coq à l’âne" ;
* Insomnie.
Ces signes peuvent parfois s’accompagner d’autres symptômes comme le délire ou des hallucinations.
Les épisodes dépressifs
Ces épisodes peuvent durer de 2 semaines à 6 mois en l'absence de traitement.
Ils associent :
* Un sentiment de tristesse, de vide ;
* Une perte d’intérêt pour les activités quotidiennes.
Ces deux symptômes centraux sont souvent accompagnés de :
* Insomnies ou au contraire envie de dormir de manière excessive ;
* Perte d'appétit ;
* Perte de poids importante ou prise de poids ;
* Difficultés de concentration ;
* Prise de décision difficile ;
* Impression de vivre ou ralenti ou au contraire d'hyperactivité ;
* Baisse de l'estime de soi.
Pendant l'épisode dépressif, le patient bipolaire peut avoir des envies suicidaires.
Les autres symptômes particuliers des troubles bipolaires
* Chez les patients jeunes, le délire est souvent présent ainsi qu'un sentiment de persécution ;
* Grande mégalomanie ;
* L'humeur se modifie très rapidement, parfois plusieurs fois dans la journée ;
* Grande mélancolie ;
* Au début de la maladie, les épisodes dépressifs peuvent être absents.
*
Troubles bipolaires : un délai de diagnostic inacceptable
Le temps d'identification de la maladie est un véritable problème. Car le principal risque accompagnant ce trouble est le suicide : 15 % des hommes bipolaires et 22 % des femmes mettront ainsi fin à leur jour. Et un quart à la moitié feront une tentative de suicide, avec plus ou moins de séquelles. Sans parler des conséquences mettant ainsi en jeu la vie de la personne, les désordres bipolaires représentent un véritable handicap social et professionnel. Ils sont responsables de difficultés au bureau et de chômage, et ont un retentissement important sur la vie de famille.
L'annonce du diagnostic intervient encore trop souvent après plusieurs années d'errance diagnostique. De plus, l'acceptation de la maladie est un processus lent.
Révision médicale :
07/05/2018
Jesus Cardenas
médecin, ancien directeur médical
Sources
* Troubles bipolaires, nouvelles perspectives, Présentation du Pr. Marie-Christine Hardy-Bayle de l'hôpital du Chesnay, parrainé par les laboratoires Lilly, MEDEC 2004.
* Article "Troubles bipolaires : Suivi médical et vie au quotidien", site de l'assurance maladie, consulté en février 2018.
* Troubles bipolaires, nouvelles perspectives, Présentation du Pr. Marie-Christine Hardy-Bayle de l'hôpital du Chesnay, parrainé par les laboratoires Lilly, MEDEC 2004.
* Patient avec un trouble bipolaire : repérage et prise en charge - Fiche Mémo - Haute Autorité de Santé (accessible en ligne)
* ALD n° 23 - Guide patient : la prise en charge d'un trouble bipolaire (accessible en ligne)
* ALD n° 23 - Actes et prestations sur les troubles bipolaires - Actualisation decembre 2017 (accessible en ligne)
* Les troubles bipolaires - Fondation Fondamental (accessible en ligne)
DOCUMENT doctissimo.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Maladie dAlzheimer : 75 facteurs de risques génétiques identifiés pour mieux comprendre la pathologie |
|
|
| |
|
| |

Maladie d’Alzheimer : 75 facteurs de risques génétiques identifiés pour mieux comprendre la pathologie
COMMUNIQUÉ | 04 AVRIL 2022 - 17H00 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE
Dans la maladie d’Alzheimer, deux phénomènes pathologiques cérébraux ont déjà bien été documentés : l’accumulation de peptides béta-amyloïdes et la modification de Tau, une protéine, qui se retrouve sous la forme d’agrégats dans les neurones. © NIH/domaine public
L’identification des facteurs de risques génétiques de la maladie d’Alzheimer est un enjeu de recherche crucial pour mieux comprendre la pathologie et mieux la traiter. Les progrès de l’analyse du génome humain, couplés à la mise en place de grandes études d’associations pangénomiques[1] permettent aujourd’hui des avancées importantes dans le domaine. Des chercheurs et chercheuses de l’Inserm, de l’Institut Pasteur de Lille, du CHU de Lille et de l’Université de Lille au sein du laboratoire U1167 « Facteurs de risque et déterminant moléculaires des maladies liées au vieillissement » – en collaboration avec des équipes européennes, américaines et australiennes – ont ainsi identifié 75 régions du génome associées à la maladie d’Alzheimer. Parmi elles, 42 sont nouvelles, n’ayant encore jamais été impliquées dans la maladie. Les résultats, publiés dans la revue Nature Genetics, renforcent nos connaissances des mécanismes biologiques impliqués dans la pathologie et permettent d’envisager de nouvelles pistes de traitement et de diagnostic.
La maladie d’Alzheimer est la plus fréquente des démences, touchant environ 1 200 000 personnes en France. Il s’agit d’une pathologie multifactorielle complexe, qui apparaît généralement après 65 ans et pour laquelle il existe une forte composante génétique. La majorité des cas serait causée par l’interaction de différents facteurs de prédispositions génétiques avec des facteurs environnementaux.
Si la maladie est de mieux en mieux comprise, il n’existe pour l’heure aucun traitement permettant de la guérir. Les médicaments disponibles visent surtout à freiner le déclin cognitif et à réduire certains troubles du comportement.
L’un des enjeux majeurs de la recherche est de mieux caractériser les facteurs de risque génétiques de la maladie, pour mieux comprendre ses origines en identifiant les processus physiopathologiques impliqués[2], et ainsi proposer de nouvelles cibles thérapeutiques.
Dans le cadre d’une collaboration internationale, des chercheurs et chercheuses de l’Inserm, de l’Institut Pasteur de Lille, du CHU de Lille et de l’Université de Lille ont mené une étude d’association pangénomique (en anglais genome-wide association study, GWAS) sur le plus grand groupe de patients Alzheimer mis en place jusqu’ici[3], sous la coordination du directeur de recherche Inserm Jean-Charles Lambert.
Favorisées par les progrès de l’analyse du génome, ces études consistent à analyser l’intégralité du génome de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers d’individus, sains ou malades, pour identifier des facteurs de risques génétiques associés à des traits spécifiques de la maladie.
Avec cette méthode, les scientifiques ont ici pu identifier 75 régions du génome (appelées locus), associées à Alzheimer, dont 42 n’avaient jusqu’ici pas été impliquées dans cette maladie. « Après cette découverte importante, la suite de notre travail a consisté à caractériser ces régions du génome que nous avions identifiées pour leur donner du sens par rapport à nos connaissances biologiques et cliniques, et donc mieux comprendre les mécanismes cellulaires et les processus pathologiques à l’œuvre », souligne Jean-Charles Lambert.
Mise en lumière des phénomènes pathologiques
Dans la maladie d’Alzheimer, deux phénomènes pathologiques cérébraux ont déjà bien été documentés : l’accumulation de peptides béta-amyloïdes et la modification de Tau, une protéine, qui se retrouve sous la forme d’agrégats dans les neurones.
Les scientifiques ont ici confirmé l’importance de ces processus pathologiques. En effet, leurs analyses des différentes régions du génome confirment que certaines sont impliquées dans la production des peptides amyloïdes et dans le fonctionnement de la protéine Tau.
Par ailleurs, ces analyses révèlent aussi qu’un dysfonctionnement de l’immunité innée et de l’action de la microglie (cellule immunitaire présente dans le système nerveux central qui joue un rôle « d’éboueur » en éliminant les substances toxiques) est à l’œuvre dans la maladie d’Alzheimer.
Enfin, cette étude montre pour la première fois l’implication dans la maladie de la voie de signalisation dépendante du facteur de nécrose tumorale alpha (TNF-alpha)[4].
Ces résultats permettent de confirmer et de renforcer nos connaissances des processus pathologiques impliqués dans la maladie, et d’ouvrir de nouvelles voies pour la recherche thérapeutique. Ils confirment par exemple l’intérêt de mener des essais cliniques sur des traitements ciblant la protéine précurseur de l’amyloïde, de poursuivre les travaux sur les cellules microgliales, initiés il y a quelques années mais aussi de cibler la voie de signalisation du TNF-alpha.
Score de risque
En s’appuyant sur leurs résultats, les chercheurs ont également construit un score de risque génétique qui permet de mieux évaluer qui, parmi les personnes souffrant de troubles cognitifs, évoluera vers une maladie d’Alzheimer, dans les trois ans après la mise en évidence clinique des troubles. « Cet outil n’est pour le moment pas du tout destiné à la pratique clinique, mais il pourrait être très utile dans la mise en place d’essais thérapeutiques pour catégoriser les participants selon leur risque et mieux évaluer l’intérêt des médicaments testés », explique Jean-Charles Lambert.
L’équipe souhaite désormais poursuivre ses travaux dans un groupe encore plus large pour valider et étendre leurs résultats. Au-delà de cette caractérisation exhaustive des facteurs génétiques de la maladie d’Alzheimer, l’équipe développe par ailleurs de nombreuses approches de biologies cellulaires et moléculaires pour déterminer leurs rôles dans le développement de la maladie.
Par ailleurs, les recherches génétiques ayant pour le moment principalement été menées sur des populations d’origines caucasiennes, l’un des enjeux à venir sera de pratiquer le même type d’études dans d’autres groupes pour déterminer si les facteurs de risque sont les mêmes d’une population à une autre, ce qui renforcerait leurs importances dans le processus physiopathologique.
[1] En anglais, on parle de genome-wide association study, GWAS. Ces études consistent à analyser l’intégralité du génome de milliers voire de dizaines de milliers d’individus, sains ou malades, pour identifier des facteurs de risques génétiques associés à des traits spécifiques de la maladie.
[2] L’ensemble des problèmes fonctionnels engendrés par une maladie ou une affection particulière.
[3] Les chercheurs se sont ici intéressés aux données génétiques de 111,326 personnes ayant reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer ou ayant des proches atteints par la maladie et 677,663 « contrôles » sains. Ces données sont issues de plusieurs grandes cohortes européennes regroupées au sein du consortium European Alzheimer & Dementia BioBank (EADB).
[4] Le facteur de nécrose tumorale alpha est une cytokine, protéine du système immunitaire impliquée dans la cascade de l’inflammation, en particulier dans les mécanismes lésionnels tissulaires.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
La consommation d'iode |
|
|
| |
|
| |
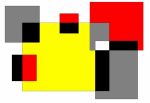
La consommation d'iode
Dans quels produits alimentaires peut-on trouver de l'iode et quels sont les besoins journaliers ? Les français consomment-ils suffisamment d'iode ? Comment se manifeste une carence en iode ? Quelles sont les conséquences d'une carence ou d'une surconsommation d'iode pour l'organisme ? Le point sur ces questions.
Publié le 3 octobre 2012
"Dans quels produits alimentaires peut-on trouver de l'iode et quels sont les besoins journaliers ?"
La plupart des aliments (viandes, légumes et fruits) sont pauvres en iode à l'exception des poissons et crustacés marins, consommés crus ou grillés. De plus le mode de cuisson et de conservation peut réduire la concentration en iode du produit consommé.
Dans les pays industrialisés, la principale source alimentaire est le lait, du fait de l'enrichissement des fourrages en iode, de l'utilisation de produits iodés antiseptiques dans la chaîne de traitement pour éviter les développements bactériens et de l'emploi de médicaments vétérinaires contenant de l'iode.
En 1952, dans le but de prévenir la déficience en iode, les pouvoirs publics français responsables de la santé ont opté pour l'utilisation de sel enrichi en iode. Le taux d'enrichissement est réglementé à 10-15 milligrammes (mg) d'iodure de sodium par kilo de sel ; il concerne exclusivement le sel à usage domestique, jusqu'à présent aucun apport d'iode n'était effectué au sel destiné aux collectivités ou à l'industrie agro-alimentaire. De plus le sel iodé ne représente que la moitié du sel domestique utilisé.
Une étude conduite en France (1999) révèle la persistance d’une légère déficience dans l’apport d’iode chez les adultes. L’apport quotidien en iode est évalué par la mesure de l’élimination urinaire, appelée iodurie. Un gradient est-ouest fait état d’ioduries plus faibles à l’est qu’à l’ouest. La valeur normale se situant à 10 µg/100 mL ; les variations mesurées sont comprises entre 6,7 et 8,6 µg/100 mL chez la femme, entre 7,4 et 9,6 µg/100 mL chez l’homme. © DR
L'apport journalier recommandé chez l'adulte se situe aux environs de 150 microgrammes (µg) par jour, les besoins sont accrus chez la femme enceinte, au cours de l'adolescence et pendant la période d'allaitement. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) préconise de respecter certaines valeurs (tableau).
Apports en iode stable recommandés par l'OMS
Age/statut physiologique particulier Apport quotidien (µg / jour)
0 à 12 mois 50
1 à 6 ans 90
7 à 12 ans 120
à partir de 12 ans 150
Grossesse 200
Allaitement 200
"Les Français consomment-ils suffisamment d'iode ?"
Une étude conduite en France (1999) révèle la persistance d'une légère déficience dans l'apport d'iode chez les adultes. L'apport quotidien en iode est évalué par la mesure de l'élimination urinaire, appelée iodurie. Un axe est-ouest fait état d'ioduries plus faibles à l'est qu'à l'ouest.
La valeur normale se situant à 10 µg/100 mL ; les variations mesurées sont comprises entre 6,7 et 8,6 µg/100 mL chez la femme, entre 7,4 et 9,6 µg/100 mL chez l'homme. L'origine de ces variations n'est pas complètement connue, mais les contributions du sol de la région et du contenu de l'eau en iode pourraient jouer un rôle, ainsi que des variations dans les habitudes alimentaires.
"Comment se manifeste une carence en iode ?"
En bref
Les nodules sont plus fréquents chez les femmes et leur fréquence augmente avec l'âge.
La carence chronique en iode se traduit par une augmentation de volume de la thyroïde, formant alors un goitre. L'apparition d'un goitre, parfois volumineux et visible extérieurement, ou de nodules, est un signe clinique des troubles dus à une déficience iodée. La taille de la thyroïde et la présence de nodules peuvent être analysées par la palpation du corps thyroïde et, depuis une vingtaine d'années, par l'échographie qui détecte aussi des nodules trop petits pour être repérés par l'examen clinique.
Qu'il y ait ou non déficit en iode, les nodules sont plus fréquents chez les femmes et leur fréquence augmente avec l'âge. Ainsi, on constate que plus d'une femme sur quatre a un ou plusieurs nodules thyroïdiens après 40 ans, plus de 90 % de ses nodules thyroïdiens étant bénins. La plupart des hypertrophies thyroïdiennes n'entraînent pas de symptôme. Elles peuvent, dans de rares cas, par compression des structures du cou, provoquer des difficultés à avaler ou respirer ou des changements dans la voix.
"Quelles sont les conséquences d'une carence ou d'une surconsommation d'iode pour l'organisme ?"
A savoir
Il n'existe pas à l'état naturel de surcharge en iode mais, au contraire, des carences, notamment dans de nombreuses régions du monde où l'apport naturel en iode est trop faible comme au Népal.
Tout d'abord, il n'existe pas à l'état naturel de surcharge en iode (toutefois des apports élevés peuvent exister au Japon) mais, au contraire, des carences, notamment dans de nombreuses régions du monde où l'apport naturel en iode est trop faible (ex. Népal, Amérique du Sud, Haut Atlas, …).
Les carences chroniques en iode sont responsables de troubles du métabolisme. Ces troubles sont d'autant plus marqués que la carence est importante et qu'il s'agit d'un sujet jeune. Le fœtus, le nouveau-né et l'enfant sont donc tout particulièrement sensibles aux carences en iode. Ainsi un abaissement du taux d'hormones thyroïdiennes chez la mère peut provoquer chez le fœtus des anomalies du développement physique et intellectuel, (retard mental, diminution du poids de naissance) et augmenter les risques de mortalité périnatale. C'est l'historique "crétinisme des Alpes", souvent observé par le passé, et attribué à une carence en iode dans l'alimentation.
Chez l'adulte, le déficit profond en iode peut également se traduire par un ralentissement intellectuel qui lui est réversible.
DOCUMENT cea LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Les neurosciences apportent de nouvelles pistes pour comprendre lorigine de nos émotions |
|
|
| |
|
| |

Les neurosciences apportent de nouvelles pistes pour comprendre l’origine de nos émotions
COMMUNIQUÉ | 01 DÉC. 2020 - 10H00 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE
On a longtemps considéré les émotions comme des expériences biologiques innées et universelles, bien distinctes les unes des autres. © Adobe Stock
Nos émotions sont-elles innées ou bien sont-elles le produit de notre culture et de notre environnement ? Cette question fait depuis longtemps l’objet de débats dans le domaine des neurosciences. Des chercheurs de l’Inserm, de l’Université de Caen Normandie, de l’École Pratique des Hautes Études et des CHU de Caen et de Rennes apportent des données cliniques robustes en faveur de la seconde hypothèse. Leurs travaux suggèrent que notre capacité à connaître et à reconnaître les émotions se construit progressivement et dépend de notre connaissance du langage. Leurs résultats sont publiés dans le journal Brain.
Tout au long de l’histoire des neurosciences, la question de l’origine des émotions n’a cessé d’intriguer les scientifiques. S’appuyant sur les théories de Charles Darwin, ceux-ci ont longtemps considéré les états émotionnels comme des expériences biologiques innées et universelles, bien distinctes les unes des autres.
Face au constat que les émotions ne sont pourtant pas définies de la même manière dans toutes les cultures, et que les frontières entre les catégories (joie, tristesse, colère…) ne sont pas les mêmes à travers le monde, cette perspective n’a cependant cessé d’évoluer. Une hypothèse dite « constructionniste » des émotions s’est ainsi développée au cours des dernières décennies, postulant que les émotions ne sont pas innées. Il s’agirait plutôt de concepts appris dans l’enfance et associés à nos sensations physiques.
Ces concepts s’enrichiraient tout au long de la vie, en fonction de nos expériences et de notre environnement. Des données robustes, issues de l’imagerie cérébrale et de la pratique clinique, manquaient toutefois pour confirmer cette théorie.
Pour départager les deux courants de pensée, le chercheur Inserm Maxime Bertoux et l’équipe du laboratoire « Neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine » (Inserm/Université de Caen Normandie/École pratique des hautes études) associés aux CHU de Caen et de Rennes et au GIP Cyceron se sont intéressés à 16 patients atteints d’une maladie neurodégénérative rare, la « démence sémantique ».
Celle-ci se caractérise par une dégradation de la mémoire conceptuelle, c’est-à-dire par une perte des connaissances que l’on a sur le monde et sur le langage. « Les patients ont des difficultés à mobiliser ce qu’ils ont appris tout au long de la vie, par exemple à se rappeler que Paris est la capitale de la France. Ils ont aussi une incapacité à identifier les objets du quotidien et à se rappeler leur fonctionnement ou leur utilité, ou encore à comprendre le sens des mots. Cependant, la dégradation des connaissances conceptuelles associée à cette maladie ne devrait pas avoir d’impact sur la capacité des patients à connaître et à reconnaître les émotions, si celles-ci sont réellement innées », explique Maxime Bertoux.
Réseau cérébral identifié
Les participants ont été testés sur leurs connaissances conceptuelles de quatre émotions : la colère, la fierté, la surprise et l’embarras. Dans un premier temps, ils étaient invités à donner un synonyme de chacune de ces émotions puis à choisir un autre mot s’en approchant au sein d’une liste. Ils devaient ensuite donner un exemple de contexte dans lequel cette émotion pouvait être ressentie puis, parmi une liste de situations, choisir celle qui était la plus susceptible de provoquer l’état émotionnel en question. Dans un second temps, les participants ont regardé des photos et des vidéos d’acteurs qui exprimaient des émotions. Ils devaient alors reconnaître celle qui était représentée.
Comparée à des participants sains, la mémoire conceptuelle des émotions était plus dégradée chez les participants souffrant de démence sémantique. En moyenne, ces patients étaient par exemple moins capables de donner ou de choisir le synonyme correct d’une émotion particulière mais aussi de sélectionner le contexte approprié dans lequel on peut s’attendre à la ressentir. Ils avaient également une plus grande difficulté à reconnaître les états émotionnels exprimés par d’autres individus, que ceux-ci soient positifs ou négatifs, présentés en photographie ou en vidéo.
En s’appuyant sur ces résultats, les chercheurs mettent à jour une corrélation étroite entre la perte de mémoire des connaissances conceptuelles et la difficulté à reconnaître les émotions et leur caractère positif ou négatif.
Les chercheurs ont aussi eu recours à des techniques d’imagerie cérébrale afin d’identifier les réseaux cérébraux mobilisés lors de la réalisation de ces différents exercices. Leurs résultats suggèrent qu’un même réseau est à l’œuvre à la fois lors des tâches de reconnaissance des émotions faciales et des tâches de mobilisation des connaissances conceptuelles sur les émotions.
« Notre étude souligne l’intrication forte de processus neurocognitifs « affectifs », liés à la reconnaissance des émotions, et « conceptuels » qui étaient supposément distincts. Nous montrons que nos connaissances conceptuelles et notre connaissance du langage ont un rôle déterminant dans la manière dont nous percevons les émotions. Cela nous permet d’apporter de nouveaux éléments pour confirmer la théorie constructionniste des émotions : nous construirions culturellement nos émotions depuis l’enfance », souligne Maxime Bertoux.
Ces travaux présentent aussi un intérêt dans le domaine clinique. En effet, de nombreuses maladies psychiatriques et neurodégénératives entraînent des perturbations émotionnelles.
« Notre étude soutient l’intérêt des approches cognitives, comportementales et émotionnelles dans les maladies mentales ou les neuroatypies. Reconnaître une émotion chez les autres mais aussi réguler nos propres émotions dépendent de notre capacité à avoir appris à les nommer et à les distinguer sur le plan conceptuel », conclut Maxime Bertoux.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
