|
| |
|
|
 |
|
La metformine améliore la motricité de patients atteints de dystrophie myotonique de Steinert, la maladie neuromusculaire la plus fréquente de ladult |
|
|
| |
|
| |

La metformine améliore la motricité de patients atteints de dystrophie myotonique de Steinert, la maladie neuromusculaire la plus fréquente de l’adulte
COMMUNIQUÉ | 30 AOÛT 2018 - 11H42 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE
myotonique. Crédits: Inserm/IGBMC
Des chercheurs Inserm au sein d’I-Stem, l’Institut des cellules souches pour le traitement et l’étude des maladies monogéniques, annoncent des résultats encourageants de la metformine, un antidiabétique connu, pour le traitement symptomatique de la dystrophie myotonique de Steinert. En effet, un essai de phase II réalisé chez 40 malades, à l’hôpital Henri-Mondor AP-HP, montre que, après 48 semaines de traitement à la plus forte dose, les patients traités avec la metformine (contre placebo) gagnent en motricité et retrouvent une démarche plus stable. Les résultats de cet essai, financé à hauteur d’1,5 million d’euros par l’AFM-Téléthon, sont publiés ce jour dans la revue Brain.
La dystrophie myotonique de Steinert (DM1) est la plus fréquente des dystrophies musculaires de l’adulte. D’origine génétique, sa prévalence est estimée à 1/8.000, soit environ 7 à 8000 malades en France. Elle affecte les muscles, qui s’affaiblissent (dystrophie) et ont du mal à se relâcher après contraction (myotonie) ce qui désorganise les mouvements (marche instable par exemple). Elle atteint également d’autres organes (cœur et appareil respiratoire, appareil digestif, système endocrinien et système nerveux). A ce jour, cette dystrophie musculaire ne bénéficie d’aucun traitement curatif.
Les résultats publiés dans Brain sont le fruit d’une recherche menée depuis plusieurs années au sein d’I-Stem. En effet, grâce au développement de modèles cellulaires à partir de cellules souches pluripotentes, l’équipe de Cécile Martinat a, en 2011, identifié des mécanismes nouveaux à l’origine de la dystrophie myotonique de Steinert (Cell Stem Cell – 31 mars 2011). En 2015, Sandrine Baghdoyan, ingénieure de recherche à I-Stem, parvient à corriger certains défauts d’épissage dans des cellules souches embryonnaires et dans des myoblastes provenant de personnes atteintes de DM1 grâce à la metformine, une molécule anti-diabétique bien connue et identifiée comme efficace dans cette nouvelle indication grâce au criblage à haut-débit.(Mol.Therapy – 3 nov 2015).
Forts de ces résultats, I-Stem a lancé un essai clinique monocentrique de phase II, en double aveugle, randomisé contrôlé, chez 40 patients, en collaboration avec des équipes de l’Hôpital Henri Mondor AP-HP, celle du Dr Guillaume Bassez du centre de référence maladies neuromusculaires Ile-de-France, et celle du Centre d’Investigation Clinique coordonné par le Pr Philippe Le Corvoisier. Dans cette étude contre placebo, la metformine a été administrée trois fois par jour, par voie orale, avec une période d’augmentation de la dose sur 4 semaines (jusqu’à 3 g/jour), suivie de 48 semaines à la dose maximale.
L’évaluation de l’efficacité du traitement était notamment fondée sur le test de « 6 minutes de marche ». A la fin de l’étude, soit après un an de traitement, les patients ayant reçu la metformine gagnent une distance moyenne de marche de près de 33 mètres sur les performances initiales alors que le groupe ayant reçu le placebo reste stable (gain moyen de 3 mètres).
Cette motricité, analysée finement grâce à l’outil Locometryx développé par le laboratoire de physiologie et d’évaluation neuromusculaire de Jean-Yves Hogrel à l’Institut de Myologie au sein de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP, est étroitement liée au fait que la metformine améliore la posture globale des patients qui, de fait, passent d’une marche instable « élargie », avant traitement, à une démarche droite, plus rapide et donc plus performante ».
Ces résultats démontrent, pour la première fois, l’efficacité d’un traitement pharmacologique sur la motricité dans la dystrophie myotonique de Steinert et, à notre connaissance, l’efficacité thérapeutique d’une molécule identifiée sur la base de la modélisation d’une pathologie avec des cellules souches pluripotentes.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
L'IMPACT DES NEUROSCIENCES SUR LES THÉRAPIES |
|
|
| |
|
| |

L'IMPACT DES NEUROSCIENCES SUR LES THÉRAPIES
Les neurosciences sont à l'origine de beaucoup d'espoirs et de fantasmes. Grâce à quelques exemples on peut démythifier ce qui est présenté dans les journaux, ce que tout le monde pense, les attentes des patients…Une vision plus réaliste sera présentée grâce à une connaissance du système nerveux, des ses troubles, de quelques modes exploratoires ainsi que des possibilités de traitements.
VIDEO CANAL U LIEN
Transcription de la 526 e conférence de l'Université de tous les savoirs donnée le 23 janvier 2004
Yves Agid « L'impact des neurosciences sur les thérapies »
L'Europe comporte 400 millions d'individus, dont 17 % ont plus de 65 ans, et représente la population la plus touchée par les maladies neurodégénératives, telles que les maladies de Parkinson ou d'Alzheimer. Il existe beaucoup d'autres pathologies neurologiques, telles que les accidents vasculaires cérébraux (AVC), l'épilepsie ou la sclérose en plaque. Ces maladies posent des problèmes de santé publique, mais aussi des problèmes socio-économiques. La maladie d'Alzheimer, qui concerne cinq millions de personnes en Europe, entraîne une dépendance totale trois à cinq ans après le début de la maladie et un coût d'environ 80 milliards d'euros par an. Au total, ces maladies neurologiques sont fréquentes, et coûtent plus de 300 milliards d'euros par an à la communauté européenne, ce qui peut paraître énorme, mais qui représente cependant moins que le coût des problèmes psychiatriques. Des dizaines de millions de personnes endurent des dépressions, des angoisses, 4 millions souffrent de psychoses (schizophrénie, délires,...). Les traumatisés de la route représentent quant à eux 1,7 million de nouveaux patients chaque année en Europe. Que peut faire la médecine pour soulager tous ces patients sur le plan neurologique ?
La première chose que le médecin apporte à son patient tient à la relation particulière qu'ils entretiennent ensemble. Tout bon médecin est un psychothérapeute qui s'ignore. Si la psychiatrie, la psychologie ou la neuropsychologie, sont des sciences très importantes dans la vie courante, elles le sont encore plus en médecine. Il y a d'ailleurs une analogie entre la psychothérapie et l'effet placebo (du latin je plairai). Cet effet existe dans tout médicament. Le placebo est une substance inerte administrée pour son effet psychologique. Il n'a, de manière remarquable, d'effet que lorsque le patient et le médecin ont une confiance parfaite dans son action. On dit que 40 % des médicaments prescrits dans en France sont d'ailleurs des placebo. Une expérience très classique illustre cet effet. Des étudiants en médecine reçoivent un comprimé parmi deux, l'un présenté comme sédatif et l'autre comme stimulant, mais ne contenant en réalité qu'une substance inactive. Plus des deux tiers des étudiants ayant reçu le « sédatif » ont déclaré avoir sommeil, et ceux ayant pris deux comprimés avaient plus envie de dormir que ceux qui n'en avaient pris qu'un. Un tiers de l'ensemble du groupe a signalé des effets secondaires, tels des maux de têtes, un picotement des extrémités, ou une démarche titubante. Trois étudiants seulement sur 56 n'ont ressenti aucun effet ! Cela prouve que l'acte médical, le fait de donner un médicament, n'a de sens que dans un contexte médecin/malade, ce que les médecins, parfois débordés, mais aussi les patients, ont tendance à oublier. Une relation médecin/patient de qualité est une chose absolument fondamentale.
Il y a encore une trentaine d'années, le cerveau était vu comme une boite noire, dans laquelle personne ne pouvait ni ne voulait regarder. Nous verrons que le cerveau est en effet une structure extraordinairement complexe. On commence cependant aujourd'hui à comprendre ce qui se passe dans un cerveau, normal ou anormal. Cette connaissance pourrait nous permettre d'agir de manière sélective sur les dysfonctionnements du cerveau malade.
Le cerveau humain pèse en moyenne 1350 g (celui de Lord Byron pesait 2,3 kg, et celui d'Anatole France, supposément le plus grand QI ayant jamais existé avec Voltaire, 900 g). Le cerveau est formé de deux hémisphères, chacun divisé par convention en quatre lobes, qui tirent leur nom des os du crâne qu'ils recouvrent : les lobes frontal, pariétal, temporal et occipital. Le cerveau humain est constitué de 100 milliards de cellules nerveuses. Chaque neurone présente des branches (des axones et des dendrites) qui ont chacune à leur extrémité des petites spicules sur laquelle sont établis en moyenne 10 000 contacts avec les cellules voisines. Le cerveau est donc un véritable réticulum. Chaque cellule nerveuse émet environ 1000 signaux par seconde. Par conséquent 1018 signaux sont véhiculés dans le cerveau chaque seconde, soit un milliard de milliard de signaux ! Vu de l'intérieur, le cerveau se présente comme une couche de cellules périphériques (le cortex cérébral) d'où des faisceaux de cellules nerveuses envoient des prolongements (projettent) vers les structures profondes du cerveau, que l'on appelle les noyaux gris centraux, ou les ganglions de la base. Différentes zones fonctionnelles ont été identifiées dans le cerveau : celle qui permet d'accomplir un acte moteur, la partie associative qui sous tend la fonction intellectuelle et le cortex dit limbique, qui contrôle les émotions. Chaque zone projette de manière spécifique vers la zone correspondante dans les structures profondes. Ces régions ne sont cependant pas cloisonnées : comment expliquer une fonction aussi extraordinaire que l'émotion déclenchée en voyant un tableau de Botticelli ?
Une cellule nerveuse peut mesurer un mètre de long : c'est le cas de cellules dont le noyau se trouvent dans la moelle, et l'extrémité de l'axone dans un orteil par exemple. Dans le cerveau, un neurone se trouvant dans une structure et projetant dans une autre émet aussi au cours de son trajet d'autres prolongements vers d'autres structures. Ce n'est pas un vecteur qui transmet une seule information à une cible unique : il reçoit des milliers d'afférences, et distribue son information électrique à une multitude d'endroits différents. L'arborescence des prolongements des neurones est d'une grande complexité, et les lois qui régissent l'établissement de ces réseaux ne sont pas encore parfaitement comprises. Les extrémités des prolongements des neurones contactent d'autres cellules nerveuses et présentent un métabolisme cellulaire extrêmement compliqué : des milliers ou dizaines de milliers de voies de transduction de signaux différentes, des récepteurs par milliers modulé par des neuromédiateurs. La vision que nous avons de ces mécanismes n'est encore que fragmentaire.
Il réside donc un hiatus entre la connaissance que nous avons du cerveau dans son ensemble et au niveau cellulaire alors que tout est relié physiologiquement. Si on veut imaginer des traitements futurs pour le malade, il faut comprendre comment il fonctionne, c'est à dire quelles sont les lois physiologiques qui vont permettre à l'information d'être émise et reçue. Comment des paroles, lorsqu'elles arrivent au cerveau, sont-elles intégrées, mémorisées, et provoquent-elles une réponse, que nous en ayons conscience ou non ? Les bases cellulaires de la mémoire, du langage et du subconscient commencent à être décortiquées et nous allons notamment voir des exemples illustrant notre compréhension de mécanismes contrôlant des phénomènes d'une part moteurs et d'autre part psychologiques.
Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque l'on bouge le pouce ? Il faut avoir l'idée de le faire, sélectionner le programme moteur (qui implique en fait tous les muscles de l'organisme car lorsque le bras est levé, le corps entier est mobilisé, ce qui est fait de manière subconsciente), le préparer à partir et exécuter le mouvement. C'est donc un problème sensori-moteur très cognitif. La neuro-imagerie, notamment l'IRM, permet de commencer à élucider ces étapes, en repérant les zones activées par une action. Les ganglions de la base s'allument ainsi lors de la préparation du mouvement. Lors de l'exécution, d'autres zones sont activées, et les ganglions de la base s'éteignent. Tout se passe très rapidement : 30 ms sont nécessaires pour qu'un signal aille de la moelle au pouce. Même si les échelles de temps sont beaucoup plus grandes que dans le domaine informatique (0,0003 ms pour la transmission d'un signal), l'homme parle et pense très vite.
Si un mouvement comme celui-ci est contrôlé, il peut aussi arriver que des pathologies entraînent des mouvements involontaires : les dyskinésies. Si tous les circuits qui permettent de réaliser ce mouvement sont connus, il doit être possible d'agir sur l'étape qui fonctionne mal. Dans certains cas les médicaments peuvent supprimer des symptômes, mais un médicament prescrit pour une petite défaillance à un endroit donné du cerveau diffuse dans tout le cerveau, ce qui provoque des effets secondaires. Un patient atteint de la maladie de Parkinson est gêné dans ses déplacements, il est très lent. Lorsqu'il est traité par de la dopamine, l'absence de mouvement fait place à la frénésie, l'hyperkinésie. Pour éviter ces complications, il est aussi possible d'aller directement à l'endroit défectueux. Pour ce faire, des électrodes stimulantes reliées à une pile, un pacemaker placé sous la clavicule, sont implantées dans une structure très profonde du cerveau, large de quelques millimètres (le noyau subthalamique). Le traitement de malades de Parkinson par cette technique pointue leur a permis de retrouver des mouvements normaux. Malheureusement cette technique ne permet de soulager que 5 % des cas de maladie de Parkinson, mais elle représente un énorme progrès scientifique : grâce à la connaissance parfaite de la physiopathologie, c'est-à-dire des bases neuronales des circuits altérés, et de ce pourquoi ils sont non fonctionnels, la vie de patients a été transformée.
La connaissance avance aussi dans le domaine du traitement par le cerveau des mécanismes émotionnels, notamment grâce à l'étude de patients présentant des pathologies atypiques. Prenons l'exemple d'un homme de 45 ans, opéré à deux reprises pour une grosse tumeur du cerveau. Quelques temps après l'opération, ce patient a commencé à collectionner les télévisions dans sa cave, sa chambre, sa salle de bain et jusque dans les tuyaux d'aération de son appartement. Cet homme était pourtant normal, malgré une légère apathie : son QI était tout à fait usuel et il vivait en famille. L'IRM a en fait montré une lésion très limitée des deux cotés du cortex limbique, dans une zone jouxtant l'ancienne place de la tumeur, expliquant ainsi ses troubles psychiques. Il existe des malades psychiatriques qui ont des lésions organiques du cerveau.
Ces cinq dernières années de nombreuses études non pathologiques ont été menées. Des patients sains sont placés dans des situations provoquant une émotion simple, et une IRM est réalisée pour observer les zones du cerveau qui s'activent. Lors d'une expérience, les témoins sont confrontés à deux photos d'une personne attrayante, la seule différence entre les deux images étant le fait que le sujet de l'image semble regarder le témoin ou non. Cela provoque donc une émotion élémentaire. Les régions du cerveau allumées dans le premier et le second cas sont soustraites. La seule zone activée uniquement dans le second cas est une petite structure se trouvant avec d'autres à la base du cerveau, l'ensemble contrôlant les émotions : le striatum ventral. Ces structures existent aussi chez les reptiles, et jouent un rôle dans les activités automatiques motrices, psychiques, et intellectuelles. De la même manière qu'il existe des structures nous permettant d'avoir une activité motrice inconsciente (on peut parler tout en conduisant), nous avons un inconscient psychique. Il est intéressant de noter que ces structures très anciennes s'activent pour une émotion aussi subtile.
De la même façon, des expériences ont été menées sur des singes avec une électrode implantée dans une unique cellule du cortex préfrontal. Ces singes apprennent à réaliser une action pour recevoir une récompense. L'enregistrement du neurone permet d'évaluer si ce neurone est actif ou non. Si la tâche est complexifiée et oblige le singe à effectuer un raisonnement abstrait, cette cellule nerveuse s'active de manière spécifique. Ce neurone encode donc des règles abstraites. La compréhension du cerveau dans ses grandes fonctions commence aussi à se faire à l'échelle cellulaire.
Une cartographie assez précise des circuits de cellules nerveuses activés et des fonctions aussi complexes que ce que l'on vient de décrire peut ainsi être réalisée. C'est très simplificateur dans la mesure où l'allumage de ces structures ne signifie pas forcément qu'elles sont un centre intégrateur.
Les malades présentant des désordres psychologiques dramatiques sont pour le moment traités avec des médicaments (anti-dépresseurs, anxiolytiques, neuroleptiques) mais cela représente une véritable camisole chimique. Chez des patients présentant un dysfonctionnement de l'attraction ou de la récompense (comme chez les toxicomanes, les pédophiles), on peut imaginer repérer les circuits de cellules participant à ces grandes fonctions intellectuelles et ici émotionnelles, affectives, pour trouver un médicament avec une action très sélective sur le circuit cérébral défectueux. Sans revenir au désastre de la psychochirurgie, on pourrait transposer ce qui a été fait sur les malades de Parkinson, c'est-à-dire l'utilisation d'une technique réversible, qui ne donne pas d'effet secondaire et qui est adaptable. Le développement d'une neurochirurgie du comportement, qui est actuellement du domaine de la recherche, peut se concevoir, dans des cas d'extrêmes sévérités et dans des conditions éthiques et juridiques réglementées. Il pourrait être possible par exemple de modifier de manière sélective des circuits de neurones pour soulager les patients.
Quelles disciplines sont mises en Suvre pour soulager les patients ? La neurophysiologie permet de comprendre le fonctionnement ou le dysfonctionnement des réseaux nerveux. Des préparations in vitro, des tranches de cerveau contenant quelques millions de neurones constituent des modèles simplificateurs. Des techniques très performantes sont mises en Suvre pour comprendre, par exemple, le phénomène épileptique et trouver des médicaments. Il faut cependant tenir compte du fait que les réseaux de neurones ne sont pas rigides comme un câblage informatique, mais peuvent se reconfigurer. Ce sont des assemblages plastiques, où les cellules repoussent et établissent de nouveaux contacts, contrairement à ce que l'on croyait dans le temps. Chaque cellule a de plus une mémoire personnelle. Il faut tirer profit de toutes ces propriétés pour essayer de soulager les malades avec des thérapeutiques adaptées pour chacune des cellules. D'autres disciplines telles que les neurosciences cognitives, la robotisation, l'informatique, la modélisation, la psychologie, l'anthropologie, la sociologie, la neuropsychologie et bien d'autres ont énormément à apporter au patient, et c'est un drame qu'existe un tel hiatus entre la faculté des lettres et celle des sciences. Des programmes de recherche en commun sont nécessaires. Les neurosciences cognitives tirent profit de l'avantage de l'homme par rapport aux modèles cellulaires ou animaux, du fait qu'il peut s'exprimer, ce qui procure des informations précieuses sur le vécu des individus et leur souffrance. La neuro-imagerie permet en outre de mesurer le volume du cerveau de certaines structures, leur fonction, d'étudier leur anatomie, voire leur chimie par spectro-IRM. La sémiologie (l'étude des signes cliniques de la maladie) est une science moins connue, mais apporte énormément, et permet de faire des diagnostics et de trouver des thérapeutiques originales.
Nous venons de montrer comment progresse notre compréhension du fonctionnement du cerveau à l'échelle des comportements, de son organisation et de son anatomie. Dans quelle mesure cela permet-il de trouver des médicaments ou des thérapies pour soulager les symptômes des malades, guérir, prévenir ou réparer ?
A l'heure actuelle, des vaccins, préviennent certaines maladies mais pas celles du cerveau. Les seuls outils disponibles pour guérir les maladies sont les antibiotiques. En outre, la chirurgie permet de réparer les fractures, et de retirer les tumeurs. Néanmoins, la médecine actuelle ne sait arrêter l'évolution ni du diabète, ni de l'arthérosclérose, ni d'aucune maladie neurodégénérative, même s'il est possible de soulager certains symptômes.
La neurodégenérescence est le résultat de deux phénomènes : une mort cellulaire d'une part sélective (des neurones dopaminergiques dans le cas de la maladie de Parkinson) et d'autre part lente, mais plus rapide que le viellissement normal d'une cellule. Une cellule peut mourir de deux manières : quand un tissu est brûlé, ou quand un abcès se forme, les cellules qui le composent meurent par nécrose, mais, dans les cas naturels, la cellule se suicide pour mourir, elle entre en apoptose. La plupart de nos neurones vivent toute notre vie, les cellules nerveuses ne meurent que très peu. Cependant leurs capacités diminuent. Dans la substance noire des patients atteints de Parkinson se trouvent trois types de neurones : des neurones sains vieillissants, quelques neurones en apoptose qui meurent en quelques jours et surtout des neurones malades, en état d'affaiblissement pathologique, qui meurent en quelques mois. En tant que pharmacologue, quel mécanisme analyser pour combattre pour arrêter l'évolution de la maladie ? Le vieillissement normal, l'apoptose, la mort pathologique ? Un grand nombre d'équipes travaillent sur l'apoptose, qui ne concerne pourtant qu'une petite partie de la mort cellulaire dans cette maladie.
La biologie moléculaire à notre disposition permet d'identifier et de comprendre le rôle des gènes qui codent les protéines, à la base de la vie cellulaire, et de leurs mutations. L'avancement actuel des connaissances montre cependant que le même gène peut être responsable de différentes maladies, et une même pathologie peut être causée par différents gènes. Il existe par exemple une maladie génétique dominante pour laquelle plus de quarante gènes ont été mis en cause. Il a été identifié une protéine (une ligase du protéasome) impliquée dans la nécessaire dégradation des protéines de la cellule qui est absente dans l'une des multiples formes de la maladie Parkinson. Néanmoins cette découverte ne permet pas de prévoir dans quel délai il sera possible de guérir la maladie. La compréhension d'une mutation et l'identification de la protéine anormale permettent d'attaquer la maladie sur un point précis mais chaque protéine a de multiples partenaires, ce qui rend la recherche encore plus difficile.
La biologie cellulaire envisage de modifier de manière spécifique le comportement de certaines cellules. Cependant les cellules malades ne représentent qu'une fraction de l'ensemble de l'organisme, et il est difficile de trouver des animaux mimant exactement les pathologies. Dans le cas de la maladie de Parkinson, les patients sont par exemple traités avec de la dopamine, ce qui permet de rétablir la transmission dopaminergique des cellules atteintes. D'autres médicaments comme les anxiolytiques ou les neuroleptiques modifient de manière connue le fonctionnement de certains neurones assez spécifiquement. Des thérapies utilisant des facteurs trophiques sont à l'étude. Ces substances produites naturellement au cours du développement du système nerveux favorisent la repousse neuronale.
La thérapie génique a pour objectif de travailler directement au niveau des gènes. L'idée est de remplacer le gène défectueux, in ou ex vivo. Dans le premier cas, l'objectif est de greffer le gène normal sur un vecteur particulier introduit dans le cerveau pour que l'échange de gènes se produise. Dans le second cas, il s'agit de modifier des cellules en culture et de les greffer par la suite. La thérapie cellulaire est envisagée de la même manière, dans l'optique de greffer de nouvelles cellules. L'ARN interférent a pour but d'agir sur l'intermédiaire entre le gène et la protéine
Ces concepts sont très intéressants sur le plan théorique, mais le cerveau est contrairement à beaucoup d'autres organes composé de tant de cellules différentes, dont on connaît mal les interactions, qu'il est chimérique de vouloir passer trop vite de la boite de Petri à l'homme.
La recherche scientifique doit concilier beaucoup d'impératifs à commencer par assurer une synergie entre des recherches cognitives et appliquées. La société a besoin, entre autre, de recherche finalisée, et il faut en même temps assurer la liberté de créer et la rentabilité industrielle. C'est le défi de l'interaction entre recherche fondamentale et recherche clinique. La recherche en neurosciences pose en outre des problèmes particuliers. Toutes ces études sont chères, et cela soulève des questions morales à l'échelle mondiale lorsque l'on sait que la tuberculose, le paludisme et le sida tuent par millions dans les pays en voie de développement. Dans les pays développés, les associations contre les maladies rares sont très puissantes, et trouvent beaucoup d'argent sur des sujets très spécifiques. Ainsi le budget de fonctionnement du Téléthon est supérieur à celui de l'INSERM ! Pour finir, la recherche sur le cerveau pose naturellement des problèmes éthiques considérables. |
| |
|
| |
|
 |
|
Comment détecte-t-on le danger ? |
|
|
| |
|
| |

Comment détecte-t-on le danger ?
| 23 MARS 2018 - 11H16 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE
Les êtres vivants sont capables d’intégrer et d’identifier les informations sensorielles pertinentes telles que les odeurs, les sons ou la lumière afin de réguler leurs réponses comportementales en présence d’un danger potentiel. C’est ce qu’on appelle la discrimination contextuelle. Des chercheurs de l’Inserm basés au Neurocentre Magendie de Bordeaux, viennent de découvrir quels sont les neurones impliqués dans ce phénomène et où ils se situent. Une bonne nouvelle pour les personnes souffrant de stress post traumatique chez qui cette discrimination contextuelle est déréglée. Ces travaux sont publiés dans la revue Neuron
Vivre des expériences traumatisantes comme une catastrophe naturelle, une attaque terroriste, ou un combat militaire, sont des événements qui peuvent mener au développement de troubles psychiatriques, comme l’état de stress post-traumatique (PTSD). Quand ces personnes se trouvent confrontées à un environnement semblable à celui dans lequel l’évènement traumatisant est arrivé, elles revivent avec la même intensité les stress du trauma original. Chez ces patients, les troubles anxieux sont associés à une généralisation contextuelle. Ils sont effectivement devenus incapables d’intégrer et d’identifier les informations sensorielles pertinentes issues de leurs cinq sens- captées dans l’environnement- afin de réguler les réponses comportementales. Les circuits neuronaux impliqués dans ce phénomène sont inconnus.
Une équipe de chercheurs dirigée par le Dr. Cyril Herry vient d’identifier pour la première fois chez la souris une population de neurones impliqués dans la discrimination contextuelle. Ces neurones sont situés dans le cortex préfrontal médial.
Pour ce faire, les chercheurs ont utilisé notamment des approches optogénétiques (voir encadré) qui permettent d’activer ou d’inhiber l’activité de populations de neurones afin de déterminer leur implication dans un comportement particulier. Afin d’évaluer les circuits neuronaux jouant un rôle dans la discrimination contextuelle, les chercheurs ont exposé des souris à un contexte composé de différents éléments sensoriels (lumière, odeur, son) dans lequel elles ont reçu un ou plusieurs chocs électriques légers afin de rendre ce contexte aversif.
Dans une deuxième étape, les souris étaient exposées au même contexte mais sans les éléments sensoriels pertinents (odeur, son, lumière) leur faisant croire à un contexte non aversif. Grâce à des enregistrements en temps réel de l’activité des neurones du cortex préfrontal médian et leur manipulation optogénétique, les chercheurs ont pu identifier une population de neurones spécifiquement activée pendant la discrimination contextuelle.
Ces travaux démontrent que l’activité neuronale dans cette zone particulière du cerveau, qu’est le cortex préfrontal médian, est un élément clé de la discrimination contextuelle. Les chercheurs ont en outre démontré que ce groupe de neurones projette spécifiquement sur le tronc cérébral, une zone du cerveau directement impliquée dans la régulation motrice des comportements émotionnels.
” Ces travaux qui améliorent notre compréhension de l’activité neuronale menant à la discrimination contextuelle pourrait contribuer au développement de traitements et de thérapies pour les personnes souffrant de troubles anxieux” estime le Dr. Cyril Herry, directeur de recherche à l’Inserm et investigateur de ce travail.”
L’optogénétique consiste à introduire dans les neurones des protéines photosensibles naturelles, comme la channelrhodopsine, extraite d’une algue qui est une protéine sensible à la lumière bleue ou l’archaerhodopsine sensible à la lumière verte ou jaune. Lorsque la lumière bleue est introduite dans le cerveau de la souris par une fibre optique, l’activation de la channelrhodopsine génère un courant dépolarisant : cela revient à activer les neurones. En revanche, si l’archaerhodopsine est activée par une lumière verte ou jaune, cela génère un courant hyperpolarisant et les neurones sont inhibés. Ces protéines photosensibles exprimées au niveau de la membrane neuronale sont donc capables d’activer ou d’inhiber l’influx nerveux à volonté. Cela permet aux chercheurs d’identifier des réseaux neuronaux impliqués dans une tâche particulière et d’en définir le rôle causal.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Maladie de Lyme : pourquoi les tests ne sont pas fiables |
|
|
| |
|
| |
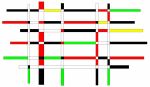
Maladie de Lyme : pourquoi les tests ne sont pas fiables
Par Olivier Hertel le 03.07.2018 à 19h30
Les tests de dépistage sont au cœur de la polémique actuelle sur la maladie de Lyme. Nous avons interrogé Hugues Gascan, immunologue, directeur de recherche au CNRS, pour comprendre pourquoi ces tests ne sont pas fiables. Selon une publication récente, ils produiraient même 500 fois plus de faux négatifs (personnes malades non détectées) que le tests de dépistage du VIH.
ELISA. La sortie du Protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) de la maladie de Lyme, rebaptisé " Recommendations de bonnes pratiques ", loin d'apaiser les esprits, ne fait qu'accroître les mécontentements. Au centre de la discorde se trouvent encore et toujours les fameux tests sérologiques de dépistage dits Elisa et Western Blot. Pour certains, ils sont jugés parfaitement fiables, pour d'autres, il faudrait tout simplement les supprimer tant ils sont dépassés. Pour rappel, dans le PNDS, ces tests sont toujours prescrits en première intention pour dépister la maladie. “Il est d'ailleurs rappelé dans l'annexe 3 du texte, qu'ils sont fiables quasiment à 100% dans certaines situations où ils doivent être utilisés. Or, nous considérons que ces données sont largement erronées” explique Hugues Gascan*, immunologue, directeur de recherche au CNRS, ayant participé à la rédaction du PNDS.
Ces tests sérologiques se font en deux temps : d'abord l'Elisa qui, s'il est positif, doit être confirmé par le Western Blot. Si ce dernier est aussi positif, alors le patient est considéré comme atteint de la maladie de Lyme. La polémique tient au fait que de nombreux malades ont des tests négatifs alors qu'ils se plaignent de symptômes qui pourraient rentrer dans le tableau clinique de la maladie de Lyme. D'où les suspicions sur leur fiabilité.
Mais les doutes ne se cantonnent pas aux témoignages des malades. Une méta-analyse menée à l’Imperial College London, parue en 2016 dans la revue International Journal of General Medicine, révèle que la sensibilité de ces tests n’excède pas en moyenne les 60%. Ainsi, 40% des personnes malades ne seraient pas détectées.
Au-delà de cette étude, c’est la méthodologie même du dépistage qui pourrait poser problème dans le cas de la maladie de Lyme. Et en particulier, celle concernant le test Elisa. Les failles sont de trois ordres :
1/ Des calibrages imprécis
Pour bien comprendre l’objet du débat, il faut revenir sur le principe de cet examen.
L’idée du test Elisa est de vérifier si le patient est ou a été infecté par une Borrelia, bactérie responsable de la maladie de Lyme. Cette vérification est indirecte. C’est-à-dire que l’on ne va pas chercher à détecter la bactérie chez le patient, mais plutôt les anticorps produits par son système immunitaire et dirigés spécifiquement contre les antigènes de la bactérie. Les antigènes sont ces protéines du pathogène reconnues spécifiquement par le système immunitaire. Cette réaction anticorps-antigène est l’un des fondements de l’immunité. Les anticorps, fabriqués par les lymphocytes B (cellules du système immunitaire), se lient naturellement avec les antigènes. C’est cette réaction qu’exploite le test Elisa.
Ces tests sont commercialisés par de nombreux fabricants. Ils se présentent sous la forme d’une plaque présentant un certain nombre de micro-puits (souvent 96), au fond desquels se trouvent fixés des antigènes de Borrelia. Le laboratoire d’analyse médicale qui effectue le test va alors remplir ces puits avec le sérum des patients. Le sérum est en fait le sang débarrassé de ses éléments cellulaires (globules rouges, globules blancs, plaquettes) et des enzymes favorisant sa coagulation. Il comporte tout un tas de composés chimiques comme des sucres, des lipides et bien sûr des protéines. C’est parmi ces dernières que se trouvent les anticorps produits par le système immunitaire contre Borrelia, mais aussi contre toutes autres sortes de pathogènes auquel la personne a été exposée au cours de sa vie.
Une fois le sérum placé dans les puits, seuls les anticorps dirigés contre Borrelia vont se fixer aux antigènes qui se trouvent au fond du puits. Ainsi toutes les autres molécules et notamment les anticorps dirigés contre d’autres pathogènes peuvent être éliminés par un simple lavage. Ne reste alors dans les puits, que les anticorps spécifiques de Borrelia que l’on cherche à détecter.
Il faut maintenant mesurer la quantité de ces anticorps pour déterminer si le patient est bien infecté par la bactérie. Cette étape repose sur la mesure de la densité optique, c’est-à-dire sur l’intensité de la couleur de la solution qui se trouve dans chaque puits. Pour cela, l’opérateur du laboratoire ajoute un produit qui change de couleur si l’anticorps est fixé sur l’antigène. Ainsi, dans chaque puits, plus il y a d’anticorps fixés aux antigènes de la bactérie, plus la couleur sera intense et plus la densité optique sera élevée.
La densité optique est donc le reflet de la réponse immunitaire de la personne contre la bactérie. Mais pour affirmer si oui ou non, la personne est “séropositive”, il faut étalonner le test Elisa afin de déterminer à partir de quelle densité optique le patient est considéré comme séropositif.
C’est dans la définition de ce seuil que les problèmes commencent. Pour réaliser ce calibrage, il faut partir d’un sérum d’une personne malade, donc que l’on sait déjà positif. Celui-ci est fourni par chaque fabricant de test afin qu’il puisse être comparé aux densités optiques mesurées pour chaque patient. Sur les plaques on trouve donc une série de puits réservés au sérum étalon pur (celui que l’on sait positif) qui est dilué plusieurs fois afin d’obtenir une gamme de couleurs de moins en moins intenses, avec les densités optiques correspondantes. La densité optique de l’échantillon de chaque patient est alors comparée aux densités optiques de cette gamme étalon.
Il faut enfin établir la densité optique seuil à partir de laquelle le patient est considéré comme malade. « Ce seuil a été défini dans les années 2000 de façon statistique par l’Action Concertée Européenne sur la Borréliose de Lyme (EUCALB), consortium européen de recherche sur la maladie de Lyme, créé dans les années 1990. Autre élément surprenant, ce seuil doit être défini dans la région dans laquelle le test est réalisé. Or, l’on sait qu’il y a une forte variation géographique. Par exemple, il y a beaucoup plus de cas de Lyme en Alsace et en Limousin qu’en région PACA. Cet étalonnage n’est donc pas standard. Il varie d’une région à l’autre et d’un fabricant à l’autre », explique Hugues Gascan. En d’autres termes, les seuils ne sont pas les mêmes dans toute la France. Une même personne peut alors être positive à Montpellier et négative à Paris.
“Une méta-analyse récente réalisée par Michael Cook et Basant Puri montre que les tests sérologiques pour la maladie de Lyme génèrent 500 fois plus de faux négatifs que les tests pour le SIDA. Imaginez un test de dépistage du VIH aussi peu robuste que ceux utilisés pour le Lyme. Cela ferait un scandale”, commente Hugues Gascan.
Pour bien faire les choses, il faudrait faire un étalonnage avec des valeurs pondérales c’est à dire en dosant précisément la quantité d’anticorps présente dans le sérum du patient. Le résultat serait alors indiqué par une valeur quantitative (par exemple en microgramme par millilitre) comme c’est le cas pour la plupart des mesures faites lors d’analyses sanguines. “Ce calibrage standard permettrait d’avoir des résultats comparables quelle que soit la région dans laquelle est pratiqué le test, et quel que soit le fabricant”, assure le chercheur.
2/ La diversité des bactéries détectées dans les tests
Chaque année ou presque une nouvelle Borrelia apparait parmi les agents impliqués dans la maladie de Lyme. Ainsi, en 2016 aux Etats-Unis, les Centers for Disease Control and Prevention et la Mayo Clinic de Rochester ont découvert une nouvelle bactérie baptisée Borrelia mayonii et impliquée dans la maladie. Or, ces nouvelles bactéries ne sont pas dépistées par les tests actuellement disponibles sur le marché.
3/ Une sérologie qui varie dans le temps
Comme nous l’avons vu, le dépistage de la maladie de Lyme repose sur la détection des anticorps dirigés contre la bactérie. Or, cette concentration d’anticorps peut varier fortement dans le temps chez une même personne. Ainsi, selon le moment où le test est effectué, le test peut être positif ou négatif. Une étude sur la souris publiée en 2015 dans PLOS et dirigée par Nicole Baumgarth de l’université californienne de Davis, montre que la bactérie s’attaque aux lymphocytes B. Ces cellules du système immunitaire sont celles qui justement produisent les anticorps que l’on cherche à détecter lors des tests Elisa. Cette action de la bactérie sur les lymphocytes pourrait en partie expliquer le faible taux d’anticorps dans le sang de personnes malades et donc un test négatif. Ces résultats sont en plus confortés par une étude génomique menée par Jérome Bouquet de l’université californienne de San Francisco qui montre chez l’homme une mauvaise réponse des lymphocytes face à la bactérie Borrelia. Ainsi, étant donné les effets modulateurs de Borrelia sur la réponse immunitaire, est-il pertinent d’utiliser un test Elisa, fondé justement sur l’analyse de cette réponse immunitaire, pour dépister la maladie de Lyme ?
*Hugues Gascan, directeur de recherche CNRS, ancien directeur d’Unité Inserm et de la plate-forme PADAM (Production Automatisée D’Anticorps Monoclonaux) – Rennes, Angers. En tant que membre de la Fédération Françaises contre les Maladies Vectorielles à Tiques, il a participé à l’élaboration du PNDS.
DOCUMENT sciencesetavenir.fr LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
