|
| |
|
|
 |
|
A lorigine de lasymétrie, une protéine qui donne le tournis |
|
|
| |
|
| |

A l’origine de l’asymétrie, une protéine qui donne le tournis
COMMUNIQUÉ | 23 NOV. 2018 - 20H00 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
BASES MOLÉCULAIRES ET STRUCTURALES DU VIVANT | BIOLOGIE CELLULAIRE, DÉVELOPPEMENT ET ÉVOLUTION | GÉNÉTIQUE, GÉNOMIQUE ET BIO-INFORMATIQUE
Doigt de migration cellulaire précédé par une cellule leader. En bleu, les noyaux des cellules, en vert, l’actine, en rouge, la myosine. Le câble pluricellulaire d’acto-myosine est bien visible sur les bords du doigt. ©Inserm/Cochet-Escartin, Olivier, 2014
L’asymétrie joue un rôle majeur en biologie, à toutes les échelles : enroulement en spirale de l’ADN, cœur positionné à gauche, préférence pour la main gauche ou la droite… Une équipe de l’Institut de biologie Valrose (CNRS/Inserm/Université Côte d’Azur), en collaboration avec des collègues de l’université de Pennsylvanie, a montré qu’une unique protéine induit le mouvement en spirale d’une autre molécule puis, par effet domino, la torsion des cellules, des organes et du corps entier, jusqu’à déclencher un comportement latéralisé. Ces travaux sont publiés dans la revue Science le 23 novembre 2018.
Notre monde est fondamentalement asymétrique : enroulement de la double hélice d’ADN, division asymétrique des cellules souches, localisation du cœur humain à gauche… Mais comment émergent ces asymétries et sont-elles liées les unes aux autres ?
À l’Institut de biologie Valrose l’équipe du chercheur CNRS Stéphane Noselli comprenant aussi des chercheurs de l’Inserm et de l’Université Cote d’Azur étudie depuis plusieurs années l’asymétrie droite-gauche afin de résoudre ces énigmes. Ces biologistes avaient identifié le premier gène contrôlant cette asymétrie chez la mouche du vinaigre (drosophile), l’un des organismes modèles préférés des biologistes. Plus récemment, l’équipe a montré que ce gène joue le même rôle chez les vertébrés : la protéine qu’il produit, la myosine 1D[1], contrôle l’enroulement ou la rotation des organes dans le même sens.
Dans cette nouvelle étude, les chercheurs ont induit la production de myosine 1D dans des organes normalement symétriques de la drosophile, comme les trachées respiratoires. De façon spectaculaire, cela a suffi à induire une asymétrie à tous les niveaux : cellules déformées, trachées s’enroulant sur elles-mêmes, organisme entier torsadé, et comportement de nage hélicoïdale des larves de mouches. Chose remarquable, ces nouvelles asymétries se développent toujours dans le même sens.
Afin d’identifier l’origine de ces effets en cascade, des biochimistes de l’université de Pennsylvanie ont apporté leur concours : ils ont mis en présence, sur une lame de verre, la myosine 1D et un composant du « squelette » des cellules, l’actine. Ils ont alors pu constater que l’interaction des deux protéines entraine un mouvement en spirale de l’actine.
Outre son rôle dans l’asymétrie droite-gauche chez la drosophile et les vertébrés, la myosine 1D apparaît donc comme une protéine unique capable à elle seule d’induire l’asymétrie à toutes les échelles, d’abord au niveau moléculaire, puis, par effet domino, cellulaire, tissulaire et comportemental.
Ces résultats suggèrent un mécanisme possible d’apparition soudaine de nouveaux caractères morphologiques au cours de l’évolution, comme par exemple la torsion du corps des escargots. La myosine 1D aurait toutes les caractéristiques requises pour l’émergence de cette innovation, puisque son expression suffit à elle seule à induire la torsion à toutes les échelles.
[1] Les myosines sont une classe de protéines qui interagissent avec l’actine (constituant du squelette des cellules ou cytosquelette). La plus connue d’entre elles, la myosine musculaire, est responsable de la contraction musculaire.
POUR CITER CET ARTICLE :
COMMUNIQUÉ – SALLE DE PRESSE INSERM
A l’origine de l’asymétrie, une protéine qui donne le tournis
LIEN :
https://presse.inserm.fr/a-lorigine-de-lasymetrie-une-proteine-qui-donne-le-tournis/33070/
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Un nouveau réseau cérébral relié à la douleur chronique dans la maladie de Parkinson |
|
|
| |
|
| |
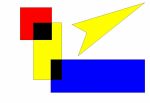
Un nouveau réseau cérébral relié à la douleur chronique dans la maladie de Parkinson
COMMUNIQUÉ | 31 AOÛT 2018 - 10H00 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE
©Inserm/U746, 2011. Stuctures cérébrales profondes en 3D des hémisphères droit et gauche du cerveau. en vert et en rouge, les deux noyaux sous-thalamiques.
Des chercheurs de l’Inserm et de l’Université Grenoble Alpes ont révélé un nouveau réseau cérébral qui relie la douleur ressentie dans la maladie de Parkinson à une région spécifique du cerveau. Ces travaux, parus dans la revue eLife, révèlent qu’un sous-ensemble de neurones situé dans une partie du cerveau appelée noyau sous-thalamique serait une cible potentielle pour soulager la douleur dans la maladie de Parkinson, ainsi que dans d’autres maladies comme la démence, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Huntington, et certaines formes de migraine.
Les personnes atteintes de la maladie de Parkinson font souvent état de douleurs inexpliquées telles que des sensations de brûlure, de coup de poignard, de démangeaisons ou de fourmillements, qui ne sont pas directement liées aux autres symptômes de la maladie. Le traitement par stimulation cérébrale profonde du noyau sous-thalamique peut aider à réduire les symptômes liés aux mouvements dans la maladie de Parkinson. Des études récentes ont cependant montré que ce traitement atténue également la douleur, mais sans pouvoir à ce jour mettre en lumière les mécanismes impliqués. C’est sur cette question que se sont penchés des chercheurs de l’Inserm et de l’Université Grenoble Alpes au sein de l’Unité 1216 Grenoble Institut des neurosciences.
« Dans cette étude, nous avons cherché à déterminer si le noyau sous-thalamique intervient dans la traduction d’un stimulus nuisible (par exemple une lésion) en douleur, et si cette transmission de l’information est altérée dans la maladie de Parkinson, » explique Arnaud Pautrat, doctorant à l’université Grenoble-Alpes et chercheur principal de l’étude.
L’équipe a commencé par utiliser l’électrophysiologie pour mesurer le déclenchement de signaux électriques dans les cellules nerveuses du noyau sous-thalamique de rats recevant un choc dans la patte postérieure. Les cellules nerveuses apparaissaient temporairement activées par cette stimulation. Les chercheurs ont également découvert que les neurones se divisaient en trois catégories de réponses par rapport à la vitesse de déclenchement de base : une hausse, une baisse ou un maintien de la vitesse.
L’équipe a ensuite cherché à savoir si ces réponses provoquaient une modification de la fonction cérébrale. Les rats au noyau sous-thalamique endommagé ont mis beaucoup plus de temps pour montrer des signes d’inconfort que les rats sains. Lorsqu’ils ont élargi leur étude au modèle du rat dans la maladie de Parkinson, les chercheurs ont découvert que les cellules nerveuses du noyau sous-thalamique présentaient des vitesses de déclenchement plus élevées et que les réponses à la douleur étaient plus importantes et plus longues que chez les animaux sains. L’ensemble de ces résultats suggère que la douleur associée à la maladie de Parkinson serait due à un dysfonctionnement des voies du traitement de la douleur dans le noyau sous-thalamique.
Pour comprendre d’où proviennent les signaux de la douleur envoyés au noyau sous-thalamique, l’équipe s’est intéressée à deux structures cérébrales connues pour leur importance dans la transmission de signaux de lésions depuis la moelle épinière : le colliculus supérieur et le noyau parabrachial. En bloquant leur activité, les chercheurs ont observé que ces deux structures jouaient un rôle déterminant dans la transmission des informations de la douleur au noyau sous-thalamique, et qu’une voie de communication directe existe entre le noyau parabrachial et le noyau sous-thalamique. Dans le cas de la maladie de Parkinson, cette voie de communication pourrait donc intervenir dans les effets bénéfiques sur la douleur de la stimulation cérébrale. Ces nouvelles données pourraient aider à orienter la stimulation sur des parties spécifiques du cerveau pour augmenter l’efficacité de ses effets antalgiques.
« Les résultats que nous avons obtenus mettent en évidence que le noyau sous-thalamique est relié de manière fonctionnelle à un réseau de traitement de la douleur et que ces réponses sont affectées dans le syndrome parkinsonien, » conclut Véronique Coizet, chercheuse Inserm et directrice de l’étude. « Il faut maintenant effectuer d’autres expériences pour caractériser précisément les effets, qui ont été observés avec nos modèles expérimentaux, de la stimulation cérébrale profonde sur cette région du cerveau, afin de trouver les moyens d’optimiser cette stimulation en tant que traitement de la douleur induite par la maladie de Parkinson et par d’autres maladies neurologiques. »
POUR CITER CET ARTICLE :
COMMUNIQUÉ – SALLE DE PRESSE INSERM
Un nouveau réseau cérébral relié à la douleur chronique dans la maladie de Parkinson
LIEN :
https://presse.inserm.fr/un-nouveau-reseau-cerebral-relie-a-la-douleur-chronique-dans-la-maladie-de-parkinson/32316/
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Nos choix alimentaires prédits par lanatomie de notre cerveau |
|
|
| |
|
| |

Nos choix alimentaires prédits par l’anatomie de notre cerveau
COMMUNIQUÉ | 07 JUIN 2018 - 12H09 | PAR INSERM (SALLE DE PRESSE)
NEUROSCIENCES, SCIENCES COGNITIVES, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE | PHYSIOPATHOLOGIE, MÉTABOLISME, NUTRITION
Plutôt gâteau ou légumes ? S’il est parfois difficile de manger sainement, une étude conduite par une équipe de chercheurs Inserm, CNRS et Sorbonne Université réunie autour de Liane Schmidt et de Hilke Plassmann au sein de l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM) a établi un lien entre l’anatomie de certaines régions de notre cerveau et la capacité de contrôle lors de choix alimentaires. Ces résultats sont publiés dans la revue The Journal of Neuroscience le 4 Juin 2018.
Manger sainement n’est pas chose aisée pour un grand nombre de personnes. La capacité à maintenir une alimentation équilibrée et à faire des choix nutritionnels sains varie grandement entre les individus.
D’un point de vue cognitif, faire un choix implique deux mécanismes principaux : le premier consiste à attribuer une valeur à chacune des options. Dans le cas des choix alimentaires, le goût de l’aliment et sa qualité nutritive peuvent par exemple déterminer sa valeur. Le deuxième mécanisme pour notre cerveau consiste à analyser la valeur donnée à chaque option pour choisir la plus adéquate, ici l’aliment auquel on aura attribué la valeur la plus importante.
Comment se traduisent ces prises de décisions dans le cerveau ? Pour répondre à ces questions, Liane Schmidt, chercheuse Inserm, Hilke Plassmann et leurs collaborateurs Anita Tusche du California Institute of Technology (USA), Cendri Hutcherson de l’Université de Toronto (Canada) et Todd Hare de l’Université de Zurich (Suisse) ont réuni les données d’imagerie cérébrale issues de quatre études portant sur la prise de décision alimentaire.
Dans trois de ces études, les participants ont effectué la même tâche qui consistait à évaluer leur appétence pour un aliment particulier selon trois critères: leur préférence naturelle, le goût de l’aliment et son bénéfice pour la santé. Les participants pouvaient ainsi baser leur choix uniquement sur le goût ou se concentrer sur l’intérêt nutritionnel de l’aliment.
Dans la quatrième étude, les participants devaient utiliser la méthode de leur choix (intérêt de faire des économies, de manger des produits bio, ou bien de faire un régime) pour réduire leur envie de produits goûteux mais sans intérêt nutritif. Dans cette dernière étude «Il s’agit d’une stratégie de contrôle plus flexible ne se focalisant pas spécifiquement sur les attributs du goût ou de la santé mais sur tous les moyens permettant de se distancier d’un aliment ou de résister à une envie.» précise Liane Schmidt, première auteure de l’étude et chercheuse Inserm.
Les chercheurs ont étudié les variations de la quantité de matière grise du cerveau des participants grâce aux données d’imagerie des trois premières études.
Ils ont ainsi mis en évidence une corrélation entre les choix alimentaires et la quantité de matière grise au niveau de deux régions du lobe frontal : la région dorso-latérale préfontale (dlPFC) – qui régit la régularisation des décisions – et la région ventro-médiale préfontale (vmPFC), en charge de l’attribution des valeurs. Ils ont observé que les personnes qui avaient plus de matière grise dans ces deux régions avaient davantage d’appétence pour les aliments qu’ils considéraient comme sains.
L’équipe de recherche a ensuite cherché à prédire les choix alimentaires des participants à la quatrième étude en se basant sur la quantité de matière grise détectable dans les deux régions identifiées précédemment. « L’idée ici était de voir si les corrélations établies dans un contexte où les stratégies de contrôle sont très claires – se concentrer sur le goût ou la santé- se généralisent à une situation où les stratégies de contrôle sont plus vagues. » poursuit Hilke Plassmann.
Les chercheurs confirment ces résultats et établissent ainsi pour la première fois que des différences dans la neuro-anatomie des régions dlPFC et vmPFC jouent un rôle dans les prises de décisions alimentaires individuelles. Ces résultats ouvrent des perspectives pour, à terme, le traitement de troubles alimentaires associés à une perturbation du contrôle alimentaire, comme la boulimie ou l’anorexie.
DOCUMENT inserm.fr LIEN |
| |
|
| |
|
 |
|
Neuroéthique : lhumain nest pas réductible à son cerveau |
|
|
| |
|
| |

Neuroéthique : l’humain n’est pas réductible à son cerveau
SCIENCE 03.07.2018
Les neurosciences correspondent à l’étude du fonctionnement du système nerveux, depuis les aspects les plus fondamentaux, biologiques et chimiques, jusqu’aux plus fonctionnels : la personnalité, les comportements, les pensées. Les avancées en neurosciences permettent désormais de corréler ces deux aspects, avec des conséquences importantes pour l’individu et la société. Les questions de neuroéthique qui en découlent ont fait l’objet de discussions dans le cadre des États généraux de la bioéthique. Catherine Vidal, neurobiologiste et membre du Comité d’éthique de l’Inserm, et Hervé Chneiweiss, neurobiologiste et président du Comité d’éthique de l’Inserm, nous en parlent.
Quelles sont les avancées récentes qui bouleversent les neurosciences ?
Catherine Vidal : Les progrès des neurosciences ont en grande partie été portés par le développement des techniques d’exploration du cerveau qui permettent de « voir » à la fois l’anatomie et le fonctionnement du cerveau. Elles ont révolutionné la pratique clinique et permis une acquisition exponentielle de connaissances. L’IRM fonctionnelle (IRMf) permet notamment d’observer le cerveau en train de fonctionner lors de tâches diverses (motrices, sensorielles, cognitives, etc.) ou même d’états psychologiques (peur, angoisse, plaisir, satisfaction, etc.).
A côté des méthodes d’exploration, des techniques de modification du fonctionnement cérébral se sont développées. Certaines sont assez anciennes, telle l’utilisation de médicaments qui agissent sur le cerveau (psychostimulants, anxiolytiques, etc.). D’autres sont plus récentes, comme les stimulations électriques et magnétiques transcrâniennes, la stimulation cérébrale profonde
stimulation cérébrale profonde
Consiste à délivrer un courant électrique de faible intensité dans certaines structures spécifiques du cerveau, grâce à des électrodes directement implantées.
, ou encore les thérapies cellulaires notamment développées pour lutter contre des maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson.
Quelles questions ou problèmes éthiques soulèvent ces avancées ?
Hervé Chneiweiss : Le champ de la neuroéthique est très vaste. Il englobe par exemple la médecine prédictive appliquées aux maladies neurodégénératives. Nos connaissances progressent si rapidement qu’elles permettent désormais de prédire l’apparition de maladies comme celle d’Alzheimer plusieurs années avant l’apparition des symptômes. Cela peut permettre d’instaurer des mesures préventives pour retarder le processus neurodégénératif. Mais, en l’absence de traitement efficace, cette médecine prédictive place le patient dans une situation très anxiogène et peut-être même discriminante. La question se pose de savoir s’il faut utiliser cette médecine prédictive à ce stade, dans l’intérêt des personnes concernées.

C.V. : Nous assistons également à une « invasion » des neurosciences dans de très nombreux domaines autres que médicaux : la justice, le marketing, l’éducation, les ressources humaines, la politique. Cet essor est étroitement lié à l’émergence des techniques comme l'IRM, que certains utilisent déjà pour décrire la pensée, les émotions, les motivations, avec au-delà la perspective de maîtriser les processus de prise de décision qui guident nos choix et nos actions. Ils vont parfois jusqu'à attribuer aux neurosciences le pouvoir de décrire l’être humain dans son individualité, sa subjectivité, ses actions, sa vie privée et sociale. Or dans la réalité, les connaissances actuelles ne permettent pas de caractériser un individu ou son comportement par la simple observation de son cerveau, loin de là. Une personne humaine n'est pas réductible à son cerveau.
H. C. : Sans oublier tout ce qui touche à la neuro-amélioration. Différents procédés permettent aujourd’hui de contrôler ou de modifier l’activité cérébrale, pour améliorer le comportement et les performances cognitives en dehors de tout contexte médical. Or non seulement le bénéfice-risque de ces techniques n’est absolument pas évalué en population générale, mais le risque de dérive est grand !
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l’utilisation des neurosciences en dehors du cadre médical ?
C. V. : Depuis 2011, la loi française inclut la possibilité de recourir à l’imagerie cérébrale dans le cadre d’expertises judiciaires. Et ce, alors que beaucoup d’experts s’y étaient opposés à l’époque. Dans les faits, les juges ne l’utilisent pas en France. En revanche, des images obtenues par IRM ont été utilisées comme « preuves » pénales dans plus de 600 affaires aux Etats-Unis. En Inde, un procès au cours duquel un électroencéphalogramme avait été utilisé comme détecteur de mensonge a fait grand bruit : une femme soupçonnée d’avoir empoisonné son fiancé avait été condamnée à la prison à vie car son cerveau ne réagissait pas au mot « arsenic », comme s’il lui était familier. La sentence a finalement été abandonnée face au scandale international suscité par cette affaire.
H. C. : Aucune étude n’est en mesure de valider l’utilisation de l’électroencéphalogramme ou de l’IRM pour prédire ou révéler un comportement et ils ne peuvent donc en aucun cas servir de preuve. Néanmoins, le nombre des publications sur la neuro-justice explose, principalement aux États-Unis : de 70 articles publiés entre 1990 et 2000, on est passé à plus de 2 000 entre 2000 et 2015.
C. V. : Il y a aussi la neuro-politique, une « nouvelle discipline » qui tente de corréler les opinions et le fonctionnement cérébral. Une étude a suggéré que le cortex cingulaire antérieur, qui joue un rôle dans la détection des contradictions, est plus volumineux chez les gens de gauche alors que la région de l’amygdale, impliquée dans la peur, est plus développée chez les gens de droite. Ainsi la peur des situations conflictuelles et des risques expliquerait les différences d'opinions politiques ! Dans le domaine du marketing, l’utilisation de l'imagerie cérébrale peut être utilisée pour savoir quelle étiquette stimule davantage l’attention de l’acheteur potentiel, le but étant bien sûr d'influencer sa décision d'achat ! Et dans le champ de l’éducation, les neurosciences influencent déjà certains programmes pédagogiques.
Aux Etats-Unis, des sociétés privées propose des examens d’imagerie cérébrale dans ces différents contextes non médicaux. En France, ces pratiques ne sont pas possibles : les appareils d’IRM sont réservés aux établissements de soins et de recherche biomédicale.
Ces applications ont elles un fondement scientifique validé ?

C. V. : Aux Etats-Unis, certains scientifiques recherchent les bases neuronales des comportements de type antisocial, agressif et criminel, pour mettre au point de nouveaux traitements et des programmes de prévention de la délinquance. Des études par IRM ont pu montrer une légère réduction de l’épaisseur du cortex cérébral dans les régions préfrontale et temporale de criminels. Mais l'interprétation de ces images est problématique : jusqu'à présent, rien ne permet d'établir une relation de causalité entre une réduction d'épaisseur du cortex et un comportement déviant. L'origine des variations d'épaisseur du cortex ne peut être déterminée. Le cerveau est plastique et l’IRM donne seulement un cliché de l’état du cerveau d’une personne à un moment donné. Elle n’apporte pas d’information sur son passé et n’a pas non plus de valeur prédictive. Enfin, le fonctionnement du cerveau est extrêmement complexe, avec de nombreuses régions impliquées dans une même fonction. La zone du crime n'existe pas.
Les dérives dans l'interprétation de l'imagerie cérébrale ne sont pas rares. D'autant plus que pour un public non averti, les images colorées du cerveau sont fascinantes et peuvent apparaître comme une preuve scientifique « objective ».
Vous avez également parlé de neuro-amélioration : où en est la science et jusqu’où pourrait-elle aller ?
H. C. : La modification du fonctionnement cérébral n’est pas une idée nouvelle. Les antidépresseurs par exemple, peuvent en quelques sortes transformer la personnalité de l’individu. C’est aussi le cas du méthylphénidate donné à des millions d’enfants pour qu’ils soient plus calmes ou encore du modafinil pris comme stimulant par autant d’adultes. Mais dans le domaine psycho-cognitif, la ligne de démarcation entre le normal et le pathologique est impossible à tracer… la question se pose alors de savoir qui traiter : une grande timidité ou une hyperactivité doivent-ils être considérés comme un handicap à prendre en charge ?

C.V. : Et pour certains, dans une société marquée par le culte de la performance, l’objectif n’est plus seulement de palier un déficit mais d’aller au-delà. Des études ont montré que, dans certains cas, la stimulation électrique transcrânienne peut améliorer les performances cognitives et l’état émotionnel de personnes en bonne santé. Le neurofeedback permet quant à lui de contrôler sa propre activité cérébrale, pour augmenter certaines fonctions comme les capacités visuo-spatiales ou la mémoire.
Des sociétés privées, en Asie notamment, proposent déjà des casques de stimulation par courant continu qu’il est possible d’acheter pour des sommes modiques sur internet. On laisse croire au grand public que la stimulation transcrânienne aidera par exemple à préparer ses concours, alors même que l’innocuité de l’administration de courant continu n’a pas été évaluée à moyen et long terme. Il n’est pas exclu que la pratique « sauvage » de la neurostimulation interfère avec certains circuits neuronaux, altère la plasticité cérébrale
plasticité cérébrale
Mécanismes au cours desquels le cerveau est capable de se modifier en réorganisant les connexions et les réseaux neuronaux, dans la phase embryonnaire du développement ou lors d’apprentissage.
et entraine des crises d’épilepsie. En France, la commercialisation de ces casques n’est pas autorisée.
A terme, le risque est d’assister à l’émergence d’une catégorie d’individus augmentés. Cette vision transhumaniste entrainerait inévitablement une fracture sociale entre ceux qui auront recours à ces techniques et ceux qui ne pourront pas y avoir accès. Sans compter que la personnalité de l’individu, son autonomie et son libre arbitre pourraient être altérées par ces neurotechnologies.
H. C. : Certains systèmes de stimulation cérébrale fonctionnent déjà de façon autonome et pourraient bientôt être proposés aux patients parkinsoniens pour contrôler leurs tremblements : une intelligence artificielle déclenche les stimulations quand elle l’estime nécessaire, alors que jusque-là le patient contrôlait lui-même son appareil. Avec ce système, le patient deviendrait donc un « homme augmenté ».
Qu’en est-il de la protection des données personnelles ?
H.C. : C’est un autre problème important. Des sociétés privées commencent à collecter les données cérébrales à tour de bras pour différentes recherches, sans consentement clair ou sans la protection des données nécessaires. Et qui sait ce qu’elles pourraient en faire un jour ? Je lisais récemment un article sur l’équipement de salariés de douze entreprises d’Etat chinoises, dépendantes de l’armée, par des casques permettant de surveiller leur activité cérébrale. Le motif officiel est de prévenir les baisses de vigilances et les accidents. Mais ces dispositifs permettent de collecter d’autres données... Il y a là un vrai problème éthique. L’activité cérébrale n’est pas neutre, elle correspond à des données personnelles.
Considérez-vous la situation actuelle comme préoccupante ?
C.V. : Nous ne sommes pas dans l’urgence, mais il faut aborder de front ces sujets qui posent des questions de société. La France est encore préservée des dérives qui gagnent d’autres pays, avec un accès à l’IRM réservé aux professionnels de santé ou encore l’interdiction de la stimulation cérébrale en dehors d’un protocole de soins. La loi de bioéthique de 2011 inclut en outre une mission de veille sur les recherches et les applications des techniques d’imagerie cérébrale, destinée à défendre une éthique dans ce domaine.
Aujourd’hui en France, pour évaluer la responsabilité pénale d’un accusé, le juge nomme des psychiatres et des psychologues qui appuient leurs expertises avant tout sur des entretiens et non sur l'IRM. Mais pour combien de temps encore ? Le risque est de voir le modèle américain gagner du terrain pour l’évaluation de la responsabilité et de la dangerosité d’un prévenu. Or les Français ne sont pas assez informés sur les dérives possibles de l'utilisation de l'IRM. En témoigne la faible participation aux discussions sur la neuroéthique dans le cadre des états généraux de bioéthique qui viennent de s’achever. Il est de notre responsabilité de chercheurs d'anticiper ces questions et de sensibiliser le grand public.
DOCUMENT inserm LIEN |
| |
|
| |
|
| Page : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ] Précédente - Suivante |
|
|
| |
|
| |
|
